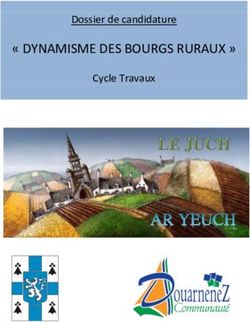Le Lien - N 416 - Eglise catholique en Algérie
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Le Lien
Diocèse d’Oran
2, rue Saad Ben Rebbi
31007 Oran el Makkari
ALGÉRIE
N°416
mai - juin - juillet
2019ÉDITORIAL
HOSPITALITE…
Dans la tradition musulmane, le mois de Ramadan est
idéalement le mois de l’hospitalité. Cette hospitalité se manifeste de
bien des manières : rassemblement des familles autour du repas de
rupture du jeûne, soutien aux plus pauvres et aux plus isolés, lecture en
continu et communautaire du Coran pour laisser davantage de place à
Dieu en soi. Nous faisons régulièrement l’expérience de cette hospitalité
par l’invitation de telle ou telle famille à venir «rompre le jeûne ».
Mais le mois de Ramadan, par ses rites, son atmosphère et le
jeûne, dessine aussi une frontière entre ceux qui en sont et ceux qui n’en
sont pas. Jamais autant que durant ce saint mois, nous nous sentons à
la fois étrangers et accueillis. Accueillis parce que largement étrangers à une culture, une religion,
une appartenance. Chacun de nous se situe comme il l’entend, pour certains en différence
assumée, pour d’autres en adaptant son rythme de vie à celui dont on partage le quotidien, pour
d’autres encore en jeûnant plus ou moins strictement. Ce mois est à la fois attendu car riche en
occasions de rencontres humaines, et aussi un peu redouté tant il bouscule nos fragiles équilibres.
Cette année, ce mois de Ramadan, comme déjà les années précédentes, a été marqué
d’une pierre blanche grâce à la quinzaine de soirées de Ramadan organisées au Centre Pierre
Claverie ou dans d’autres lieux du diocèse (CDES, bibliothèque Sofia, bibliothèque biomédicale,
bibliothèque du Centre Pierre Claverie, soirées du groupe de marche du frère César…). Pour ne
parler que d’Oran !
Soirées spirituelles, festives, culturelles, musicales, organisées à notre initiative ou en
partenariat avec des associations oranaises, ces soirées auront attiré des centaines de personnes,
essentiellement des jeunes. Ce fut un réel bonheur de sentir battre le cœur d’une société civile et
d’une jeunesse qui force le respect. La soirée du 16 mai, deuxième célébration de la journée
internationale du Vivre Ensemble en Paix, a par exemple rassemblé les quinze associations
oranaises qui ont organisé des manifestations diverses à Oran dans la quinzaine précédente.
Une nouveauté cette année : l’organisation d’un repas de rupture du jeûne participatif
avec ceux qui le souhaitaient. C’est un geste fort de venir vivre ce moment à la fois familial et
quasi-religieux hors de chez soi, et chez des chrétiens. Nous étions soixante-dix pour cette
première édition. Quelques jours plus tard, c’est une association de jeunes oranais qui organisait
une des très belles soirées de ce mois. Avant la soirée, une magnifique table d’une cinquantaine
de convives avait été dressée par leurs soins dans la cour du Centre, nous étions invités chez nous
à partager ce repas de rupture du jeûne avec eux !
Ce moment fut pour moi très emblématique de ce que nous avons vécu durant tout le
mois : la réciprocité de l’hospitalité. Nous avons ouvert largement nos portes et accueilli aussi
bien que nous le pouvions tous ceux qui ont manifesté le désir d’organiser ou de participer à une
soirée de Ramadan. En ce sens, nous avons offert l’hospitalité. Mais en même temps, souhaiter
organiser une soirée au Centre Pierre-Claverie, ou y participer, est un signe d’ouverture qui n’est
pas sans lien avec l’hospitalité. En Algérie, l’Église est accueillie par ceux qu’elle accueille. Ce qui
est vrai pour toutes les activités de notre vie quotidienne prend dimension symbolique particulière
en période de Ramadan. Cette année, ces soirées ont été, avec la prière, le partage et quelques
journées de jeûne, ma façon privilégiée de vivre un beau mois de Ramadan.
+ fr. Jean-Paul Vesco op
2JOURNEE INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX 2019
La JIVEP à Oran, ce n’est plus seulement la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix » mais le nom d’un Collectif d’Associations de la ville. Et la « Journée » n’est plus de 24 heures
mais une « Quinzaine du Vivre Ensemble en Paix » !
Quinze associations ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois. « Vivre ensemble c’est
faire ensemble ! » Une journée, c’est trop peu : du 1er au 16 mai, un programme débordant
d’initiatives a été établi. Du début (avec la randonnée populaire au Murdjajo en passant par Santa
Cruz) à la fin (avec la soirée de clôture au Centre Pierre Claverie), le diocèse a été protagoniste de
tant de beaux moments de fraternité.
Deux moments marquants : Le
samedi 4 mai, l’association SDH a
organisé un teambuilding dont le slogan
était : « Coopérons pour bâtir la paix ». Le
lieu choisi ? L‘« Esplanade du Vivre
ensemble en Paix » du sanctuaire Notre-
Dame de Santa Cruz, la première place au
monde dédiée au Vivre Ensemble.
Différents jeux et activités étaient
proposés à une trentaine de jeunes ;
quelques étudiants et focolarini présents
ont pu s’y joindre. Ensemble, en se
donnant les mains, ils ont représenté le
mot « PAIX ». « Cette esplanade désormais est pour vous ! », a lancé l’évêque Jean-Paul Vesco aux
associations réunies pour la soirée finale : 365 jours du vivre ensemble en paix sont possibles à
Santa Cruz !
Le dimanche 5 mai, la Chorale Spirit (Fondation Djanatu El Arif) et la Chorale du Diocèse ont
animé une soirée spirituelle au Théâtre Régional d’Oran. Si chacun chante son répertoire
« traditionnel », c’est beau, mais si on chante ensemble c’est magnifique ! « Allahu mahabba, Allahu
nûrun, Allahu hayâtunâ » : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre vie, à partir de ce refrain,
d’autres versets en arabe ont été composés. Une seule chorale des jeunes « de toute langue, peuple
et nation » … et religion ! Quelle révélation !
LISTE DU COLLECTIF JIVEP 2019 :
- ASSOCIATION AMEL
- ASSOCIATION ASPEIN
- ASSOCIATION BEL HORIZON
- CISP ONG
- ASSOCIATION CHOUGRANI
- ASSOCIATION DIOCESAINE D’ALGERIE
- FONDATION DJANATU AL ARIF
- ASSOCIATION FARD
- ASSOCIATION GRAINE DE PAIX
- ASSOCIATION LE PETIT LECTEUR
- ASSOCIATION LES NOMADES ALGERIENS
- ASSOCIATION REVE DE VIE POSITIVE (ARV+)
- ASSOCIATION SANTE SIDI EL HOUARI (SDH)
- THEATRE REGIONAL D’ORAN (TRO)
Si vous cherchez des informations sur la page Facebook du Collectif JIVEP pour voler le secret
d’une telle réussite, vous trouverez une seule indication utile : « Seul je vais plus vite, Ensemble on
va plus loin » !
3JOURNEE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX A SIDI BEL ABBES
Un mois avant, le 16 mai, en plein ramadan, nous nous sommes réunis à une douzaine de
personnes pour préparer ensemble cette après-midi du 15 juin : étudiants, chrétiens, voisins, jeunes
adultes artistes, membres de la Fondation Emir Abdel Kader, jeunes et plus âgés membres de la Zaouya
Allaouiya, collaborateurs divers, les spiritains. L’esprit que nous voulons : une dizaine de participations
diverses limitées chacune à dix minutes… expression du vivre ensemble dans la diversité culturelle et
religieuse. Chacun va préparer son intervention : artistique, spirituelle, lectures de messages, panneaux
et les affiches sont faites. Et donc un mois après, nous voilà prêts pour cette demi-journée du vivre
ensemble dans la paix.
D’abord, bien sûr, l’accueil dans la grande salle pour nous saluer et se mettre dans le bain en
regardant les panneaux d’expositions préparés par les uns et les autres : panneaux sur l’origine de la
journée internationale du Vivre dans la paix, panneaux sur la visite du pape au Maroc, panneaux sur
deux prix « Nobel » de la paix : Nelson Mandela et Rigoberta Menchu.
Puis, on se rassemble dans la chapelle, aménagée pour privilégier la bonne écoute : presque 100
personnes, c’est une bonne surprise mais surtout, le bonheur de voir une assemblée diverse.
Un artiste de SBA, passé maitre dans l’art des contes et des marionnettes, nous introduit à cette
après-midi. Avec une courte vidéo et des prises de paroles des responsables, on rappelle l’origine et le
sens de cette journée internationale : vivre ensemble en paix, c’est se reconnaître différents par nos
cultures et nos religions, respecter le chemin de chacun, reconnaître les richesses des uns et des autres,
ce qui nous unit comme la foi en Dieu et le respect de toute vie. Ce n’est pas toujours facile et cela
s’apprend.
Un artiste photographe présente des clichés qui montrent des personnes en situation de
précarité : ces photos, ce n’est pas du « voyeurisme » c’est pour montrer des personnes pauvres,
exclues : leur donner la parole par la photo : comme des interpellations qui nous sont faites pour nous
mettre au service de la dignité de tous.
Des jeunes adultes parlent de leur musique : Flamenco, chants du sud de l’Algérie, chants
oranais ; c’est cela aussi s’ouvrir au vivre ensemble de différentes cultures.
Lectures de messages du Cheikh Bentounès et du Pape François sur le Vivre ensemble dans la
paix lus par Jean Marc et Michel, spiritains, deux membres de la Zaouiya Alaouiya et de la fondation
Janatu al-Arif. Chants
musulmans soufis, chants
chrétiens par un groupe
d’étudiants de la paroisse
avec le Père Henry.
Prise de parole du
président des étudiants
étrangers à SBA et
président aussi de notre
communauté chrétienne :
sens et réalités du vivre
ensemble pour des
étudiants sub-sahariens ;
prise de parole pour dire la nécessité, la difficulté et la joie de construire le Vivre ensemble dans leurs
pays d’origines. Il a aussi souligné cette manière de vivre ensemble ici en Algérie : difficultés, parfois
racisme, mais souvent bonne entente. Il appelle les parents à éduquer les enfants au respect de toute
personne, quelles que soient son origine ou sa religion. Le Vivre ensemble dans la paix doit faire
vraiment partie de l’éducation des enfants faite par les parents, par la religion et par l’école. Nous avions
déjà souligné cela dans notre réunion de préparation.
Chants flamenco par un jeune adulte algérien : chanter la vie. Le Vivre ensemble passe aussi par
l’enrichissement mutuel entre cultures. Bonne après-midi bien vivante, avec de la diversité de
personnes et de modes d’expressions. Rencontres interpersonnelles enrichissantes. Comme toute
journée « temps fort » avec de bons messages : c’est à vivre après chaque jour.
Jean-Marc BERTRAND
4LA FETE DES DIX-NEUF BIENHEUREUX
Le décret de béatification lu le 8 décembre lors de la cérémonie de Santa Cruz fixait la
fête liturgique des nouveaux bienheureux au 8 mai, date de la mort du frère Henri Vergès et de
la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond en 1994.
Le mercredi 8 mai, la communauté chrétienne et quelques amis ont donc célébré pour
la première fois à la cathédrale cette fête des Bienheureux Pierre Claverie, ses compagnes et
ses compagnons. À la fin de la messe, tout le monde s’est dirigé vers la tombe de Pierre Claverie
pour y déposer dix-neuf lumières marquées du nom de chacune et chacun.
Et en ce troisième jour de ramadan, tout le monde put prendre le repas du soir, une
paella, dans la cour du Centre, à l’heure prescrite.
VEILLEES DE RAMADAN
Pendant ce mois de ramadan, environ quatorze veillées nocturnes de différents styles
ont été organisées au Centre Pierre-Claverie et dans les deux bibliothèques du CDES. Il serait
fastidieux de les énumérer toutes, mais quelques-unes méritent de rester dans les archives.
Le 9 mai, la bibliothèque du Centre
Pierre-Claverie, avec Alice et ses amis,
annonçait une veillée des « mille-et-une
saveurs ». Chacun était invité à préparer
sur place ou chez soi un plat de sa région
ou de son pays. Dans les cours du
Centre, les visiteurs pouvaient goûter,
moyennant une petite participation, à
des plats de divers pays africains,
préparés par les étudiants, ou à ceux de
la tradition familiale algérienne.
Le 16 mai est devenu depuis l’an
dernier, sur décision unanime de l’ONU
répondant à une initiative algérienne, la
« Journée internationale du Vivre-Ensemble en paix ». Un concert en plein air, avec les 2
chorales musulmane et chrétienne, a eu lieu au Centre Pierre-Claverie, suivi de vidéos dans la
salle de conférence, montrant les initiatives qui, pendant la quinzaine précédente, avaient
préparé la journée du 16.
Le lendemain 17 mai, les Drôles-Madaires, troupe d’improvisation théâtrale bien
connue au Centre Pierre-Claverie, a présenté un spectacle en plein air, suivi d’une quête pour
les enfants nécessiteux organisée par l’association « Donacœurs ».
Le 25 mai, un grand repas se tenait dans les cours à l’heure de la rupture du jeûne, avec
des plats préparés tant par la cuisine du Centre Pierre-Claverie que par les participants. En fin
de soirée, le Dr Ali-Hikmet Sari, président
du Club de la Culture Soufie, a présenté
les grandes étapes du soufisme iranien.
Avec son club en effet, depuis plusieurs
années, il suit les traces de la vie terrestre
de Sidi Boumédienne (de l’Andalousie au
Maroc et en Algérie) et celles de son
influence (ce qui, l’an dernier, l’a conduit
en Iran et prochainement l’emmènera peut-être jusqu’en Inde). Les chapitres de sa conférence
étaient séparés par le jeu de deux grands artistes : Khalil Baba-Ahmed au violon et Walid Hakim
5au luth. La mystique et la musique en effet ont ceci de commun qu’elles échappent aux limites
des mots.
Le 27 mai, c’était le tour des « Nomades Algériens », une association de jeunes Oranais
qui veulent faire connaître les différentes facettes de la culture algérienne. Ils ont passé toute
la journée avec les jeunes de la chorale étudiante, préparant ensemble à la fois le repas du soir
et la veillée nocturne. Celle-ci a
présenté la culture « gnawa », c’est-
à-dire celle que les esclaves
originaires de « Guinée » ont
développée au Maghreb. On a
entendu le « guembri », un luth très
rudimentaire, et les « qraqeb » (ou
karkabous), sortes de castagnettes
dérivées, nous a-t-on dit, des
menottes qui entravaient les
esclaves. Des contes, admirablement
déclamés, faisaient revivre l’odyssée d’un esclave ou une légende du Hoggar. Les étudiants
rythmaient les chants
des « Nomades » ; ceux-
ci rythmaient les chants
des étudiants, pris dans
la tradition sud-africaine
et camerounaise. Le
groupe existait depuis
une journée seulement,
mais tous jouaient
ensemble comme des
complices associés
depuis longtemps. En
partant, une personne
qui avait bien compris
l’enjeu de la soirée disait
à un étudiant :
« Félicitations. Et merci pour votre présence ici. »
6AU CIMETIERE MILITAIRE FRANÇAIS DE PETIT LAC
Actuellement, le cimetière militaire français de Petit Lac, à Oran, est en pleine rénovation. À
cette occasion, les autorités ont décidé d’y
restaurer la chapelle qui menaçait de
tomber en ruine pour qu’elle devienne un
lieu muséal. Le 16 juin, M. Driencourt,
ambassadeur de France, et Mgr Vesco,
évêque d’Oran, ont inauguré cette
chapelle restaurée. M. Bernard Paquelier,
directeur du service des Anciens
Combattants à l’ambassade, a rappelé
l’histoire de ce cimetière où, après 1965,
ont été regroupés les corps de plus de
10 000 militaires dispersés dans de nombreux endroits du pays. Et le P. J.-P. Vesco a lu une
lettre écrite par le pasteur Dietrich Bonhoeffer, engagé avec toute sa famille dans la résistance
au régime nazi. Il était alors en prison militaire à Tegel (Berlin) et il écrit à sa fiancée Maria von
Wedemeyer à la Pentecôte 1944 :
Ma Maria bien-aimée !
Un message pour Pentecôte – tu viendras certainement me voir et cela vaut cent lettres réunies,
mais quand tu rentreras à Bundorf, à nouveau seule, il faut que tu trouves une lettre, pour que
tu sois heureuse et moi aussi, même de très loin. (Par bonheur, en ce moment cela ne va pas
trop mal !) Que dois-je souhaiter
pour toi et pour moi ? Je ne peux rien
dire d’autre, bien que cela franchisse
rarement mes lèvres, je souhaite que
cette Pentecôte soit bénie pour nous
deux. La bénédiction – cela veut dire
une proximité de Dieu qui soit visible,
sensible et qui devienne efficace. La
bénédiction demande à être
transmise, et passe par d’autres
personnes. Celui qui est béni est lui-
même une bénédiction. Soyons-le
l’un pour l’autre, ainsi que pour tous
ceux qui sont confiés à notre travail
ou à notre intercession. Il n’y a rien de
plus grand que lorsqu’une personne est une bénédiction pour les autres, n’est-ce pas ? Non
seulement une aide, un compagnon, un ami, mais une bénédiction. C’est beaucoup plus. C’est
ainsi qu’il doit en être dans notre couple. Prions pour cela. C’est ainsi que nous voulons fêter
Pentecôte.
Dietrich Bonhoeffer, Maria VON WEDEMEYER, Lettres de fiançailles. Cellule 92 (1943-1945),
éd. Labor et Fides 1998, p. 239
8LE SEJOUR DES SEMINARISTES DE LA « MISSION DE FRANCE »
UN VOYAGE REMPLIS DE SIGNES…
Il est compliqué de résumer un séjour de dix jours en Algérie. Dix jours durant le temps de
Pâques. Ce séjour est rempli de signes ! Signes d’accueil, de fraternité, de dialogues, de partages, de
découvertes. Et si ces signes étaient justement des signes de Pâques, passage de la mort à la vie. Pour
nous, ce fut le passage d’un bord à l’autre de la Méditerranée. Mais surtout il fut un passage d’une
tradition, d’une culture à une autre. J’ai ouvert mes yeux et mon cœur sur la réalité algérienne : un
peuple et une Église. Un peuple qui marche vers plus de démocratie et de justice depuis quelques mois.
Une Église minoritaire qui tient sur l’implication de tous pour faire des ponts avec les Algériens que les
chrétiens côtoient et construire une Église qui fait signe ! Une Église signe de dialogue, de partage et de
paix.
Si un sacrement est un signe, alors nous avons eu la chance de recevoir le sacrement de la
rencontre ! Une première rencontre avec le frère Christophe, qui à travers la parole de Jean-Marie
Lassausse nous a donné un témoignage de vie donnée au service du Christ. Une vie faite de doutes, de
questionnements mais aussi de fidélité, une vie ouverte et donnée à la société algérienne au cœur du
monastère de Tibhirine, une vie qui est bien un signe pour nous au service du Christ !
Une autre rencontre
signifiante au cœur de ma semaine à
Oran : un dîner dans une famille dont
la mère française est catholique et
ses enfants algériens musulmans.
« C’est le même Dieu de toute
façon ! » nous a-t-elle lancé. Elle qui
se fait amener régulièrement à la
messe par ses enfants… Cela résonne
comme un cri, un message fort pour
nous exhorter à vivre ce dialogue
interreligieux dans la simplicité du
cœur. Ce dîner fut un signe de la
rencontre dont les paroles
résonnaient de partage de traditions
et de dialogue pour nous mener vers
une vérité recherchée à plusieurs
voix : Chrétiens et Musulmans, Français et Algériens…
A Tlemcen ou à Oran, le sacrement de la rencontre et de la fraternité étaient présents au
quotidien comme une invitation à vivre et à le reconnaître au cœur de ma vie.
Henri VEDRINE
RELECTURE D’UN SEJOUR EN ALGERIE
Par ce voyage en Algérie, j’ai découvert une réalité d’Église dont plusieurs visages m’ont
interpellé.
Une Église humble et discrète
L’Église d’Algérie est d’abord petite par le nombre de personnes. Cela m’a marqué en particulier
à Ghardaïa, où nous avons célébré la messe dominicale dans la petite salle qui constitue la cathédrale
de ce diocèse, avec une seule personne n’appartenant pas à notre groupe : une religieuse espagnole. À
Tlemcen aussi, où j’ai vécu le Triduum pascal, la communauté chrétienne réunie était constituée d’un
petit nombre de personnes dont un bon nombre de « permanents » de l’Eglise, religieux ou Focolare, le
reste de la communauté étant essentiellement constitué d’étudiants subsahariens. Ce constat me
rappelle que nous avons souvent tendance à juger d’une réalité ecclésiale par le nombre de personnes
qu’elle représente. Or, ce que j’ai vécu en Algérie m’amène à orienter mon regard vers la profondeur
de ce qui se vit plutôt que par le nombre. En effet, le rayonnement de l’Église en Algérie est faible si l’on
9regarde extérieurement ou sociologiquement. Mais celui-ci se fait sentir si l’on regarde intérieurement.
J’ai été touché par la profondeur de certaines vies vécues comme des signes en terre d’Islam dans la
discrétion. Je me rappelle ainsi du dîner dans le modeste appartement des Petites Sœurs de Jésus à
Oran, qui pour la plupart d’entre elles sont installées en Algérie depuis longtemps et vivent une présence
auprès des Algériens dans le service, par l’insertion dans le tissu associatif par exemple. Dans l’échange
que nous avons eu avec elles, elles ont insisté sur l’importance de la durée pour la construction d’une
relation humaine, dans leur expérience en Algérie. Quand je leur ai demandé ce qu’elles font, Roselyne
a dit si justement : « Ce qui compte, ça n’est pas ce que nous faisons ; l’essentiel, c’est la vie intérieure,
et à partir de là, ça rayonne. » J’ai senti que leur présence discrète peut être un signe de la présence du
Christ pour qui est disposé à Lui ouvrir son regard.
Une Église vivante et universelle
J’ai été sensible à la vitalité de l’Église
d’Algérie. Ses membres en sont des « pierres
vivantes » acteurs de la vie de l’Église tant dans sa
dimension liturgique que communautaire ou de
service. Ainsi à Tlemcen, j’ai été touché de voir
combien les jeunes prenaient leur place dans la
communauté. Plusieurs d’entre eux participaient à la
préparation des célébrations et de temps de
convivialité, à l’animation des chants, à l’animation
d’un temps de partage sur l’amour de Dieu… Ils
prennent leur part dans la vie de la communauté en
prenant des initiatives. Il se sentent responsables de ce
qui est vécu. Cela m’a particulièrement marqué car
ceux qui s’engagent ainsi sont des jeunes, présents depuis peu de temps dans la communauté, qui
viennent d’une autre culture et qui pour ces raisons peuvent ne pas être familiers avec les codes locaux,
ne pas savoir comment s’y prendre, ce qu’il faut faire… Et cela fait aussi écho pour moi aux
responsabilités que chacun peut prendre dans sa communauté ecclésiale en France.
Les personnes que j’ai rencontrées en Algérie sont aussi des témoins de l’universalité de
l’Église : étudiants subsahariens, personnes en situation de migration, « permanents d’Église » (religieux
ou volontaires), en majorité Européens… quelle diversité d’origine ! Tous ensemble font Église, riches
de leur diversité, unis par leur foi. Leur foi chrétienne les rassemble et se prête à vivre l’œcuménisme,
rassemblés ensemble en Église. Quand on est peu nombreux, la communion au nom du Christ prime
devant des différences de confessions… Cette diversité se vit par des éléments concrets comme les
chants : pendant les célébrations, la chorale varie la langue du répertoire et tous chantent ensemble,
dans la langue des uns et des autres ! Les lectures sont souvent lues en français et en anglais, et à
Tlemcen, une personne traduisait en direct en anglais toute la liturgie célébrée en français, pour
permettre aux non francophones de vivre la célébration. Nous étions en Algérie au moment de Pâques,
mais c’était déjà la Pentecôte !
Une Église au service, œuvrant pour la construction du Royaume avec tous
Une question se pose à l’Église en Algérie : quel est le sens de sa présence, dans un pays à
majorité musulmane, avec si peu de Chrétiens algériens ? Le contexte culturel algérien l’oblige à la
discrétion, mais j’ai perçu que l’Église vit le service de tous, en cherchant à construire le Royaume, avec
tous ceux qui sont prêts à coopérer avec elle, là où elle est. J’ai ainsi été impressionné par les
nombreuses activités proposées à tous au Centre Pierre Claverie d’Oran : ateliers éducatifs pour les
enfants, ateliers de couture pour les femmes, troupe de théâtre, spectacles et conférences… L’Église
est aussi impliquée dans la gestion de bibliothèques universitaires fréquentées par de nombreuses
personnes de la société algérienne. Par ces activités l’Église est en lien avec la population algérienne et
crée du lien au sein de la population, en étant comme un levain dans la pâte. Elle est une Église de la
rencontre : non pas seulement une Église qui va à la rencontre des autres, mais aussi un lieu qui permet
la rencontre de tous.
Par ces découvertes, j’ai pu questionner ma conception de l’Église, et par tous ces visages
d’Église que j’ai rencontrés, je me suis demandé comment ce que j’en ai perçu peut se déplacer sur le
visage de l’Église en France. Antoine
10AU CLUB D’ÉVEIL
Le CLUB D’ÉVEIL du Centre-Pierre Claverie a pour vocation d’accueillir les enfants en bas âge de
trois à quatre ans et de leur assurer une formation de base en dispensant les enseignements en langue
française. La classe dont nous nous occupons, ma collègue et moi, est composée de vingt enfants :
quatorze Algériens et six migrants.
1- Adaptation à la vie de l’école.
La peur des autres : quand ils arrivent le premier jour au centre, une attitude de peur se lit sur
leur visage.
L’insécurité dans un lieu inconnu : ils se
voient perdus dans ce nouvel environnement si
différent de leur lieu d’origine, ils ont peur de
toucher les objets et les jouets pourtant mis à
leur disposition. Concrètement, nous avons des
chansonnettes, des jeux de psychomotricité
auxquels nous jouons ensemble afin de les
aider à aller vers les autres et à se sentir chez
eux à l’école.
2- L’expression de soi : Ils
expriment rarement leurs désirs (répondre aux
questions, envie d’un jouet ou aller aux toilettes). Nous les maîtresses, en utilisant les gestes de
politesse, en les aidant à demander la permission et puis à satisfaire leur demande, nous les aidons à
exprimer leurs désirs et leurs besoins en utilisant les chansonnettes, les historiettes (la collection de
Choupi et autres).
3- La découverte de la nature : Chaque jour nous faisons le rituel du matin, c’est-à-dire la
météo et le jardinage, sur un programme établi pour la semaine : par exemple, nous visitons chaque
matin des petites plantes (oignons, haricots) pour en prendre soin.
Nous leur faisons découvrir
que nous sommes en relation avec
la nature. Que prendre soin d’elle,
c’est prendre soin de nous. Les
enfants sont très contents de les
arroser chaque matin, de voir
comment les plantes grandissent et
de regarder leur verdure.
4. Résultat : Après deux ou
trois mois d’intenses activités, de
formation patiente et de suivi
permanent, on note chez les
enfants des changements positifs ;
ils deviennent plus gais, plus joyeux
d’être ensemble (Algériens, migrants) se partageant des jouets et se racontant de petites histoires entre
eux.
Par exemple quand un enfant migrant est absent, son voisin algérien demande de ses nouvelles
à ses camarades ; l’adaptation et l’intégration se maîtrisent peu à peu, la joie de vivre ensemble domine
dans l’ensemble de la classe. Les parents rencontrés ne cessent d’exprimer leur satisfaction et leurs
remerciements pour les changements positifs opérés dans la vie de leur enfant à partir de la formation
qu’ils ont reçue.
Avec ma collègue Khadidja, nous voudrions dire combien notre collaboration nous a rapprochées
et nous a remplies de bonheur en constatant l’épanouissement des enfants dans leurs familles. Notre
gratitude est grande à l’égard des responsables du Centre Pierre Claverie, et en particulier Mme Muriel
de Failly, pour leur accompagnement. Avec joie, nous recueillons déjà les inscriptions des enfants pour
une nouvelle année en CLUB d’ÉVEIL.
Séraphine TCHUIDJANG
11UNE ANNEE DE GRACE
« Tout est bien qui finit bien. » Le titre de cette comédie écrite par William Shakespeare s’accorde
littéralement au déroulement de l’année académique 2018-2019 à Mascara. En effet, nous avons remarqué
avec satisfaction l’assiduité des fidèles adhérents à notre bibliothèque depuis le début de l’année jusqu’à la
fin. Nous avons enregistré un nombre croissant d’élèves, étudiants ou travailleurs pour les cours de soutien
dans certaines matières et pour l’apprentissage du français et de l'anglais. Parmi les douze professeurs qui
interviennent dans notre plateforme, certains ont
décidé, à l’approche des échéances, de donner des
cours gratuitement aux élèves en classe d’examen.
Cette initiative a été saluée par beaucoup de parents
d’élèves qui fréquentent le centre El Amel.
Cependant, une nouveauté est à signaler : avec
la sœur Jyoti, une Mascarienne a accepté de faire cours
bénévolement à un groupe d'enfants en préscolaire
mais aussi à un groupe
d’enfants autistes trois
matinées par semaine.
Avec l'aide du club de
lecteurs qui se réunit une
fois par mois, beaucoup de conférences concernant divers thèmes ont été
organisées cette année à El Amel.
Par ailleurs, dans le cadre des activités sportives, il faut noter qu'une
centaine de jeunes femmes de 16 à 50 ans et une vingtaine de filles de 6 à 13
ans ont été inscrites pour la gymnastique avec trois monitrices. En plus de
cela, une quinzaine suivent des séances de yoga chez la sœur Lucie. La zumba,
l’aérobic et le yoga qui constituent les sports les plus prisés au sein de notre
plateforme ont été assidûment pratiqués cette année, trois fois par semaine.
À toutes ces activités mentionnées s’ajoute la célébration de l'Aïd el
Fitr par une trentaine d’étudiants subsahariens musulmans dans notre
plateforme, le Ribat es-Salam qui se tient chaque deuxième mardi du mois.
Cette rencontre où musulmans et chrétiens se réunissent pour penser le Vivre
ensemble en paix est sans doute l'une des multiples grâces de la béatification
de nos bienheureux martyrs. C'est même dans ce sens qu'une grotte mariale baptisée « Notre-Dame du vivre
ensemble » est en construction à Mascara. Toute personne qui croit que l’harmonie du monde dépend du
vivre ensemble en paix entre des hommes et des femmes de cultures et de religions différentes peut
désormais faire un pèlerinage à Mascara !
Enfin tout le personnel et les bénéficiaires des activités du centre El Amel se sont dits très satisfaits
de cette année qui tire à sa fin.
Bertrand MBELLA, cssp Mascara
12UNE ANNEE SABBATIQUE EN ALGERIE, QUELLE IDEE ?
Une année sabbatique, c’est UNE année. Difficile de rendre compte
d’une telle expérience d’autant plus que l’année n’est pas totalement
accomplie. Et peut-être aussi parce que c’est « APRÈS » que l’on recueille les
fruits «d’une année de grâce accordée par le Seigneur ». Accordée par le
Seigneur et par l’évêque du diocèse de Créteil (banlieue est-sud-est de Paris)
dont je suis originaire, et accordée également par l’évêque d’Oran qui
m’accueille dans son diocèse. D’ailleurs, pour pouvoir mieux apprécier ma
première relecture de cette année sabbatique, peut-être vous demandez-
vous d’où je viens, de quelle histoire, et comme on me l’a si souvent demandé
« pourquoi une année sabbatique en Algérie ? »
Trois motifs : le premier est lié à la manière dont je suis entré en relation concrète avec
l’Algérie (car j’avais bien sûr été touché par les lectures des bienheureux Charles de Foucauld,
Christian de Chergé, Christophe, Pierre Claverie… mais ce n’était pas vraiment du « concret »), le
deuxième motif est suscité par un événement qui est venu secouer ma vie de prêtre, le troisième
motif est un concours de circonstances qui me rendait disponible.
Je suis entré en relation concrète avec l’Algérie à l’occasion d’une journée mondiale de prière
pour les vocations. J’avais demandé aux paroissiens de rechercher les connaissances originaires de
notre paroisse devenus prêtres, religieux, religieuses, couples ou laïcs engagés en vue d’une veillée-
témoignages. L’un des noms de la liste de ces personnes que les paroissiens m’ont donnée est
prêtre à Oran en Algérie. Il avait été baptisé et avait suivi le catéchisme dans notre paroisse. Il a
répondu à ma recherche et nous sommes restés en contact. Je l’ai accueilli lors de ses passages en
région parisienne pour une conférence dans les différentes paroisses où je me trouvais. Un jour (ou
plutôt un soir au resto), il me dit : « A tout âge, on peut venir en Algérie pour un temps. Un prêtre
du diocèse de Limoges rentre bientôt, il a dans les 70 ans, il a passé plusieurs années avec nous ».
Je pense que cette année sabbatique aura été un approfondissement de ma vocation de
baptisé. Réentendre Dieu m’appeler… Me laisser rencontrer autrement par Lui… Comme Moïse me
déchausser pour me laisser rencontrer dans ce qui fait mon humanité avec ses fragilités, ses péchés,
ses capacités, ses dynamiques…. Relire mon histoire d’alliance avec Dieu… Avec l’Eglise d’Algérie je
me suis trouvé témoin privilégié de la venue du Christ à la manière de Jean-Baptiste…. Et la
béatification de Pierre Claverie et de ses 18 compagnes et compagnons m’a confirmé dans la vision
d’une Eglise en phase de sanctification – sans frontières ni de culte ni de dogmes ni de culture – une
Eglise du ciel – « Signe de fraternité dans le ciel de l’Algérie pour le monde ».
L’événement qui a secoué ma vie de prêtre est l’expulsion d’un squat sur la commune dont
j’étais le curé. Je me suis trouvé auprès des « mille de Cachan », puisqu’il s’agissait de mille
personnes, des familles, prises au piège d’une expulsion décidée sans véritablement de négociation
par la préfecture. Les représentants de ces familles venues principalement d’Afrique m’avaient
demandé, ainsi qu’au pasteur protestant (originaire de RDC) de la région, d’exercer la médiation
avec le préfet, dans la mesure où il l’accepterait (ce qui n’a jamais été vraiment le cas). J’ai vécu
13trois mois, loin de la vie paroissiale ordinaire, au cœur d’un conflit socio-politique qui se reproduit
si souvent. En sortant de cette expérience, je m’interrogeais sur les ressources spirituelles pour
vivre une telle implication, sur la dimension missionnaire ou apostolique du ministère de prêtre.
Cette année sabbatique m’aura invité à aller plus loin, sur « l’autre rive », dans l’expérience
de la réconciliation possible, au cœur des ruptures de l’histoire des personnes, des peuples, des
communautés. Vivre une Eglise présente sur les « lignes de fracture » selon la phrase connue de
Pierre Claverie. L’autre rive, celle d’où viennent ceux qui réussissent le voyage mais aussi celle où
restent ceux qui seront peut-être « refoulés » un jour ou l’autre… Et comme j’aimerais aller encore
plus loin au-delà d’une autre rive encore celle du désert où un vivre mieux, autrement et en paix, est
à générer. Et comme j’aimerais que les rives ne soient plus infranchissables mais passages heureux
pour un aller-retour, un aller-venir de liberté, de créativité, d’échange, et de fraternité.
J’ai 61 ans, je suis prêtre depuis 35 ans. Je suis né et j’ai vécu dans un rayon de 30 km dans la
banlieue est-sud-est de Paris où j’ai vécu la plupart des facettes de l’exercice du ministère :
aumônier, accompagnateur, curé, responsable de service, conseiller… etc. J’ai vécu l’accueil de
beaucoup de nationalités du monde dans cette dense agglomération en limite parisienne. Depuis
huit ans, j’étais responsable d’un secteur de six paroisses d’une commune populaire du diocèse.
L’évêque de mon diocèse annonçait en conseil épiscopal, où il m’avait appelé neuf ans plus tôt, le
départ d’un « train d’années sabbatiques » pour répondre de manière alternée aux demandes de
plusieurs prêtres. Un des prêtres du diocèse rentrait de dix-huit années comme fidei donum, il
pouvait prendre ma suite. Concours de circonstances, correspondance de fins de mandats, je
postulais pour prendre le train (qui s’avèrera être un avion) et donner cette 35ème année de
presbytérat à l’Eglise d’un autre pays… Ailleurs ! Et les subtilités d’attribution de visa rendirent
possible l’Algérie.
En situation d’étranger sur cette terre qui nous connait trop et pas assez. Ministère de
« visitation » des paroisses, des communautés, de quelques amis.
Participation à la préparation de l’événement de la béatification, au
service des responsables pastoraux en particulier le curé d’Oran.
Accompagner des « chercheurs de Dieu ». Participer au Ribat es-
Salam. Soutenir la formation Monica. Disponible pour accueillir,
recueillir, se recueillir, pour découvrir, s’ouvrir… Lire… Être présent
à l’événement, aux personnes, aux demandes… Au rythme du
quotidien du centre Pierre Claverie. Essayer de comprendre
pourquoi certains sont attirés par cette Eglise, ce Jésus-Christ… Les
histoires qui se croisent dans les communautés sont tellement
diverses, uniques, et communes à toute humanité… Un peuple qui
se lève pour sa dignité, pour sa liberté, pour la justice… Une
quinzaine du « vivre ensemble en paix » pendant un ramadan si
contrasté jour et nuit… Je ne pourrai pas vivre les responsabilités qui
me seront confiées à mon retour de la même manière, ni écouter
les personnes en voyage… les Musulmans… et en particulier les
Algériens, comme avant…
Oui, il y aura « un avant et un après » cette année sabbatique que vous m’avez permis de
vivre en m’accordant votre confiance, en m’accueillant si chaleureusement, en me permettant de
vivre une expérience de foi, d’espérance et d’amour. Traditionnellement, l’année sabbatique
s’accompagne d’une remise de dette…. Envers vous, elle est immense… Merci, et louange à Dieu.
L’évêque du diocèse de Créteil me nomme, au 1er septembre, curé de la paroisse Saint Michel
du Mont-Mesly à Créteil et doyen de cette ville de 90 000 habitants. J’accompagnerai l’équipe
diocésaine du Secours Catholique.
Marc LULLE
14« POURQUOI SE RACONTER QUAND ON PEUT SE DONNER ? »
Durant ces 17 années de présence à Tlemcen, je me suis seulement efforcé, pour ma part, de
semer et de susciter de l’amitié au sein de la population de ce pays :
– comme témoin, à l’évidence imparfait, de l’Évangile de Jésus-Christ, au sein d’une Eglise de la
rencontre
– et comme Français, bien malgré lui solidaire d’un lourd passé colonial et désireux d’apporter
une infime contribution à la réconciliation de nos deux pays et à la construction d’un avenir
commun apaisé, dans le respect mutuel des différences de cultures et de conviction religieuses.
Je reconnais avec bonheur que cette amitié m’a été rendue au centuple.
Cette sensibilité à la « réalité algérienne » n’est pas récente chez moi puisque, pendant trente-
trois ans, mon parcours de prêtre-ouvrier dans une usine de métallurgie de la région lyonnaise m’a
amené à la côtoyer presque quotidiennement : la majorité du personnel ouvrier en était, en effet,
algérienne. Camarade de travail et longtemps délégué du personnel, j’ai vécu avec eux la fin de ce que
l’on a appelé les « trente glorieuses », les restructurations successives et à chaque fois les compressions
de personnel, sources de tension, de frustration et parfois d’injustices. A la différence de certains clercs,
je n’étais guère tenté d’idéaliser ces compagnons immigrés, parfois rudes et facilement manipulables.
Pourtant, je crois sincèrement avoir vécu avec certains d’entre eux une véritable fraternité et c’est assez
naturellement que, l’âge de la retraite professionnelle se profilant, j’ai vraiment désiré poursuivre cette
relation privilégiée avec « l’autre Algérie » en devenant moi-même immigré, non par nécessité
économique mais par choix. C’est ainsi qu’avec l’accord de nos responsables religieux, Jean-Paul Vesco
et moi-même avons débarquée du Djezaïr II à Alger, le 6 octobre 2002, avant de rejoindre le 1er
novembre, le presbytère de Tlemcen qui nous était proposé par l’ancien évêque d’Oran, où trois Jésuites
nous accueillirent et nous réservèrent deux belles années de collaboration harmonieuse.
L’ancien évêque d’Oran, Mgr Alphonse Georger, nous confiait la responsabilité de la petite
communauté catholique de Tlemcen et nos supérieurs religieux la tâche de tenter de jeter des
passerelles en direction de la société tlemcénienne, autrement que par le biais exclusivement religieux
de l’œcuménisme officiel. A la vérité, je n’étais guère préparé à cette tâche pastorale, ayant vécu, en
France, d’abord au sein d’une petite communauté de prêtres-ouvriers, décimée progressivement par
les décès et les départs, puis seul pendant vingt ans, en dehors des structures paroissiales.
Ici, à Tlemcen, avec mes
confrères successifs, nous nous
sommes efforcés de veiller à la
cohésion de cette communauté
paroissiale, en fait assez diverse, et
recomposée chaque année par
l’arrivée de nouveaux étudiants
subsahariens, chance évidente
mais aussi facteur de précarité.
Jean-Paul Vesco y a investi
beaucoup de ses forces et peut
légitimement être fier de la réussite
de cette intégration. Puis, ces
dernières années, le drame des
migrants nous a rejoints, ici à
Tlemcen, surtout au travers d’un ministère de présence amicale auprès de ceux qui étaient incarcérés
dans les centres de détention de la région.
Mais, ma véritable vocation, je l’ai vécue, pour mon bonheur, au sein de la population
tlemcénienne, commerçants du voisinage, petits vendeurs « informels » autour du marché, si souvent
malmenés, tout-venant, jeunesse perdue comme ils se désignaient eux-mêmes, étudiants désireux de
progresser dans la maîtrise de la langue française ou encore voisins très estimés qui ne laissaient jamais
passer les fêtes musulmanes sans nous en faire goûter les douceurs… Je garderai un souvenir lumineux
de beaucoup de ces rencontres, le plus souvent fortuites et que j’imaginais sans lendemain, d’autant
plus que l’absence de maîtrise de l’arabe dialectal – un de mes regrets – limitait forcement les échanges,
15sans pour autant empêcher la communication. Voilà ce que j’ai essayé de faire : tisser des liens, semer
de l’amitié, sans désir de prosélytisme, sans jouer les censeurs ou les redresseurs de tort. Imprudences
ou erreurs n’ont certainement pas manqué mais j’ai toujours cru à la fidélité dans l’amitié. Et le nombre
de gens qui me saluent aujourd’hui dans la rue me fait penser que je n’y ai peut-être pas totalement
échoué.
C’est à tous ceux-là que je pense aujourd’hui et c’est d’abord à eux que je voudrais dédier
l’honneur qui m’est fait. A mes yeux, l’Évangile se vit au cœur de cette humanité désemparée, cabossée,
que l’on voit aujourd’hui redresser la tête et retrouver joyeusement et pacifiquement sa fierté.
Comme Michel de Certeau, je crois que « le mouvement missionnaire n’a pas pour but de
conquérir, mais de reconnaître Dieu là où jusqu’ici il n’était pas perçu ». J’avoue – et c’est une de mes
nombreuses limites – j’avoue n’avoir que peu de goût pour la pesanteur inévitable des institutions et la
multiplication des instances. Je crois davantage à la vie secrète qui se fraie un chemin malaisé dans les
interstices de nos sociétés.
Une correspondance de Georges Bernanos avec un écrivain sud-américain, lue dans ma
jeunesse, me survient très souvent en mémoire : « Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela… qu’importe
ce que vous n’êtes pas ! Je répète que ceux-là seuls à travers le monde qui ont besoin de nous pourraient
dire ce que nous sommes puisqu’ils savent ce qui leur manque et qu’ils trouvent en nous. Pourquoi se
raconter quand on peut se donner ? »
Gérard JEANNINGROS
LES 10 MISSIONS PRIORITAIRES D'UN AUMONIER
La maison Dar es-Salam située à
Tlemcen dans le diocèse d’Oran a abrité du 12
au 15 mai dernier la session interdiocésaine
annuelle de formation pour la pastorale
universitaire qui a réuni plus d'une quinzaine
d’aumôniers. L’exhortation apostolique
Christus vivit du pape François et un corpus
contenant les récits ou les témoignages
d’étudiants finissants ayant vécu en Algérie
ont été les documents de base de cette
formation. Dans son analyse de Christus vivit,
Jean Toussaint, l’animateur principal de cette
formation nous a fait repérer les dix missions
prioritaires d'un aumônier de jeunes que
sont : donner la première place au kérygme,
créer des espaces inclusifs, prendre en compte les liens intergénérationnels, diversifier les propositions,
former des leaders, une pastorale populaire, missionnaire, vocationnelle et une pastorale de
l’accompagnement et du discernement. Ces dix missions permettent à un aumônier d’être toujours
attentif aux jeunes dont il a la charge.
D’une part, l’objectif de cette formation, basée à la fois sur le document magistériel traitant
de la question de la pastorale des jeunes et sur le récit de la vie de nos étudiants avant, pendant et après
leur séjour en Algérie, était de voir ce que l’Église attend des jeunes et de ceux qui les accompagnent
aujourd’hui. D’autre part, l’objectif était aussi de voir ce que l’expérience de ces jeunes nous renvoie
comme point d’attention ou d’interpellation.
Nous avons, par ailleurs, discuté, lors de cette rencontre, de la question œcuménique du
rapport avec le groupe des « rachetés », mais aussi celle de l’organisation des Journées Algériennes des
Jeunes (JAJ). Il est ressorti de ces discussions que désormais les JAJ doivent s’organiser tous les trois ans
afin de permettre à beaucoup de nos jeunes de prendre part à cet événement ecclésial au moins une
fois dans leur vie en Algérie avant de partir ailleurs.
Bertrand MBELLA
16Vous pouvez aussi lire