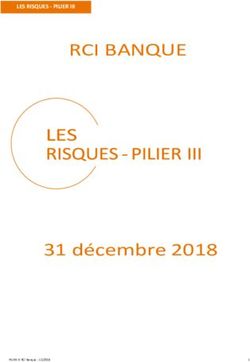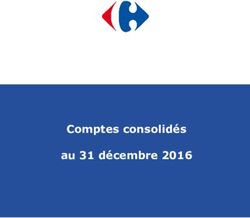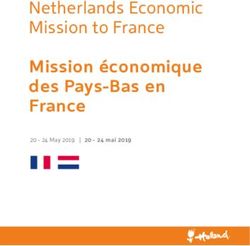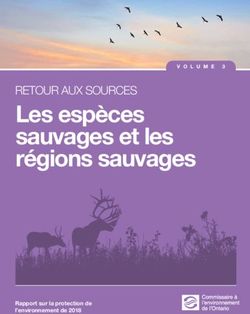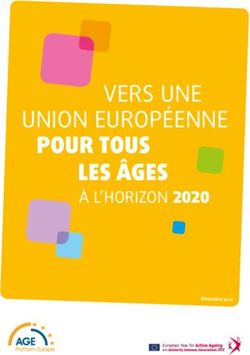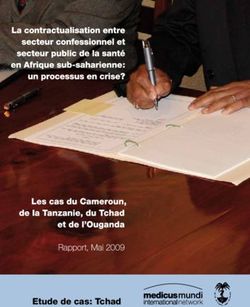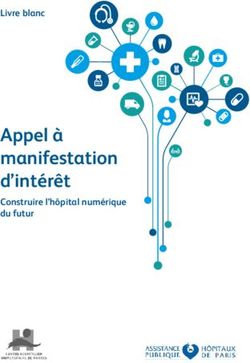Membres du groupe de travail Lise LEBRUN (Cheffe de projet) Natacha SANCHEZ Samy TIROUVANZIAM Benjamin GAYTE Fanny ME MOUGAMADOU Directeur de la ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Membres du groupe de travail
Lise LEBRUN (Cheffe de projet)
Natacha SANCHEZ
Samy TIROUVANZIAM
Benjamin GAYTE
Fanny ME MOUGAMADOU
Directeur de la recherche - action
Docteur Pascal PERROTREMERCIEMENTS
Le groupe de recherche-action souhaite présenter ses remerciements à
l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cette étude.
En premier lieu nous remercions le Directeur de la recherche-action, Docteur Pascal
PERROT, Médecin Conseil national, Directeur de la Gestion du risque et de l’action
sociale à la caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), pour son
accompagnement au fil de notre travail. Il nous a orienté efficacement pour nos travaux
et lors de la rédaction du rapport. Madame Christine LASSERRE, Directrice de mission
qui travaille également à la Direction de la Gestion du risque et de l’action sociale à la
caisse nationale RSI et qui a également fortement contribué, par son investissement et
son appui, à l’avancement de notre projet.
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Madame Christine GUIMOND
(Médecin conseil RSI Ile-De-France), Madame Catherine GERMON (Responsable du
service santé – RSI Poitou-Charentes), Madame Cynthia FLEURI (Référente PARI – RSI
Poitou-Charentes), Madame Patricia VERNAY (Responsable du département politique
de santé et prévention) et Madame Patricia MOLL (chef de projet PARI), pour les
échanges que nous avons pu avoir sur les parcours.
Pour les discussions sur l’avenir des parcours dans le cadre de l’adossement du RSI au
Régime Général, nous remercions vivement Madame Lucie DUARTE (Directrice action
sociale de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail -CARSAT- Bretagne) et
Monsieur Vincent GOD (responsable régional du service social de la CARSAT Midi-
Pyrénées).
Nous tenons à remercier les assurés du Régime Social des Indépendants, qui ont
bénéficié ou non des parcours, pour leurs retours éclairants sur PARI et MAPI ainsi que
la condition des travailleurs indépendants.
Nous remercions enfin, pour le temps qu’elles nous ont consacré, l’ensemble des
personnes contactées au cours de nos travaux, dont les indications et conseils ont
contribué à la rédaction de ce rapport.
Les propos qui suivent n’engagent que leurs auteurs.
2SOMMAIRE
Remerciements ..................................................................................................................... 2
Sommaire .............................................................................................................................. 3
Introduction ............................................................................................................................ 4
1. Etat des lieux : La question des parcours en prévention santé ..................................... 5
1.1. Perspectives théoriques : les notions de parcours et de prévention ..................... 5
1.2. Perspectives empiriques : les pratiques autour des parcours de prévention dans
le champ de la Protection Sociale ..................................................................................... 9
1.3. Le cas des travaileurs indépendants : construire des parcours adaptés à un profil
spécifique......................................................................................................................... 10
1.4. Facteurs clés de succès des parcours et hypothèses d’analyse ........................ 12
2. Analyse critique des parcours MAPI et PARI au sein du RSI ...................................... 12
2.1. Hypothèse 1 : Affiner la gouvernance pour articuler l’intervention des différents acteurs
12
2.2. Hypothèse 2 : Structurer et organiser les cellules locales en phase avec les
besoins des usagers et partenaires ................................................................................. 17
2.3. Hypothèse 3 : Renforcer les partenariats pour mieux accompagner les travailleurs
indépendants ................................................................................................................... 19
2.4. Hypothèse 4 : Définir une stratégie de communication interne et externe
segmentée et lisible pour le Travailleur Indépendant ...................................................... 21
2.5. Hypothèse 5 : Utiliser le plein potentiel du numérique comme condition du
développement des parcours .......................................................................................... 23
3. Pistes de réflexion pour la réussite des parcours MAPI et PARI ................................. 26
3.1. Pistes de réflexion sur l’organisation et le déploiement des parcours MAPI et PARI
26
3.2. Pistes de développement dans le cadre de l'adossement du Régime Social des
Indépendants au Régime Général ................................................................................... 31
4. Conclusion ................................................................................................................... 32
5. Table des matières ...................................................................................................... 33
6. Bibliographie ................................................................................................................ 35
3INTRODUCTION
Les travailleurs indépendants, qui regroupent les artisans, commerçants et
professionnels libéraux, sont des travailleurs non-salariés œuvrant dans des domaines
d’activité variés. Il existe une porosité importante entre leur vie professionnelle et personnelle
: les risques liés aux évènements économiques, sociaux ou sanitaires sont fortement
imbriqués ce qui entraine des besoins spécifiques.1
Les professionnels indépendants bénéficient, depuis 2008, d’une couverture sociale unifiée
et adaptée à leurs besoins. Leur protection consiste en un ensemble de prestations
maladies, indemnités maternités ou indemnités journalières en cas d’arrêt de travail,
pensions de retraite ou de réversion, une couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) pour ceux qui le requièrent ou encore la prise en charge des affections longue
durée. En plus de cette protection, le Régime Social des Indépendants (RSI) propose des
programmes supplémentaires destinés à des publics ciblés. C’est le cas de parcours
personnalisés mis en place auprès de deux catégories de publics qui nécessitent une
attention particulière :
- Les travailleurs indépendants en risque de désinsertion professionnelle, pour lesquels est
proposé le parcours de "maintien dans l'activité professionnelle des indépendants (MAPI)",
- Les travailleurs indépendants âgés de 60 à 80 ans qui présentent des risques de perte
d'autonomie, auxquels est proposé le parcours "Programme d'action pour une retraite
indépendante (PARI)"
Dans ce cadre, l’action du RSI se différencie des démarches engagées par les autres
régimes de Protection Sociale, notamment le Régime Général et le Régime de Mutualité
Sociale Agricole. La plus-value de l'accompagnement proposé est basée sur une démarche
adaptée, personnalisée et globale, conçue pour les indépendants.
Le rôle de la Caisse nationale est d’impulser une dynamique visant à proposer des parcours
répondant à l’exigence d’un régime de Sécurité Sociale et prenant en compte les besoins
des assurés. Elle est pilote de la démarche, et cadre l’action des caisses régionales. Pour
cela, il faut tout d’abord identifier les profils des assurés ayant des besoins spécifiques, et
construire ensuite les réponses envisageables en fixant un cadre, des objectifs, et en
accordant les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. L’analyse statistique occupe une
place importante dans cette démarche.
Les caisses régionales du Régime Social des Indépendants ont quant à elles un rôle de mise
en œuvre concrète des parcours. Des comités de pilotage réunissent des représentants du
Conseil d’Administration et des directeurs au niveau local. La commission d’action sociale,
de par ses missions, participe également au déploiement des programmes. Cela implique la
détection des publics destinataires des services, le développement et la mobilisation des
partenariats au niveau local, et la personnalisation des réponses accordées.
L’analyse des moyens déployés dans le cadre de ces parcours suppose de porter un regard
sur les aspects Ressources Humaines, Métiers, Système d'information ou encore
Logistiques.
La participation du tissu associatif et les liens avec les acteurs sociaux et médico-sociaux au
niveau local est également un enjeu fort de la personnalisation des parcours proposés aux
bénéficiaires.
Les questions de santé et de prévention font également apparaitre une problématique de
communication à l’égard des professionnels indépendants et des partenaires. Offrir un accès
à l’information aux bénéficiaires est indispensable pour la mise en œuvre efficace des actions
1
« La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi octobre-décembre 2012, Élisabeth
ALGAVA, DARES, Catherine CAVALIN, Centre d’études européennes de Sciences, Sylvie CELERIER,
Centre d’études de l’emploi, Université d’Evry Val d’Essonne
4et l’accès aux droits. La connaissance des parcours et leur transparence vis-à-vis des
bénéficiaires potentiels participe à la réussite de leur mise en œuvre.
Pour la réussite des programmes, il faut également s’intéresser aux leviers de motivation et
à l’adéquation entre les réponses apportées et les besoins de chacun. Pour cela, l’évaluation
des parcours est un axe de réflexion important : qui doit la mener, comment et à qui
transmettre les informations et quel « reporting » est nécessaire à une juste prise de hauteur.
Des acteurs divers sont déjà à l’œuvre pour recenser les avancées des parcours (notamment
des centres d’études universitaires). L’objet de cette note sera d’étudier les parcours
personnalisés, et de proposer des mesures concrètes d’évolution.
L'actualité suppose de tenir compte de l'avenir du régime. Par conséquent, l'analyse des
conditions de réussite des parcours MAPI et PARI s'intéressera aux conséquences
potentielles de leur intégration au Régime Général.
1. ETAT DES LIEUX : LA QUESTION DES PARCOURS EN PREVENTION SANTE
L’état des lieux des parcours en prévention santé s’appuie sur plusieurs ressources :
les éléments théoriques issus de la littérature d’une part, et d'autre part les éléments
empiriques issus de l’observation des pratiques dans la Sécurité Sociale et dans des
secteurs connexes.
1.1. Perspectives théoriques : les notions de parcours et de prévention
Les notions de parcours et de prévention sont croisées au sein des dispositifs MAPI et PARI.
Pour autant, elles appartiennent à des champs d’étude différents. Il est donc nécessaire de
les définir pour en croiser les apports.
1.1.1. La notion de parcours : l’expérience client au cœur du service rendu2
Dans le champ du marketing de services, l’idée de parcours entend rompre avec l’idée d’une
relation de service segmentée par produit, générique dans sa conception et unique dans le
temps. Elle répond en effet d’abord à l’évolution des parcours de consommation, lesquels
reposent désormais non seulement sur le service rendu, mais aussi sur l’expérience d’accès
et de consommation de ces mêmes services3. Le parcours est donc inscrit dans la durée,
d’où l’importance des conditions dans lesquelles il est déployé. De plus, il comprend
généralement une dimension partenariale, du fait de son ouverture et de son évolutivité. En
ce sens, MAPI et PARI sont donc effectivement des parcours : ils entendent fournir une
solution adaptable et dynamique aux problématiques de prévention que rencontre le régime.
Il s’agit non plus de prévenir simplement, mais de cibler pour anticiper et adapter les services
offerts par le RSI en fonction du profil de l’assuré.
Sur ce fondement, en tant que parcours, MAPI et PARI reposent sur la création d’une
expérience client : celle d’une prise en charge adaptée et évolutive. L’expérience client est
en effet une notion consubstantielle à celle de parcours en cela que le parcours existe du fait
d’une interaction entre l’entreprise et son client. En effet, c’est le client qui fournit la donnée
pour façonner le produit, et la donnée qui permet la production évolutive du produit par
l’entreprise. Par conséquent, l’expérience client au cœur du parcours est un fait :
Partagé : ni totalement lié à celui qui produit l’objet, ni à celui qui le consomme4
2
Le vocable utilisé dans cette partie s’appuie sur les concepts développés dans la littérature en marketing
et en sciences de gestion. Les objets d’étude dans cette discipline sont majoritairement issus d’organisations
du secteur marchand, d’où la présence d’un vocabulaire qui en porte la couleur. Néanmoins, au-delà de la
question de la logique commerciale qui sous-tend ses concepts, il est possible d’en tirer des enseignements
sur le plan de la relation de service qui permettent de nourrir la réflexion des parcours conduits par le service
public de sécurité sociale.
3
Holbrook M. B., Hirschman E. C., “The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasy, Feelings
and Fun”, Journal of Consumer Research, vol. 9, n° 2,1982, p. 132-140
4
Brudney JL, England RE. (1983), Toward a definition of the coproduction concept, Public Administration
Review, 43(1)
5Diffus : co-produit en fonction de la situation de consommation5
Dont la valeur est contextuelle : non liée à l’objet lui-même, mais aux bénéfices produits
par sa consommation6
L’ensemble de ces critères trouve pour point d’union la nature transversale de l’expérience
client. Clients et entreprises ne sont plus ici deux entités distinctes, sinon antagonistes, dans
la production de service. Elles font toutes deux parties d’un processus d’ensemble.
Cette définition se traduit concrètement dans notre expérience quotidienne de
consommation des produits et des services. Par exemple, il suppose de considérer que
l'essentiel n'est pas dans l’achat d’une table chez Ikea ou dans le fait de l'installer chez soi,
d’en faire l’usage. Il s’agit de considérer que l’expérience client démarre depuis la conception
de la table, et surtout, à partir de l’exposition faite en showroom jusqu’à l’installation chez
soi. L’objet n’est plus le cœur de l’expérience de la consommation, c’est la projection et le
déroulement de l’usage qui constitue l’expérience client.
Figure 1. Formalisation de la notion d’expérience client (d’après JOHNSTON et CLARK, 2008)
La nature expérientielle du service dans le cadre d’un parcours comporte en effet une
dimension transversale, qui redéfinit les cadres classiques de la production de service. A un
modèle fondé sur les positions séparées du client et de l’entreprise, le modèle sur lequel
repose tout parcours suppose l’effacement des frontières entre entreprise, client et produits7.
Or, selon WECHLSER, le design d’un service comme parcours est d’autant plus pertinent
que le service rendu est complexe8. Les services PARI et MAPI, du fait de leur complexité,
ont donc tout intérêt à être analysés comme parcours. Les notions qui s’y rapportent ont
donc un sens différent, en cela qu’elles intègrent directement l’idée d’expérience client.
Caractéristique de l'expérience
Dans le cadre de la production de services Dans le cadre d'un parcours de service
client en jeu
Choix stratégiques opérés pour que le service Choix stratégiques opérés pour que le client
- Eigler, Langeard (1987), notion de
Plus-value produise davantage de bénéfices que de puisse tirer un maximum de bénéfices de son
coproduction
contraintes pour le client expérience de consommation du produit
Caractéristiques et coût du service en Caractéristiques et coût attribués à un service par
Valeur comparaison aux autres services positionés sur un consommateur au regard de l'expérience qu'il - Lusch et al. (2007), value-in-use
un segment similaire peut faire du service
Capacité d'un service à répondre par ses Capacité d'un service à adapter ses - Brudney, England (1983), notion
Qualité de
caractéristiques aux différents besoins de ses caractéristiques pour répondre de façon de partage des fonctions de
service
utilisateurs évolutive aux besoins des usagers consommation et de production
Tableau 1. Synthèse des implications théoriques de la notion de parcours
5
Eiglier P., Langeard E. (1987), Servuction, McGraw Hill
6
Lusch RF., Vargo SL, O’Brien M. (2007), Competing through service: Insights from service dominant logic,
Journal of Retailing, 83(1)
7
Johnston R., Clark G. (2008), Service Operations Management, 3ème edition
8
Wechsler J. (2012). Reflections on Service Design, Frameworks and the Service Organization. Design
Management Review, 23(2)
6Au regard des critères qui permettent ainsi d’évaluer les parcours PARI et MAPI, il convient
de considérer la prévention comme un processus qui n'est pas simple, ponctuel et univoque.
Celle-ci doit être entendue de façon globale, et non pas seulement de façon médicale.
1.1.2. La notion de prévention : au-delà des aspects médicaux, une prévention
globale et intégrée
La notion de prévention couvre bien sûr le champ sanitaire, mais pas uniquement.
CLARK DW définissait en 1967 la prévention comme « au sens strict, ce qui permet de
prévenir le développement d’un état pathologique. Au sens large, cela inclut toutes les
mesures, y compris thérapeutiques, qui limitent la progression d’une maladie quel que soit
son stade d’avancement »9. Cette définition se fonde notamment sur la classification retenue
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1948, qui distingue prévention primaire,
secondaire et tertiaire, en fonction du stade de développement de la maladie.
Définition retenue par l'OMS (1948)
Avant l'apparition de la maladie
Ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie dans la
Prévention primaire
population en réduisant autant que possible les risques d'apparition de
nouveaux cas
Au tout début de la maladie
Prévention secondaire Ensemble des actes visant à diminuer la prévalence d'une maladie dans
la population
Une fois la maladie installée
Ensemble des actes qui visent à diminuer la prévalence des incapacités
Prévention tertiaire
chroniques ou des récidives dans un population, et de réduire les
complications
Tableau 2. Synthèse des définitions des types de prévention distingués en 1948 par l’OMS
Cependant, facteurs de risques et maladies ont dans la pratique pu être intervertis dans la
conduite des actions de prévention. A ce titre, STARFIELD, HYDE, GERVAS et HEATH
parlent d’un « glissement depuis la santé publique vers la maladie clinique »10, lequel nuit à
la lisibilité des stratégies de prévention. Ils suggèrent par conséquent de recentrer l’attention
« depuis les individus sur les populations ». En capitalisant sur les avantages des
précédentes conceptions de la prévention, l'idée est d'avoir une approche populationnelle et
globale de la prévention. A ce titre, le professeur SAN MARCO propose une définition, et
détermine la prévention globale comme étant :
Universelle, accordant ainsi une place à l’éducation pour la santé
Sélective, sans ignorer l’importance de sélectionner en fonction de facteurs de risques
Ciblée, et ne se limite donc pas seulement aux facteurs de risques mais s’intéresse
aussi aux malades (éducation thérapeutique)11
De cette définition découle l’idée que la prévention repose sur une participation active de
chacun à sa santé (en association), mais aussi sur « tous les aspects » de la vie. Le rapport
de Monsieur André FLAJOLET définit dès lors quatre actions types pour la mise en œuvre
d’une prévention globale :
ü par les risques, ü par les populations,
ü par les milieux de vie, ü par les territoires.
Or, les parcours PARI et MAPI sont construits dans le cadre d’un service
multidimensionnel (sanitaire, économique et social). On se retrouve donc dans une
9
Clark DW, Macmahon B. Preventive medicine. Boston, MA: Little, Brown&Co, 1967.
10
B. Starfield, J. Hyde, J. Gérvas, I. Heath, The concept of prevention: a good idea gone astray? Journal of
Epidemological Community Health, 2008
11
FLAJOLET André, Député du Pas-de-Calais, 2008, Rapport au nom de la Mission au profit du
gouvernement, "les disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire"
7logique de ciblage réactive, qui par certains aspects rejoint les conceptions issues de
l’idée de prévention globale.
1.1.3. L'enjeu du non-recours au droit
Les principales caractéristiques populationnelles du non-recours12 peuvent s’illustrer
ainsi :
Tableau 3. Illustration des principales caractéristiques populationnelles du non recours
Le phénomène du non-recours aux politiques sociales « renvoie à toute personne qui ne
reçoit pas – quelle qu’en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait
prétendre ». L’ODENORE, Observatoire des non-recours aux droits et services, définit
trois formes de non-recours :
La non-connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue,
La non-proposition, lorsque l’offre n’est pas activée par les agents prestataires
malgré l’éligibilité du demandeur, que celui-ci connaisse ou non l’offre,
La non-réception, dans le cas où l’offre est connue, demandée mais pas obtenue ou
utilisée.
Les situations de non-recours interrogent l’effectivité et la pertinence de l’offre de Service
Public, représentant ainsi un enjeu fondamental pour l’évaluation des dispositifs
proposés, développés, voire imposés aux usagers.
Pour Antoinette CATRICE-LOREY, la notion de « non-recours » est perçue à la fois
comme cause et conséquence des inégalités sociales. Elle revêt une dimension globale,
prenant en compte les environnements externes et internes à l’accès aux droits (les
facteurs socio culturels notamment). En effet, elle considère que le non-recours des
personnes aux droits n’est pas exclusivement dépendant de leur comportement, d’un
choix délibéré mais intègre bien une dimension politique à la réflexion.
L’approche sociologique peut être envisagée. Elle consiste à considérer le non-recours
comme le résultat d’une appréciation de l’offre publique par ses destinataires, exprimant
ainsi une sorte de critique de la pertinence des actions, services, dispositifs ou parcours
proposés. Dans cette acception, la prise en compte institutionnelle de ce phénomène est
une forme de défense ou de renouvellement des choix publics.
La définition de la notion de non-recours est donc multiforme. C’est avec une meilleure
connaissance de ce phénomène que le regard porté sur les publics, destinataires des
politiques publiques, change. La capacité de l’Etat social à relever ce défi est alors
interrogée.
Philippe WARRIN13 développe la thèse selon laquelle la compréhension du phénomène
ne résulte pas uniquement d’un choix, donnant ainsi une dimension politique du non-
recours. Il s’appuie sur une traduction du non-recours par la « non demande ». Cette
12
« Evaluation du non recours aux minimas sociaux et aux soins des personnes en situation de précarité
sociale, Observatoire des non-recours aux droits et services, ODENORE, synthèse du 26 septembre
2016 »
13
« Le non recours aux politiques sociales", 2016, WARRIN Philippe
8dimension suppose que l’individu ait connaissance de l’offre de prestations mais ne fasse
pas de démarche pour l’obtenir ou qu’il ne l’utilise pas (droit ou service ouvert). Ce type
de non-recours exprime une forme de désaccord de l’usager vis-à-vis des droits et
interroge ainsi la pertinence des politiques sociales.
Le non-recours est donc à la fois un enjeu fondamental dans la construction des parcours
proposés par les organismes de sécurité sociale et une démarche d’évaluation de leur
réussite.
Cette approche théorique peut être complétée par une approche empirique en observant
l'existant au sein de la Protection Sociale.
1.2. Perspectives empiriques : les pratiques autour des parcours de
prévention dans le champ de la Protection Sociale
Afin de mieux cerner comment parcours et prévention ont pu être associés en
pratique, il convient de voir comment les acteurs du secteur privé ont pu s’en saisir, de
même que ceux de la Sécurité Sociale.
1.2.1. Les enjeux et les expérimentations des acteurs du secteur privé
Pour les acteurs du secteur privé (mutuelles et assurances), développer des parcours de
prévention ne rentre pas dans le cadre de leur activité classique. Pour autant, ces acteurs
sont amenés à s’interroger sur leurs pratiques et leurs offres de service. L’environnement
économique de ces acteurs change rapidement, et réduire le risque par la prévention
revient pour les sociétés d’assurance ou assimilés à « réduire les matières assurables ».
Ceci implique à terme un impact budgétaire sur les bilans des sociétés. Dans ce cadre,
la mise en place de parcours de prévention devient une réponse cohérente aux enjeux
que rencontrent ces sociétés.
La recherche-action a été l’occasion de passer en revue 122 mutuelles et 12 sociétés
d’assurance. La quasi-totalité d'entre elles communique sur des actions de prévention.
En pratique, celles-ci se limitent la plupart du temps à des campagnes d’informations. Au-
delà de ces pratiques à moindre coût, nous avons cependant étudié quelques initiatives
intéressantes parmi les acteurs de la protection sociale.
Il apparait parmi les initiatives innovantes la volonté de faire de la prévention un cœur
« actif » d’activité, associé à l’offre de service classique du métier d’assureur. De plus,
Malakoff Médéric a dans ce cadre mis en place une solution numérique innovante, qui
semble pouvoir renouveler l’approche des parcours de prévention.
Finalement, la prévention joue un rôle moteur dans l’anticipation de la réalisation des
risques pour les acteurs du secteur privé. L’utilisation de nouveaux canaux (et notamment
du numérique), de façon à dépasser une approche simplement informative, est au cœur
des enjeux pour ces acteurs.
Type d'approche
Public cible Actions entreprises
de prévention
Accompagnement des entreprises en situation de
Klésia Mutuelle Economique Entreprises
fragilité économique
Promotion de l'activité physique pendant et après
Pasteur Mutualité Santé Patients
traitement afin de prévenir la récidive
Cycle de conférence en lien avec la prévention à
Harmonie Mutuelle Santé Praticiens de santé
destination des assurés
Macif Mutualité Santé Tous Budget de 4M€ dédié aux actions de prévention
Remboursement des actes de prévention + actes
IBM Mutualité Santé Assurés
de dépistage
Salariés des Application VIGISANTE permettant d'établir un
Malakoff Médéric Santé
entreprises assurées baromètre santé + Application de coaching
Gestion de centres de prévention gratuits
Agirc Arrco Santé Assurés permettant une recontre avec un médecin et un
psychologue
Tableau 4. Recensement d'actions entreprises par des mutuelles et sociétés d'assurances
91.2.2. Les enjeux et les expérimentations dans la sphère de la sécurité sociale
Dans la sphère de la Sécurité sociale, la notion de prévention a pour rôle d’éviter la
réparation de certains risques, en les anticipant. Au-delà de cet aspect, des parcours ont
aussi été construits de façon à lutter contre le non-recours aux droits14. Un enjeu
fondamental consiste dans l’évaluation des dispositifs proposés.
La structuration de l’offre publique sur la base de l’élaboration de parcours répond
aujourd’hui à plusieurs ambitions dont la finalité est commune : lutter contre le non
recours. Ainsi, les stratégies incitatives développées par les organismes de sécurité
sociale visent la responsabilité et la liberté individuelle des usagers dans leur accès aux
droits, couplées à un accompagnement structuré, individualisé et adapté (exemples :
PRADO15, SOPHIA16…).
Ce passage vers des politiques sociales actives renvoie à l’idée d’une société de
réciprocité, de responsabilisation. Les différentes branches et régimes se sont saisis de
cet enjeu. Cet engagement s’illustre dans les différentes conventions d'objectifs et de
gestion (COG) :
La COG de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) prévoit un axe permettant de « garantir à tous les assurés un accès réel
aux droits et aux soins ». Les objectifs sont ambitieux : simplifier les démarches et,
surtout, développer une démarche active pour favoriser l’accès aux droits et
prestations. Dans cette optique, la branche a mis en œuvre la PFIDASS17.
Celle de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) prévoit quant à elle de
répondre aux besoins des familles. L’accès aux droits est au centre de l’offre de service
de la branche.
La MSA avance dans son axe 2 le fait de favoriser l’accès aux droits et aux soins de
ses adhérents. En complément, le régime s’appuie sur une politique d’action sociale
forte, ancrée sur les territoires via ses élus, permettant ainsi de valoriser la démarche
de diagnostic pour identifier au mieux les besoins des adhérents et développer une
offre de service adaptée.
La COG des Accidents du Travail et Maladie professionnelles (AT/MP) positionne la
prévention au cœur de la gestion du risque. Dans cette optique, les CARSAT ont
notamment développé la PDP18.
Le Régime Social des Indépendants suit aussi cette logique et fait de l’amélioration du
contact avec l’assuré un axe central, appuyé par le développement des offres de
service, d’une communication et d’un accompagnement adaptés au travailleur
indépendant. Les parcours étudiés (MAPI et PARI) en sont les déclinaisons concrètes :
ils visent ainsi à construire des parcours adaptés pour un profil d’assurés spécifiques.
1.3. Le cas des travaileurs indépendants : construire des parcours adaptés
à un profil spécifique
La construction de parcours adaptés au profil des travailleurs indépendants
suppose d’appréhender leurs particularités pour cerner leurs besoins.
14
Voir annexe 4
15
Prado : service de retour à domicile des patients hospitalisés de l'Assurance Maladie
16
Sophia : service d'accompagnement des malades chroniques de l'Assurance Maladie
17
Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé. Ce dispositif a pour
objectif d'accompagner les assurés sociaux dans leurs démarches de soins pour ceux qui y auraient
renoncés et se décompose en une phase de diagnostic, une phase de détection et la proposition d’un
accompagnement adapté. Enfin, une démarche d’évaluation est assurée pour le suivi de ce dispositif.
18
Prévention de la désinsertion professionnelle : l’objectif est d’accompagner un assuré social qui
présente un risque de désinsertion professionnelle du fait de son état de santé. Cette action repose sur
l’implication, la mobilisation et la complémentarité de multiples acteurs au sein de l’Assurance Maladie
qui sont coordonnés au sein de cellules locales. Ce programme s’appuie sur une détection coordonnée
avec les services médicaux, un signalement qui peut être initié par plusieurs canaux (partenaires par
exemple) qui permettent de définir la prise en charge et actionner les dispositifs les plus adaptés à la
situation.
101.3.1. Le profil des travailleurs indépendants
Il est délicat de parler des travailleurs indépendants comme un tout, d’un point de vue
socio-économique, compte tenu de l’hétérogénéité de leurs profils. Par exemple, le
revenu moyen des professions libérales est de 51500€/an contre seulement 23000€/an
pour les commerçants. Pour autant, les travailleurs indépendants se distinguent des
salariés. Ils sont tout d’abord plus âgés en moyenne, et se caractérisent surtout par la
porosité entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Par ailleurs, du point de vue
de leur protection sociale, les indépendants se caractérisent souvent par leur pluri-
affiliation : 10% sont polyactifs, et 95% des retraités du régime sont polypensionnés.
Sur le plan sanitaire, les données relatives à l’état de santé des travailleurs indépendants
font ressortir un taux de mortalité et une espérance de vie favorables. Ainsi, le taux de
mortalité des hommes travailleurs indépendants entre 35 et 64 ans est de 12% (16% en
population générale). Leur espérance de vie à 60 ans est supérieure à celle de la
population générale (Hommes : 22,2 ans contre 21,1 ans - Femmes : 27,1 ans contre
26,1 ans). Concernant les affections de longue durée (ALD 30), il apparaît que les
travailleurs indépendants sont moins nombreux à bénéficier du ticket modérateur à ce
titre : 11,9% contre 16,6% au Régime Général en 201519. Toutefois, la prise en compte
de taux standardisés permet de constater qu’à structure âge et sexe équivalente, le RSI
se caractérise par un taux d’admission en ALD supérieur par rapport au Régime Général.
Enfin, le rapport des travailleurs indépendants aux problématiques de santé est
également caractérisé par une faible participation aux actions de prévention et des
consultations médicales tardives. Parmi les explications, il est à noter que les travailleurs
indépendants se déclarent globalement en meilleure santé, alors même qu’il s’agit d’une
population plus âgée que la moyenne des français. De plus, la place importante accordée
à leur vie professionnelle les amènerait à privilégier la bonne santé de l’entreprise avant
la leur.
Compte tenu de ces caractéristiques, il convient de tenir compte des besoins spécifiques
des travailleurs indépendants dans l’analyse des parcours MAPI et PARI.
1.3.2. Les besoins spécifiques des travailleurs indépendants
Les besoins spécifiques des travailleurs indépendants découlent de plusieurs facteurs20 :
des risques spécifiques liés à leur profession, un moindre recours au système de soins,
une faible participation aux actions de prévention et un lien étroit entre la santé de
l’entreprise et celle de l’indépendant. Par ailleurs, ils ne bénéficient pas d’un service de
santé au travail qui pourrait permettre de détecter précocement des pathologies, dans le
cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés.
Le moindre recours au système de soins pose la question d’un éventuel renoncement aux
soins des indépendants. Sur ce point, aucune étude ne permet de conclure qu’il aurait
pour cause des raisons financières. Ainsi, le comportement de santé des travailleurs
indépendants relèverait du statut lui-même et du rapport au travail.
Face à ce constat, le RSI doit intégrer les particularités de ses ressortissants pour définir
des démarches de prévention adaptées. Il s’agira de démarches globales qui intègrent
les dimensions sanitaires mais aussi économiques et sociales.
La détection des situations de fragilité est d’autant plus importante que les travailleurs
indépendants ne participent que très peu aux actions de prévention, comme ils anticipent
peu leur départ en retraite. De même, la réussite d’un dispositif d’accompagnement
dépendra de sa capacité à apporter des réponses globales au travailleur indépendant en
difficultés.
19
Stress au travail et santé, Inserm 2011
20
Voir annexe 3
111.4. Facteurs clés de succès des parcours et hypothèses d’analyse
Les éléments tant théoriques que pratiques montrent que les facteurs clés de succès des
parcours de prévention sont nombreux. Parmi eux, l’évolutivité de la prise en charge, la
co-construction des parcours, la qualité des échanges clients, la globalité de la prise en
charge ou encore le travail en réseau.
Afin de permettre une analyse critique des deux parcours MAPI et PARI, qui s’appuie sur
l’ensemble des remarques faites ci-avant, les différents facteurs clés de succès dégagés
lors des analyses ont été recoupés en cinq hypothèses21 :
La définition d’une gouvernance claire de façon à articuler l’intervention des différents
acteurs
La mise en place d’une structuration partenariale en phase avec les ressources et
l’organisation des cellules locales
L’utilisation du partenariat dans le cadre d’une relation client construite pour le
travailleur indépendant
La définition d’une stratégie de communication interne et externe segmentée et lisible
L’utilisation du plein potentiel du numérique comme condition de développement des
parcours
Ainsi, il convient désormais de questionner les parcours en fonction de ces hypothèses,
afin de dégager les bonnes pratiques et les axes d’amélioration qui permettent
effectivement de construire des parcours personnalisés pour les travailleurs
indépendants.
2. ANALYSE CRITIQUE DES PARCOURS MAPI ET PARI AU SEIN DU RSI
Les cinq hypothèses dégagées ci-avant sont analysées selon une méthode et des
données communes. Méthodologiquement, l’étude porte de manière croisée sur les deux
parcours, les hypothèses ayant été dégagées de façon transversale. L’analyse s’appuie
quant à elle sur des données variées et croisées :
Des entretiens avec les assurés ayant bénéficié des parcours (27 entretiens au total
sur chacun des deux parcours)
Des entretiens avec des agents du régime, à la fois issus des caisses locales et des
caisses nationales, de façon à croiser les regards et perspectives
La documentation interne (procédures internes, notes de service), ainsi que toutes
les publications extérieures (notamment IRDES) portant sur les parcours MAPI et
PARI
De façon à intégrer l’actualité du régime, les analyses sont attentives aux récentes
publications portant sur le RSI, et s’appuient aussi sur des entretiens avec des agents
du Régime Général travaillant sur des secteurs similaires à ceux pilotant les parcours
MAPI et PARI.
2.1. Hypothèse 1 : Affiner la gouvernance pour articuler l’intervention des
différents acteurs
La question de la gouvernance des parcours, du fait de leur ampleur, est
particulièrement cruciale.
2.1.1. Contexte et périmètre de l’étude sur les parcours PARI et MAPI
Par gouvernance, on entend « l’ensemble des structures, processus et mécanismes par
lesquels l’organisation est dirigée et managée de façon à créer de la valeur pour ses
21
Voir annexe 9 : passage des données aux hypothèses
12parties prenantes »22. En lien avec les parcours MAPI et PARI, s’intéresser à la
gouvernance suppose d’examiner l’articulation des différents acteurs décisionnaires,
mais aussi d’interroger le partage des responsabilités et des initiatives au cours du
processus.
2.1.1.1. Définition et justification de l’hypothèse
La question de la gouvernance se pose dans le cadre des parcours MAPI et PARI, d’abord
au titre de la nature même des dispositifs, mais aussi au regard des enjeux et objectifs
qui leur sont assignés en termes de prévention.
Les dispositifs MAPI et PARI sont en effet des parcours. En cela, la valeur qu’ils créent
« pour les parties prenantes »23 dépend à la fois des services offerts par le régime, mais
aussi de leur appropriation par les ressortissants du régime24. La gouvernance de ces
parcours est donc par définition partagée : elle ne saurait être seulement descendante, et
suppose que leurs contenus soient (re)définis et (re)travaillés en local, à la fois par les
caisses et les partenaires. Examiner leur gouvernance permet de souligner les enjeux liés
à leur continuité et leur cohérence.
Au regard des objectifs assignés aux parcours, ceux-ci cherchent du fait du public qu’ils
ciblent à être pluridimensionnels (économiques, sanitaires, et sociaux). Ils impliquent
donc de tenir compte d’une notion globale de prévention25, en associant des acteurs de
champs variés : administratifs, professions médicales, travailleurs sociaux… Il convient
de s’intéresser à la prise en compte de cette dimension plurielle au niveau de la
gouvernance dans la répartition des responsabilités, et dans les structures de décision.
La notion de gouvernance est particulièrement critique pour la réussite des parcours MAPI
et PARI, en cela que leur originalité suppose d’adapter les modes de prise de décision et
d’organisation.
L’hypothèse est donc que, du fait de leur configuration singulière, les parcours MAPI et
PARI doivent se décliner de façon opérationnelle selon une gouvernance adaptée et
partagée entre acteurs.
2.1.1.2. Périmètre d’étude de l’hypothèse sur le parcours PARI
Dans le cadre du parcours PARI, la gouvernance concerne davantage l’aval du parcours
que l’amont. En effet, la sélection des potentiels bénéficiaires est réalisée grâce à l’outil
ARIAN, sur la base des données économiques, sanitaires et sociales dont dispose le
régime.
En revanche, l’organisation du parcours pour la prise en charge du bénéficiaire est
articulée autour d’un réseau qui engage à la fois les acteurs des services administratifs,
sociaux et de santé pour prendre les décisions. Plus encore, le parcours repose sur des
partenariats avec l’ordre des médecins et d'autres partenaires compétents pour la prise
en charge des assurés, en fonction du parcours adapté aux besoins de l’assuré. La
gouvernance est ici interrogée en amont, à deux niveaux :
Le choix de parcours de prévention retenus pour l’assuré : ceux-ci sont ciblés par
l’outil ARIAN, mais engagent in fine une décision de la caisse locale. La mobilisation
des services en interne, inclut notamment la coordination, voire la coopération entre
acteurs.
La prise en charge par la caisse ou par un partenaire d’un assuré : la responsabilité
et la prise de décision posent question, en cela que l’organisation partenariale
suppose un mode de gouvernance du moins éclaté, sinon décentralisé.
22
S. FAN, Review of literature and empirical research on corporate governance, Monetary Authority of
Singapore, 2004
23
Ibid.
24
Cf. partie 1.1.
25
Cf. partie 1.2.
13Légende
BDD RSI Définition
(sans BDD autres indicateurs +
régimes) pondération Abc Eléments SI
Abc Eléments caisse nationale
Abc Eléments caisses locales
Abc Sortie de l'assuré du parcours
Actions menées conjointement
NIVEAU ARIANE
NATIONAL
(CNRSI)
5%
Classement des assurés Envoi d'un
1. Sans risque/minime (4 catégories selon le risque) questionnaire
2. Risque faible
3. Risque élevé
4. Dépendance
Réponse Sans rép.
Prise en charge Exclusion
par la cellule
régionale PARI
NIVEAU
LOCAL (RSI
disposant
d'une cellule Pas de parcours
PARI) adapté à
proposer à Modes de décision et de participation des différents acteurs, en interne
l'assuré
Parcours Parcours Parcours Parcours autres
santé ASS précarité
énergétique
Envoi de
Professionnels
de santé, TS, ...
courrier et Structure de décision et d'évaluation dans l'organisation partenariale
prise en charge
Figure 2. Le fonctionnement du parcours PARI
2.1.1.3. Périmètre d’étude de l’hypothèse sur le parcours MAPI
Au niveau du parcours MAPI, la question de la gouvernance est plus transversale : le
pilotage du dispositif repose actuellement essentiellement sur les caisses locales26. Par
conséquent, on distingue trois instances dans lesquelles l'enjeu de la gouvernance peut
être identifié :
Au niveau de la phase de signalement et de l’analyse du dossier : la question du
pilotage, de la centralisation et de la priorisation des signalements reçus se pose en
cela que la prise en charge de assurés en dépend directement
Au niveau de la prise en charge :
- Concernant l’aménagement de poste : la question du pilotage, du partage de
responsabilités, de l’inclusion de l’assuré dans le projet de reclassement, ainsi
que celle des modalités d’intervention des partenaires
- Concernant le reclassement : la question du pilotage de la prise en charge des
assurés, et celle des structures de décision et d’information entre les caisses et
leurs partenaires (SAMETH, AGEFIPH...)
Le périmètre d’étude de la question de la gouvernance sur le parcours MAPI inclue donc
prioritairement la question de la coordination des différents intervenants depuis le ciblage
jusqu’à la prise en charge de l’assuré.
Les ressources utilisées pour l’examen de cette hypothèse recouvrent essentiellement
les données relatives à leur organisation interne. Ces analyses s’appuient donc sur la
documentation disponible concernant les parcours MAPI et PARI, ainsi que sur les
entretiens réalisés avec des agents. Le point de vue de l'usager est globalement hors du
spectre d’analyse.
26
Madame MOLL a signalé lors de l’entretien réalisé en juillet 2017 qu’un outil était en construction pour
le dispositif MAPI, de façon à reposer sur une logique similaire à celle mise en place pour PARI. Les
questions de gouvernance pourront être alors influencées au regard des modifications (en termes de
processus et de structure du parcours) qu’induiront la mise en place de cet outil.
14Arrêt de travail de plus
de 90j Autres
- Signalement
service social
- Signalement
Organisation du dispositif de signalement, partage des responsabilités
partenaires
- Spontané
Envoi Analyse du Légende
Exclusion
questionnaire dossier
Abc Action menée par le RSI
Abc Action menée par un partenaire
Actions menée conjointement
Financement - Aménagement
Reclassement
aide ponctuelle de poste
Intervention du Financement 2ème
Exclusion
SAMETH Agefiph questionnaire
Structures de décision et de partage d'information
Bilan de Aide financière
compétences
Structures de décision, responsabilités et modalités
d'intervention des
partenaires
Figure 3. Le fonctionnement du parcours MAPI
2.1.2. La gouvernance : des enjeux de responsabilité, de coordination et de
coopération entre les acteurs
Les différents acteurs qui interviennent font face à des enjeux de responsabilité partagés.
Leur action nécessite une réelle coordination et même une coopération pour la bonne
réussite des parcours.
2.1.2.1. Des responsabilités partagées pendant une prise en charge
évolutive
Les parcours MAPI comme PARI montrent tous deux que la prise en charge de l’assuré
n’est pas formellement définie au moment du repérage des faiblesses de celui-ci. La
définition des modes de prise en charge est donc évolutive, et est complétée par les
informations et l'expertise de chacun des acteurs intervenant au cours du parcours. Il
ressort de l’analyse de ces parcours qu’en l’absence de cellules métier dédiées, chaque
caisse prévoit une comitologie ad-hoc et s’appuie sur des échanges informels pour aboutir
à la prise de décision.
En soi, ce partage des responsabilités n’est pas un problème : c’est au contraire une
richesse qui permet de mettre en place des modes d’intervention à la fois
pluridisciplinaires et évolutifs pour les assurés. Cependant, il gagne à être formalisé et
assumé de façon à :
Homogénéiser les modes de gouvernance et assurer l’égalité de traitement entre
caisses
Uniformiser les modes d’intervention et optimiser les ressources allouées au pilotage
stratégique et opérationnel des dispositifs
Clarifier la stratégie opérationnelle poursuivie et permettre la mise en place d’un suivi
et d’une évaluation des parcours, qui permette des comparaisons entre caisses
2.1.2.2. Un enjeu fort de coordination pour la fluidité et la continuité des
parcours
Les acteurs de terrain rencontrés relèvent que les deux parcours nécessitent un effort de
coordination important. La coordination peut être entendue comme une forme de partage
des tâches et des responsabilités, qui suppose un but commun et des relations de
dépendance réciproque27. Dans ce cadre les parcours correspondent à cette perspective :
il s’agit d’articuler différents modes d’intervention et de décision en vue d’un ou plusieurs
besoins spécifique(s) d’un assuré. Au-delà du partage des responsabilités évoqué
27
K. SMITH, S. CARROLL, S. ASHFORD, Intra- and Interorganizational cooperation: toward a research
agenda, Academy of Management Journal, 1995, 38(1)
15Vous pouvez aussi lire