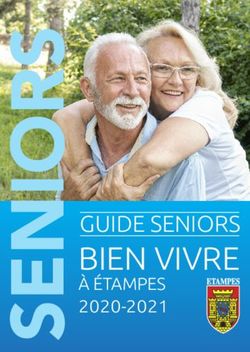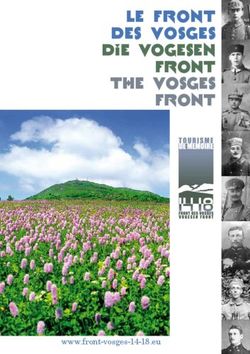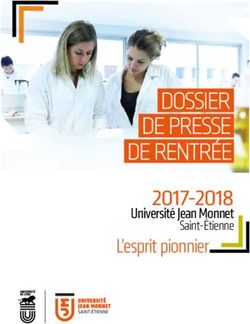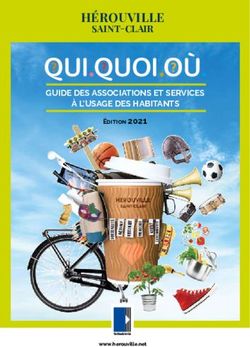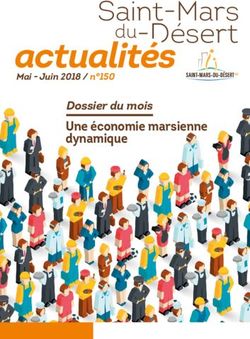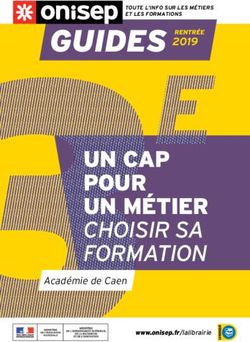Suggestions bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité à Saint-Bruno - Le Montarvillois
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Suggestions de bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité à Saint- Bruno À l’approche de l’Halloween, le ministère de la Santé et des Services sociaux publie quelques suggestions de bonnes pratiques afin que cette fête se déroule de façon sécuritaire, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il est important de souligner que toute personne qui présente des symptômes de la COVID‑19, ou qui doit respecter des consignes d’isolement ou qui est en quarantaine ne doit pas participer à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des fêtes. Pour ceux et celles qui ne présentent pas de symptômes et qui participent à la collecte et la distribution de friandises, rappelons que la prudence est toujours de mise afin de limiter les risques de propagation du virus. Collecte de friandises en porte-à-porte
Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il
leur est demandé de s’abstenir de chanter ou de crier
devant les personnes qui donnent les friandises.
Une distance d’un mètre doit être observée entre les
personnes, dans la mesure du possible.
Avant et après la collecte de friandises, le lavage des
mains est recommandé, ainsi que l’utilisation d’une
solution à base d’alcool au besoin.
Distribution de friandises
Les friandises devraient être préparées en sacs
individuels, pour en faciliter la distribution et
limiter les contacts.
Ajoutons que le risque de contamination est surtout présent
dans les fêtes à l’intérieur. Les mesures en vigueur doivent
être respectées, et particulièrement la limite de 10 personnes
permises dans les domiciles privés.
Moins de restrictions qu’en 2020
Il s’agit de mesures assouplissement sur les consignes de
l’année dernière, alors qu’aucun «party» et rassemblement
privé n’était toléré, la collecte de friandises limité au
quartier entourant le domicile des enfants et disponible dans
un endroit qui respectait la distance sanitaire de 2 mètres
qui était alors exigé, etc.
Bonne Halloween…
Le Montarvillois,
Le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de-Montarville
Photo à la une: Yves Blackburn, décoration 2021 rue Cusson
Source MSSS
Sur le même sujet: Une Halloween colorée à Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois. Le CISSS-M.E. dresse un bilan très positif de sa campagne de vaccination Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est dont le territoire couvre Saint-Bruno-de- Montarville, qualifie de succès sa campagne de vaccination contre la COVID-19 sur son territoire. La population adulte ayant reçu une double dose du vaccin atteint désormais 86%. Il faut également souligner la participation exemplaire des jeunes âgés de 12 à 17 ans, qui ont reçu, à un peu plus de 95%, une première dose du vaccin. «Ces données révèlent que la population continue de participer en grand nombre à la campagne de vaccination historique déployée sur notre territoire. Nous sommes fiers qu’elle ait répondu à l’appel de façon si favorable. Tout en poursuivant cette campagne de vaccination auprès de la clientèle, nous accentuons nos efforts pour rejoindre ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés. Nous les invitons à prendre contact avec nous par notre centrale de rendez-vous. Un accompagnement particulier peut être offert afin de répondre à leurs différentes questions et calmer leurs possibles appréhensions,
tout au long de leur processus de vaccination.» affirme la
directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est,
Nathalie Chénier.
Leurs différentes initiatives
Une roulotte mobile s’est déplacée dans la région tout
l’été afin d’aller sur près de 50 lieux stratégiques
déjà fréquentés et connus par la population; festivals,
campings, fêtes de quartier, entreprises ciblées.
Afin d’encourager davantage les jeunes âgés de 12 à 30
ans à se faire vacciner, nous avons organisé sur les
médias sociaux un concours avec l’humoriste Mathieu
Dufour.
Des équipes mobiles ont été déployées dans des centres
d’hébergement et autres clientèles à mobilité réduite.
Dans l’objectif de rejoindre des clientèles plus
vulnérables, des cliniques de vaccination pour les
clientèles immigrante et itinérante ont été mises en
place. De plus, des cliniques spéciales pour les gens
vivant en situation de handicap ont également eu lieu.
Ces initiatives ont pu se faire grâce à la collaboration
des organismes communautaires locaux.
Faits saillants de leur bilan
En moyenne, plus de 3000 doses ont été administrées par
jour sur notre territoire;
Plus de 1500 employés dédiés à la vaccination ont œuvré
sur nos 8 sites;
Au total, plus de 820,000 doses (première et deuxième)
ont été administrées;
Le taux de vaccination le moins élevé se situe chez les
jeunes âgés de 25 à 29 ans avec un taux de 75%.
Et ça continue
Chaque jour, le CISS-M-E ouvre de nouvelles plages de
vaccination afin de permettre à la population d’obtenirleur première dose ou leur deuxième dose. Voici la
marche à suivre :
Pour prendre un rendez-vous pour votre 1re dose, veuillez
consulter le site www.quebec.ca/vaccinCOVID;
Pour votre rendez-vous pour la deuxième dose, veuillez
vous rendre sur le site
: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/cor
onavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-
covid-19/deuxieme-dose-du-vaccin-contre-la-covid-19;
Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire en ligne
ou si vous éprouvez des difficultés, veuillez appeler au
450 644-4545 ou au 1 877 644-4545.
Le Montarvillois
Le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de-Montarville
Source communiqué CISS-M.E.
Photo: Doum Bergeron
Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à
aujourd’hui, le plus important groupe Facebook
exclusivement dédié aux Montarvillois
Neuf barrières psychologiques
derrière le refus de lavaccination Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue Alors que le Québec est frappé de plein fouet par la quatrième vague pandémique, mettant sous pression le réseau hospitalier, refuser encore de se faire vacciner contre la Covid-19 peut sembler insensé et en irriter plusieurs. Dans l’optique de mieux comprendre ce qui peut amener une personne à hésiter ou à refuser la vaccination, il s’avère essentiel d’identifier les barrières psychologiques qui peuvent sous-tendre le refus de la vaccination. Comme psychologue clinicienne œuvrant majoritairement auprès d’adultes présentant des troubles de la personnalité et des troubles anxieux ou de l’humeur, je suis aux premières loges de la détresse, de la frustration et de l’expression du mal- être des gens au cœur de cette pandémie. Derrière le refus de se faire vacciner, il y a tout un éventail émotionnel complexe qui teinte les comportements et les choix de chacun. En effet, hormis les motifs religieux et culturels, ou des conditions de santé justifiant de ne pas recevoir le vaccin, le choix de ne pas se faire vacciner peut être attribuable à un ensemble d’autres facteurs. En voici neuf qui offrent un bon aperçu de la complexité de la situation. Incompréhension et manque d’information Une première barrière réside dans l’incompréhension et le fait de ne pas savoir quoi penser de la nécessité de se faire vacciner. Face à des avis contradictoires et à un manque d’informations,
on peut ressentir de la perplexité : pourquoi se faire vacciner si, de toute façon, on peut attraper le virus et le transmettre ? Pourquoi vacciner les jeunes s’ils sont moins vulnérables face au virus? Ne pas trouver de réponse satisfaisante à ces questions paralyse la pensée et diminue la mobilisation. Craintes liées aux piqûres… et aux vaccins Certaines personnes ressentent une forte peur des aiguilles ou de la douleur liée à la vaccination. Bien que de l’extérieur cette peur puisse sembler irrationnelle, elle est ressentie intensément par la personne qui en souffre. L’appréhension de l’aiguille ou de la douleur est parfois si anxiogène que cela peut mener à éviter toute situation impliquant de près ou de loin la vaccination. Au point où parfois la seule vision d’images de vaccination peut être source d’anxiété.
Le zoothérapiste Sylvain Gonthier et son chien Bidule réconforte Divine Nsabimana alors qu’elle attend sa dose de vaccin contre la Covid-19, à Montréal, le 26 août. La Presse canadienne/Graham Hughes Dans d’autres cas, la peur sera plutôt associée aux effets secondaires du vaccin. Sans être dans un refus massif de la vaccination, certains préfèrent attendre que plus de gens se fassent vacciner et évaluer les répercussions du vaccin à long terme avant de tendre le bras. Sentiment d’impuissance Une autre barrière psychologique se rapporte au sentiment d’impuissance et de découragement face à l’idée que la pandémie va perdurer, peu importe les efforts de vaccination, notamment devant la menace des nouveaux variants du virus. Le terme de «fatigue pandémique» a été mis de l’avant pour traduire cet état de lassitude et de démotivation à un moment de la crise où les périodes se suivent et se ressemblent. La
résignation et une perte d’espoir peuvent entraîner une démobilisation, entre autres envers les efforts de vaccination. Sensible, mais non concerné D’autres personnes encore sont sensibles aux répercussions de la pandémie, mais ne se sentent pas personnellement concernées: «Je suis en bonne santé, ça me protège». Comme elles ont souvent un manque de connaissances sur la maladie et la vaccination, elles ne sont pas particulièrement préoccupées par les impacts néfastes du virus sur leur santé et sur les risques de transmission. À noter que ces personnes ne sont pas réellement en opposition au vaccin. Méfiance par rapport à ce qui est introduit dans le corps Certaines personnes surveillent scrupuleusement tout ce qui pénètre dans leur corps. Elles ont un malaise viscéral à absorber un agent extérieur menaçant leur équilibre et leur intégrité. Se sentir obligé d’incorporer ou d’ingérer un élément inconnu peut être perçu comme une intrusion, une contamination voire une agression. Ne connaissant pas les ingrédients qui composent le vaccin, ces personnes seront réticentes ou même opposées à le recevoir. Déni de l’anxiété Face à une situation anxiogène, chacun réagit différemment. Certains vont être dans l’action et la recherche de solutions, d’autres vont se confier à des proches, ou seront davantage débordés émotionnellement. D’autres encore seront dans des réactions de déni. Le déni est un réflexe automatique et non conscient agissant comme un pansement pour maîtriser l’angoisse. Dans le contexte pandémique, cela peut s’exprimer par le déni de la gravité de
la maladie, le déni de sa propre vulnérabilité à contracter le virus, ou encore le déni de l’existence même du virus. Sentiment de rejet et d’exclusion En tant qu’être social, nous sommes extrêmement sensibles au rejet. Certains individus ont eu un parcours de vie au sein duquel les expériences de rejet ont été plus présentes et souffrantes que pour d’autres. Ils se sentent davantage exclus de la société, ne se reconnaissent pas dans le discours officiel et les normes proposées. De leur point de vue, les mesures sanitaires annoncées sont perçues comme «contrôlantes». Lorsque, comme eux, on ne se sent ni représenté ni écouté par les autorités, quand on se fait parodier ou critiquer par d’autres groupes de la société, on réactive les blessures d’un passé déjà marqué de rejet et on les rejoue dans un actuel souffrant. La personne se sentira également davantage exclue et sera moins ouverte à suivre les recommandations. Elle est aussi susceptible de se sentir mieux comprise par des voix alternatives et réfractaires qui lui font miroiter qu’elle est enfin entendue. Dépendance et évitement de conflits Certaines personnes sont plus dépendantes face à l’opinion de leurs proches. Les dynamiques relationnelles font en sorte que la personne doute d’elle-même, se fie à l’autre pour prendre des décisions au quotidien, l’idéalise, ou encore cherche à minimiser les conflits avec lui. Dans ces cas-là, la position et le choix de la personne seront influencés par le fait qu’un pair ne considère pas que la vaccination soit importante. Crise de confiance Les facteurs préalablement cités tels que la méfiance par
rapport à ce qui entre dans le corps, le déni de l’angoisse et l’expérience de rejet peuvent se cristalliser vers une méfiance plus importante face aux sources gouvernementales, aux autorités sanitaires et à l’industrie pharmaceutique. Et aussi vers une crise de confiance et une défiance face à ce qui est proposé. La croyance complotiste et le rejet de l’autorité en viennent à façonner la pensée et l’identité. Il y a alors danger de polarisation. Un manifestant anti-vaccins devant un hôpital de Montréal, le 13 septembre. La Presse canadienne/Paul Chiasson D’autres facteurs pourraient s’ajouter à cette description des facteurs contribuant au refus de la vaccination. Comme psychologue, je considère qu’il est essentiel de comprendre les raisons pour lesquelles une personne refuse de se faire vacciner. Car les mesures et les solutions mises en place pour inciter à la vaccination rejoignent différemment les gens en fonction de leurs questionnements personnels. Certains auront davantage besoin d’explications, d’autres
d’être accompagnés au moment de recevoir le vaccin ou encore, d’avoir un espace pour se sentir écoutés et acceptés dans leur sentiment d’irritation. Des personnes enfin, pour éviter de se sentir «contrôlées», préfèreront suivre des recommandations alternatives — comme passer des tests de dépistage régulièrement — plutôt que de recevoir le vaccin. Afin d’offrir des solutions pertinentes et avancer collectivement dans cette crise pandémique, sachons mieux comprendre les réactions de tout un chacun. Je crois que cette compréhension permettra de mieux guider les autorités dans la transmission de l’information, ainsi que dans le choix et la présentation des mesures. Pour qu’une mesure soit respectée, on doit connaître les raisons profondes qui expliquent son rejet. Geneviève Beaulieu-Pelletier Psychologue, conférencière et professeure associée, Université du Québec à Montréal (UQAM) Image à la une: Getty Texte: La Conversation Le Montarvillois, le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de- Montarville Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois
Variant Delta au Canada: ses origines, ses points chauds et sa résistance aux vaccins L’émergence de variants dits «préoccupants» à la fin de 2020 a marqué un tournant dans la pandémie de Covid-19, le terme entrant ainsi dans le vocabulaire de tout un chacun. L’accélération dans le monde de l’un d’entre eux, le variant Delta, soulève des questions sur son origine, sa transmissibilité, ses points chauds et son potentiel de résistance au vaccin. Qu’est-ce qu’un variant? Grâce au séquençage du génome, nous pouvons déterminer l’ordre spécifique des gènes individuels et des nucléotides qui composent l’ADN et l’ARN. Si l’on considère le virus comme un livre, c’est comme si toutes les pages avaient été découpées en morceaux. Le séquençage nous permet de remettre les mots et les phrases dans le bon ordre. Les variants diffèrent les un des autres en fonction des mutations. Ainsi, deux exemplaires du livre seraient des «variants» si un ou plusieurs des morceaux découpés étaient différents. Il faut également savoir que des variants sont apparus tout au long de la pandémie sans que cela n’ait d’effet sur les comportements viraux. Cependant, l’émergence de variants préoccupants, où les mutations ont entraîné une modification des caractéristiques du virus (augmentation de la transmission et de la gravité de la maladie, réduction de l’efficacité des vaccins, échec du dépistage) a eu des conséquences importantes. L’émergence et la transmission de B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta) et P.1 (Gamma) au Canada ont donné lieu à des troisièmes vagues de transmission qui ont entraîné
l’engorgement des systèmes de soins de santé et de nouvelles restrictions. L’Organisation mondiale de la santé a introduit un nouveau système de dénomination, basé sur l’alphabet grec, pour les variants des coronavirus au printemps 2021. Qu’est-ce que le variant Delta, et où a-t-il émergé? Le variant Delta est un variant préoccupant également connu sous le nom de B.1.617.2 et constitue l’une des trois sous- lignées connues de B.1.617. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, le variant Delta a été détecté pour la première fois en Inde en décembre 2020. L’Organisation mondiale de la santé a introduit au printemps 2021 un nouveau système de dénomination, basé sur l’alphabet grec, pour les variants de coronavirus. (Shutterstock) Qu’est-ce qui rend Delta différent des autres variants préoccupants? L’une des caractéristiques du variant Delta est sa
transmissibilité accrue, avec des augmentations estimées de 40 à 60% par rapport au variant Alpha. Des données récentes provenant d’Écosse suggèrent que le risque d’hospitalisation double à la suite d’une infection par le variant Delta (par rapport au variant Alpha), en particulier chez les personnes présentant au moins cinq autres problèmes de santé. Une augmentation du risque d’hospitalisation a été observée à partir de données recueillies en Angleterre. L’analyse épidémiologique, qui porte sur des éléments tels que la distribution de l’infection et la gravité de la maladie, peut souvent fournir des évaluations rapides des modifications des caractéristiques du virus. L’étude de mutations spécifiques à l’aide de l’analyse de la relation structure à activité, qui examine comment la structure chimique du virus affecte son activité biologique, peut également fournir des indices, bien que la validation prenne souvent beaucoup de temps.
La protéine spike (au premier plan) permet au virus de pénétrer dans les cellules humaines et de les infecter. Sur le modèle de virus à l’arrière-plan, la surface du virus (en bleu) est couverte de protéines spike rouges. (NIH), CC BY Les premières analyses de la relation structure à activité ont porté sur la relation entre trois mutations et le comportement de Delta. En particulier, une étude en prépublication, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, suggère que trois mutations dans la protéine de pointe du SARS-CoV-2 peuvent rendre le variant plus transmissible en facilitant la liaison de cette protéine au récepteur des cellules humaines (connu sous le nom de récepteur ACE2). Si nous reprenons l’analogie du livre, cela signifie que trois des morceaux découpés dans la version Delta du livre sont différents de l’original. Chacun de ces trois morceaux peut permettre au virus d’infecter plus facilement les cellules humaines. Que savons-nous de l’épidémiologie du variant Delta et de ses points chauds? Tout porte à croire que Delta a joué un rôle important dans la vague de cas de Covid-19 observée en Inde en 2021. Depuis, ce variant s’est répandu dans le monde entier. Au 14 juin, le variant Delta a été détecté dans 74 pays, a représenté plus de 90% des nouveaux cas au Royaume-Uni et au moins 6% du total des cas aux États-Unis , avec des estimations allant jusqu’à 10%. Une grande partie de ce que nous savons sur le variant Delta provient du Public Health England. Il a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni vers la fin du mois de mars 2021, et lié à des voyages. Au 9 juin, le nombre de cas confirmés ou probables était de 42 323, avec une distribution bien répartie dans tout le pays. Au Canada, Delta a été détecté pour la première fois au début du mois d’avril en Colombie-Britannique.
Bien qu’Alpha soit toujours le plus dominant au pays, la croissance de Delta s’est accélérée dans de nombreuses provinces. Le nombre de cas confirmés a bondi de 66% au Canada la semaine dernière, selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il est maintenant présent dans toutes les provinces et au moins un des territoires. Les données de l’Alberta indiquent que le nombre de cas double tous les six à douze jours. L’Ontario a estimé que 40 % de ses nouveaux cas depuis le 14 juin 2021 sont dus à Delta. Le Québec est moins touché : il y aurait 35 cas du variant Delta, surtout à Montréal (21) et en Montérégie (7), selon les dernières données sur le site de l’Institut national de santé publique du Québec. Il faut cependant noter que la prévalence de Delta est sous- estimée car un test de dépistage efficace n’a pas encore été développé. Que savons-nous de Delta et des vaccins? Les données suggèrent que la vaccination offre une certaine protection contre l’infection et l’hospitalisation par la variante Delta. La Presse Canadienne/Jonathan Hayward Les premières analyses effectuées au Royaume-Uni sur l’efficacité du vaccin contre le variant Delta ont suscité un certain optimisme.
Des données provenant d’Écosse indiquent que la vaccination par AstraZeneca ou Pfizer réduit les hospitalisations et les infections, mais avec moins d’efficacité que pour le variant Alpha. Cependant, les données suggèrent que les vaccinations à deux doses avec AstraZeneca ou Pfizer ont réduit les hospitalisations de 92% et 96%, respectivement. La protection contre les symptômes de la maladie est réduite de 17% pour Delta par rapport à Alpha avec une seule dose de vaccin. La propagation du variant Delta accroit l’urgence, pour les santés publiques, d’offrir les deux doses de vaccin à l’ensemble de leur population. Cependant, les premières doses semblent offrir une protection substantielle contre les maladies graves nécessitant une hospitalisation. Jason Kindrachuk, Assistant Professor/Canada Research Chair in emerging viruses, University of Manitoba Souradet Shaw, Assistant Professor, Canada Research Chair in Program Science and Global Public Health, University of Manitoba Texte publié initialement dans la conversation Image à la une: Détails de la licence Créateur : iSO-FORM LLC, iSO-FORM LLC Droits d’auteur : These images may be used and distributed in accordance with an Attribution-No Derivatives 4.0 International Creative Commons License. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/Vous voulez connaître l’origine de ces informations ? En savoir plus Le Montarvillois, le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de- Montarville Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à
aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois Plus de 77% des Montérégiens adultes ont reçu une première dose de vaccin Nous ne disposons pas de statistiques pour la population de Saint-Bruno-de-Montarville mais la direction de santé publique de la Montérégie a annoncé que 77,7% de la population de 18 ans et plus de la région a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Plus d’un million de doses de vaccins ont ainsi été administrées à des résidents de la Montérégie https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination. «Je suis extrêmement fière de la participation des adultes à la campagne de vaccination. Je veux aussi remercier nos équipes de vaccination qui ne ménagent aucun effort pour favoriser la vaccination d’un plus grand nombre de personnes. Nous l’avions déjà dit, c’est grâce à la vaccination que nous pourrons reprendre une vie normale et nous sommes vraiment près du but», indique Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie. «Pour être mieux protégé contre le virus, il faut recevoir une deuxième dose de vaccin. J’insiste donc sur l’importance de recevoir cette deuxième dose, vous pouvez même devancer votre rendez-vous si vous le souhaitez en suivant le calendrier qui a été proposé aujourd’hui», poursuit-elle.
Une deuxième dose en 8 semaines Le gouvernement du Québec a annoncé que tous les gens qui ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la COVID peuvent devancer leur rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose dans un délai de 8 semaines ou plus. La population pourra changer son rendez-vous pour la 2e dose selon son groupe d’âge en suivant le calendrier (tableau). Pour ce faire, il suffit de se rendre à cette adresse: Québec.ca/vaccinCOVID, cliquer sur deuxième dose et prendre un
nouveau rendez-vous (ce qui annulera l’ancien). À noter que les rendez-vous seront conservés pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas changer le moment prévu pour recevoir leur deuxième dose. Le Montarvillois, le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de- Montarville Source: communiqué DSP Montérégie Sur le même sujet, lire: Deuxième dose d’AstraZeneca: dois-je recevoir le même vaccin ou choisir Pfizer ou Moderna?Lire l’article: https://lemontarvillois.com/deuxieme-dose-dastrazen eca…/ Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois Deuxième dose d’AstraZeneca: dois-je recevoir le même vaccin ou choisir Pfizer ou Moderna?
Alexander Wong Au Canada, les gens qui ont reçu en première dose le vaccin d’AstraZeneca ont un choix à faire: ils peuvent opter pour l’un des vaccins à ARNm (Pfizer ou Moderna), ou prendre une autre dose d’AstraZeneca pour leur deuxième injection. La saga du vaccin d’AstraZeneca a été compliquée. Des essais cliniques et des données réelles du Royaume-Uni ont démontré sa grande efficacité contre les maladies graves et les hospitalisations dues à la Covid-19. Mais des études en provenance de l’Union européenne ont confirmé l’existence d’un lien entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins rares mais potentiellement mortels, appelés «thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin» ou TTIV. Au Québec, une femme de 54 ans en est décédée, et trois autres personnes au pays.
Le chef du NPD, Jagmeet Singh, se fait administrer un vaccin AstraZeneca par le Dr Nili Kaplan-Myrth dans un cabinet de médecine familiale à Ottawa, le 21 avril. La Presse Canadienne/Adrian Wyld Après quelques tergiversations, le 1 e r juin, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié des directives supplémentaires. Les personnes qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca peuvent recevoir soit une deuxième dose du même vaccin, soit d’un vaccin à ARNm. Les provinces, dont le Québec, ont rapidement modifié leurs directives pour permettre ce choix. La question est donc la suivante : que dois-je choisir pour ma deuxième dose si j’ai reçu une première dose d’AstraZeneca ? Les preuves à l’appui
Le Premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau ont reçu des injections d’AstraZeneca dans une pharmacie d’Ottawa le 23 avril. La Presse Canadienne/Adrian Wyld Commençons par les preuves dont nous disposons jusqu’à présent concernant les vaccins mixtes, en particulier AstraZeneca et Pfizer/BioNtech (Pfizer). Le 12 mai, les premières données sur la réactogénicité (la capacité à produire des effets secondaires courants) de l’étude COM-CoV au Royaume-Uni ont été publiées). L’étude portait sur 830 personnes âgées de 50 ans et plus, réparties au hasard dans quatre groupes, et qui ont reçu différentes combinaisons de vaccins AstraZeneca et Pfizer à des intervalles de quatre semaines. Les participants qui ont reçu des vaccins différents pour leur première et leur deuxième dose, quelle que soit la séquence de vaccination, ont présenté davantage d’effets secondaires (sans gravité et disparaissant d’eux-mêmes) que ceux qui ont reçu le même vaccin deux fois. Aucun problème de santé n’a été relevé. Les experts ont émis l’hypothèse qu’un grand nombre d’effets
secondaires pouvait laisser présager une réponse immunitaire plus forte, mais les données sur l’immunogénicité (la capacité du vaccin à provoquer une réponse immunitaire) sont toujours en attente et devraient être publiées dans le courant du mois. Les résultats de l’étude espagnole CombiVacS ont été communiqués le 18 mai. Dans le cadre de cette étude, 663 personnes ayant reçu la première dose d’AstraZeneca ont été choisies pour recevoir une deuxième dose de rappel de Pfizer huit semaines plus tard, ou pour faire partie d’un groupe témoin sans deuxième dose. Les personnes qui ont reçu AstraZeneca suivi de Pfizer ont développé deux fois plus d’anticorps que ceux observés chez les personnes ayant reçu deux doses d’AstraZeneca. Aucun problème de santé n’a été identifié. Des personnes âgées de plus de 45 ans font la file à une clinique de vaccination sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca, à Montréal, le 21 avril. La Presse Canadienne/Paul Chiasson Une étude récente réalisée en Allemagne et publiée le 1er juin
sous la forme d’un document préliminaire sans comité de lecture («non-peer reviewed pre-print») apporte des informations supplémentaires sur le mélange et l’association des vaccins AstraZeneca et Pfizer. Ces données préliminaires portent sur 26 personnes, âgées de 25 à 46 ans, qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca, suivie d’une seconde dose de Pfizer huit semaines plus tard. L’activité neutralisante était 3,9 fois plus importante contre le variant Alpha (B.1.1.7) et similaire contre le variant Delta (B.1.617.2) par rapport à l’activité neutralisante observée chez les personnes ayant reçu deux doses du vaccin Pfizer. Aucun problème de santé n’a été noté. Enfin, une petite étude canadienne à l’Université Dalhousie a été réalisée auprès de deux volontaires âgés de 66 ans, à qui on a administré une première dose de vaccin AstraZeneca suivie d’une seconde dose de vaccin Pfizer, 33 jours plus tard. Les réponses immunitaires ont été rapportées comme étant fortes, sans aucun problème de santé. Risque de TTIV avec une deuxième dose d’AstraZeneca Le risque de TTIV avec une seconde dose d’AstraZeneca pour les personnes ayant reçu une première dose de ce vaccin est très faible. Les meilleures données actuellement disponibles sont celles de surveillance du Royaume-Uni. Au 27 mai, 17 cas de TTIV avaient été signalés après l’administration de 10,7 millions de secondes doses du vaccin AstraZeneca, soit un risque d’environ 1 sur 600 000.
Le maire de Toronto, John Tory, reçoit une dose du vaccin d’AstraZeneca de la pharmacienne Niloo Saiy dans une pharmacie de Toronto, le 10 avril. La Presse Canadienne/Cole Burston Donc, quel est le meilleur choix? La disponibilité actuelle et prévue des deux vaccins à ARNm au Canada est excellente, avec des approvisionnements constants prévus durant les mois de juin et de juillet. Cela signifie que, dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire d’attendre l’option que l’on préfère. J’ai eu la chance de recevoir deux doses du vaccin contre la Covid-19 au début de 2021, je n’ai donc pas à prendre de décision pour moi-même. Cependant, de nombreuses personnes m’ont demandé des conseils à ce sujet au nom de leurs proches, de leurs amis et d’eux-mêmes. Bien que les données ne soient pas définitives, les preuves s’accumulent en faveur d’une approche de mélange et d’association avec AstraZeneca suivi de Pfizer, qui est au moins aussi bonne (sinon meilleure) que l’administration de
deux doses du même vaccin. Il n’y a pas de risque inhérent au mélange de vaccins, et aucun problème de santé n’a été constaté jusqu’à présent. De plus, en prenant un vaccin à ARNm, on évite complètement le risque de TTIV. Même si ce risque est très faible, la TTIV est grave et potentiellement mortelle. Pour ces raisons, je pense que s’il est accessible, une deuxième dose de vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) est préférable pour la plupart des gens qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca. Le cas d’AstraZeneca Certains préfèrent l’approche éprouvée consistant à recevoir deux doses du vaccin AstraZeneca. La Presse Canadienne/Paul Chiasson Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne pourrait choisir AstraZeneca plutôt qu’un vaccin à ARNm pour sa deuxième dose. Il n’existe pas de données sur l’efficacité clinique du mélange de vaccins. Pour cette raison, certaines
personnes peuvent préférer une approche « éprouvée » consistant à recevoir deux doses d’AstraZeneca. D’autres, qui n’ont pas ressenti d’effets indésirables avec leur première dose d’AstraZeneca, peuvent opter pour une deuxième dose du même vaccin afin d’éviter les effets secondaires. L’étude COM-CoV menée au Royaume-Uni présentera des données sur l’immunogénicité (réponse des anticorps) dans le courant du mois. Ces données peuvent ou non être favorables à une approche de mélange. Certains préféreront peut-être attendre ces données avant de prendre une décision. D’autres se contenteront de prendre le vaccin qui leur est proposé en premier. Quelle que soit la décision que l’on prenne, l’essentiel est que chacun reçoive une deuxième dose dès qu’il est éligible, qu’il s’agisse du vaccin AstraZeneca ou d’un vaccin à ARNm. Les données disponibles permettent d’affirmer que les deux options sont sûres et efficaces, il n’y a donc pas de «mauvais» choix. Une vaccination complète offre une protection optimale contre les souches actuelles et émergentes, y compris le variant Delta. Au Canada, nous avons la chance de pouvoir choisir entre deux excellentes options pour nos deuxièmes doses. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les stocks de vaccins non utilisés ne soient pas gaspillés, et nous devons faire beaucoup plus pour soutenir l’équité mondiale en matière de vaccins afin de contribuer à mettre fin à la pandémie de Covid-19 dans le monde. Je vous en prie, allez vous faire vacciner pour vous-même et pour votre communauté! Alexander Wong, Associate Professor, Infectious Diseases, University of Saskatchewan Texte publié initialement en anglais dans The Conversation
Le Montarvillois,lLe journal hyperlocal de Saint-Bruno-de- Montarville Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois Déconfinement: Une liberté retrouvée pour les Montarvillois et la population du Québec Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé hier les grandes étapes du déconfinement qui s’amorcera à partir du 28 mai prochain et qui permettra à la population de Saint-Bruno-de-Montarville et du Québec de retrouver bientôt une vie plus normale. Plusieurs mesures seront ainsi allégées graduellement au cours des prochaines semaines, dans l’ensemble des régions du Québec, selon un échéancier qui a été établi en fonction des projections de la situation épidémiologique et de la progression de la vaccination. Il est à noter que les allègements prévus ne seront toutefois pas appliqués dans les territoires visés par des mesures spéciales d’urgence.
Assouplissements è Saint-Bruno et partout au
Québec à partir du 28 mai
Dès le 28 mai :
le couvre-feu sera levé en Montérégie et dans l’ensemble
des régions du Québec;
les rassemblements seront permis sur les terrains privés
extérieurs (maximum de 8 personnes de résidences
différentes ou occupants de 2 résidences, avec
distanciation);
les terrasses extérieures des restaurants de Saint-Bruno-de-Montarville et de l’ensemble des municipalités
du Québec pourront de nouveau accueillir la clientèle
(en zones rouge et orange : deux personnes seules avec
enfants mineurs ou occupants d’une même résidence; en
zone jaune, occupants de deux résidences);
les déplacements entre les régions seront permis;
les grandes salles et les stades extérieurs pourront
accueillir un maximum de 2,500 personnes en plusieurs
zones indépendantes de 250 personnes.
Ensuite, dès le 11 juin, les bars pourront à leur tour ouvrir
leurs terrasses extérieures (avec les mêmes restrictions que
les restaurants) et les activités extérieures supervisées de
sports et de loisirs seront permises en groupes de
25 personnes, maximum.
Enfin, à partir du 25 juin, les personnes complètement
vaccinées pourront se rencontrer dans les résidences privées,
sans masque et sans distanciation. Aussi, les camps de jour et
les camps de vacances rouvriront et les festivals et autres
activités extérieures pourront reprendre avec un maximum de 2
500 personnes. Sur ce dernier point, le détail des mesures
exigées pour de tels événements sera rendu public plus tard
cette semaine.
«Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, allez vous faire
vacciner! Vacciné, ça rime avec bel été et avec petits
partys!» François Legault, premier ministre du Québec
Pour la fin du mois d’août, le premier ministre a mentionné
que «si on atteint notre objectif de 75% de la population de
12 ans et plus complètement vaccinée, dans plusieurs lieux
publics, on ne devra plus porter de masque et les cégeps et
les universités ouvriront en présentiel».
Port du masque ou du couvre-visage
Le port du couvre-visage ou du masque a démontré sonefficacité afin de limiter les risques de transmission du virus. À compter du 25 juin, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les personnes complètement vaccinées qui prendront part à des rassemblements privés. Dès la fin août, ce sera également le cas pour plusieurs lieux ou événements publics. Plus de 60% des adultes vaccinés en Montérégie-Est D’autre part le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annonceé que le seuil de 60% de couverture vaccinale a été atteint, lundi, sur son territoire. Ce sont donc plus de six personnes de 18 ans et plus sur dix qui ont reçu une première dose de vaccins contre la COVID-19 et, à ce jour, plus de 271,000 doses de vaccins ont été administrées. En comparaison, 50,5% des adultes de la province sont vaccinés. Le CISSS de la Montérégie-Est poursuit sa vaste opération dans les huit sites de vaccination de son territoire. Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne sur www.quebec.ca/vaccinCOVID ou encore en composant le 1-877-644-4545. Le Montarvillois, le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de- Montarville Source: communiqués du Gouvernement du Québec et du CISSS Montérégie-Est Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à
aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois 50% de couverture vaccinale en Montérégie-Est & Vaccination des jeunes de 12 à 17 ans & Passeport vaccinal Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé que le seuil de 50% de couverture vaccinale a été atteint, vendredi dernier, sur son territoire. La majorité des personnes de 18 ans et plus ont ainsi reçu une première dose de vaccins contre la COVID-19 et, à ce jour, plus de 221,000 doses de vaccins ont été administrées. Vaccination des 18 ans plus Depuis le 30 avril, la prise de rendez-vous s’est déployés, de façon graduelle, selon les groupes d’âge. L’objectif est d’ouvrir la vaccination à tous d’ici le 14 mai.
Des livraisons importantes confirmées de doses de vaccin sont
prévues au cours des prochaines semaines et permettront
d’amorcer la vaccination de la population générale. Le nombre
total de doses prévues est de 2,517,080, ventilé de la façon
suivante:
594 770 doses au cours de la semaine du 3 mai ;
458 640 doses au cours de la semaine du 10 mai ;
458 640 doses au cours de la semaine du 17 mai ;
458 640 doses au cours de la semaine du 24 mai ;
546 390 doses au cours de la semaine du 31 mai.
J’encourage les clientèles visées à prendre rendez-vouspuisque le vaccin est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications. » – Nathalie Chénier, directrice de la vaccination, CISSS de la Montérégie-Est. Il sera possible pour les adultes de 18 ans et plus de se faire vacciner à la clinique Marcel-Dulude de Saint-Bruno-de- Montarvilles ou à une autre des cliniques de la Montérégie. La façon la plus simple de prendre rendez-vous, c’est de se rendre sur le site web à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID. Les gens qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien. Vaccination des jeunes de 12 à 17 ans D’autre part le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que le Québec travaille sur la possibilité de vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. Santé Canada a déjà donné mercredi son aval à l’administration du vaccin de Pfizer-BioNTech chez les jeunes de 12 à 15 ans. De son coté, le ministère de la Santé et des Services sociaux attend l’avis du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) sur la vaccination des 12 à 17 avant de débuter cette vaccination. En parallèle, les travaux sont déjà en cours concernant l’échéancier et la logistique, en collaboration avec le ministère de l’Éducation. Passeport vaccinal dès le 13 mai Le ministre Dubé a également annoncé les premiers détails concernant la preuve de vaccination électronique contre la COVID-19. Cette preuve, qui se présentera sous la forme d’un code QR, sera disponible à compter du 13 mai et pourra être fournie par courriel ou par texto. Ainsi, les personnes qui ont déjà reçu une dose ou qui iront se faire vacciner à compter du 13 mai vont recevoir un courriel ou un texto
demandant s’ils veulent obtenir la preuve électronique. Une preuve papier continuera tout de même d’être fournie dans les cliniques après la vaccination. La Santé publique poursuit ses travaux intensifs sur l’utilisation potentielle de la preuve de vaccination électronique et fera ensuite une recommandation au gouvernement du Québec. Le Montarvillois Le journal hyperlocal de Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Bruno-de-Montarville d’hier à aujourd’hui, le plus important groupe Facebook exclusivement dédié aux Montarvillois Sources: Communiqués du CISSS M-E et Ministère de la Santé et des Services sociaux COVID-19: Pas d’effets secondaires après le vaccin? Pas de problèmes! Veenu Manoharan
La plupart des vaccins ont des effets secondaires et ceux contre la Covid-19 ne font pas exception. Bien des gens se sentent rassurés s’ils ont mal au bras à l’endroit où ils ont reçu l’injection, s’ils sont fatigués, ont mal à la tête, de la fièvre ou des nausées. Ce ne sont là que des signes que leur système immunitaire fonctionne comme il le devrait. À l’inverse, l’absence d’effets secondaires peut inquiéter: mon système immunitaire ne semble pas faire ce qu’il est censé faire… cela signifie-t-il qu’il n’est pas apte à me protéger? Rassurez-vous, cela ne signifie rien de tel. Les essais cliniques du vaccin menés par Pfizer montrent que la moitié des participants n’ont pas ressenti d’effets secondaires importants pendant l’essai, alors que 90 % d’entre eux ont développé une immunité contre le virus. Et les recommandations qui suivent l’injection du vaccin Moderna indiquent que des effets secondaires courants peuvent être ressentis par une personne sur dix, alors que le vaccin protège 95 % des personnes qui le prennent. Ces différences dans les réactions peuvent s’expliquer en considérant la manière dont le système immunitaire développe une immunité protectrice contre les virus lorsqu’il est déclenché par un vaccin. La plupart des vaccins contre la Covid-19 utilisent une protéine virale présente sur l’enveloppe extérieure du coronavirus, appelée protéine spike, pour imiter une infection virale naturelle et déclencher une réponse immunitaire. La branche de la réponse immunitaire connue sous le nom d’immunité innée réagit presque immédiatement à la protéine spike virale. Elle lance une attaque contre elle en initiant une inflammation, dont les signes caractéristiques sont la fièvre et la douleur. C’est donc la réponse immunitaire innée qui provoque les effets secondaires courants que les gens ressentent un jour ou deux après avoir été vaccinés.https://www.youtube.com/embed/k9QAyP3bYmc?wmode=trans
parent&start=0L’immunité innée et adaptative expliquée. Une immunité spécifique durable, qui est le but ultime de toute vaccination, n’est obtenue qu’en activant la deuxième branche de la réponse immunitaire : l’immunité adaptative. L’immunité adaptative est déclenchée à l’aide des composants de l’immunité innée et se traduit par la production de lymphocytes T et d’anticorps, qui protègent contre l’infection lors d’une exposition ultérieure au virus. Contrairement à l’immunité innée, l’immunité adaptative ne peut pas déclencher d’inflammation, bien que des études récentes suggèrent qu’elle peut y contribuer de manière significative. Chez certaines personnes, la réponse inflammatoire des systèmes immunitaires inné et adaptatif est exagérée et se manifeste comme un effet secondaire. Chez d’autres, bien qu’elle fonctionne normalement, elle n’atteint pas des niveaux qui pourraient provoquer des effets secondaires notables. Dans tous les cas, l’immunité contre le virus est établie. L’immunité innée et adaptative expliquée. Qu’est-ce qui cause une réponse immunitaire différente ? Les scientifiques ont remarqué que les personnes âgées de plus de 65 ans présentent moins d’effets secondaires au vaccin. Cela peut être attribué au déclin progressif de l’activité immunitaire lié à l’âge. Bien que ce phénomène puisse être en lien avec une baisse du taux d’anticorps, les personnes concernées conservent une immunité contre le virus. Hommes et femmes ne réagissent pas de la même manière. Dans une étude américaine, 79 % des rapports sur les effets secondaires provenaient de femmes. Ce déséquilibre entre les sexes pourrait avoir un rapport avec la testostérone. Elle a tendance à atténuer l’inflammation et donc les effets secondaires qui y sont associés. Les hommes ont davantage de
Vous pouvez aussi lire