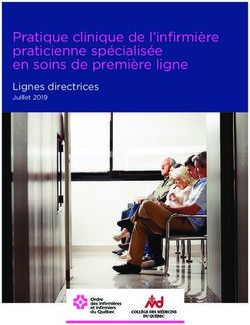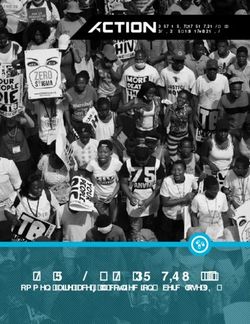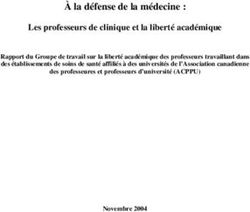VEILLE LEGISLATIVE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE DU 20 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2018 - Conseil ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
VEILLE LEGISLATIVE, POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE
DU 20 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2018
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 1I – POLITIQUE DE SANTE DU GOUVERNEMENT
Présentation de la stratégie de transformation du système de santé par le Président de la République
Le 18 septembre dernier, tous les acteurs du monde de la santé étaient réunis à l’Elysée autour d’Emmanuel Macron, Président de la République. En présence
d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, et de nombreux parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Président de la République a présenté
les principales mesures de la stratégie de transformation du système de santé.
Cette stratégie, intitulée « Ma Santé 2022 », est le résultat de travaux de concertation initiés en février 2018 par le Ministère des Solidarités et de la Santé, et
auxquels le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a participé et contribué dans le cadre de plusieurs groupes de travail.
Agnès Buzyn avait alors confié à douze pilotes les cinq chantiers prioritaires pour engager une transformation du système de santé :
Qualité des soins et pertinence des actes,
Organisation territoriale,
Modes de financement et de régulation,
Ressources humaines et formation,
Numérique.
Ces travaux de consultation, de diagnostic et d’échanges entre les acteurs du système de santé ont permis de dégager une liste de 54 mesures regroupées en trois
grands axes :
Favoriser la qualité et replacer le patient au cœur du soin,
Créer un collectif de soins au service des patients,
Adapter les métiers et les formations aux enjeux de la santé de demain.
Suppression du numerus clausus pour la rentrée 2020-2021
Parmi les principales mesures annoncées par le Président de la République, le numerus clausus imposé aux filières de médecine, pharmacie, maïeutique et
odontologie et le concours d'accès en fin de première année seront supprimés à compter de l'année universitaire 2020-2021. L'objectif de la réforme « vise à
mettre en place une orientation progressive et à créer des passerelles entre les différentes formations », afin d'assurer « un exercice décloisonné entre établissements
de santé, structures ambulatoires et médico-sociales ».
Parallèlement, à compter de 2019, le concours d'accès aux instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) sera supprimé, et le recrutement dans les filières de
formations paramédicales s'effectuera à travers la plateforme de vœux ParcoursSup, conformément à ce que le gouvernement a annoncé en juillet dernier.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 2Libérer du temps médical et améliorer l’accès aux soins
La stratégie « Ma Santé 2022 » prévoit en outre de créer 4000 postes d’assistant médical, chargés d’accompagner le travail du médecin dans les cabinets issus de
regroupements de praticiens, et le décharger d’actes simples, comme la préparation d'une consultation, le suivi des rendez-vous, des tâches administratives de
gestion et de coordination.
La télémédecine, reconnue comme un acte médical de droit commun, sera également encouragée avec la définition de cibles prioritaires et l’association d’autres
professionnels de santé dans les territoires.
Améliorer l’organisation des soins de proximité
Afin de favoriser l'exercice collectif, le Gouvernement souhaite favoriser les professionnels qui adhèrent aux communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS). Le Président de la République a ainsi fixé comme objectif la fin de l’exercice isolé d’ici 2022 par la constitution de ces CPTS qui seront chargées de faire le
pont avec les établissements de santé, notamment les hôpitaux de proximité, et avec le secteur médico-social.
L'objectif est de déployer au moins 1000 CPTS d'ici 2022. L'idée est d'engager tous les professionnels de santé d'un territoire dans une "responsabilité
populationnelle" pour qu'ils assument ensemble un certain nombre de missions à garantir à la population.
Par ailleurs, l’exécutif entend proposer la labellisation dès 2020 des premiers « Hôpitaux de proximité », avec l’objectif de reconnaissance de 500 à 600
établissements. Ces derniers assureront des missions hospitalières de proximité, en médecine polyvalente, soins aux personnes âgées, soins de suite et de
réadaptation, consultations de spécialités, consultations non programmées. Ils devront disposer d’un plateau technique de biologie et d’imagerie, d’équipes mobiles
et d’équipements en télémédecine.
Mise en œuvre des 54 mesures : plusieurs chantiers et une loi en 2019
Si certaines mesures de « Ma Santé 2022 » seront inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, un projet de loi sera
nécessaire au cours de l’année 2019 afin d’adopter d'autres propositions, notamment concernant la réforme des études de santé.
De manière concrète, la déclinaison de ces 54 mesures a été confiée à la Direction générale de l’Offre de Soins (DGOS), rattachée au Ministère des Solidarités et de
la Santé.
Le pilotage sera structuré autour de dix chantiers avec, pour chacun, un ou plusieurs pilotes appartenant à la DGOS ou à d'autres directions ministérielles, ou à
l'Assurance maladie.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 3Plusieurs chantiers intéressent particulièrement l’Ordre des sages-femmes et la profession : la qualité et la pertinence des soins, la réforme du financement et des
formations en santé, le numérique et l’évolution des conditions d’exercice.
Enfin, un chantier est transversal puisqu'il est relatif à la préparation d'un projet de loi sur la stratégie de transformation du système de santé.
S’agissant du calendrier, après un temps national prévu au dernier trimestre 2018 pour le déploiement des chantiers et la concrétisation des annonces prioritaires,
un travail de déploiement régional des premières mesures de la stratégie devrait avoir lieu au début de l’année 2019.
Le calendrier législatif relatif à la future loi de santé reste cependant à préciser.
>>> Pour consulter la liste des 54 mesures :
https://www.apmnews.com/documents/201809191626030.MaSante2022_liste54mesures.pdf
>>> Et les rapports finaux :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-transformation-du-systeme
PLFSS 2019 : plusieurs mesures en faveur de la prévention des jeunes et des indépendantes
Les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ont été présentées le 25 septembre dernier par Agnès Buzyn, Ministère
des Solidarités et de la Santé, et Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics, à l'issue de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité
sociale (CCSS).
L'avant-projet compte 58 articles.
Les ministres Buzyn et Darmanin devraient présenter le texte lors d'un conseil des ministres décalé au lundi 8 octobre, avant d'être auditionnés dès le lendemain
par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a jusqu'au lundi 15 octobre pour déposer le PLFSS devant le Parlement.
La procédure parlementaire
L'examen des amendements en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale aura lieu du mardi 16 au jeudi 18 octobre, avant le début de la discussion
en séance publique entre le mardi 23 et le vendredi 26 octobre, avec un vote solennel mardi 30 octobre.
Au Sénat, la discussion devrait se dérouler du lundi 12 au samedi 17 novembre avec un vote solennel prévu mardi 20 novembre en première lecture, avant une
navette entre les deux chambres et une adoption définitive par le Parlement début décembre.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 4Des mesures en faveur de la prévention des jeunes
Plusieurs mesures destinées à améliorer les actions de prévention chez les enfants et les jeunes sont prévues dans le cadre du PLFSS.
Le gouvernement souhaite traduire à travers le projet de loi quelques-unes des 10 mesures du volet "prévention" de la stratégie nationale de santé (SNS) 2018-
2022, annoncées le 26 mars, concernant la santé des enfants et des jeunes.
Ainsi, le PLFSS prévoit de "redéployer les 20 examens obligatoires, aujourd’hui tous réalisés avant les 6 ans, pour couvrir également l’adolescence, comme le
recommande le Haut conseil de la santé publique" (HCSP).
Le gouvernement veut instaurer ces examens pour plusieurs tranches d'âge (8-9 ans, 11-13 ans et 15-16 ans), avec un contenu adapté aux besoins des jeunes et une
prise en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais.
Parmi les autres mesures de prévention, le PLFSS prévoit la généralisation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens pour la campagne 2019-2020.
Aujourd'hui expérimentée dans 2 régions, elle a été étendue à 2 régions supplémentaires pour la campagne 2018-2019.
La prolongation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes
Actuellement, les travailleuses indépendantes bénéficient d’une allocation forfaitaire ainsi que d’indemnités journalières forfaitaires versées jusqu'à 74 jours sous
condition d'un arrêt de travail effectif de 44 jours.
Les salariées bénéficient quant à elles d'un congé maternité de 112 jours.
Dans un objectif de protection de la santé de la mère et de son enfant, le PLFSS pour 2019 prévoit de porter la durée minimale d’arrêt en cas de grossesse à 8
semaines pour toutes les femmes.
De plus, la durée du congé maternité des indépendantes sera portée à 112 jours, comme pour les salariées. Les indépendantes pourront ainsi bénéficier de 38
jours de congés indemnisés supplémentaires.
! ATTENTION ! Ces dispositions ne sont pas encore adoptées, ni effectives. Elles ne pourront s’appliquer qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire
à partir du 1er janvier 2019.
>>> Pour consulter le dossier de presse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/182509_-_dp_-_plfss_2019.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 5Révision de la loi relative à la bioéthique : les principales propositions du CCNE
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu, le 25 septembre dernier, son avis sur les thématiques abordées lors des Etats généraux de la bioéthique,
en vue de la révision de la loi relative à la bioéthique.
Procréation
Dans son avis de 163 pages, présenté lors d'une conférence de presse, le CCNE se déclare favorable à l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP)
aux couples de femmes et aux femmes seules, tout en maintenant l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA).
Il est également pour l’autorisation d’une autoconservation ovocytaire "de précaution" après avis médical et avec des restrictions d’âge, sans que cette possibilité
soit cependant encouragée.
La levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme doit être rendue possible, estime le comité, en respectant le choix du donneur.
Il approuve également le transfert d’embryons post-mortem.
Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
Le CCNE considère justifiée l’autorisation de recherche sur les embryons surnuméraires, y compris avec des modifications génétiques, à condition du non-transfert
de l’embryon.
Il propose de ne plus soumettre la recherche sur l’embryon et celle sur les lignées de cellules souches embryonnaires au même régime juridique, les enjeux éthiques
associés étant différents.
Il souhaite que le nouvel encadrement législatif afférent à la recherche sur l’embryon soit précisé et clarifié sur la création d’embryons transgéniques, la création
d’embryons chimériques et la limite temporelle au temps de culture de l’embryon.
Examens génétiques et médecine génomique
Le CCNE propose que toute personne en âge de procréer puisse avoir accès au diagnostic génétique préconceptionnel, après une consultation spécialisée.
Il est également favorable à la recherche d’aneuploïdies pour les couples ayant recours au diagnostic pré-implantatoire (DPI) d'une maladie génétique.
Il appelle à une nouvelle définition du diagnostic prénatal (DPN), en accord avec les pratiques et possibilités thérapeutiques développées récemment.
Il considère souhaitable d’élargir le dépistage néonatal aux déficits immunitaires héréditaires.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 6Dons et transplantations d’organes
Le CCNE appelle à ce que soient résorbées les inégalités régionales actuelles au niveau de l’offre de greffons, notamment par la réduction des écarts en matière
d’inscription par les équipes soignantes -parfois précoce, parfois tardive- de leurs patients sur liste d’attente de greffe.
Il propose d’intensifier l’information sur l’existence d’un protocole national pour les prélèvements Maastricht III, jugeant "essentiel d’apporter de la clarté aux
familles à propos des décisions d’arrêts des soins, afin de leur garantir qu’elles ne sont pas motivées par l’opportunité d’un prélèvement d'organes".
Pour les greffes à partir de donneurs vivants, il insiste sur l'importance d’une grande vigilance des professionnels encadrant la procédure de recueil du consentement
du donneur à l’égard des pressions intrafamiliales en faveur du don.
Il souhaite une évolution de la législation sur les dons de reins croisés, afin d’autoriser la mise en place de chaînes de donneurs.
Il propose également la création d’un statut de donneur.
Numérique et santé
La diffusion du numérique en santé est considérée comme prioritaire par le CCNE, qui souhaite que le recours au droit opposable soit actuellement "circonscrit au
maximum", tout en proposant d’engager une réflexion sur la création d’instruments de régulation de type "droit souple".
Il suggère l’inscription au niveau législatif du principe fondamental d’une garantie humaine du numérique en santé, c’est-à-dire la garantie d’une supervision humaine
de toute utilisation du numérique en santé.
Il propose également une plateforme nationale sécurisée de collecte et de traitement des données de santé.
Santé et environnement, neurosciences
Au chapitre santé et environnement, le CCNE appelle à des réflexions interdisciplinaires permettant de mieux soutenir les décisions politiques et recommande que
les entreprises présentent chaque année un document éthique.
Sur le thème des neurosciences, il demeure "très défavorable" à l’utilisation de l’IRM fonctionnelle dans le domaine judiciaire et déconseille l’emploi de l’IRM
fonctionnelle dans les applications "sociétales" telles que le neuro-marketing ainsi que dans le cadre de la sélection à l’embauche ou des pratiques assurantielles.
Il souhaite qu’une plus grande information autour des techniques de neuro-amélioration concernant des dispositifs non médicaux soit délivrée à la population.
>>> Pour consulter l’avis du CCNE : http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/avis_129_vf.pdf
>>> Et le résumé : http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne_avis_129_resume.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 7Remise du rapport sur « l’amélioration de l’information des usagers et des professionnels de santé sur le médicament »
Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, a reçu le 3 septembre dernier le rapport de la « mission information et médicament » mise en place le 1er
décembre 2017 et présidée par Magali LEO (responsable du plaidoyer de l’Association Renaloo) et Gérald KIERZEK (praticien hospitalier et chroniqueur santé).
Elle réaffirme sa volonté d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’information sur le médicament en mettant en œuvre les mesures suivantes :
Mettre en place une source unique d’information publique sur le médicament en s’appuyant sur sante.fr, le service public d’information en santé, et en y
intégrant la base de données publiques des médicaments et les informations du site medicaments.gouv.fr ;
Optimiser et faciliter la coordination des soins entre les prescripteurs et les pharmacies d’officine en améliorant l’information faite au grand public sur
l’existence et l’intérêt des dossiers santé dématérialisés (dossier pharmaceutique, dossier Médical Partagé) ;
Le Dossier Médical Partagé (DMP) sera généralisé par l’Assurance maladie sur l’ensemble du territoire national à compter d’octobre 2018.
Confier la communication d’urgence en cas d’alerte portant sur un médicament à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) qui s’appuie sur le centre d’appui aux situations d’urgence, aux alertes sanitaires et à la gestion des risques (CASAR) mis en place fin 2017 ;
Encourager les remontées d’information de patients et de professionnels de santé par l’élaboration dès 2018 d’une stratégie de promotion de la
déclaration des événements indésirables et le développement des technologies permettant de repérer des signaux faibles d’alerte en dehors du système de
pharmacovigilance ;
Assurer une mobilisation rapide des professionnels de santé en cas d’alerte en étendant progressivement l’outil d’alerte DGS-Urgent à l’ensemble des
professionnels de santé exerçant dans le secteur libéral ;
Renforcer la transparence de l’information en permettant une représentation des usagers au sein du Comité économique des produits de santé (CEPS).
>>> Pour lire le rapport : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180903_-_mim_rapport.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 8Lancement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Emmanuel Macron, Président de la République, a présenté le 13 septembre dernier la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Les 5 engagements de la stratégie pauvreté :
Engagement n° 1 : L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté
Parmi les mesures prévues par cet engagement :
Développer les modes d’accueil de la petite enfance, notamment dans les territoires fragiles avec la création d’un bonus « territoires » permettant de
diminuer à moins de 10% le reste à charge des communes,
300 crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) créées d’ici 2020,
Rénover la politique de soutien à la parentalité et créer 300 nouveaux centres sociaux dans les territoires prioritaires.
Engagement n° 2 : Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants
Citons notamment la mesure suivante :
Renforcer les missions des PMI sur l’accès à la santé et l’appui de la médecine de ville aux missions de la santé scolaire, dans le cadre du parcours de
santé des enfants de 0 à 6 ans
Engagement n° 3 : Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes
Engagement n° 4 : Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité
Engagement n° 5 : Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
>>> Pour consulter le dossier de presse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_strategie_v26_pages.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 9Matignon lance une mission sur les arrêts maladie
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a missionné, le 5 septembre dernier, le directeur des ressources humaines du groupe industriel Safran, Jean-Luc Bérard et le
magistrat à la Cour des comptes Stéphane Seiller pour faire “un diagnostic” sur l’augmentation des arrêts maladie et proposer des pistes « d’évolutions ».
Une décision qui fait suite à plusieurs réunions du Premier ministre avec les partenaires sociaux ces derniers jours, au cours desquelles le chef du gouvernement a
rappelé “le caractère insatisfaisant du système actuel” et indiqué qu’il entendait “engager une démarche de concertation avec les partenaires sociaux, ainsi que
l’ensemble des acteurs concernés, notamment professionnels de santé, médecins et organismes d’assurance maladie”, a expliqué son entourage.
La mission confiée à Jean-Luc Bérard et Stéphane Seiller doit ainsi notamment “proposer un certain nombre d’évolutions” afin de faire face à l’augmentation de
près de 4 % par an des arrêts maladie, notamment de courte durée.
Un point d’étape avec “des premiers éléments de diagnostic” et de “premières orientations” sera fait fin octobre, a-t-il été précisé.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 10II – ACTUALITE LEGISLATIVE
Assemblée nationale : La commission d'enquête sur l'égal accès aux soins dévoile ses propositions
Vingt-sept. C'est le nombre de propositions rédigées par la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins de l'Assemblée nationale. Le rapport, public depuis le
25 juillet, contient plusieurs propositions visant à améliorer l’accès aux soins et remédier à la désertification médicale.
Pour rappel, le CNOSF avait été auditionné conjointement avec les Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens le 19 avril dernier.
NB : La démographie des sages-femmes est présentée comme étant « très dynamique » (p. 82).
La commission souhaite notamment "recenser toutes les compétences dont disposent les sages-femmes, pharmaciens et auxiliaires médicaux et qui ne peuvent
pas être exercées pour des raisons juridiques ou financières", pour leur permettre "de participer davantage à la chaîne des soins" (Proposition n° 8).
Le rapport ajoute (p. 107) : « D’importantes extensions de compétences devraient également être envisagées pour les sages-femmes, dans la continuité de la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : leur compétence pourrait ainsi être étendue à l’IVG instrumentale, et, selon Mme
Anne-Marie Curat, présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, au suivi des couples et non plus des seules femmes « pour la surveillance des
infections sexuellement transmissibles (IST), le suivi tabacologique, la surveillance vaccinale ».
Permettre aux pharmaciens de vacciner, renouveler certains traitements ou encore prescrire des substituts nicotiniques figurent aussi parmi les propositions.
Les infirmiers pourraient quant à eux, "sous certains cas et sous certaines conditions", disposer du droit de prescription, vaccination et adaptation de certains
traitements.
Il est aussi proposé la création de la pratique avancée, en place désormais pour les infirmiers, à d'autres professions telles que les kinésithérapeutes.
À noter toutefois, les trente députés qui composent la commission d'enquête ne sont pas parvenus au consensus. Le rapporteur Philippe Vigier (UDI, Agir et
indépendants, Eure-et-Loir) a donc aussi présenté, le 19 juillet, 3 propositions plus personnelles :
Supprimer les ARS en les remplaçant par des directions départementales de la santé publique, sous l'autorité du préfet ;
Revaloriser le tarif de consultation chez l'ensemble des généralistes établis en zone sous-denses pour le porter de 25 à 35 euros ;
Mettre en place le conventionnement sélectif pour ces professionnels.
>>> Pour consulter le rapport de la mission d’information :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r1185-t1.pdf
>>> Et les comptes rendus des auditions (audition du CNOSF des pages 7 à 29) :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r1185-t2.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 11Prévention santé en faveur des jeunes : des députés suggèrent de nommer un délégué interministériel
Les députés Ericka Bareigts (PS, La Réunion) et Cyrille Isaac-Sibille (Modem, Rhône) ont présenté, le 12 septembre dernier, une série de mesures destinées à
améliorer la prévention santé en faveur des jeunes, et suggèrent notamment de nommer un délégué interministériel en charge de coordonner les politiques
publiques en ce sens.
Ce rapport d'information vient conclure les travaux de la mission lancée en février dernier, au cours de laquelle ils ont procédé à une cinquantaine d'auditions.
Dans les trois premières parties du rapport, les deux députés dressent un état des lieux très critique des politiques de prévention en matière de santé à destination
des jeunes, pointant de fortes inégalités sociales et territoriales d'une part, et une multiplicité d'acteurs peu coordonnés et dotés de moyens insuffisants d'autre
part, pour déployer des actions qui ne sont pas toutes évaluées.
Les quatrième et cinquième parties du rapport sont respectivement consacrées à leurs propositions d'amélioration et à une feuille de route en ce sens, suivant trois
grands axes. Ils ont précisé qu'ils porteraient certaines de ces propositions lors de l'examen des lois budgétaires à l'automne.
Pour Cyrille Isaac-Sibille, il faut :
Assurer un véritable "portage politique" de la politique de prévention,
Améliorer l'efficacité et l'influence des structures existantes plutôt que d'en créer de nouvelles,
Décloisonner les secteurs sanitaire, socio-sanitaire et éducatif, tout en érigeant la politique de prévention parmi les priorités.
Avec Ericka Bareigts, ils ont fait valoir que l'impact croissant du vieillissement et des maladies chroniques rendaient nécessaire un rééquilibrage des moyens entre
les soins et la prévention, faute de quoi le système de protection sociale risquait l'implosion à moyen terme.
Ils suggèrent la mise en place d'une gouvernance clarifiée, d'abord au niveau national par la mise en place d'une "délégation interministérielle à la prévention,
responsable de l’application de la politique de prévention et de la stratégie nationale de santé (SNS)".
Au niveau régional, ils préconisent de faire de la direction de la santé publique "la direction pivot des ARS [agences régionales de santé]", et s'appuyer sur la
commission de coordination des politiques publiques de santé (CCPPS) qui réunit l'ensemble des acteurs concernés à l'échelon régional.
Au niveau local, les députés appellent à rassembler les acteurs de prévention de première ligne (professionnels, associations, collectivités) autour des contrats
locaux de santé (CLS) et des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Ils appellent par ailleurs à l'introduction systématique d'un volet "santé" dans la préparation des projets de loi, des schémas et plans nationaux, régionaux ou
locaux.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 12Sur le plan opérationnel, ils proposent la mise en place d'"actions précoces et ciblées s’inscrivant dans le cadre d’un universalisme proportionné, dirigées vers les
déterminants de santé plutôt que vers les pathologies, et intervenant le plus précocement possible".
Ils suggèrent ainsi un renforcement du parcours éducatif de santé (induisant une formation accrue des enseignants), la conduite d'actions dans les bassins de vie
pour promouvoir un environnement de santé favorable (alimentation, activité physique, environnement), le développement d'un portail national des interventions
évaluées de prévention et le renforcement de la protection des jeunes (application stricte des interdits et encadrement du marketing des industriels).
Ils invitent par ailleurs à "assurer le suivi individuel de chaque famille et enfant" par la mise en place de 5 rendez-vous médicaux obligatoires de prévention (à 8
jours, 9 mois, 3 ans, 6 ans et à 12 ans), inciter à la création d'un dossier médical partagé (DMP) dès la naissance, et instaurer une consultation de prévention pour
les médecins et chirurgiens-dentistes pour les enfants de 6 ans. Sa valeur pourrait être portée à 50 €, a observé Cyrille Isaac-Sibille.
Ils ont plaidé pour donner davantage de moyens aux services de la protection maternelle et infantile (PMI) et à la médecine scolaire, "aujourd’hui en grande
difficulté", tout en dressant un "bilan étayé" de leur situation, en "renforçant l’attractivité des postes de médecins" qui y travaillent, et en demandant davantage de
comptes aux conseils départementaux qui en dépendent, afin de résorber l'hétérogénéité des pratiques et des compétences déléguées.
Ils proposent aussi d'unifier les systèmes de recueil des données de santé, notant que le système national des données de santé (SNDS) n'était pas chaîné avec les
données recueillies par la médecine scolaire et les services de PMI.
S'agissant du financement, ils proposent notamment de d'instaurer un document de politique transversale (DPT ou "jaune budgétaire"), annexé chaque année au
projet de loi de finances (PLF)" retraçant l'ensemble des financements publics et privés en faveur de la prévention.
Ils ont souligné la faiblesse des montants publics consacrés à la prévention en France, et que la DREES évaluait à 5,8 milliards € en 2017.
Ils proposent de flécher une partie des produits des "taxes comportementales" vers le financement des actions de prévention et de la promotion de la santé, et
d'encourager les financements privés de la politique de prévention (mutuelles, fondations d’entreprises,…) en s'assurant que ces actions s’inscrivent dans le cadre
institutionnel et respectent les bonnes pratiques (labellisation, etc.).
A plus long terme, ils proposent une loi de programmation consacrée à la prévention, disposant de crédits dédiés, et de doter le futur service national universel
d’un volet médico-social.
>>> Pour consulter la note d’information publiée par la mission d’information :
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2018/09/Note-information-presse-rapport.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 13Assemblée nationale : Xavier Breton préside la mission des députés sur la bioéthique
L'Assemblée nationale se prépare à la révision de la loi relative à la bioéthique. En amont de l'étude du projet de loi du Gouvernement, une mission d'information
est constituée.
Elle est présidée par l'opposition, en la personne de Xavier Breton (LR, Ain). Le rapporteur de la mission est un parlementaire quant à lui issu de la majorité, à
savoir Jean-Louis Touraine (LREM, Rhône).
Quatre vice-présidents complètent l'organisation de la mission :
Joël Aviragnet (Nouvelle Gauche, Haute-Garonne) ;
Emmanuelle Fontaine-Domeizel (LREM, Alpes-de-Haute-Provence) ;
Caroline Janvier (LREM, Loiret) ;
Jean-François Mbaye (LREM, Val-de-Marne).
La mission d'information se concentrera sur le cadre juridique de la révision et sur le périmètre stricto sensu des lois de bioéthique : recherche sur la personne
humaine et sur l'embryon, don d'organes, procréation, neurosciences et intelligence artificielle.
Les parlementaires ont débuté leurs auditions le 19 juillet sans que la date de clôture ne soit connue. En effet, les missions d'information, à la différence des missions
d'enquête, ne sont pas limitées dans le temps.
Assemblée nationale : PMI : une mission confiée à la députée Michèle Peyron
La députée Michèle Peyron (LREM, Seine-et-Marne) s'est vue confier par le premier ministre, Edouard Philippe, une mission de diagnostic et de préconisation
concernant l'organisation de la protection maternelle et infantile (PMI).
La parlementaire est chargée de réaliser "un diagnostic quant à la mise en œuvre des missions portées par les services de PMI" et d'établir "un certain nombre de
propositions visant à définir les modalités d'un renforcement des PMI dans leur rôle de prévention et d'accompagnement", explique Edouard Philippe dans la lettre
de mission adressée à Michèle Peyron. "Il importe de préciser les orientations qui permettront à la PMI de continuer à répondre aux besoins de la population en
termes de prévention et de promotion de la santé", développe le premier ministre.
Il cite trois "objectifs prioritaires" :
le maintien d'une offre de proximité accessible à tous, axée sur la prévention, et une "approche globale de la santé incluant en particulier le soutien à la
parentalité" ;
la réduction des inégalités de santé via un focus sur les publics en difficulté ;
l'accroissement des démarches proactives en direction des familles.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 14III – INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG)
IVG : un droit fondamental pour les femmes (communiqué de presse du CNOSF)
Plus de quarante ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, le droit à l’IVG, essentiel à l’autonomie
et à l’émancipation des femmes, demeure menacé.
Actuellement, l’accès à l’IVG se complexifie pour les femmes, comme en témoigne la fermeture d’activités IVG dans certains hôpitaux faute de praticiens exerçant
cet acte. Les propos récents du président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France (SYNGOF), estimant que « [les médecins] ne sont pas là
pour retirer des vies », révèlent que les débats autour de l’IVG sont encore vifs et que cet acte est loin d’être normalisé.
Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes estime pour sa part que les sages-femmes doivent être présentes pour accompagner les femmes durant leur
grossesse, quelle qu’en soit l’issue.
C’est pourquoi l’instance, à l’instar de nombreuses associations et syndicats professionnels, s’était fortement impliquée en faveur d’une extension de compétences
permettant aux sages-femmes de prescrire et de pratiquer des IVG médicamenteuses, compétence acquise depuis 2016.
Alors que l’accès à l’IVG n’est plus garanti pour l’ensemble de nos concitoyennes, le CNOSF en appelle à la responsabilité individuelle de chacun afin de ne pas
remettre en question ce droit, acquis sociétal fondamental pour la liberté des femmes.
>>> Pour plus d’informations : http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/livg-un-droit-fondamental-pour-les-femmes/
Accès à l'IVG : Agnès Buzyn demande un état des lieux aux ARS
La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a demandé un « état des lieux » de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) aux Agences
Régionales de Santé (ARS) a-t-elle indiqué le 18 septembre, sur RMC BFM/TV.
Une éventuelle suppression de la clause de conscience relative à l'IVG n'est « pour l'instant pas prévue », mais « je veux m'assurer qu'il n'y a pas une augmentation
du nombre de médecins qui font valoir la clause de conscience », « une information difficile à avoir », a-t-elle dit. « Je veux m'assurer que l'accès à l'IVG aujourd'hui
est toujours aussi simple qu'il y a cinq ou dix ans », a-t-elle insisté.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 15La loi libéralisant l'avortement promulguée en Irlande
Le président irlandais Michael Higgins a annoncé le 18 septembre avoir promulgué la loi constitutionnelle légalisant l'avortement en Irlande, à la suite
d'un référendum historique en mai dernier abrogeant l'interdiction constitutionnelle de l'IVG dans ce pays catholique.
Les Irlandais avaient approuvé par référendum à une majorité de plus de 66 %, le 25 mai, la libéralisation de l'avortement, trois ans après la légalisation du mariage
homosexuel.
La consultation posait précisément la question de l'abrogation du 8e amendement de la constitution irlandaise, qui en 1983 « gravait dans le marbre » le tabou de
l'avortement en Irlande. Il est désormais remplacé par le 36e amendement ouvrant le droit à l'IVG.
Le ministre irlandais de la Santé, Simon Harris, a indiqué qu'il soumettrait une législation visant à mettre en œuvre le droit à l'IVG au gouvernement, en vue de son
examen parlementaire à partir d'octobre.
L’Irlande avait annoncé, en cas de victoire du « oui », son intention d'autoriser l'IVG sans conditions jusqu'à 12 semaines, ou jusqu'à 24 semaines dans des cas
exceptionnels, notamment quand la vie de la mère est menacée.
216 700 interruptions volontaires de grossesse en 2017
En 2017, 216 700 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été réalisées en France, dont 202 900 auprès de femmes résidant en Métropole. Le taux de
recours s’élève à 14,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en Métropole et à 26,1 dans les départements et régions d’outremer (DROM).
Les jeunes femmes (20 à 24 ans) restent les plus concernées, avec un taux de 26,7 IVG pour 1 000 femmes pour la France entière. L’indice conjoncturel d’avortement
se maintient à 0,53 IVG par femme en 2017.
Les écarts régionaux perdurent, les taux de recours allant du simple au double selon les régions. En Métropole, ils varient de 10,2 IVG pour 1 000 femmes en Pays
de la Loire à 21,4 IVG en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ils sont souvent plus élevés dans les DROM et atteignent 33,6 en Guadeloupe.
48 100 IVG ont été réalisées hors d’une structure hospitalière, soit 22 % du total des IVG.
À l’hôpital, la part des IVG instrumentales continue de décroître et s’élève à 41 %, soit 32 % du total des IVG.
>>> Pour consulter l’étude de la DREES : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1081.pdf
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 16IV – DROITS ET SANTE DES FEMMES
Le recours à la contraception d'urgence ne progresse pas en France
Selon une analyse tirée du Baromètre santé 2016, publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), l'utilisation de la contraception d'urgence n'a pas
progressé en France malgré un accès facilité et une évolution importante du paysage contraceptif au cours des dernières années,
Les auteurs suggèrent que "la promotion de la contraception d'urgence comme complément à une contraception régulière [soit] soutenue au regard de la stabilité
du nombre de grossesses non prévues et d'IVG [interruptions volontaires de grossesse]". Cette promotion doit s'accompagner d'une information sur les délais
d'utilisation et l'efficacité de cet outil, ajoutent-ils.
L'enquête sur la contraception d'urgence, réalisée entre le 8 janvier et le 1er août 2016, a porté sur 3.395 femmes âgées de 15 à 49 ans exposées à un risque de
grossesse non prévue au cours des 12 derniers mois, n'utilisant pas de contraception définitive.
Parmi ces femmes, 6,9% avaient eu recours à la contraception d'urgence au cours des 12 derniers mois, dont 1,8% à plusieurs reprises.
L'utilisation la plus forte a été retrouvée chez les plus jeunes, avec 21,4% de recours chez les 15-19 ans (6,4% y ayant eu recours plusieurs fois), contre 1,5% chez les
40-49 ans.
Le niveau d'utilisation est le plus important parmi les moins de 30 ans (11,5%) et il est stable depuis 2010 (11,0%), notent les auteurs.
La taille de l'agglomération de résidence est liée au taux de recours à la contraception d'urgence, le risque d'y recourir étant 4 fois plus élevé en région parisienne
qu'en dehors.
Les comportements sexuels et contraceptifs influençaient davantage le recours à la contraception d'urgence que les critères socio-démographiques : nombre de
partenaires déclarés au cours des 12 derniers mois, antécédent de grossesse non prévue ou d'infection sexuellement transmissible (IST) étaient associés à une plus
grande probabilité d'utilisation de la contraception d'urgence.
En outre, plus de 10% des femmes qui déclaraient utiliser la pilule ou une méthode hormonale comme l'anneau ou le patch avaient eu recours à la contraception
d'urgence au cours des 12 derniers mois, tandis que celles utilisant le préservatif comme méthode principale de contraception ou aucune méthode contraceptive y
avaient eu recours dans 7,3% et 2,0% des cas, respectivement.
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 17Les auteurs soulignent un lien entre utilisation de la contraception d'urgence et connaissances et perceptions liées à celle-ci. Ainsi, une bonne connaissance des
délais de prise de la contraception d'urgence ou une perception de la contraception d'urgence comme efficace étaient associées à un recours plus fréquent à cette
dernière (9,8% et 8,1%, respectivement).
Ils rappellent qu'à partir de 2012 et la "crise des pilules", les pratiques contraceptives se sont fortement modifiées et de manière durable, avec une baisse
importante de l'utilisation des pilules contraceptives et un report vers les dispositifs intra-utérins (DIU) ou le préservatif.
"Les changements récents dans l’usage de la contraception chez les femmes de moins de 30 ans ne semblent pas avoir impacté les niveaux de recours aux solutions
de rattrapage. La mise à disposition sans prescription en 2015 de la formule à [base d’]ulipristal acétate [EllaOne*, HRA Pharma], peu relayée médiatiquement, ne
s’est pas accompagnée d’une hausse de l’utilisation contrairement à ce qui avait été observé entre 2000 et 2005 avec l’arrivée de la contraception d'urgence au
lévonorgestrel [Norlevo*, HRA Pharma, et génériques]", commentent les auteurs.
Toutefois, le taux d'utilisation parmi les utilisatrices de pilule est passé de 4,9% en 2004 à 13,9% en 2016, notent-ils.
"On peut faire l’hypothèse que les discussions et l’information réalisée ces dernières années et, en particulier, la médiatisation de la crise des pilules, ont contribué à
sensibiliser les utilisatrices de pilule à la conduite à tenir en cas de mésusage. Par ailleurs, l’utilisation de la contraception d'urgence parmi les femmes sous
contraception hormonale pourrait s’expliquer par une plus grande facilité à identifier un oubli ou une erreur de manipulation, et donc un risque potentiel de grossesse,
qu’avec des méthodes traditionnelles par exemple."
Ils estiment que des travaux complémentaires semblent nécessaires "pour identifier les freins et leviers à l'identification des situations à risque de grossesse afin de
favoriser l'utilisation de la contraception d'urgence, une méthode de rattrapage sûre, accessible et efficace".
Dépistage du cancer du sein : l'INCa cherche à mieux informer les femmes
En 2017, seules 49,9 % des femmes ont réalisé une mammographie dans le cadre du dépistage organisé, loin des 70 % attendues. En cause, des femmes mal
informées, note en substance l'Institut national du cancer (INCa), qui met au cœur de sa nouvelle campagne nationale la transmission des informations aux femmes.
Objectif : « porter à la connaissance des femmes une information claire et accessible et leur permettre de faire un choix en toute connaissance de cause ».
En partenariat avec le ministère des Solidarités et de la santé, cette nouvelle campagne de l'INCa repose notamment sur un film, diffusé depuis le 23 septembre
dans les médias et sur les réseaux sociaux.
En fournissant une information complète, l'INCa espère répondre à toutes les questions potentielles des femmes afin de les sensibiliser aux enjeux du dépistage. En
plus des modalités pratiques, l'INCa fournit également des informations sur les bénéfices et les limites du dépistage dans un livret et une plateforme dédiée :
https://cancersdusein.e-cancer.fr/
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 18L'enjeu du dépistage organisé est de repérer les cancers du sein au stade le plus précoce possible. De fait, « alors que 99 % des femmes survivent à 5 ans lorsqu'elles
ont été diagnostiquées de façon précoce, elles ne sont plus que 26 % lorsque le diagnostic est posé au stade métastatique », rappelle l'INCa.
Plus de 10 millions de femmes sont concernées par le dépistage organisé qui cible les femmes de 50 à 74 ans.
Violences obstétricales : l’Académie de Médecine se prononce
L’Académie de Médecine vient de publier un rapport intitulé « De la bientraitance en obstétrique. La réalité du fonctionnement des maternités », écrit par René
Charles RUDIGOZ, Jacques MILLIEZ, Yves VILLE et Gilles CREPIN.
Ce rapport dresse un constat précis de l’évolution de l’obstétrique et des maternités en France depuis la fin des années 1970 en détaillant toutes les évolutions qui
ont impacté la prise en charge obstétricale, qu’elles soient d’ordre législatif, organisationnel ou sociétal.
Si les auteurs reviennent sur un bilan jugé très positif en termes de sécurité, ils ne manquent pas de souligner la disparité des pratiques (césariennes, déclenchement,
utilisation de l’oxytocine durant le travail, extractions instrumentales, épisiotomies, accompagnement humain) et ce, malgré les recommandations pour la pratique
clinique (RCP) en vigueur.
Les auteurs détaillent toutes les doléances exprimées par les femmes et estiment notamment que les défauts dans la qualité de prise en charge pourraient « entraîner
des perturbations psychologiques majeures analogues à un état de stress post-traumatique (SPT) qui nécessitera une prise en charge psychosomatique complexe (…)
qui toucherait près de 5% des patientes. »
Le rapport insiste également sur la nécessité d’individualiser les parcours et sur l’importance de l’écoute qui doit être accordée aux femmes enceintes et à leur
entourage.
Si la plupart des constats formulés par l’institution sont partagés par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, on peut souligner que les auteurs
méconnaissent le fonctionnement des maisons de naissance puisqu’ils jugent que la création de « maisons de naissance isolées, sans lien géographique et
fonctionnel avec un établissement classique » constituerait un danger. Or, une maison de naissance, qu’elle soit accolée ou non à une maternité, a systématiquement
des liens à la fois géographiques et fonctionnels avec un, voire plusieurs établissements de santé et ne peut donc être « isolée ». On peut également souligner que
la sécurité y est garantie.
Il est intéressant de noter le positionnement en faveur de la physiologie des auteurs, ceux-ci appelant à une évolution du fonctionnement des salles de naissance
« où doivent pouvoir coexister des modalités de prise en charge différentes en favorisant la mise en place de secteurs « physiologiques », pour les patientes à bas
risque, moins médicalisés (…). »
Veille législative, politique et institutionnelle du CNOSF du 20 août au 30 septembre 2018 19Vous pouvez aussi lire