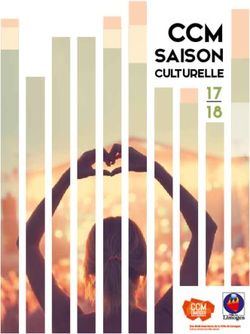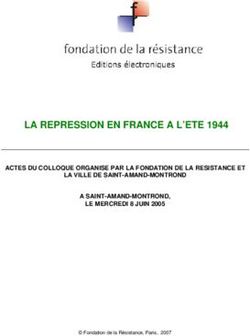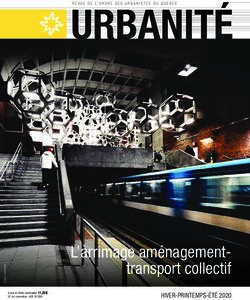Chroniques du sol : l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, archétype d'une nouvelle destination en marge de la ville. Analyse communicationnelle de ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Chroniques du sol : l’aéroport Paris-Charles de Gaulle,
archétype d’une nouvelle destination en marge de la
ville. Analyse communicationnelle de l’aéroport
Paris-CDG et du discours de la marque Paris Aéroport
Hortensia Cisterna
To cite this version:
Hortensia Cisterna. Chroniques du sol : l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, archétype d’une nouvelle
destination en marge de la ville. Analyse communicationnelle de l’aéroport Paris-CDG et du discours
de la marque Paris Aéroport. Sciences de l’information et de la communication. 2020. �dumas-
04017406�
HAL Id: dumas-04017406
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04017406v1
Submitted on 7 Mar 2023
HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
CopyrightMémoire de Master 2
Mention : Information et communication
Spécialité : Communication Management et culture
Option : Magistère, management et culture
Chroniques du sol : l’aéroport Paris-Charles de Gaulle,
archétype d’une nouvelle destination en marge de la ville
Analyse communicationnelle de l’aéroport Paris-CDG
et du discours de la marque Paris Aéroports
Responsable de la mention information et communication
Professeure Karine Berthelot-Guiet
Tuteur universitaire : Pauline Brouard
Nom, prénom : CISTERNA Hortensia
Promotion : 2019-2020
Soutenu le : 05/11/2020
Mention du mémoire : Bien
École des hautes études en sciences de l'information et de la communication – Sorbonne Université
77, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine I tél. : +33 (0)1 46 43 76 10 I fax : +33 (0)1 47 45 66 04 I celsa.frRemerciements 3
Introduction 4
I. L’aéroport incarne la ville mais n’est pas la ville 11
1. L’aéroport vu depuis la ville 11
a. Une interaction ambiguë avec la ville 11
b. Le lieu périphérique de la ville 13
2. L’aéroport comme sas d’entrée vers Paris 16
a. Lieu d’ouverture, lieu de fermeture 16
b. Un espace touristique parisien à part entière 18
3. Une entreprise-métaphore de la capitale 21
a. Paris Aéroport, une marque gage de parisianité pour ADP 21
b. Parler au nom de Paris, sans être Paris 25
II. L’aéroport incarne la société de consommation moderne entre shopping et innovation 28
1. Le royaume du consumérisme d’aujourd’hui 28
a. Une allégorie de la société de consommation 28
b. Le voyage comme moment économique particulier 30
2. Une extension du mall à l’américaine 32
a. L’exportation du modèle du mall 32
b. Une attractivité inspirée des modèles américains 35
3. Le lieu de l’innovation technologique par excellence 36
a. Un espace qui performe le futur 36
b. Un écrin symbolique pour l’innovation 39
III. L’aéroport devient une destination à part entière 41
1. Une destination commerciale 41
a. La zone duty free, reine du commerce d’aéroport 41
b. Un sixième continent pour l’industrie du luxe 43
2. Une destination culturelle 45
a. L’aéroport comme écrin muséal 45
b. Une culture aéroportuaire universelle ? 49
3. Une destination spirituelle 53
a. La spiritualité matérialisée à l’aéroport 53
b. Rapprocher voyage et réalisation de soi 55
Conclusion 59
Bibliographie 62
Annexes 65
Résumé du mémoire 93
Mots-clefs 93
2Remerciements
Mes sincères remerciements vont tout d’abord à Pauline Brouard, pour son oreille
attentive et impliquée tout le long de la production de ce mémoire, ainsi qu’à Lucie
Marchais, ma tutrice professionnelle, qui m’a aidée de son expertise et de l’assurance de
sa présence. Leur suivi bienveillant a été pour moi moteur de ce travail.
Merci également à Thierry Devars, président du jury, pour ces années au CELSA,
mais aussi pour la lecture de ce mémoire, qui je l’espère, lui plaira. Monsieur Devars
personnifie pour moi les qualités de cette école, dans son enseignement comme dans son
humanité.
Au CELSA, de manière générale, mais aussi à des personnes comme Aïssatou
Diallo-Camara et Sylvie Gesson, qui nous ont suivi avec la plus grande sympathie. Je suis
reconnaissante d’avoir pu passer trois ans au 77 rue de Villiers, bien que l’effet de
décentralisation au terminus de la ligne 3 du métro parisien n’était pas des plus
réjouissants. Le CELSA m’a fait oublier ce caprice !
Merci également aux professeurs et aux intervenants rencontrés à l’école, dont je
me remémorerai les cours pendant longtemps : Olivier Aïm, Valérie Patrin-Leclère, Adeline
Wrona, Erwan Sommerer, Christophe Rioux, Bruno du Teilleul, Laurent Raverat, Joëlle Le
Marec, Thibaut Thomas, Hervé Marc et bien d’autres.
Merci à mes chers amis Louise de Longueville, Mathias Breteau et Marin Mornieux,
pour leur grande douceur et leur générosité de tous les jours. À mon ami et soutien de
bibliothèque Félix Duval. Merci à eux pour leur amitié et pour leur humour à toute épreuve.
Pour mes parents et pour mon frère Horacio viennent des remerciements
affectueux. Merci à eux pour leur soutien indéfectible et pour les encouragements qu’ils
n’ont jamais cessé de me prodiguer tout au long de ma scolarité.
Une pensée particulière s’adresse à Djaïd Yamak, avec qui j’ai connu mes plus
beaux moments, au CELSA comme dans la vie, à la ville comme à la scène.
3Introduction
En temps de Covid-19, les possibilités de voyage sont rares. Si rares, que la
nostalgie se fait ressentir. Mais plus que le rêve d’ailleurs, c’est l’expérience de l’aéroport
elle-même puis du vol qui constitue un objet de convoitise pour les individus. C’est ce que
nous apprend le succès des ventes « Flights to Nowhere » organisée par des compagnies
aériennes qui ont eut l’idée de vendre des billets au départ et à l’arrivée de la même
destination,« pour nulle part », avec des prix pour toutes les bourses, de la classe
économique à la première1 . La vente organisée par Qantas pour voler au-dessus de
Sydney s’est en effet retrouvée sold out en dix minutes, les Australiens étant reclus dans
leurs frontières depuis le début de l’épidémie2.
Nous aurions pourtant pu penser que la tendance scandinave du Flygskam
(« honte de prendre l’avion », en suédois) aurait pu mettre à mal l’appétit des voyageurs
pour les vols3. Nous observons en effet un mouvement de recul face à l’avion, considéré
comme mode de transport le plus polluant, au bénéfice du train. Le trafic aérien contribue
aux émissions de gaz à effet de serre4 . Il serait de la responsabilité de chacun de mesurer
si oui ou non prendre l’avion pour son intérêt personnel prévaut sur l’intérêt de la planète.
Pour se rendre au sommet mondial de l’ONU à New York en août 2019, Greta Thunberg,
fidèle à ses convictions, a en effet préféré suivre une traversée de l’Atlantique de deux
semaines en voilier de course zéro carbone5 . Dernièrement, au mois de juin 2020, des
militants d’Extinction Rebellion se sont levés pour l’interdiction des vols intérieurs en
tentant d’empêcher la réouverture de l’aéroport d’Orly, fermé pendant trois mois suite à
l’épidémie liée au coronavirus : « Sauvons les vivants, pas les avions », pouvait-on lire sur
leurs banderoles, alors que le hashtag #AvionsATerre battait son plein sur Twitter. Cette
préoccupation écologique pour l’aérien donne son titre à un article du Monde publié le 3
1 MZEZEWA Tariro, « The Flight Goes Nowhere. And It’s Sold Out. » in New York Times, 19
septembre 2020 [En ligne]
2 LABEYRIE Isabelle, « En Australie, la croisière s’amuse…en avion », in France TV Info, 18
septembre 2020 [En ligne]
3AMSILI Sophie, « En Suède, la « honte de prendre l’avion » plombe déjà le trafic aérien », in Les
Echos, 20 avril 2019 [En ligne]
4BIGO Aurélien, « Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs », in
Sud Ouest, 10 mai 2019 [En ligne]
5SERRAJORDIA Esther, « Greta Thunberg arrive à New York après sa traversée de l'Atlantique
en voilier », in RTL, 28 août 2019 [En ligne]
4octobre 2020 : « Les aéroports, nouvelles destinations des marches pour le climat »6. Une
opération de « Marche sur l’aéroport » était organisée partout en France ce jour là, sous
l’égide de Greenpeace.
Mais revenons au succès des opérations « Flights to Nowhere ». Il évoque toute
l’attraction que peut susciter le fait de se rendre à l’aéroport puis de prendre l’avion.
Jamais un vol ne s’était vendu aussi vite que celui mis en ligne par Qantas. Un sentiment
particulier propre au paysage aéroportuaire et aérien ?
Des oeuvres culturelles parlent de la particularité du voyage en avion : des films
surtout, avec des blockbusters américains, comme le récent Sully (2016), ou Flight Plan
(2005), mais aussi Y a-t-il un pilote dans l’avion ? (1980); ou des comédies romantiques,
comme le film français Amour et Turbulences (2013). Dans l’aéroport, nous pouvons
songer à la série du photographe Harry Gruyaert, Last Call , qui raconte l’attente, mais
surtout au film de Steven Spielberg Le Terminal (2004) récompensé aux Oscars. Dans ce
film, la société américaine est mise en exergue au travers de l’histoire d’un réfugié bloqué
pour des raisons politiques. Le personnage principal, incarné par Tom Hanks, se retrouve
enfermé dans un microcosme aseptisé des Etats-Unis, et vit au fil des déconvenues la
découverte d’une allégorie de la société américaine, dans sa dimension marchande,
culturelle, et surtout inégalitaire. Plus récemment, dans Je Suis Là (2020), nous suivons le
personnage d’Alain Chabat qui se confine de son propre chef dans l’enceinte de l’aéroport
Incheong de Séoul, et qui arrive à vivre une véritable aventure humaine au gré d’activités
et de rencontres, sans sortir des murs de ce gigantesque bâtiment.
Nous pouvons également penser à la transformation de l’aéroport de Berlin-Est,
Tempelhof, fermé en 2008, en un immense parc culturel inclus dans la ville, réapproprié
par les habitants après des décennies de service. Véritable morceau de l’histoire de
Berlin, sa fermeture puis sa réhabilitation en 2010 en un espace de verdure
incontournable dans la capitale allemande confirment la symbolique d’un tel endroit7.
L’aéroport semble donc incarner plus que ce lieu de passage, cet espace destiné
au process de passagers et de machines à transporter. Car un aéroport, c’est avant tout,
selon la définition du CNRTL, un lieu « aménagé pour le départ, l’arrivée, les escales des
lignes aériennes, et comprenant notamment, l’aérogare, les pistes, les hangars ».
6MANDARD Stéphane, « Les aéroports, nouvelles destinations des marches pour le climat », in
Le Monde, 03 octobre 2020 [En ligne]
7 RAZEMON Olivier, « Berlin Tempelhof, l’aéroport transformé en parc urbain », in Le Monde, 14
juin 2012 [En ligne]
5Dans sa dimension symbolique d’une part, puis dans le rôle qu’on lui donne
aujourd’hui d’autre part, l’aéroport change progressivement de définition et semble
assumer un nouveau rôle, celui d’une ville autonome entre culture et commerce.
Pour revenir à la genèse de ce travail, les rapports d’hybridité m’intéressent.
Plusieurs sujets auraient pu faire l’objet de ce mémoire. Il n’en sont finalement pas si
éloignés.
- Premièrement, l’aisance avec laquelle les grands magasins deviennent des lieux
d’expression artistique, comme c’est le cas avec le Bon Marché à Paris qui accueille
régulièrement des artistes en résidence, ou 10 Corso Como à Milan, un concept-store de
luxe qui intègre de manière permanente un espace de galerie. Nous observons, avec le
sujet de l’aéroport, que la juxtaposition d’oeuvres d’art et de biens de consommation
s’étend de plus en plus.
- Deuxièmement, la manière dont les marques de mode peuvent proposer des
performances, des expériences à la place du traditionnel défilé : Jacquemus dans la
calanque de Sormiou à Marseille pour la collection « Gadjo », Weston et les
chorégraphies de chaussures, Louboutin et le « Loubicircus » pour présenter sa nouvelle
collection au Musée des Arts Forains. Finalement, euphémiser l’acte même de la
consommation au profit de l’expérience est un élément que nous retrouvons aussi dans
les transactions en aéroport.
Mais c’est en lisant un article sur la grandiosité du nouvel aéroport de Singapour,
Changi, que j’ai été frappée par son architecture et par les services qu’il propose. Une
véritable forêt vierge installée en plein milieu de l’aérogare, avec en prime une cascade.
Un décor majestueux, si bien réalisé dans son artificialité qu’il en devient naturel.
Je me suis donc demandé, de manière intuitive, les raisons pour lesquelles les
aéroports aujourd’hui se dotent de tels attributs, qui n’ont strictement rien à voir avec la
fonction seule du voyage.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées. En effet, la technologie a permis de
dévoyer la seule fonction du voyage car elle a libéré un certain nombre d’espaces, comme
ceux dédiés à l’enregistrement des passagers : dorénavant, la carte d’embarquement se
télécharge la veille du départ sur le téléphone portable. Ces espaces désormais vidés
peuvent être utilisés à d’autres fins.
Les chiffres sur les revenus liés aux activités extra-aéronautiques des aéroports
sont révélateurs. Alors que les entreprises gestionnaires s’appuient en majorité sur la
location des espaces d’atterrissage et des fuseaux horaires (les slots) aux compagnies
aériennes, elles tirent de plus en plus de bénéfices du Travel retail (terme anglais qui
6permet de désigner le commerce de détail tel qu’il est vendu en aéroport) : dans le cas du
Groupe ADP, les commerces, services et l’immobilier ont généré 615 millions d’euros de
chiffre d’affaires au premier semestre 2018 contre 906 millions pour les activités
aéronautiques8. Développer une forte activité commerciale est donc un enjeu majeur pour
le secteur aéroportuaire.
Enfin, je me suis rendue compte que souvent les prestations proposées par les
aéroports racontaient quelque chose du territoire dans lesquels ils étaient insérés. Ces
prestations ont pour particularité de retranscrire l’identité de la ville ou du pays dans lequel
l’aéroport se situe. C’est notamment le cas de l’aéroport d’Ibiza (Espagne), fidèle à sa
réputation de capitale européenne de la fête, qui abrite dans sa zone duty free une boîte
de nuit en collaboration avec la marque de bière Carlsberg ; de Munich (Allemagne), dont
l’Oktoberfest rassemble pendant plus de deux semaines chaque année les
consommateurs de bière du monde entier, avec une brasserie implantée en plein milieu
de l’aéroport qui propose des visites guidées insolites afin de tout savoir sur le processus
de fabrication de la bière. C’est encore le cas de l’aéroport de Tokyo (Japon), au pays du
kawaï et des cerisiers en fleur, où l’on peut observer la voûte céleste du Planétarium Café
qui recompose plus de quarante millions d’étoile ; et évidemment de Singapour, où la
jungle et la forêt de papillons de l’aéroport Changi racontent le paysage luxuriant de la
Cité-État.
De plus en plus, il semblerait que les aéroports euphémisent leur fonction comme
lieu de transit des passagers, qui attendent d’être pris en charge par des acteurs tiers, les
compagnies aériennes, afin d’être transportés vers un Ailleurs. Ces lieux, spécifiquement
dévolus au transport aérien, se dotent d’infrastructures qui s’éloignent de cette fonction
première. Nous comprenons que dans des espaces mondialisés il est nécessaire de créer
la préférence pour des voyageurs qui ont aujourd’hui le choix de plusieurs hubs pour se
rendre dans leur destination. La digitalisation que nous évoquions plus tôt permet cette
euphémisation puisqu’en libérant des espaces, elle permet de proposer une gamme de
services de plus en plus larges, comme la création d’un musée interne à l’aéroport.
Aujourd’hui, pour présenter des oeuvres, il ne suffirait plus d’être un musée : nous
pouvons penser au succès de l’Atelier des Lumières à Paris et de son antenne aux Baux
de Provence, les Carrières de Lumières, où le miracle se produit grâce à des installations
sons et lumières grandioses.
8TREVIDIC Bruno, « Comment les grands aéroports sont devenus des poules aux oeufs d’or », in
Les Echos, 1er août 2020
7C’est dans ce contexte que, faute de pouvoir aller visiter l’aéroport Changi de
Singapour, nous remarquons que l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est lui aussi
réceptacle des nouvelles problématiques à l’oeuvre pour les aéroports. Ainsi, ce sont pour
des raisons de simplicité, d’accessibilité, de compréhension même, que cet aéroport,
fleuron du Groupe ADP, constitue notre terrain de recherche, comme échantillon local des
transformations que nous pouvons observer à travers le monde de ce secteur.
Ainsi, pourquoi l’aéroport, espace périphérique pensé pour le transit de
passagers, cherche-t-il à se définir de plus en plus comme une destination
touristique de premier ordre ?
Avant de procéder à l’énonciation des hypothèses qui font le sujet de ce mémoire
de recherche, il est important de rappeler que la crise lié à la Covid-19 remet en question
cette problématique. En effet, à la lumière d’un entretien avec Justine Léger, chargée de
communication presse et digitale chez ADP, il est clair que les objectifs du secteur
aéroportuaire ont du évoluer pour des questions de survie. Les sujets prioritaires pour le
Groupe ADP portent sur la sécurité sanitaire et sur la restauration du lien de confiance
entretenu avec ses utilisateurs (annexe 1). Je n’ai cependant pas adapté mon travail aux
conséquences de cette conjoncture, pour plusieurs raisons. La première, est que le plan
de ce mémoire a été construit avant même les événements de la crise sanitaire qui ont
défini l’année 2020. La seconde, est que j’estime ne pas avoir assez de recul, dans mes
lectures comme dans ma réflexion, pour pouvoir décrire les effets directs de cette situation
sur le paysage aéroportuaire.
C’est pour cela que nous répondrons à cette problématique par les trois hypothèses
suivantes :
Hypothèse 1. L’aéroport d’aujourd’hui raconte, parle même, au nom d’une ville sans
être une ville.
Cette hypothèse permet de questionner le statut de ville de l’aéroport, et d’amener
le sujet de l’expérience que l’on donne de la ville alors que l’aéroport n’est pas, à première
vue en tout cas, une ville à proprement parler. En outre, nous chercherons à connaître le
rapport à son territoire qu’entretient l’aéroport, toujours rattaché à une zone géographique.
Le Groupe ADP semble en effet fonder ses communications sur une évocation de la ville
de Paris alors même que Paris-Charles de Gaulle ne s’y situe pas immédiatement.
8Hypothèse 2. L’aéroport, écrin pour l’innovation et la technologie, est allégorique de
la société de consommation moderne.
La société de consommation du XXIème siècle comporte son lot d’imaginaires, tout
comme les nouvelles technologies. Nous nous attacherons à observer la place que tient
l’aéroport quant à ces discours, et de quelle manière Paris-Charles de Gaulle correspond
au rêve consumériste du mall, né aux Etats-Unis, et à l’aura du grand magasin parisien.
Hypothèse 3. L’aéroport est devenu une destination à part entière, en ce qu’il
s’approche d’un lieu dédié à la culture et au commerce.
En conséquence des hypothèses citées précédemment, nous nous intéresserons à
une nouvelle approche de l’aéroport comme lieu de destination. L’espace de l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle s’est transformé afin de laisser place à de nouveaux services qui
s’éloignent de sa fonction première comme lieu de passage. Comment cela s’y vérifie-t-il ?
Méthodologie
Afin de vérifier ou non ces hypothèses, la méthodologie employée repose à la fois
sur des recherches bibliographiques, sur des analyses sémiotiques et sur la réalisation de
deux entretiens directifs. J’ai également surveillé la presse internationale, friande de
discours sur les aéroports, qu’il s’agisse de la presse généraliste ou de la presse
spécialisée ; ceci afin de comprendre les circulations autour des différentes thématiques
qui constituent ce mémoire.
Tout d’abord, il est important de préciser que le thème de l’aéroport ne trouve que
peu d’écho dans notre domaine d’études. J’ai donc d’abord constitué une bibliographie
regroupant des ouvrages en sciences de l’information et de la communication, mais, par
nécessité, je me suis ouverte à des ouvrages de géographie, en particulier deux thèses
dont les sujets traitent du rapport de l’aéroport à la ville de laquelle il dépend. Ces deux
thèses en géographie m’ont été très précieuses notamment par tout le travail d’enquête
effectué. Les chercheurs ont mobilisé différentes disciplines, puisque nous retrouvons un
regard sociologique, voire anthropologique dans leurs travaux.
J’ai eu ensuite l’opportunité de rencontrer deux personnes dont les témoignages, et
les verbatims que j’en ai retenus, sont clefs pour l’analyse de ce sujet. La première,
Justine Léger, travaille au service de presse et de communication du Groupe ADP, et
9connaît donc les rouages de l’image de marque à l’oeuvre dans les discours de
l’entreprise. La seconde, Anne de Turenne, n’est pas employée par le Groupe ADP mais
s’occupe directement de la gestion du projet culturel au sein de Paris-Charles de Gaulle,
Espace Musées. Elle travaille en effet pour l’Agence Artcurial, qui est délégataire de ce
projet. Sa position, mi-interne, mi-externe, m’a permis de comprendre les mécanismes
d’Espace Musées et les ambitions culturelles du Groupe ADP.
Consécutivement aux événements provoqués par la Covid-19, j’ai du renoncer à
une étude de terrain sur place, et j’ai donc du reconsidérer mon objet de recherche au
travers des communications autour de Paris Aéroport : ce que cette entreprise dit d’elle et
de ses lieux à travers ses publicités principalement. Je me suis pour cela appuyée sur
l’analyse sémiologique de la campagne de communication diffusée par le Groupe ADP
autour de la nouvelle signature de marque de Paris Aéroport, « Paris vous aime ». Cette
promesse, déclinée en affichage comme en digital, est révélatrice de l’utilisation de Paris à
la fois comme figure symbolique et figure d’autorité pour raconter les bénéfices de
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Enfin, je me suis appuyée sur des documents, pour certains en accès-libre. Le
premier est le Rapport d’activité et de développement durable produit par le Groupe ADP
en 2018. Le deuxième est une note d’analyse de la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) paru en septembre 2017 qui résume une étude prospective commandée par la
DGAC auprès du cabinet Ernest & Young sur « l’activité des aéroports métropolitains de
plus de 5 millions de passagers à l’horizon 2025 ». Le dernier, communiqué directement
par Anne de Turenne, est la maquette en PDF du livre consacré au projet Espace Musées,
à paraître prochainement.
Annonce de plan
Le plan proposé s’attachera à répondre de façon chronologique aux trois
hypothèses énoncées précédemment. Dans une première partie, nous analyserons le
rapport de l’aéroport à la ville et particulièrement la manière dont Paris-Charles de Gaulle
s’insère dans la capitale. La deuxième partie fera l’objet d’une étude sur la manière dont la
société de consommation d’aujourd’hui s’affiche à l’aéroport. Enfin, il sera question dans la
troisième partie de vérifier si l’aéroport devient une destination à part entière, entre
commerce, culture et spiritualité.
10I. L’aéroport incarne la ville mais n’est pas la ville
1. L’aéroport vu depuis la ville
a. Une interaction ambiguë avec la ville
La ville aujourd’hui, d’un point de vue géographique, « Agglomération relativement
importante dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées, notamment
dans le secteur tertiaire »9 est indissociable de la mondialisation. Le secteur tertiaire tel
qu’il participe à la définition de la ville constitue 75% des emplois dans le tourisme, les
services financiers, les télécommunications. De fait, le tourisme, comme les échanges de
type commerciaux, font partie d’un processus de flux primordial aujourd’hui relatif à la
mondialisation, autrement dit à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des
services et des personnes.
De fait, l’aéroport semble constituer une condition sine qua none pour faire d’une
ville une métropole. Ce qui caractérise aujourd’hui la grande ville, c’est sa faculté à nouer
des échanges, commerciaux comme individuels, à gérer des flux. Par sa dimension de
port, l’aéroport porte la symbolique de la globalisation. C’est d’ailleurs la thèse de John
Kasarda, chercheur en économie américain, qui parle d’aerotropolis et qui considère que
« les aéroports jouent le même rôle dans la formation des villes de demain que les ports
ont pu exercer autrefois »10. Ainsi, l’aéroport permettrait donc d’adouber la ville au rang de
capitale, de métropole, comme la présence d’une baignoire dans une chambre symbolise
le passage des deux étoiles aux trois étoiles pour un hôtel.
Chaque métropole d’importance possède donc un, voire plusieurs aéroports. C’est
le cas de New York, qui en possède sept, et de Londres, qui en possède six. C’est en cela
que nous pouvons estimer que l’aéroport est marqueur de la Ville en tant que telle, et non
pas d’une ville. D’autant plus que l’architecture standardisée des aéroports, qui répond à
des impératifs techniques, rend ce territoire immédiatement reconnaissable. La
chercheuse en géographie Lucie-Emmanuelle Drevet-Demettre l’explique dans sa thèse
soutenue en 2008, Quand l’aéroport devient ville : géographie d’une structure paradoxale.
Au même titre qu’une autoroute, l’aéroport constitue un marqueur urbain :
9 Définition donnée par le CNRTL
10CELERIER Frédérique, « Entendu/Entretien : l’urbanité à l’épreuve des aéroports. Entretien
avec Jean-Baptiste Frétigny », in revue-urbanites.fr, 16 avril 2015 [En ligne]
11« Que l’on observe la carte ou la photographie aérienne de villes asiatiques,
africaines, américaines ou encore européennes, certains éléments-clés rendent
l’espace urbain immédiatement intelligible ».
L’aéroport est donc un signe qui permet de faire la ville. Il est reconnaissable de
tous car il est systématiquement identifiable.
Cet esprit générique de l’aéroport quant à la ville se retrouve également dans la
notion d’airport city telle qu’elle est citée par Lucie-Emmanuelle Drevet-Demettre dans sa
thèse. En développant ses activités commerciales, l’aéroport prend un caractère urbain
encore plus fort.
« Ainsi, l’airport city peut être définie comme résultant de l’injection d’une
combinaison de nouvelles préoccupations commerciales avec un ensemble plus
ou moins dense d’activités aéronautiques, dans le périmètre aéroportuaire ou à sa
proximité immédiate ».
Comme si, en se dotant de commerces, l’aéroport deviendrait une ville à part entière ; un
centre dynamique fait d’activités économiques. Une ville à côté de la ville.
Cependant, dans notre cas de Paris-Charles de Gaulle, nous observons que
l’aéroport ne cherche pas à remplacer la ville. Il cherche à en faire partie, et à s’ancrer
dans une territorialité à la fois métropolitaine, par le fait qu’il soit facilement accessible en
transports en commun, et locale. C’est notamment le coeur du projet des Maisons de
l’environnement du Groupe ADP. Le site parisaeroport.fr en retrace les origines :
« Créées en 1995 pour Paris-Charles de Gaulle et en 1996 pour Paris-Orly, les
Maisons de l’Environnement et du Développement Durable sont au coeur de la
relation avec les riverains, du citoyen à l’élu local. Elles ont pour but de développer
les relations humaines, la compréhension et la connaissance mutuelle entre les
riverains et les acteurs du transport aérien ».
Il y a donc une visée de l’entreprise à ne pas nier son territoire d’emplacement, à interagir
avec la localité. Une localité pourtant effacée, notamment par le nom de l’aéroport.
En effet, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle porte le nom de Paris. Cela témoigne,
pour Drevet-Demettre, « d’une relation inaltérable, puisque l’aéroport international est
d’abord désigné par la ville qu’il dessert, bien qu’il ne se situe qu’exceptionnellement sur
les terres de la municipalité ». Prendre le nom de la ville garantirait de bénéficier du
12rayonnement qui lui est associé. Cet enjeu du nom nous apparaît comme légitime.
Comme le rappelle Justine Léger, chargée de communication presse et digitale, dans son
entretien (annexe 1), « Comme l’aéroport est la première image de Paris, et la dernière
image, c’est celle qui peut être déterminante pour donner envie de revenir grâce à
l’expérience qu’on y a vécu ». L’aéroport s’incarnerait donc comme la première expérience
que l’on a de la ville. Et donc à ce titre, nous pouvons l’envisager non pas comme une
périphérie, mais comme un sas d’entrée, constituant de la ville.
b. Le lieu périphérique de la ville
Puisque nous avons pu définir l’aéroport comme élément constituant de la ville, il
est désormais intéressant de se demander quelle place celui-ci tient quant à elle. Quel
type de lieu est véritablement l’aéroport ?
Sur ce point, nombreux sont les articles et les essais à citer en premier lieu le
concept de non-lieu forgé par Marc Augé dans son ouvrage Non-Lieux. Introduction à une
anthropologie de la surmodernité ainsi que le concept d’hétérotopie de Michel Foucault.
Nous allons observer si ces deux concepts correspondent à la définition de l’aéroport
d’aujourd’hui et à son fonctionnement.
Au premier abord, la théorie de Marc Augé sur les Non-Lieux peut sembler
anachronique pour qualifier l’aéroport. C’est le mot « Non-lieux », en lui-même, terme
qu’Augé récupère de Michel de Certeau, qui est porteur de sens, comme s’il niait au lieu
sa possibilité d’être un lieu. Augé évoque cette ambiguïté : « Lorsque Michel de Certeau
parle du « non-lieu », c’est pour faire allusion à une qualité négative du lieu, d’une
absence du lieu à lui-même que lui impose le nom qui lui est donné »11. Puis, il explique le
non-lieu intègre « des espaces constitués en rapport à certaines fins (transport, transit,
commerce, loisir), et le rapport que des individus entretiennent avec ces espaces ». Dès
lors, il est évident que l’aéroport participe de cette définition. Cela est d’autant plus
renforcé lorsqu’Augé analyse le fait que le parcours du voyageur est quadrillé selon un
jargon et des idéogrammes précis, des textes finalement, seuls interlocuteurs de l’individu.
Comme si le non-lieu finalement était conditionné par le rapport du voyageur avec ce lieu,
11 AUGÉ Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, 1992
13et non pas seulement par l’intervention de l’aéroport. En cela, l’aéroport semble être la
quintessence du non-lieu raconté par Marc Augé.
En outre, suite à une conférence radiophonique, où il lit un texte écrit en Tunisie en
1967, Michel Foucault met à jour le concept d’hétérotopie afin de qualifier les différents
espaces qui constituent l’époque12. Pour Foucault, nous traversons « l’époque de
l’espace », une époque « du simultané », de la juxtaposition », et il faut donc définir la
place que prend chaque lieu par rapport à un autre, à un emplacement. De fait, lorsqu’il dit
« Nous vivons à l’intérieur d’un ensemble de relations qui définissent des emplacements
irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables », nous comprenons
que l’aéroport, nouveau lieu né au XXème siècle, trouve sa place dans ce raisonnement.
Plus loin, il analyse deux grands types d’espaces, « qui ont la curieuse propriété d’être en
rapport avec tous les autres emplacements, mais sur un mode tel qu’ils suspendent,
neutralisent ou inversent l’ensemble des rapports qui se trouvent, par eux, désignés,
reflétés ou réfléchis ». De cette analyse découlent les utopies, « emplacements sans lieu
réel », et les hétérotopies, des « espaces différents, des autres lieux ». Ce sont des lieux
autres, dans le sens où il s’y déroule des choses qui ne pourraient avoir lieu ailleurs. Ils ne
sont pas forcément délimités géographiquement, puisqu’il prend l’exemple du voyage de
noces ou du service militaire. Mais en ce que l’aéroport est un lieu spécifique
conditionnant le transport en avion pour les individus, nous pourrions imaginer qu’il s’agit
d’une hétérotopie. Michel Foucault essaime cinq principes de l’hétérotopie, et nous
pouvons jouer au jeu des correspondances pour observer si l’aéroport remplit ces
principes.
- Premier principe : « Il n’y a probablement pas une seule culture au monde qui ne
constitue des hétérotopies ». Dans le cas de l’aéroport, nous pouvons estimer qu’une
seule culture abrite ce type de lieu, une culture à caractère mondial. L’espace de
passage, de process de passagers n’existe que dans le cas de rapports d’échanges et
de commerce très développés.
- Deuxième principe : « Au cours de son histoire, une société peut faire fonctionner d’une
façon très différente une hétérotopie qui existe et qui n’a pas cessé d’exister ». Si nous
partons du postulat que l’aéroport n’est plus seulement un lieu de passage, alors oui,
nous pouvons estimer qu’il change de fonction - du moins, symboliquement.
12FOUCAULT Michel, « Des espaces autres, les Hétérotopies », retranscription de la conférence
radiophonique diffusée le 14 mars 1967
14- Troisième principe : « L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel
plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles ». Si
nous projetons musée (oeuvre d’art) et commerce (bien marchand) comme deux
éléments incompatibles entre eux, l’aéroport peut répondre à cette assertion en ce qu’il
les fait de plus en plus exister ensemble.
- Quatrième principe : « Les hétérotopies sont liées le plus souvent à des découpages du
temps ». Le rapport au temps est particulier à l’aéroport d’autant que les fuseaux
horaires entrent en compte. Par exemple, dans le lounge La Première d’Air France à
Paris-Charles de Gaulle, la temporalité du repas est décalée et il n’existe plus de
segmentation classique du petit-déjeuner/déjeuner/dîner comme c’est le cas dans notre
société française.
- Cinquième principe : « Les hétérotopies supposent toujours un système d’ouverture et
de fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables ». L’aéroport correspond
complètement à l’édiction d’un tel principe puisque l’on y accède contractuellement,
suite à l’achat d’un billet d’avion qui fait office de passe-droit pour rejoindre les espaces.
- Sixième principe : « Le dernier trait des hétérotopies, c’est qu’elles ont, par rapport à
l’espace restant, une fonction ». La définition même de l’aéroport est sa fonction, telle
que nous l’avons citée en introduction de ce mémoire : « Un lieu aménagé pour le
départ, l’arrivée, les escales des lignes aériennes (…) ».
Si nous analysons les six principes relatés par Foucault pour qualifier les
hétérotopies, il est évident que l’aéroport, bien qu’il ne soit pas cité directement par le
chercheur, correspond à ce concept. Mais nous pourrions également partir d’un autre
point de vue. Tout le travail des entreprises actuelles qui occupent le paysage
aéroportuaire n’est-il pas d’enlever la dimension hétérotopique à l’aéroport ? En effet, il est
évident dans les discours qui circulent que le souhait des aéroports est de rentrer dans la
ville, d’en être le prolongement. Pour cela, plusieurs éléments sont à prendre en compte.
En effet, dans le rapport d’activité et de développement durable rendu par le
Groupe ADP en 2018, l’entreprise insiste régulièrement sur la manière dont les aéroports
ont vocation à être joignables facilement dans un horizon proche. Notamment le projet du
Grand Paris permet d’envisager l’aéroport comme lieu de la ville puisqu’il inclue des
métamorphoses du paysage urbain renforçant l’accessibilité de l’aéroport, et de fait sa
banalisation comme un lieu urbain comme un autre. On parle même de « mue des
plateformes parisiennes ». Le terme de mue est particulièrement révélateur puisqu’il induit
15un changement mais aussi une adaptation à un environnement. Une rubrique reprend des
« Exemples de temps de trajet en 2024 » :
« Paris-Orly < > Olympiades : 16 minutes via la ligne 14 contre 43 minutes
aujourd’hui.
Paris-Orly < > Kremlin Bicêtre : 12 minutes via la ligne 18 contre 52 minutes
aujourd’hui. »
De plus, lors de l’entretien mené avec Justine Léger, celle ci évoque les objectifs du
Groupe ADP : « Dans un futur proche, nous pourrions imaginer qu’il soit très simple de
rejoindre le Terminal 1 pour déjeuner chez Thierry Marx et déguster son adaptation de la
spécialité japonaise de Teppanyaki » (annexe 1).
La finalité pour une entreprise comme celle du Groupe ADP est donc de s’insérer
dans le paysage urbain de la ville de Paris comme un lieu comme un autre de la capitale.
Ainsi, l’aéroport ne se veut plus seulement une zone de passage, ou un checkpoint.
L’aéroport se veut comme une zone commerciale attractive afin de créer la préférence
parmi les voyageurs, afin qu’ils choisissent cet aéroport là, plutôt qu’un autre. Une identité
propre de l’aéroport se dessine, et cette identité joue précisément sur la prolongation de la
ville.
La place de l’aéroport apparaît donc être celle du prolongement de la ville, comme
un espace originellement périphérique mais qu’il faut désormais intégrer au paysage local.
Cet ancrage dans la territorialité, est une problématique pour une entreprise comme le
Groupe ADP. Si nous observons cette volonté d’ancrage comme géographique, elle en est
également symbolique.
2. L’aéroport comme sas d’entrée vers Paris
a. Lieu d’ouverture, lieu de fermeture
Ainsi nous pouvons envisager l’aéroport comme l’antichambre de la ville.
Cependant, nous nous plaçons ici d’un seul point de vue : celui du touriste, celui de la
femme ou de l’homme d’affaires en voyage. Ces différentes catégories de voyageur ne
pourraient en être en réalité qu’une seule : celle de la personne qui est en règle et dont les
portes s’ouvrent systématiquement, sur le plan symbolique comme physique. Cependant,
d’autres populations parcourent l’aéroport.
16Il y a en effet tout d’abord les personnes qui travaillent à l’aéroport mais qui ne
voyagent pas. Il s’agit de tous les salariés, à la fois des compagnies aériennes, mais
également des boutiques et des divers services. Un recensement de 2013 produit par le
Groupe ADP compte environ 85 000 personnes. C’est une catégorie d’individus qui fait
fonctionner toutes les industries autour de l’aéroport, dont la plupart oeuvrent pour que la
première catégorie que nous avons évoquée puisse voyager le plus aisément, simplement
possible. Mais il y a aussi toute un ensemble de personnes sans-abri qui ont élu domicile
dans l’aéroport. Pour Jean-Baptiste Frétigny, « La mobilité, en tant que fait, n’en demeure
pas moins une ressource inégalement qualifiée et distribuée au sein des espaces où elle
est mobilisée »13.
Ces individus n’ont pas accès à la mobilité. Ils ont un nom, donné par les salariés :
les « Diogènes ». Le syndrome de Diogène désigne la particularité de certaines
personnes à l’accumulation, à tout conserver par crainte du manque. Il y aurait en effet un
cliché commun aux SDF de Paris-Charles de Gaulle de prendre avec eux des charriots de
bagage remplis de leurs effets personnels. Au moment de la réalisation de ce mémoire, je
me suis posée la question de la présence de ces individus délocalisés, vivant à Paris sans
être vraiment à Paris14 . En effet, l’aéroport se voit être l’objet d’une dérive de sa fonction
par la vie parallèle qui s’est installée sans son consentement. Une vie parallèle en marge
des voyageurs, des personnes qui habitent là, ou alors qui viennent passer leur journée là
et qui se débrouillent pour effectuer des petits boulots payés à la journée. Une
cohabitation s’installe dans l’aéroport, dissonante : entre des gens installés dans le
dénuement, et d’autres présents le temps de quelques heures, de passage. De plus, le
temps de l’aéroport n’est pas le temps de la gare. Les gens y sont moins pressés,
puisqu’ils prennent le temps de venir en avance. Le rapport à l’espace est différent, car
l’aéroport est très étendu. Ainsi, la présence de Paris ne pèse pas dans le rapport de ces
personnes à l’aéroport : comme si Paris était la périphérie et que c’était l’aéroport qui en
était le centre.
Cet effet de périphérie se retrouve pour une troisième catégorie d’individus. Jean-
Baptiste Frétigny met en exergue l’idée selon laquelle tout travail sur les frontières induit
un paradoxe : la frontière induit à la fois ouverture et blocage. Cela précipite l’impossibilité
pour des individus de franchir les murs de l’enceinte de l’aéroport puisqu’ils y sont refusés.
13 FRETIGNY Jean-Baptiste, « La frontière à l'épreuve des mobilités aériennes : étude de
l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle », Annales de géographie, 2013/2 (n° 690), p. 151-174
14 L’enquête de terrain sur ce sujet est présente en annexe 3 du mémoire.
17« Ce phénomène de fermeture renvoie à l’ambivalence constitutive de la frontière et
de la mobilité, qui hésitent toutes deux entre déplacement et blocage, entre
réalisation et potentialité. Au coeur de l’aéroport ressurgit la fonction de filtrage de
la circulation exercée par la frontière ».
De fait, pour des raisons que nous imaginons politiques, cette existence de l’aéroport
comme lieu de fermeture n’est pas invoquée dans les discours du Groupe ADP. Elle est
même éludée : « Les aéroports (…) seront toujours des lieux de vie permettant l’inclusion,
l’ouverture à soi et au monde », explique Augustin de Romanet dans une interview donnée
à l’occasion du rapport d’activité 2018. En effet, la visibilité que nous avons de cette réalité
est celle dans les discours qui portent sur la sécurité et sur le profilage des individus. Le
rapport d’activité 2018 fait état de la présence de « Parafe » à l’aéroport, quatre-vingt
seize au total, qui sont des portiques qui permettent de scanner les passeports et
d’automatiser le passage des frontières. Or, cette innovation à l’aéroport n’est destinée
qu’à une partie des voyageurs : les ressortissants de l’Union Européenne, de la Suisse, de
l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. La présence de tels dispositifs automatisés
créerait donc un effet de fermeture aux personnes qui ne viennent pas de ces pays. En
s’ouvrant facilement à certains, les portiques se ferment pour d’autres. C’est ainsi que
l’aéroport est à réfléchir comme porte d’entrée vers Paris, mais également comme un lieu
qui ne connaît pas de continuité. Cela s’inscrit, dans une bien autre mesure, également
pour les voyageurs en escale, qui passent par Paris mais ne s’y arrêtent pas. Ces
voyageurs sont concernés par l’objet de notre seconde sous-partie.
b. Un espace touristique parisien à part entière
Paris est une ville qui compte un certain nombre de monuments, qu’il s’agisse de la
Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe ou de Notre-Dame. Ce sont des monuments dont
l’architecture et les liens avec l’Histoire leur procurent une aura toute particulière. Ces trois
monuments symboliques possèdent par ailleurs une architecture qui à chaque fois a
constitué une performance technique et remarquable.
Mais d’autres lieux font partie de l’histoire de la capitale, qu’il s’agisse de musées à
visiter certes, mais aussi de grands magasins et de boutiques, dont la finalité, mercantile,
ne se détache pas d’un effet emblématique. Ces lieux sont chargés d’histoire et disent
quelque chose de Paris.
Car nombre de grands magasins constituent le paysage culturel français à
l’international, et sont très connus, comme les Galeries Lafayette ou le Bon Marché,
18Vous pouvez aussi lire