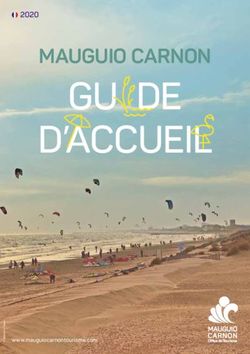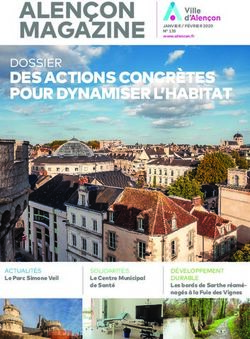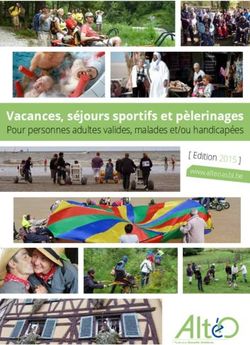COMMERCE DE URGENCE POUR LE - ANDRÉ ANTOINE - André Antoine
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ANDRÉ ANTOINE LES CAHIERS DE LA PRÉSIDENCE DU PARLEMENT DE WALLONIE URGENCE POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 1
TABLE DES MATIÈRES
L’ÉDITO............................................................................................................................................................. 4
LE COMMERCE DE PROXIMITE DANS L’IMPASSE.................................................................................................... 6
DES CENTRES HABITÉS PEU ATTRACTIFS.......................................................................................................... 8
UN GRAND COMMERCE INSUFFISAMMENT ENCADRÉ......................................................................................... 16
UN COMPORTEMENT D’ACHAT CONTRASTÉ....................................................................................................... 23
UN E-COMMERCE QUI SE DÉVELOPPE.............................................................................................................. 28
UN MÉTIER DE COMMERÇANT QUI SE COMPLEXIFIE.......................................................................................... 31
NOTRE AMBITION POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ........................................................................................ 40
DE VÉRITABLES CENTRES COMMERÇANTS........................................................................................................ 42
UNE RÉGULATION DU GRAND COMMERCE........................................................................................................ 44
UNE PROMOTION DU COMMERCE LOCAL......................................................................................................... 49
UN PARTENARIAT E-COMMERCE...................................................................................................................... 51
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’INITIATIVE DE PROXIMITÉ.......................................................................... 52
Accompagnement du commerçant.............................................................................................................. 52
Amélioration du cadre légal et fiscal............................................................................................................ 54
SYNTHÈSE DE NOS PROPOSITIONS...................................................................................................................... 56
CONCLUSION..................................................................................................................................................... 60
RETROUVER CE CAHIER EN LIGNEL’ÉDITO
L
a désertification des centres habi- boucher qui ferme son commerce pour
tés est une réalité à laquelle nous aller travailler dans une grande surface
sommes régulièrement confrontés.
Elle est visible au quotidien par la multipli- Cette réalité est souvent exprimée par
cation des cellules vides ou la fermeture les associations de commerçants, mais
des enseignes dans nos villes et villages aussi corroborée par les chiffres. Ainsi,
de Wallonie : c’est le libraire qui fait fail- entre 2010 et 2015, le taux de cellules
lite, le boulanger qui part à la retraite et vides en Wallonie est passé de 14,8 %
ne trouve pas de repreneur, ou encore le à 17 %.
4Outre l’impact économique de ces fer- privés. Toutefois, il est de la responsa-
metures, les difficultés du petit com- bilité des pouvoirs publics d’organiser
merce sont lourdes de conséquences sur une concurrence équitable, de soutenir
la vie des commerçants, qui subissent les comportements d’achat vertueux et
directement ces ennuis financiers, com- d’assurer la qualité de vie en centre-ville
me sur celle des citoyens. Le petit com- et centre-village. À cette fin, il convient
merce est en effet garant d’un service et notamment d’adapter le cadre légal aux
d’un conseil personnalisé, mais aussi por- réalités de terrain et d’apporter le cas
teur d’un lien de confiance. Par sa proxi- échéant un soutien technique et finan-
mité avec les noyaux habités et les petits cier aux PME, afin qu’elles réalisent leur
producteurs, il permet le recours à une transition numérique. Pour être cou-
mobilité alternative à la voiture et joue un ronnée de succès, cette politique devra
rôle dans le développement des circuits impliquer tous les acteurs, qu’ils soient
courts. Enfin, en maintenant une réelle vi- commerçants, associations ou citoyens-
talité dans nos agglomérations, le petit consommateurs.
commerçant joue pleinement son rôle
sociétal, car il participe à un sentiment de Par ce cahier, nous entendons remettre
sécurité, il permet les échanges et il as- le commerce de proximité au centre des
sure un lien social entre tous les citoyens. débats, et inviter l’ensemble des respon-
Ces caractéristiques font du commerce sables à travailler à sa redynamisation. Il
de proximité un enjeu politique majeur est indispensable de transformer les dif-
pour les pouvoirs publics. ficultés que les petits commerçants ren-
contrent en opportunités, afin qu’ils
Différentes catégories de facteurs expli- remplissent durablement leur rôle es-
quent les difficultés que vivent les petits sentiel dans la vie de nos villes, de nos
commerçants. Ainsi, le manque d’attra- villages et surtout de nos concitoyens. Il
ctivité des centres habités pousse les s’agit de garantir notre bien-vivre à tous,
consommateurs à leur préférer de grands en assurant une diversité de l’offre, une
centres commerciaux périphériques. En qualité du service, mais également un en-
effet, ceux-ci répondent davantage aux vironnement agréable, loin de l’omnipré-
habitudes contemporaines de consom- sence de surfaces commerciales autour
mation et ont tendance à se multiplier à des agglomérations et des immenses
la faveur d’une législation toujours plus parkings qui les accompagnent.
permissive. Par ailleurs, le développe-
ment de l’e-commerce illustre une ten- L’approche des fêtes de fin d’année
dance générale à la complexification du constitue assurément un moment idéal
métier de commerçant, particulièrement pour s’interroger sur la pertinence et
lourde pour les petites structures. la cohérence de nos choix, à l’heure où
nous fréquentons les commerces pour
Certes, le commerce est d’abord et avant acheter des cadeaux, garnir le sapin ou
tout une question qui relève des acteurs la table du réveillon.
5Q
ue l'on habite en ville ou en milieu des villages. Outre une évidente fonc-
rural, nous constatons régulière- tion de service (fourniture de biens de
ment que des petits commerces consommation quotidienne à la popu-
ferment et ne sont pas remplacés. Dès lation locale), il joue aussi un rôle de lien
lors un véritable cercle vicieux s’enclen- et de contrôle social, notamment pour
che dans les centres habités, où les cel- les personnes seules. En cela, il donne
lules vides se multiplient, l’offre com- aux centres-villes et centres-villages leur
merciale se raréfie et la fréquentation fonction de générateurs de liens sociaux
baisse. Les habitants n’ont plus d’autre et d'échanges1 . Le commerce de proxi-
choix que de prendre leur voiture pour mité est par ailleurs garant d'un lien de
faire leurs courses dans de grandes sur- confiance, d'une qualité particulière, d'un
faces ou des shopping centers périphé- service personnalisé et amplifie le déve-
riques, augmentant ainsi les difficultés loppement des circuits courts. Enfin, il fa-
des commerçants restants. cilite le recours à une mobilité alternative
et joue donc un rôle important dans les
Les facteurs déclenchant ce cercle vicieux solutions de mobilité et d'environnement.
recouvrent en réalité un large faisceau de
problèmes qui se renforcent mutuelle- Étant donné ces fonctions primordiales,
ment. La littérature sur le sujet identifie il est indispensable pour les pouvoirs
cinq grandes problématiques que sont : publics d’enrayer le déclin du commerce
le manque d'attractivité des centres habi- de proximité, en agissant sur les cinq
tés, l'insuffisante régulation des implanta- problématiques identifiées ci-dessus.
tions commerciales, l'évolution des com- En effet, malgré un contexte de reprise
portements d'achat, le développement économique, un certain nombre de sec-
de l'e-commerce et enfin la complexifica- teurs commerciaux connaissent tou-
tion du métier de commerçant. jours d'importantes difficultés, comme
l'illustre la hausse du nombre de faillites
Or, le petit commerce remplit des fonc- en Belgique, en particulier dans le sec-
tions essentielles dans la vie des villes et teur de l'Horeca 2 .
1
En ce sens, le CEPESS utilise la notion de « linking cities » dans différentes études. Voy.
notamment A. de Borman et J. Dagnies, « Linking Cities, l'avenir des villes au 21e siècle »,
Le Soir, 4 novembre 2015.
2
Cette hausse de 5,8 % entre novembre 2016 et novembre 2017 conduit au chiffre record
de 956 dépôts de bilan en un mois. Voy. « Pic de faillites en novembre », trends.levif.be,
1er décembre 2017.
7DES CENTRES HABITÉS d’une approche concertée, visant à met-
PEU ATTRACTIFS tre en œuvre des mesures conformes
aux besoins des usagers, des citoyens
Les centres-villes et centres-villages et des commerçants, qui vont souvent
connaissent un manque d'attractivité de au-delà des idées reçues. Par exemple,
leur environnement commercial, notam- la caractère payant du stationnement
ment dû à un problème d'accessibilité, à en centre-ville peut s’avérer positif pour
un manque de confort par rapport aux le commerce, en ce qu’il permet une ro-
centres commerciaux, ou encore à de lon- tation indispensable à la venue des cli-
gues et régulières phases de travaux pu- ents 4 . L'amélioration ou la création de
blics. Ils peuvent également générer un places de parkings publiques peut, elle,
sentiment d'insécurité, qui se renforce à notamment être financée, comme c'est
mesure que leur fréquentation baisse. le cas dans certaines communes wal-
lonnes 5 , par une taxe sur les nouvelles
Relevons en particulier qu’il y a déjà constructions ne comportant pas d'em-
près de dix ans, le stationnement était placement de parking.
jugé problématique pour 55 % des com-
munes en Wallonie. Cette proportion Par ailleurs, le manque d’attractivité
s’élevait même à 81 % pour les communes commerciale est également renforcé
de plus de 20 000 habitants. La poli- par un phénomène de suppression des
tique de stationnement constitue non services d’utilité publique dans les cen-
seulement un outil de mobilité, mais tres-villes et centres-villages. Il est par
aussi de développement local, de fi- exemple frappant de constater qu’en
nancement pour la commune, ou en- Brabant wallon, 5 communes sur 27 ne
core de gestion de l’espace public en disposent que d’un seul distributeur
général 3 . Dès lors, elle doit faire l’objet automatique de billets6 . De même, la
3
Voy. la présentation de T. De Schutter, directeur de département à l’UVCW, dans le cadre
de la journée d’étude « La gestion du stationnement en Belgique », organisé par l’AVCB
le 13 novembre 2008. http://www.avcb-vsgb.be. Ce problème est encore accentué par
l’augmentation du nombre de véhicule prévu en Wallonie : + 3,2 % entre 2014 et 2016.
Voy. www.statbel.fgov.be
4
Voy. «Brabant wallon: les centres-villes se réinventent pour ne pas mourir», Le Soir, 20 octobre 2017.
5
C 'est notamment le cas de la commune de Wavre qui a introduit une telle taxe en 2011. Voy.
le règlement de la taxe sur l'absence d'emplacement de parcage sur : http://www.wavre.
be/index.php/telechargez-documents/category/5-documents-du-service-des-taxes
6
Voy. « 164 distributeurs en Brabant wallon, un seul dans cinq communes », lavenir.net, 18
novembre 2017.
8Le stationnement jugé
problématique pour
81 % des communes
en Wallonie* * pour les communes de plus de 20 000 habitants
9suppression annoncée de certaines jus- d’alarme début 2017, après la dispari-
tices de paix, ou encore les fermetures tion en 2016 d’un nombre important de
régulières de bureaux de poste jugés commerces en centre-ville 9 . Les villes
trop peu rentables constituent autant wallonnes qui se portent le mieux sont
de facteurs participant à une diminu- celles de Louvain-la-Neuve, Waterloo,
tion drastique du nombre de clients po- Malmedy et Bastogne 10 .
tentiels dans les rues commerçantes.
Face à la diminution de fréquentation
dont ce manque d'attractivité est la
cause (la diminution des flux piétons
dans les centres-villes wallons a atteint
16,5 % entre 2009 et 20177), beaucoup
de petits commerçants se voient obligés
de cesser leur activité. Si ce phénomène
est visible par tout un chacun dans la
multiplication des « cellules vides », il est
confirmé par les statistiques disponibles.
Le taux de cellules vides en Wallonie
est ainsi passé de 14,8 % en 2010 à 15,1 %
en 2012 et 17 % en 20158 . Les villes les
plus touchées sont Mouscron, Verviers
et Charleroi, comme l’illustre l’infogra-
phie qui suit. Namur et Liège semblaient,
jusqu’en 2015, résister à cette tendance
grâce à une stratégie de maintien de l’hy-
percentre. Toutefois, l’association namu-
roise des commerçants a tiré la sonnette
7
Voy. Doc. Parl., Parlement de Wallonie, session 2016-2017, CRIC n°152, 18 avril 2017, p. 3.
8
Voy. G. Devillet, M. Jaspard, J. Vasquez Paras, Atlas du commerce en Wallonie : struc-
tures, dynamiques, comportements spatiaux des consommateurs, Liège, 2014, p. 46. Ces
chiffres couvrent tout le commerce aggloméré, mais, parmi les commerces isolés, seule-
ment ceux de 400 m2 et plus.
9
113 en 2016, un record. Voy. Y. Van Looveren, « Déclin du commerce dans le centre-ville de
Namur », 6 mars 2017, sur www.retaildetail.be
10
Chiffres de l’AMCV cités par J. Dagnies et M. Goelff, op.cit., p. 17.
10Taux de vacance commerciale dans plusieurs centres-villes wallons en 201511
CHARLEROI
VERVIERS
MOUSCRON
LOUVAIN-LA-NEUVE
TOURNAI
LA LOUVIÈRE
ARLON
11
Voy. C. Legrand, V. Clérin, « Wallonie : les rues commerçantes de plus en plus désertées »,
RTBF, 3 septembre 2015.
11Ce phénomène ne touche cependant globale du nombre de commerces. En
pas que notre région, puisque la Belgi- Belgique, cette diminution a atteint 48 %
que dans son ensemble, mais également entre 1947 et 2015. Elle était de 2,5 % par
les pays voisins, sont concernés. Entre an entre 1947 et 1961, de 0,5 % entre 1961
2007 et 2015, le taux de cellules vides en et 2010, puis de 0,9 % entre 2010 et 201515 .
Belgique est ainsi passé de 5 % (ce qui
correspond au taux de rotation habituel) Face à ce constat sans appel, les pou-
à un peu plus de 9 % 12 . voirs publics ont déjà pris des mesures
pour agir sur l'environnement commer-
En France, en 2015, plus de 50 % des cial des centres habités.
cœurs des villes moyennes (moins de
100 000 habitants) présentaient un La Wallonie a notamment élaboré en
taux de commerces vides supérieur à 1997 un cadre permettant la création
10 % . Citons également le Royaume-
13
d'organismes locaux de développement,
Uni, l’Italie ou l’Espagne parmi les pays œuvrant à l'amélioration de l'attractivité
dont le commerce de proximité con- des centres16 . L'Association de Manage-
naît des difficultés. Au Royaume-Uni, ment Centre-Ville a ainsi initié le con-
les prévisions suggèrent que le nom- cept de cellules de Gestion centre-ville
bre de commerces de proximité va di- (GCV), pouvant être mises sur pied dans
minuer de 22 % entre 2015 et 2018 14 . Un des zones urbaines de plus de 20 000
autre indicateur alarmant est la baisse habitants17. Dans les zones rurales, ces
12
Idem, p. 18. Pour le CRISP, « les commerces vides ne sont que la partie émergée de la
désaffection commerciale. Au cours du temps, de nombreux commerces ont été trans-
formés en logements ou en une autre fonction, ou le bâtiment a été démoli ». J.P. Grim-
meau et B. Wayens, Crisp, op.cit., p. 106.
13
Voy. C. Prudhomme, « Le déclin commercial des centres-villes s’aggrave », Le Monde, 20
octobre 2016.
14
Voy. Center for Retail Research, Retail Futures 2018, 2013.
15
Voy. J.P. Grimmeau et B. Wayens, Crisp, op.cit., p. 9.
16
Via la création de l'Association de Management Centre-Ville (AMCV).
Voy. http://www.amcv.be.
17
Voy. la page sur la gestion de centre-ville sur le site Internet de la DGO6: http://emploi.
wallonie.be/home/developpement-local/gestion-centre-ville.html
12organismes prennent la forme d’Agenc-
es de développement local (ADL) 18 .
Les missions de ces organismes sont no-
tamment de renforcer la compétitivité
des centres habités, d'en améliorer l'en-
vironnement commercial, de réunir l'en-
semble des acteurs locaux au sein d'un
partenariat et d'identifier les besoins et
les potentialités locales afin de dévelop-
per des projets adaptés19
Ces associations ont développé une
expertise unique concernant ces prob-
lématiques. Elles travaillent en parallèle
avec les groupements d'animation com-
merciale (GAC), dont le travail est à
encourager, et constituent un relais es-
sentiel pour les pouvoirs publics dans
l'élaboration et la mise en œuvre de
leurs politiques.
18
Les ADL agissent dans les zones rurales,
pour des territoires de moins de 40 000
habitants, regroupés sur une ou plusieurs
communes. Voy. http://emploi.wallonie.
be/home/developpement-local/agenc-
es-de-developpement-local.html.
19
Voy. notamment l’article 3 du décret wal-
lon du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et
à l’octroi de subventions aux agences de
développement local ainsi que la page sur
La baisse globale du
les agences de développement local sur nombre de commerces
le site Internet de la DGO6 : http://emploi.
wallonie.be/home/developpement-local/
a atteint 48 % entre 1947
agences-de-developpement-local.html et 2015
13Elles bénéficient à ce titre d'un soutien
régional indispensable, sous forme d'une
subvention annuelle de fonctionnement20
et d'aides à l'emploi21 . En outre, les com-
munes doivent contribuer financière-
ment à hauteur de 30 % du montant de la
subvention régionale.
L'action de ces organismes concerne
l'ensemble des aspects touchant à l'en-
vironnement commercial. La stratégie
régionale Digital Wallonia 22 met, quant
à elle, l'accent de manière spécifique sur
le développement du recours au numé-
rique dans la gestion urbaine, autour du
concept de Smart Cities23 . Le numérique
permet en effet la coordination des flux
de trafic, l'optimisation de l'utilisation des
transports en commun, ou encore l'amé-
lioration de la communication quant à
la mobilité. Le développement de cette
stratégie numérique est donc essentiel à
l'amélioration de l'environnement urbain.
20
Q ui couvrent ses frais de fonctionnement
et la rémunération d'un agent (deux pour
les ADL).
21
Aides à la promotion de l'emploi (APE), Pro-
gramme de transition professionnelle (PTP),
Conventions de premier emploi (CPE).
22
Stratégie numérique de la Wallonie. Voy.
site de l’Agence du Numérique : http://
w w w. aw t. b e/we b/aw t /in d ex . aspx?-
page=awt,fr,foc,100,064.
23
Le concept de SmartCities englobe l'en-
semble des mesures visant à développer
le numérique dans l'ensemble des as-
pects de la gestion urbaine.
14Au niveau politique, l'importance de l'at- de résultats. Elle prévoit aussi l'adoption
tractivité des centres-villes et du com- d'un dispositif encadrant le bail commer-
merce de proximité semble faire l'objet cial de courte durée. Enfin, le ministre
d'un large consensus. Ainsi, la majorité Jeholet a récemment affirmé sa volonté
précédente avait adopté le Plan Wal- d’ajuster certaines mesures du Plan Wal-
lonie Commerce 24 , dont deux des axes lonie Commerce, afin qu’elles puissent
qu'il développe concernent l'environne- sortir leurs effets à la fois dans les centres
ment commercial 25 . urbains et dans les zones rurales26 .
Plus récemment, la Déclaration de poli- Signalons encore que plusieurs pays voi-
tique régionale 2017-2019 propose que sins ont élaboré des politiques de redyna-
soit rapidement initié un programme misation des centres-villes. Les Pays-Bas
transversal de soutien aux commerces de ont par exemple mis au point un Retail-
proximité, qui soit coordonné avec des Agenda définissant 20 orientations à
mesures de redynamisation des centres suivre pour soutenir le commerce de
urbains et ruraux wallons mises en œuvre proximité27. Il se base pour sa mise en
par les ASBL de Gestion centre-ville. Par œuvre sur un RetailDeal impliquant les
ailleurs, la DPR encourage la constitution municipalités, acteurs essentiels en la ma-
de groupements d’animation commer- tière. Le Royaume-Uni, de son côté, a ini-
ciale, rassemblant la majorité des com- tié en 2011 une grande réflexion associant
merçants d’une zone en leur octroyant également les communautés locales28 .
une base légale intégrant des objectifs
24
Présenté en décembre 2016 par le Gouvernement wallon en collaboration avec la Cellule
d’intelligence économique des outils financiers, l’AMCV et la Direction des implantations
commerciales. Le Plan Wallonie Commerce dispose d’un budget de 30 millions d’eu-
ros d’ici à 2019. Il est disponible sur http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/
Implantations_commerciales/Doc/Doc2017/Wallonie%20Commerce%20plan.pdf
25
Comme le soutien à des projets d'Innovation Design, destinés à améliorer l'attractivité
de l'espace public.
26
Voy. Réponse du ministre de l’Économie, M. Jeholet à une question écrite de M. Culot du
26/10/2017 sur « La raréfaction du commerce de proximité » session 2017-2018, année
2017, n°87 (2017-2018).
27
Voy. http://onsretailland.nl/retailagenda/
28
Le rapport qui en a résulté s'intitulait « The Mary Portas Review ». Voy. « The Portas Re-
view : 5 Years on », Hitachi Capital (UK) Plc, sur hitachicapital.co.uk
15UN GRAND COMMERCE
INSUFFISAMMENT
ENCADRÉ
Le problème de l'attractivité des
centres-villes est d'autant plus prégnant
que ceux-ci sont concurrencés par les
grands commerces périphériques dont
l'offre ne cesse de s'accroître. Si ce déve-
loppement est certes causé par l'évolu-
tion de la demande (voir page 23), il est
amplifié par la libéralisation de la législa-
tion sur les implantations commerciales.
Cette libéralisation a eu d'importantes
répercussions. Elles apparaissent no-
tamment en comparant l'évolution de la
superficie commerciale totale avec celle
du nombre de petits commerces. Entre
2010 et 2014, la surface nette de vente
de l’ensemble des commerces en Wallo-
nie a augmenté de 473 055 m2, passant
dès lors à plus de 6 millions de m2. Ainsi,
si la superficie moyenne des commerces
de détail (soit l'ensemble des magasins
vendant des biens de consommation
courante aux particuliers) en Wallonie 29
atteignait déjà 1090 m2 en 2010, elle
était de 1140 m2 en 2013.
De 2005 à 2013,
le nombre de petits
commerces a baissé de
5,4 % en Wallonie
29
Hors secteur alimentaire. Chiffres SPF
Économie.
16Cela correspond à une croissance de nées '60. Pour le résoudre, le législateur
7,3 %, qu’il faut comparer à celle de la po- avait alors introduit un examen de l'im-
pulation qui est de 2,2 %30. Or, de 2005 pact socio-économique du projet com-
à 2013, le nombre de petits commerces mercial dans la procédure d'octroi de
(entendu ici comme une entreprise de permis, par la loi du 29 juin 1975 33 , dite
moins de 10 employés dans le secteur du « loi cadenas ». Toute nouvelle implan-
commerce) a baissé de 5,4 % en Wallo- tation commerciale nécessitait donc un
nie (17,5 % en Flandre) 31 . Il apparaît donc double permis : un permis d’urbanisme
une double tendance à la diminution du et un permis socio-économique 34 .
nombre de commerces, d’une part, et à
l’augmentation importante de la super- Mais la loi de 1975 a été remplacée par
ficie commerciale moyenne d’autre part. la loi du 13 août 2004, dite loi « Ikea » 35 .
Cela traduit la réduction de la part des Elle a diminué la durée de la procédure,
petits commerces situés généralement élargi les possibilités de recours des de-
dans les centres urbanisés, par rapport mandeurs, mais surtout, rendu consulta-
aux surfaces plus larges des périphéries32 . tif l'avis du Comité socio-économique 36 .
Le problème de l'accroissement du nom- L'assouplissement de l'octroi de permis
bre de grandes surfaces n'est pas neuf, a du reste été confirmé en 2006, avec
puisqu'il se présentait déjà dans les an- la directive européenne 2006/123/CE
30
Voy. l’audition de M. Bianchet, chercheur pour la CPDT (Conférence permanente du
Développement territorial). Voy. Doc. Parl., Parlement de Wallonie, session 2016-2017,
CRIC n°152, 18 avril 2017, p. 28.
31
Voy. J. Dagnies et M. Goelff, Quel avenir pour le commerce en centre-ville ?, Policy Paper
du CEPESS, avril 2016, p. 11.
32
Idem, p. 13.
33
Voy. B. Lombaert et I. Mathy, « La loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implanta-
tions commerciales », in G. Benoit, C. Delforge, P. Jadoul, G. Rommel et M. Vlies (dir.), Le
bail commercial, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 624.
34
Voy. B. Assouad, « Avec Bolkestein, la boulimie commerciale continue: il faut que ça
cesse », sur le site de la Fédération Inter-Environnement Wallonie, www.iewonline.be, 6
mars 2010.
35
Voy. B. Lombaert et I. Mathy, op. cit. p. 627.
36
Voy. « La loi Ikea a un an : record d’implantations commerciales autorisées, La Libre Bel-
gique, 26 avril 2006.
17relative à la liberté d'établissement (dite du territoire qui doit pouvoir justifier
« Services » ou « Bolkestein ») , qui a 37
des restrictions aux libertés fondamen-
interdit le recours par les autorités pu- tales »40 . Cet argument est notamment
bliques à un « test économique » . 38
utilisé depuis lors par l’Allemagne pour
défendre une politique limitant stricte-
Cette libéralisation a donc touché toute ment les implantations commerciales
l'Union européenne. Il faut toutefois si- hors des centres-villes 41 . Recourir à cet
gnaler qu’il existe un avis motivé de la avis a permis à l’Allemagne de voir seu-
Commission européenne, adressé à la lement 33 % du chiffre d’affaires du com-
France le 15 décembre 2006 39
et qui re- merce se réaliser en périphérie, contre
connaît que, concernant les « produits et 62 % en France !
services de base satisfaisant un besoin
immédiat ou quotidien », « l’accessibili- La 6e réforme de l’État a transféré la com-
té des commerces pour tous, y compris pétence des implantations commerciales
les personnes habitant dans des zones aux entités fédérées. La Wallonie a, depuis
rurales, ou celles ne disposant pas de lors, adopté le décret du 5 février 201542 ,
moyen de transport, est un objectif qui instaure divers mécanismes visant à
d’intérêt général lié à l’aménagement rétablir une régulation des projets d'im-
37
Concernant les implantations commerciales, la loi qui transpose cette directive a été
votée le 22 décembre 2009 par le Parlement fédéral. Voy. B. Assouad, op.cit.
38
En effet, trois des quatre critères utilisés par la commission fédérale pour fonder ses avis
ont été jugés contraires à la directive, car d’ordre économique : les intérêts des consom-
mateurs ; l’influence du projet sur l’emploi, les répercussions du projet sur le commerce
existant. Ils ont été remplacés par : la protection de l’environnement urbain, la protection
du consommateur, le respect de la législation sociale. Le seul critère n'ayant pas subi de
modification était celui de la localisation spatiale. Voy. B. Assouad, op.cit.
39
Suite à une plainte déposée par une chaîne de maxi-discount auprès de la Commission
européenne contre la réglementation française, jugée discriminatoire. Avis motivé de la
Commission européenne 36/2006.
40
La Commission précise que cela ne s’applique qu’aux « produits et services de base
satisfaisant un besoin immédiat ou quotidien », afin de viser le maintien d’une offre com-
merciale de base et de proximité.
41
Voy. « Quand l’Allemagne défend ses centres-villes contre l’Union européenne », Le
Courrier des Maires et des élus locaux, 16 août 2016.
42
Voy. http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/im-
plantations.html
18plantation commerciale, dans les limites
du droit européen43 . Il crée notamment
une administration des Implantations
commerciales, dirigée par un Fonction-
naire des Implantations commerciales.
Celui-ci est compétent lorsque :
le projet d'implantation commerciale
est situé sur le territoire de plusieurs
communes ;
la surface commerciale nette de l'im-
plantation commerciale est supé-
rieure à 2500 m2 ;
l'extension d'un établissement de
commerce de détail ou d'un ensem-
ble commercial engendre une sur-
face commerciale nette supérieure à
2500 m2.
43
Par « projet d'implantation commerciale »,
le décret entend un « projet de construc-
tion nouvelle, d'ensemble commercial,
d'extension d'un établissement de com-
merce ou d'un ensemble commercial, un
projet d'exploitation d'un ou plusieurs
établissements de commerce ou un
projet de modification importante de la
nature de l'activité commerciale d'une
surface commerciale nette supérieure à
400 m2 ». Art. 1er du Décret du 5 février
2015 sur les implantations commerciales.
Voy. Art. 28 du Décret du 5 février 2015
sur les implantations commerciales.
19En dehors ce ces cas, le collège commu- Pour prendre sa décision, l'autorité com-
nal de la commune sur le territoire de la- pétente s'appuie sur le Schéma régional
quelle est situé le projet d'implantation de développement commercial, vaste
commerciale est compétent pour déli- outil d'analyse, de cartographie et d'aide
vrer le permis 44 . à la décision. Il vise à « fournir des réfé-
rences quantitatives à l'autorité qui sera
L'autorité prend sa décision au regard chargée de délivrer une autorisation
des critères suivants 45 : d'implantation commerciale, afin de per-
mettre une évaluation objective et cohé-
la protection du consommateur ; rente des nouveaux critères et sous-cri-
la protection de l'environnement urbain ; tères » et ce, afin de structurer le paysage
les objectifs de politique sociale ; commercial47. Il est issu d'une volonté
la contribution à une mobilité plus
régionale de « défendre le commerce
durable. de proximité et sa réimplantation dans
les quartiers d'habitation, et de garan-
Le décret a également créé l'Observa- tir une offre diversifiée dans les noyaux
toire du commerce, qui a pour mission commerçants »48 . L'actuel schéma a été
de rendre des rapports, avis, observa- approuvé par le Gouvernement wallon
tions ou suggestions dans les cas prévus en date du 27 novembre 2014 et doit en
par le décret 46 . principe être renouvelé tous les cinq ans.
44
Les projets d’extension d’une implantation commerciale ne dépassant pas 20 % de la
surface commerciale nette existante, avec un plafond maximum de 300 m2 de surface
commerciale nette supplémentaire, ne sont soumis qu'à une déclaration préalable écrite
et expresse. Il en va de même pour les projets de déménagement d’une implantation
commerciale dans un rayon d’un kilomètre de son implantation, sur le territoire d’une
même commune, et ne dépassant pas 400 m2 de surface commerciale nette.
45
Au vu de ces critères, le rapport sur la revitalisation commerciale des centres-villes de
l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du dé-
veloppement durable considère la politique wallonne en matière d’implantations com-
merciales comme restrictive, au regard de la législation en vigueur dans les autres pays
européens étudiés (excepté l’Allemagne).
46
Voy. http://www.cesw.be/index.php?page=detail-2&alias=Observatoire-du-commerce
47
Voy. Réponse du ministre de l’Économie, M. Marcourt, du 4/11/2013 à une question écrite
du M. Mouyard du 1/08/2013 sur « La mise en œuvre du Schéma régional de développe-
ment commercial (SRDC) session 2012-2013, année 2013, n°341 (2012-2013).
48
Voy. la Déclaration de politique régionale 2009-2014.
20Le Schéma régional de développement Au 6 février 2017, 316 dossiers de permis
commercial peut être décliné au niveau ont été reçus, portant sur une superficie
communal via le Schéma communal de de 958 000 m2 51 .
développement commercial. Il permet
une analyse du territoire communal en Selon Jean-Claude Marcourt, alors mi-
matière d'aménagement du territoire et nistre wallon de l'Économie, le pour-
le développement d'une stratégie com- centage de dossiers autorisés et la taille
munale en matière commerciale. La lour- moyenne de ceux-ci, sous le régime
deur et le coût de la procédure ont ce- du décret du 5 février 2015, sont plus
pendant pour conséquence qu'aucune faibles que sous l’ancienne loi de 2004 52 .
commune wallonne n'a jusqu'à présent Il introduit donc une certaine régulation.
finalisé un tel schéma 49 . Au vu du déclin continu du commerce de
proximité, causé notamment par le dé-
Les chiffres disponibles permettent de veloppement de centres commerciaux
dresser un premier bilan de la capaci- périphériques, cette capacité régulatrice
té régulatrice du décret de 2015. Ainsi, semble toutefois encore insuffisante.
au 1er juillet 2016, soit un an après l'en-
trée en vigueur du décret, 168 dossiers À cet égard, relevons que la DPR 2017-
avaient été reçus et traités par les ser- 2019 prévoit de fusionner le dispositif
vices du Fonctionnaire des Implanta- des permis d’implantation commerciale
tions commerciales. Ceux-ci représen- avec le dispositif des permis uniques,
taient une superficie de 473 027 m2 50 , qui regroupe un permis d’urbanisme et
soit une moyenne de 2815,16 m par pro-
2
d’environnement lorsque les deux sont
jet. Sur ces dossiers, 10 % ont été refusés nécessaires. L’objectif est de rationaliser
contre 71 % octroyés. À noter que les 19 % et de simplifier la procédure. Les travaux
restants concernent des dossiers aban- en ce sens sont en cours 53 . En outre, le
donnés ou irrecevables (17 %). ministre de l’Économie Pierre-Yves
49
Voy. « Schéma communal de développement commercial », SPW Économie, Namur, mai
2016.
50
Voy. DGO6, Think Retail ! Les analyses commerciales, partie 4, 2016.
51
Voy. Doc. Parl., Parlement de Wallonie, session 2016-2017, CRIC n°152, 18 avril 2017, p. 13.
52
Voy. réponse du ministre de l’Économie, M. Marcourt, du 27/10/2016 à une question
écrite de M. Destrebecq du 3/10/2016 sur « L'Observatoire wallon du commerce », n°19.
53
Voy. Réponse du ministre de l’Économie, M. Jeholet à une question orale de M. Henry du
10 octobre 2017 sur « Les permis d'implantation commerciale » session 2017-2018, année
2017, n°14 (2017-2018).
21Jeholet a précisé que le décret « im-
plantation commerciale » était en cours
d’évaluation, afin d’y apporter des amé-
liorations au regard des objectifs qui lui
sont assignés 54 . Au vu de la complexi-
té d’une telle réforme, elle sera pilotée
conjointement par les ministres de l’Éco-
nomie et de l’Aménagement du territoire.
À ce stade, aucune décision n’a toutefois
été prise par le gouvernement55 .
Enfin, à côté des zones de grand com-
merce périphériques, il faut également
citer le cas de quelques Zones d'activité
économique mixtes qui, en Wallonie, com-
prennent principalement des commerces
vendant des biens de consommation
courante. Elles sont pourtant initialement
destinées à accueillir les activités non
compatibles avec l'habitat56 . Il est dès lors
nécessaire d'en renforcer la régulation.
54
Voy. Réponse du ministre de l’Écono-
mie, M. Jeholet à une question écrite de
M. Culot du 26/10/2017 sur « La raréfac-
tion du commerce de proximité » session
2017-2018, année 2017, n°87 (2017-2018).
55
Voy. Doc. Parl., Parlement de Wallonie, ses-
sion 2017-2018, CRIC n°14, 10 octobre 2017,
pp. 1-2 et Réponse du ministre de l’Écono-
mie, M. Jeholet à une question écrite de M.
Culot du 26 octobre 2017 sur « La raréfac-
tion du commerce de proximité » session
2017-2018, année 2017, n°87 (2017-2018).
56
Voy. B. Mérenne-Schoumaker, « L'avenir
des zones d'activité économique en Wal-
lonie, réflexions et propositions », Terri-
toire en Mouvement, n°3, 2007.
22UN COMPORTEMENT aux changements urbanistiques : la
D'ACHAT CONTRASTÉ dissociation croissante entre la loca-
lisation des logements et des com-
merces 58 par une périurbanisation de
Si le développement du grand commerce l'habitat et l'augmentation du nombre
périphérique et l’offre supplémentaire de voitures.
qui en découle sont encouragés par la
libéralisation des implantations com- Il en résulte un transfert de la vitalité com-
merciales, ils sont également causés par merciale des centres-villes et centres-vil-
l'évolution de la demande. lages vers les centres commerciaux péri-
phériques. Relevons que cette mutation
Les comportements d'achat ont en effet de l’offre commerciale semble tout à fait
évolué de manière importante depuis convenir aux consommateurs. En effet,
plusieurs décennies. Le phénomène un récent sondage réalisé par RTL iVOX
s'explique par différents facteurs qui et Sudpresse révélait que l’offre commer-
agissent au niveau global. Nous pensons ciale au sein de leurs communes respec-
particulièrement : tives était le troisième motif de satisfac-
tion des citoyens francophones, avec une
aux changements sociologiques et note de 6,2/10. L’offre commerciale du
culturels : l'augmentation du taux d’em- Brabant wallon reçoit même une note un
ploi, qui diminue le temps disponible peu supérieure de 6,4/1059 .
pour réaliser ses achats, la progression
du travail rémunéré féminin, le déplace- Ces dernières années, l’on peut cepen-
ment des classes moyennes vers les pé- dant observer un tournant dans l'évo-
riphéries, ou encore la diminution de la lution de ces comportements d’achat,
proportion des dépenses des ménages grâce à une sensibilisation croissante
dans les commerces de détail57 ; aux enjeux écologiques, économiques
57
Voy. J.P. Grimmeau et B. Wayens, Crisp, op.cit., p. 69.
58
Diagnostic territorial de la Wallonie, CPDT, 2011. Notons qu’en France est entré en vigueur
le 13 juillet 2015 l’arrêté ministériel du 4 avril de la même année, limitant globalement à
la vente de produits du terroir et aux activités culturelles les dérogations à l’interdic-
tion des pré-enseignes. Ces dérogations s’appliquaient auparavant à de plus nombreux
secteurs : horeca, stations-service, centres commerciaux, etc. Voir l’arrêté du 23 mars
2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des préenseignes dérogatoires, dis-
ponible sur https://www.legifrance.gouv.fr. Nous pensons aussi au Drive Shopping.
59
Voy. « Notre grand baromètre des élections 2018 dans votre commune : découvrez les
premières indications à un an du scrutin (vidéo) », sudinfo.be, 7 octobre 2017.
23ou encore sanitaires de l'acte d'achat.
La demande envers des produits locaux,
bio et de saison augmente progressive-
ment60 , ce qui concerne évidemment les
commerces de proximité, proches des
producteurs locaux.
Il est primordial de soutenir ces compor-
tements et d’accompagner leur dévelop-
pement. Le travail qui doit être entrepris
ici est un travail de long terme, mais qui
pourra avoir une influence structurelle
sur cette demande. Il implique l’ensemble
des acteurs, tant locaux que globaux.
Il s’agit premièrement d’éducation per-
manente, d’actions culturelles et scolaires
sensibilisant à l’importance de changer
nos comportements. Ensuite, il convient
de soutenir le travail des associations lo-
cales de commerçants, qui sont à l’origine
de nombreuses initiatives permettant de
favoriser cette demande (mise en place
de système de cartes de fidélité, actions
de modernisation des commerces, ani-
mations commerciales, participation au
débat public pour améliorer l’attractivité
et l’accès aux commerces, etc.) 61 .
60
Voy. « Consommation et production bio : un
appétit grandissant », RTBF.be, 19 mai 2016.
61
La Déclaration de politique régionale
2017-2019 « La Wallonie plus forte » en-
tend à cet égard (p. 9) encourager les
groupements d’animation commerciale.
Dans ce but, elle propose de leur octroy-
er une base légale prévoyant, entre au-
tres, des objectifs de résultat.
24Enfin, il faut inclure dans cet axe les in-
citants directs à l’achat dans les com-
merces de proximité. Sur ce point, plu-
sieurs initiatives ont déjà été prises.
Parmi celles-ci, citons les chèques-com-
merces, créés par les communes elles-
mêmes ou les ADL. Il existe plusieurs
exemples de telles initiatives dans les
provinces de Luxembourg, de Liège ou
du Brabant wallon par exemple à Tenne-
ville, Sainte-Ode et Bertogne depuis
2012, à Perwez depuis mai 2014, à Houf-
falize et La Roche depuis le 29 mai 2017,
à Herstal depuis juin 201762 . Il s’agit de
chèques d’une valeur généralement limi-
tée à quelques euros (5,15 euros) favori-
sant leur utilisation pour les petits achats
et valables un an. Ils sont distribués par
la commune à diverses occasions (pour
des personnes âgées, pour fidélité au
parc à conteneurs, pour une naissance
ou un anniversaire de mariage), à la
place de ristournes sur la facture d’eau
des familles nombreuses ou de per-
sonnes à bas revenus, comme paiement
62
Sur les communes de Bertogne, Sainte-
Ode et Tenneville, plus de 8000 chèques
commerces ont été mis en circulation en-
tre décembre 2012 et juin 2016, représen-
tant plus de 75 000 euros injectés dans
les commerces participants. À Herstal, la
cellule de redynamisation du tissu com-
mercial urbain Urbeo Commerce a égale-
ment annoncé début juin 2017 le lance-
ment de chèques commerces locaux,
entre autres mesures visant à favoriser le
commerce local.
25de certains subsides, etc. Les communes merçants qui désirent utiliser ces mon-
ayant adopté le système voici plusieurs naies locales doivent signer une charte
années sont généralement satisfaites de prévoyant l’adhésion à certaines valeurs
son fonctionnement, même si quelques en rapport avec le développement du-
mois peuvent être nécessaires pour une rable. Il y a donc une dimension sociale
bonne intégration dans les habitudes et durable, favorisant l’artisanat, les ser-
des consommateurs . 63
vices locaux ou les circuits courts. Les
fast-foods, par exemple, ne sont donc
Ces incitants financiers peuvent égale- pas concernés. Enfin, relevons que ces
ment prendre la forme d'une monnaie monnaies locales ne bénéficient à l'heure
locale. Ce sont des monnaies complé- actuelle d'aucun soutien régional 65 .
mentaires à l’euro, valables dans une
commune ou un groupe de communes, Deux exemples de monnaies locales is-
émises par une association locale et uti- sus du Brabant wallon illustrent bien
lisables dans les commerces partenaires la plus-value de telles initiatives. Ain-
de l’action. Elles permettent de favoriser si, la première commune brabançonne
l’achat dans ces commerces locaux et wallonne à en avoir adopté une est
plus largement de développer une éco- Grez-Doiceau, en avril 2015, avec le
nomie locale. Elles ont généralement « Blé », à l’initiative de l’ASBL « Grez en
un cours fixe (1 euro = 1 unité de mon- transition ». Dès le début, ce projet a
naie locale) 64 et se développent depuis reçu un bon accueil des commerçants et
quelques années dans plusieurs pays des consommateurs. Les euros échan-
européens, mais également en Wallo- gés sont placés sur un compte éthique
nie. Aujourd’hui, dans notre Région, plus chez Triodos et les intérêts qui en dé-
d’une dizaine de projets de monnaie coulent sont réinvestis dans des pro-
locale sont actifs à travers toutes les jets locaux axés sur la transition. Cette
provinces ; d’autres sont en cours de dé- première initiative a été suivie par l’in-
veloppement. Généralement, les com- troduction du « Talent » à Ottignies-Lou-
63
« Tenneville : les chèques-commerces sont en circulation », www.tvlux.be, 31 décem-
bre 2012, et « La Roche et Houffalize: des chèques pour booster le commerce », www.
lameuse.be, 29 mai 2017.
64
Ces initiatives participent généralement de projets locaux plus larges dits « de tran-
sition », et dont l’objectif est de créer une dynamique de transition durable, écolo-
gique et sociale à travers différents types d’actions. Plusieurs de ces actions, on le voit,
concernent la problématique du commerce de proximité.
65
Malgré le travail effectué notamment par le réseau Financité. Voy. https://www.finan-
cite.be/fr/article/guide-pratique-des-monnaies-complementaires
26vain-la-Neuve, fin 2016 66 . Il a ensuite été monnaie s’engage à lui échanger les de-
étendu aux communes de Genappe, de vises excédentaires68 .
Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Gui-
bert et de Villers-la-Ville 67. Le Talent a
été adopté par près de 122 commerçants
et artisans sur l’ensemble des communes
qu’il couvre, dont 52 à Louvain-la-Neuve.
L’idée est non seulement de soutenir les
commerces locaux, mais également de
constituer un fonds local d’investisse-
ment, au service de la « transition écolo-
gique, économique et sociale du Brabant
wallon ». En outre, le Talent a bénéficié
de la collaboration du Crypto Group de
l’UCL, ce qui en fait une des monnaies lo-
cales les plus sécurisées au monde.
Ces initiatives doivent pouvoir être sou-
tenues, afin de renforcer le cercle ver-
tueux d'une relocalisation de l'offre.
Ainsi, la commune d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve a annoncé au mois de no-
vembre 2017 qu’elle effectuera doréna-
vant un certain nombre de transactions
au moyen de cette monnaie. Il sera par
exemple possible d’acheter les sacs
poubelles ou de louer des salles com-
munales avec des Talents, mais aussi de
s’acquitter de certaines taxes. Par ail-
leurs, la commune écoulera ses Talents
en effectuant un maximum d’achats au
niveau local et l’ASBL qui gère cette
66
Voy. « Le Talent, nouvelle monnaie locale lancée à Ottignies/Louvain-la-Neuve », Le Vif,
25 octobre 2016.
67
Mont-Saint-Guibert et Rixensart pourraient les rejoindre prochainement.
68
Voy. S. Grynberg, « La monnaie locale gagne la commune », La Capitale Brabant wallon,
15 novembre 2017, p. 7.
27Vous pouvez aussi lire