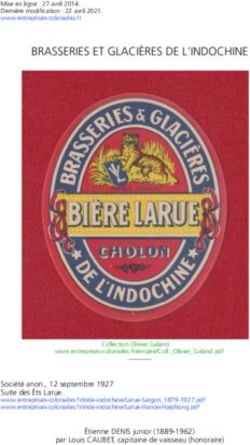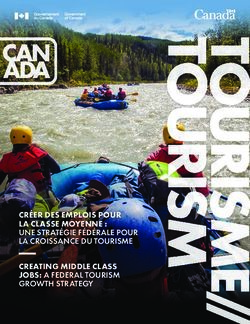Distance physique, proximité sociale et inégalités devant le chômage
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Distance physique, proximité sociale et inégalités devant le chômage
Emre KORSU, Sandrine WENGLENSKI1
Université Paris-Est
Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) – UMR INRETS 9403
19, rue Alfred Nobel, 77455 Marne-La-Vallée Cedex 2, France
Introduction
Les classes populaires sont de loin les principales victimes du chômage. En 1999, en France, 18%
des ouvriers non-qualifiés étaient au chômage contre 4% pour les cadres supérieurs. Les
théorisations de l’économie et la sociologie du travail ont apporté les explications majeures de
cette inégalité de risque de chômage. Mais, aux Etats-Unis, l’économie et la sociologie de la ville
ont également proposé des pistes théoriques pour expliquer ces différentiels. Deux facteurs
proprement urbains seraient susceptibles d’alimenter le chômage, et plus encore celui des classes
populaires.
Le premier facteur renvoie à une question de distance/dispersion : c’est l’hypothèse d’un « spatial
mismatch ». La dissociation croissante entre lieux d’habitat et lieux d’emploi serait source d’une
faible accessibilité à l’emploi pour les catégories d’actifs les plus modestes et les moins motorisés.
Les distances internes de la ville dispersée pèseraient sur le destin professionnel de ceux qui
contribuent le moins à en imprimer les formes. L’autre ressort urbain évoqué dans l’explication du
chômage des catégories populaires est associé au contraire à une question de
proximité/concentration et suggère l’existence de « neighbourhood effects ». La concentration des
ménages de catégories populaires dans les quartiers les plus dévalorisés de la ville serait
génératrice d’un environnement où, dans la proximité de chacun, domine un modèle de pauvreté
et de détresse sociale. Ces environnements quotidiens auraient des conséquences sur le destin
social des résidents. Autrement dit, la localisation résidentielle aurait des incidences en termes de
reproduction sociale.
Les analyses issues de ces traditions scientifiques ont suscité des débats d’autant plus vifs, outre-
atlantique, que leurs résultats alimentent nécessairement une discussion sur l’opportunité d’une
action publique de lutte contre la ségrégation. Le bilan est controversé (Gordon et al., 1989 ; Kain,
1992 ; Ihlanfeld et Sjoquist, 1998 ; Marpsat, 1999, Bacqué et Fol, 2007), mais plusieurs études ont
fourni des résultats corroborant l’hypothèse de variables spatiales « agissantes ». Dans le cas
français, les recherches empiriques sont beaucoup plus rares (Marpsat et Laurent, 1997 ; Choffel
et Delattre, 2003 ; Gaschet et Gaussier, 2003 ; Gobillon et Selod, 2004).
La présente contribution souhaite enrichir le corpus empirique existant en questionnant le rôle de
l’espace – et de la difficulté à s’en affranchir – dans le risque de chômage des actifs les plus
modestes, en explorant le cas de la région parisienne, grande aire urbaine de onze millions
d’habitants. On exposera (i) les fondements théoriques des hypothèses sur les effets de l’espace,
(ii) les partis pris méthodologiques retenus dans la présente recherche et le corpus des données
mobilisées2, puis (iii) les principaux résultats, qui feront l’objet (iv) d’une discussion finale.
1
Maîtres de conférences à l’Université Paris Est – Marne-la-Vallée (France)
2
Nous remercions le Groupe Études et Stratégies des Transports de la Division des Infrastructures et des
Transport (DIT) de la DREIF pour la mise à disposition de données nécessaires à la conduite de cette
recherche.
1Les effets de l’espace dans la théorie
Pour certains auteurs, la configuration de la ville fournit une part de l’explication des plus grandes
difficultés d’emploi rencontrées par les classes populaires. Toutes choses égales par ailleurs,
certaines localisations, présentant une faible accessibilité à l’emploi ou un environnement urbain
marqué par le chômage et la pauvreté, entraîneraient un sur-risque de chômage. On expose ici les
raisons d’un risque de chômage accru et les raisons pour lesquelles les classes populaires y
seraient plus spécifiquement exposées.
Accessibilité à l’emploi et risque de chômage
Les économistes de l’urbain considèrent que le marché du travail fonctionne d’autant mieux qu’il
est grand. Offres et demandes d’emploi ont alors de meilleures probabilités de se satisfaire et de
se rencontrer rapidement, limitant ainsi les épisodes de chômage (Veltz, 1994 ; Jayet, 2000).
Néanmoins, l’offre d’emploi n’est pas dépendante du seul nombre d’emplois présents localement.
Du point de vue d’un actif en recherche d’emploi, l’offre réelle ne compte que les emplois qui lui
semblent à sa portée depuis son domicile. Autrement dit, l’offre d’emploi effectivement
disponible individuellement parmi celle qui est recensée globalement pour une ville est fonction
de l’accessibilité. Meilleure est l’accessibilité à l’emploi, plus large est le marché de l’emploi
« effectif » des individus (Prud’homme et Lee, 1999). A contrario, une mauvaise accessibilité
réduit le volume de l’offre et risque d’induire de plus fortes probabilités de chômage.
Deux grands déterminants concourent à la formation du niveau d’accessibilité des actifs aux
emplois : la localisation respective des emplois et des résidences produisant la distance
« absolue » qui les sépare, et la capacité à s’affranchir de ces distances « absolues » et à les rendre
plus « relatives ». Au vu de ces deux facteurs, il est permis de penser que les classes populaires
disposent d’une moindre accessibilité à l’emploi dans les villes d’aujourd’hui.
Premièrement, pour beaucoup, la localisation intra-urbaine est arbitrée par la capacité d’enchère
des candidats. Or, d’une part, pour élire domicile, ces capacités sont les plus modestes chez les
actifs des catégories populaires3 ; d’autre part, les types d’activité économique qui les emploient
ont moins de besoins stratégiques de centralité. Par conséquent, pour ces actifs plus que pour
d’autres, la localisation à la fois des résidences et des emplois auxquels ils sont potentiellement
candidats encourt le risque d’une faible accessibilité.
De fait, en Ile-de-France, le fonctionnement du marché du logement conduit souvent les
populations les moins favorisées à occuper les secteurs de la ville offrant les moins bons niveaux
d’accessibilité en respect d’une hiérarchie des prix du sol décroissant du centre à la périphérie.
Parallèlement, les activités économiques recourant abondamment au travail peu qualifié se
dirigent davantage vers les localisations périphériques, dans des zones moins accessibles. Celles
qui emploient les actifs les plus qualifiés valorisent le plus les localisations centrales. La
géographie des ménages et des entreprises montre donc des configurations très différentes selon la
catégorie des actifs. D’un côté, les résidences et les emplois ouvriers sont disséminés dans les
zones périphériques peu denses : 48% des résidences et 43% des emplois sont localisés en grande
couronne en 1999 (contre respectivement 35% et 25% pour les cadres). A l’autre extrémité, les
résidences et les emplois des cadres sont en moyenne plus souvent localisés près du centre de
l’agglomération et se concentrent dans des zones restreintes qui se superposent : 33% des
résidences et 37% des emplois sont recensés à Paris-centre en 1999 (contre 12% et 21% pour les
ouvriers). La grande distance entre les lieux de résidence et les lieux d’emploi ainsi produite
contribue naturellement à réduire l’accessibilité à l’emploi des classes populaires, puisqu’elle tend
à restreindre le nombre d’emplois présents dans un rayon donné.
3
Initialement, dans la littérature américaine, c’est la ségrégation « raciale » dont sont victimes les Noirs qui
explique leur localisation « inadéquate » par rapport aux lieux d’emploi.
2Deuxièmement, l’effet de ce premier handicap est mécaniquement renforcé par le moindre accès
des classes populaires à la voiture, mode de transport qui permet les déplacements les plus
rapides. En effet, la voiture a la particularité d’être le transport à la fois le plus coûteux
financièrement et le moins coûteux en temps de parcours. La possibilité d’en disposer est donc
déterminante en termes d’accessibilité mais elle reste discriminée. En Ile-de-France, en 2001, la
part des salariés disposant d’un « accès total »4 à la voiture n’excédait pas 48% des ouvriers et
43% des employés, alors que ceux qui ne disposaient d’aucun accès à la voiture atteignait 25% et
32%. Ces parts étaient respectivement de 66% et 15% pour les cadres supérieurs. Ce moindre
accès à la voiture des classes populaires contribue à réduire leur accessibilité à l’emploi dans la
mesure où l’usage des transports en commun contraint à des déplacements plus lents et donc à la
fréquentation d’espaces et de destinations plus restreints.
De fait, en région parisienne en 1999, dans la limite d’un déplacement d’une heure et compte tenu
de ses chances d’utiliser la voiture, un ouvrier francilien avait accès à 44% de l’emploi ouvrier
régional en moyenne, contre 65% en moyenne pour un cadre supérieur (Wenglenski, 2007). Cette
plus faible accessibilité à l’emploi, en moyenne, des classes populaires les pénalise dans l’accès à
l’emploi et les rend plus vulnérables face au risque de chômage.
Outre-atlantique, la littérature autour de la « Spatial Mismatch Hypothesis » a initié une série de
travaux testant ce type d’hypothèses dès la fin des années 1960. Kain (1968), le premier, a montré,
pour Chicago et Detroit, que le taux de chômage des Noirs serait moins élevé si ceux-ci n’étaient
pas cantonnés aux ghettos du centre quand les emplois se développent en périphérie. Vingt ans
plus tard (Kain, 1992), il pointe les limites méthodologiques des recherches qui ne parviennent
pas à valider sa propre hypothèse, et que recensent les synthèses mitigées de Jencks et Mayer
(1990) et Holzer (1991). Dans les années 1990, l’amélioration des méthodes permet le
fleurissement d’études plus favorables à l’hypothèse d’un effet de l’espace sur le risque de
chômage des populations défavorisées (Ihlandfeldt et Sjoquist, 1990 ; Ihlanfeldt et Sjoquist,
1998). Dans les années 2000, les approches se renouvellent et se diversifient : Hess (2005) prend
en compte les modes de transport disponibles ; Dawkins, Shen et Sanchez (2005) s’interrogent sur
la durée du chômage ; Johnson (2006) prend en compte la compétition des actifs pour un même
emploi. Cette tradition scientifique se répand en Europe : en Angleterre sur des données
désagrégées (Houston, 2005 ; Fieldhouse, 1999) et en France sur la base de données agrégées le
plus souvent (Dujardin, Selod et Thomas, 2004 ; Gobillon et Selod, 2004 ; Gaschet et Gaussier,
2003), avec des résultats qui valident généralement l’idée d’une corrélation entre niveau
d’accessibilité aux emplois des actifs et taux de chômage.
Ségrégation et risque de chômage
La division sociale de l’espace urbain constitue un second facteur urbain susceptible d’alimenter
le chômage élevé de ceux qui la subissent. En effet, le fonctionnement du marché du logement et
les préférences des ménages en matière de choix résidentiel ont pour effet de concentrer une partie
des classes populaires entre elles, dans les quartiers les plus dévalorisés de la ville. Ce faisant,
dans un contexte où le chômage frappe un ouvrier non-qualifié sur cinq, ces populations
connaissent un environnement social qui les expose à la détresse économique et sociale d’un
grand nombre. La littérature scientifique anglo-saxonne, qui voit dans le fait de vivre dans un tel
voisinage un facteur de risque pour l’accès à l’emploi des habitants, distingue trois pistes pour
expliquer ces « effets de quartier » (cf. Massey et Denton, 1995, sur ce point).
4
Ces indicateurs sont produits à partir de l’Enquête Globale de Transports. On dit qu’un actif dispose d’un
« accès nul » à la voiture s’il n’a pas le permis de conduire ou vit dans un ménage sans voiture. A l’opposé,
l’« accès total » à la voiture correspond à la situation d’un actif qui, ayant le permis de conduire, vit dans un
ménage comptant au moins autant de voitures que d’actifs.
3Une première piste renvoie aux conditions de la socialisation des jeunes. Grandir dans les
quartiers défavorisés, au contact quotidien de la pauvreté, du chômage et de l’insécurité, dans la
proximité de groupes de pairs dont certains côtoient déjà l’illégalité, risquerait de détourner les
jeunes des normes dominantes et de les conduire vers une socialisation « déviante ». Sans un
apprentissage et une intériorisation suffisants du système de normes, de valeurs et de codes
comportementaux que transmet une socialisation « normale », ces jeunes rencontreraient, à
l’heure de l’entrée dans la vie active, des difficultés spécifiques que le manque de capital scolaire
seul n’explique pas.
La seconde piste part de certains résultats issus des théories des réseaux (Granovetter, 1973),
établissant que les réseaux sociaux constituent une ressource capitale dans la recherche d’emploi.
Le rendement d’un réseau social en tant que « relais vers l’emploi » est proportionnel à la capacité
de ses membres à faire circuler des informations sur les opportunités d’emploi ou à interférer
auprès d’employeurs potentiels. A contrario, cette tradition souligne l’inefficacité des réseaux
sociaux bâtis dans les quartiers défavorisés dans ce rôle de relais vers les opportunités d’emploi.
Ces quartiers défavorisés concentrent en effet une forte population privée d’emploi, exclue du
marché du travail et peu susceptible de détenir des informations sur les opportunités du marché du
travail ou d’influencer les employeurs. On peut donc penser que les réseaux sociaux construits
dans les quartiers défavorisés sont peu facilitateurs d’accès à l’emploi, ce qui grève les difficultés
d’emploi des classes populaires.
La troisième piste met en avant les stigmates subis par les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Les classes populaires des quartiers défavorisés subiraient, dans l’accès à l’emploi, les
conséquences de la mauvaise réputation dont sont porteurs ces quartiers dans les représentations
collectives. Associant les quartiers défavorisés à des univers pathogènes et délictueux, certains
employeurs exprimeraient une franche aversion envers les candidats à l’embauche provenant de
ces quartiers.
Les recherches empiriques qui ont tenté de tester les effets de quartier sont très abondantes dans
les domaines de l’échec scolaire, des problèmes de santé ou des comportements déviants mais ont
beaucoup moins exploré le domaine de l’accès à l’emploi. Toutefois, celles qui ont été menées
dans cette voie valident l’hypothèse d’une corrélation, toutes choses égales par ailleurs, entre la
composition ethnique du quartier et le niveau de salaire des jeunes noirs (Datcher, 1982 ;
Corcoran et al., 1989) ou entre le niveau de pauvreté et la probabilité des jeunes adultes d’être
employés (Massey et al., 1995 ; O’Reagan et Quigley, 1998). Le suivi des bénéficiaires du
Programme Gautreaux (système d’allocation logement en direction des familles quittant les inner-
cities pauvres pour louer dans le secteur privé des banlieues de classe moyenne) a permis de
confirmer ces résultats en comparant le sort des familles ayant déménagé à celui des familles
demeurées dans les centres déshérités (Mendenhall et al., 2006 ; Fauth et al., 2004).
Les années 2000 ont également vu cette tradition s’étendre à l’Europe, en particulier pour
observer le lien entre le profil du voisinage et la longueur des périodes de transition entre
chômage et emploi (Musterd et al., 2003 ; Van der Klaauw et Van Ours, 2003 ; Brannstorm,
2004). En France, les deux seules recherches existantes, reposant sur des échantillons nationaux
de petite ou moyenne taille, opposent des résultats divergents. Pour Marpsat et Laurent (1997), les
caractéristiques du quartier ne semblent pas peser sur la chance d’être employé pour les jeunes
adultes qui y résident ; pour Choffel et Delattre (2002), la probabilité d’être toujours au chômage
au bout de 18 mois est plus élevée dans les quartiers pauvres. Dans le cas de l’Île-de-France , dont
la spécialisation sociale des espaces résidentiels s’est accrue dans les années 1980 et 1990 (Korsu,
2007), les effets de quartiers ont été établis dans le champ de la réussite scolaire (Korsu, 2002).
4Méthodologie d’exploration empirique du cas parisien
Données et méthode d’analyse
La méthode utilisée dans la présente recherche pour explorer l’hypothèse de l’influence de
facteurs urbains sur l’accès à l’emploi des actifs est largement éprouvée : on recourt en effet aux
techniques de régression logistique permettant d’évaluer l’influence de facteurs sur la probabilité
de survenue d’un phénomène. On estime ainsi le risque de chômage des actifs selon les
caractéristiques de leur lieu de résidence en termes d’accessibilité et d’environnement social, tout
en contrôlant l’effet des autres variables jugées influentes. L’analyse est conduite à partir des
données individuelles issues du fichier détail du Recensement Général de la Population française
de 1999. Le recours au fichier détail du Recensement singularise notre recherche à plus d’un titre
par rapport aux recherches empiriques françaises antérieures testant le même type d’hypothèse5.
Premièrement, à notre connaissance, dans le contexte français, c’est la première fois que le
Recensement est exploité pour produire une recherche consacrée aux déterminants spatiaux des
difficultés d’emploi sur la base de données désagrégées. Les recherches de Gaschet et Gaussier
(2003) sur Bordeaux et de Gobillon et Selod (2004) sur Paris s’appuient également sur les
données du Recensement mais manipulent des données non individuelles, agrégées à l’échelle des
communes. Compte tenu de la problématique abordée, on peut penser que les données
individuelles désagrégées autorisent des analyses beaucoup plus fines que les données agrégées
spatialement.
En deuxième lieu, après délimitation de son champ, l’analyse porte sur près de 100 000
observations, ce qui est très largement supérieur à ce que l’on enregistre dans les recherches
similaires mobilisant des données individuelles. Marpsat et Laurent (1997), par exemple,
travaillent sur les 1 000 observations de l’enquête « Situations défavorisées » ; Choffel et Delattre
(2003) analysent les 7 000 observations de l’enquête « Trajectoires des demandeurs d’emploi et
marché local du travail ». Cette grande quantité d’observations réduit substantiellement les risques
d’erreur inhérents aux analyses statistiques sur échantillon et renforce la fiabilité et la précision
des mesures.
Enfin, le Recensement permet de restreindre le champ spatial de l’analyse à une agglomération
unique et d’éviter une analyse qui porte, par contrainte, sur la France entière. En effet, la taille
réduite des échantillons contraint Marpsat et Laurent (1997) et Choffel et Delattre (2003) à mener
leur analyse sur la France entière (les échantillons n’étant représentatifs qu’à cette échelle-là), ce
qui a l’inconvénient de mêler des contextes urbains extrêmement différents. Le Recensement
permettant la constitution d’un échantillon représentatif à l’échelle d’une agglomération, nous
avons pu échapper à cet inconvénient et avons pu centrer l’analyse sur la région parisienne.
Conceptuellement, la démarche consiste à mesurer le lien statistique entre une variable à expliquer
– le risque de chômage6 – et des variables explicatives – les caractéristiques du lieu de résidence –
« toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire en neutralisant l’effet éventuel des autres
variables actives – les caractéristiques individuelles. Deux modèles ont été testés7 : (1) le lien
entre risque de chômage et accessibilité à l’emploi à partir du lieu de résidence ; et (2) le lien entre
risque de chômage et environnement social du lieu de résidence.
5
La recherche de Dujardin, Selod et Thomas (2004) y recourt pour l’analyse du cas bruxellois.
6
Dans les recherches antérieures pré-citées, la variable à expliquer varie selon les analyses. Dujardin, Selod et
Thomas (2004) ainsi que Marpsat et Laurent (1997) estiment la probabilité pour un actif d’être au chômage à
un instant t. Choffel et Delattre (2003) estiment la probabilité, pour un actif au chômage à l’instant t, d’être
toujours au chômage à l’instant t+1. Gaschet et Gaussier (2003) et de Gobillon et Selod (2004) veulent
expliquer le taux de chômage communal.
7
La variable à expliquer comme les variables explicatives sont conçues sous forme de variables discrètes
dichotomiques.
5Champ et variables observés
Le champ de l’analyse concerne les actifs de type salarié non fonctionnaires : les professions
libérales et les employés de la fonction publique n’étant pas soumis aux mêmes modalités
d’emploi en termes de recrutement et de chômage. Ce champ ne retient également que les
personnes résidant en 1999 dans la même commune qu’en 1990, c’est-à-dire les seuls actifs ayant
vécu suffisamment durablement dans un environnement aux caractéristiques données pour en
avoir éventuellement reçu les influences.
Les variables de contrôle retenues sont l’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle (en huit
modalités d’après la nomenclature des PCS en 24 postes de l’INSEE), le niveau d’études/dernier
diplôme obtenu, la nationalité/pays de naissance, la détention d’une voiture.
Les variables descriptives des caractéristiques urbaines en termes d’environnement social et
d’accessibilité aux emplois des actifs sont présentées dans le tableau 1. La variable liée à
l’accessibilité à l’emploi du lieu de résidence est construite à partir d’un indicateur quantitatif
exprimant, pour un actif francilien d’une catégorie sociale donnée et habitant une commune
donnée, la part des emplois régionaux de sa catégorie qui lui sont accessibles en moyenne depuis
son domicile au terme de déplacements d’une heure au maximum compte tenu de sa propension à
l’usage des transports en commun et de la voiture (Wenglenski, 2007)8. Sur la base de cet
indicateur, les communes de résidence sont classées en cinq catégories selon l’accessibilité
qu’elles offrent aux employés et ouvriers, d’un côté, et aux cadres et professions intermédiaires,
de l’autre.
Cet indicateur constitue une autre différence avec les recherches empiriques antérieures françaises
dans la construction d’une variable d’accessibilité. Les indicateurs d’accessibilité sont en effet
souvent exprimés par les caractéristiques des déplacements domicile-travail accomplis par les
actifs occupés, ce qui a l’inconvénient d’affecter comme possibilités de déplacement aux
chômeurs les pratiques de déplacement des détenteurs d’emploi et plus généralement d’identifier
des potentiels à des pratiques. Par ailleurs, quand c’est bien le potentiel d’accès à l’emploi qui est
approché par l’indicateur, il est souvent approximatif : taux d’emploi ou distance moyenne aux
emplois.
La variable liée à l’environnement social de la commune de résidence est conçue à l’échelle des
quartiers IRIS (sauf quand l’information n’existe pas). Elle est construite à partir de données
portant sur le chômage (taux de chômage calculé à partir du Recensement de la population de
1999) et sur les revenus des ménages (1er décile de la distribution des revenus imposables par
unité de consommation du ménage dans le quartier en 2001 d’après la Direction Générale des
Impôts). Les quartiers et les communes sont classés selon leur « score » d’après cet indicateur
composite9, des plus défavorisés aux plus favorisés, puis regroupés en cinq catégories. Les
communes périurbaines de petite taille pour lesquelles aucune information sur les revenus n’est
disponible sont regroupées dans une catégorie à part.
8
L’indicateur d’accessibilité élaboré consiste à sommer les emplois présents dans les communes repérées
comme destinations atteignables sous contraintes de temps et d’argent. La contrainte de temps est fixée à une
heure de déplacement. La contrainte monétaire est exprimée par la propension à mobiliser les différents
modes, dont les coûts et les performances différenciés sont décisifs dans la faisabilité d’un déplacement : une
destination peut être accessible en voiture et non en transports collectifs compte tenu du périmètre temporel
fixé. Des temps de transport dit « synthétiques » intègrent les probabilités différenciées d’usage des modes
pour chaque catégorie sociale (Les temps de transport en voiture et en transports collectifs entre toutes les
origines et destinations franciliennes sont donnés par des modélisations de la DREIF. Pour un couple
d’origine-destination, la durée de trajet « synthétique » est la moyenne des temps de trajet connus dans chaque
mode pondérés par la probabilité d’usage de ces modes pour un actif).
9
L’indicateur composite est obtenu en deux étapes : (i) calcul des écarts centrés-réduits pour les distributions
relatives aux deux variables (taux de chômage et 1er décile de la distribution des revenus) ; (ii) addition des
deux écarts centrés-réduits pour chaque quartier/commune.
6Un rôle de l’environnement social sur le chômage ?
L’hypothèse de facteurs urbains producteurs d’effets négatifs sur l’accès à l’emploi en particulier
pour les classes populaires n’apparaît que partiellement confortée par les analyses empiriques
menées sur la région parisienne : seul l’environnement social du lieu de résidence semble corrélé
au risque de chômage.
L’effet attendu des caractéristiques individuelles
Les deux modèles testés (tableaux 2 et 3) sont globalement cohérents – les tests statistiques
donnent des résultats satisfaisants – significatifs et plutôt performants –, la capacité des modèles à
prédire le chômage est non-négligeable (taux de prédictions concordantes entre 60% et 65%). La
plupart des variables explicatives individuelles présentent les signes attendus et des coefficients
significatifs, à l’exception partielle de l’effet du diplôme pour les cadres et professions
intermédiaires et de la catégorie sociale pour les employés et ouvriers.
Dans les deux modèles, s’agissant du groupe des cadres et professions intermédiaires comme celui
des employés et ouvriers, toutes choses égales par ailleurs, l’âge est bien lié au risque de
chômage. Dans le groupe des catégories moyennes et supérieures, les actifs les plus jeunes (les
moins de 25 ans) sont devancés par les seniors (les plus de 50 ans) parmi ceux qui encourent les
plus grands risques de chômage devant les actifs d’âge intermédiaire (de 25 à 35 ans et de 35 à 50
ans). Dans le groupe des catégories modestes, ce sont les actifs les plus jeunes, directement suivis
des 25-35 ans, qui dominent la hiérarchie des risques de chômage, devant les seniors et les actifs
d’âge mur.
Toutes choses égales par ailleurs, et conformément aux résultats attendus, les femmes encourent
davantage le risque de chômage que les hommes dans le groupe des employés et des ouvriers. En
revanche, elles y semblent moins souvent vulnérables dans le groupe des cadres et des professions
intermédiaires. De façon générale, les différences de chômage entre hommes et femmes sont
beaucoup moins marquées en Île-de-France qu’ailleurs (en 1999, le taux de chômage régional
atteint 11,3% chez les hommes et 11,8% chez les femmes contre respectivement 10,9% et 15,9%
en Province) et en particulier dans les départements de la zone dense (Paris-centre et la petite
couronne), où les catégories supérieures sont sur-représentées (INSEE, 2003).
Les effets de la catégorie socioprofessionnelle et du niveau d’études semblent se « parasiter »
quelque peu. Pour les catégories moyennes et supérieures, la catégorie sociale produit l’effet
escompté sur le risque de chômage mais pas le diplôme. Inversement, pour les catégories
populaires, le niveau de diplôme produit l’effet escompté sur le risque de chômage mais pas la
catégorie sociale. Toutes choses égales par ailleurs, le risque de chômage apparaît moins élevé
pour les cadres que pour les professions intermédiaires et, parmi eux, pour les ingénieurs que pour
les autres cadres, et pour les agents de maîtrise que pour les autres professions intermédiaires. En
revanche, toutes choses égales par ailleurs, le risque de chômage serait supérieur pour les
personnes diplômées du baccalauréat que pour celles qui n’ont pas le bac, et pour les diplômés
d’un 2ème ou 3ème cycle universitaire par rapport à un 1er cycle universitaire. La double prise en
compte de la catégorie sociale et du niveau de diplôme apparaît responsable de ce brouillage :
menée sans la catégorie sociale parmi les variables explicatives, l’analyse redonne sa place
traditionnelle au diplôme.
Symétriquement, pour les classes populaires, toutes choses égales par ailleurs et conformément
aux prédictions, le risque de chômage des ouvriers apparaît supérieur à celui des employés. Mais,
de façon moins conventionnelle, celui des ouvriers qualifiés apparaît supérieur à celui des non
qualifiés, et celui des employés administratifs d’entreprise supérieur à celui des personnels de
service aux particuliers et de commerce. En revanche, toutes choses égales par ailleurs, pour ces
actifs, conformément aux résultats attendus, le risque de chômage décroît linéairement avec
l’élévation du niveau de diplôme. De nouveau, la prise en compte simultanée de la catégorie
7sociale et du niveau de diplôme peut brouiller leur rôle respectif. Ces apories trouvent peut-être
aussi des éléments d’explication dans la sélection de l’échantillon : très stables du point de vue de
l’habitat (puisqu’ils habitaient le même lieu au précédent Recensement), les actifs observés sont
peut-être d’autant plus souvent au chômage que les emplois auxquels ils postulent sont plus
spécialisés et à recrutement moins local (ouvriers qualifiés, employés administratifs d’entreprise).
La variable nationalité/pays de naissance influence également le risque de chômage dans le sens
escompté. Toutes choses égales par ailleurs, les citoyens français nés en France apparaissent
moins menacés par le chômage que les étrangers nés à l’étranger. Ces derniers bénéficient eux-
mêmes généralement de préjugés positifs et sont moins exposés que les Français nés à l’étranger
ou dans les départements et territoires d’outre-mer, c’est-à-dire pour partie les immigrés
naturalisés et les natifs d’anciennes colonies françaises, qui sont davantage victimes d’antipathie
raciale ; mais ceci, toujours moins que les étrangers nés en France. Parmi ces derniers, la
probabilité d’être au chômage se montre même la plus élevée au sein des catégories supérieures,
comme si ces actifs n’étaient pas considérés comme des candidats crédibles aux fonctions
qualifiées.
Enfin, conformément aux prédictions, la possession ou non d’une voiture semble bien liée au
risque de chômage, même si le sens de la causalité reste ambigu. Car il est tout aussi
vraisemblable que le statut d’activité explique la possession d’une voiture que l’inverse. Toutes
choses égales par ailleurs, le risque de chômage est le plus important pour les actifs membres de
ménages sans voiture et le plus faible pour les actifs membres de ménages comptant deux voitures
ou plus. D’une situation à l’autre, le risque de chômage double : passant de 6-7% sans voiture à
13-14% avec deux voitures au moins chez les cadres et professions intermédiaires et de 8-9% à
16-18% chez les employés et ouvriers, selon le modèle testé.
L’effet contraire de l’accessibilité à l’emploi
Un premier modèle a cherché à mesurer, à caractéristiques individuelles égales, la corrélation
entre le risque de chômage et l’accessibilité à l’emploi d’un actif depuis sa commune de résidence
compte tenu de sa catégorie sociale (tableau 2). L’analyse statistique révèle que, toutes choses
égales par ailleurs, le risque de chômage varie significativement avec l’accessibilité à l’emploi
depuis le lieu de résidence, mais ceci dans le sens opposé au pronostic envisagé. Il semble que
plus faible est l’accessibilité des actifs aux emplois de leur catégorie, meilleure est leur probabilité
d’être employés : les probabilités de chômage estimées se hiérarchisent de façon très ordonnée
dans ce sens (notons que, pour les actifs des classes moyennes et supérieures, les coefficients ne
sont pas significatifs au seuil fixé).
Pour l’actif-type10 des classes moyennes et supérieures, la probabilité d’être au chômage s’élève à
6,59% dans les communes de très faible accessibilité ; 7,31% dans les communes de médiocre
accessibilité et 7,04% dans les communes d’accessibilité moyenne, puis respectivement 8,16% et
8,22% dans les communes d’accessibilité bonne et très bonne. De la même façon, pour l’actif-
type des classes populaires, la probabilité d’être au chômage s’échelonne progressivement de
10,24% dans les communes de mauvaise accessibilité ; à 10,38% dans les communes
d’accessibilité médiocre ; 10,36% dans les communes d’accessibilité moyenne ; 11,41% dans les
communes de bonne accessibilité et 11,45% dans les communes de très bonne accessibilité.
10
L’actif-type correspond à l’individu qui présente les caractéristiques de référence dans l’analyse de régression.
Pour les catégories moyennes et supérieures, il s’agit d’un homme, entre 35 et 50 ans, français né en France,
disposant d'une voiture dans son ménage et habitant une commune depuis laquelle l' accessibilité à l'
emploi est
bonne, diplômé d' un bac+2 et de profession intermédiaire administrative d’entreprise. Pour les catégories
populaires, il s’agit d’un homme ayant les mêmes caractéristiques mais détenteur du bac et employé
administratif d’entreprise.
8En comparaison, on constate que, parmi les recherches françaises déjà mentionnées, celles qui
reposent sur des données agrégées spatialement observent bien, elles, un lien significatif et dans le
sens attendu, quoique faible, entre la variation des taux de chômage locaux et celle des variables
d’accessibilité (Dujardin, Selod et Thomas, 2004, pour Bruxelles ; Gaschet et Gaussier, 2003,
pour Bordeaux ; Gobillon et Selod, 2004, pour Paris). En revanche, parmi celles qui sont menées,
comme présentement, au niveau individuel, les résultats apparaissent plus concordants. D’un part,
Dujardin, Selod et Thomas (2004), lorsqu’ils procèdent à une analyse sur données individuelles,
constatent que les variables d’accessibilité jouent significativement dans le sens contraire à l’effet
attendu. D’autre part, Choffel et Delattre (2003) relèvent un effet des variables d’accessibilité sur
la durée moyenne du chômage mais en mobilisant pour cela des caractéristiques individuelles
renseignant sur les possibilités de déplacement, sans lien avec les opportunités d’emploi existantes
effectivement accessibles (détention du permis de conduire, disposition de moyens de transport,
titre de transport gratuit ou réduit). Autrement dit, les résultats obtenus avec ces indicateurs sont
conformes à ceux que l’on obtient : une probabilité supérieure d’être chômeur lorsque l’on
appartient à un ménage sans voiture que lorsque l’on est membre d’un ménage avec une voiture,
et à plus forte raison pour un individu membre d’un ménage ayant plus d’une voiture.
D’un côté, la corrélation avec la situation d’emploi des actifs est observée positivement pour la
variable « disposer d’une voiture » ; de l’autre, elle est négative pour la variable « être à portée
d’un grand nombre d’emplois ». Tout se passe comme si, contrairement à nos prospectives, pour
une part de ces actifs, et en particulier pour les plus modestes (pour les autres, les résultats ne sont
pas significatifs), la détention d’un emploi était la condition première de la conduite d’un projet
résidentiel menant à l’éloignement, quand les marges de manœuvres sont étroites, et à
l’indispensable acquisition d’une voiture.
Un environnement social actif sur les classes populaires
Le second modèle élaboré (tableau 3) a cherché à explorer le lien statistique entre le risque de
chômage et les caractéristiques sociales du quartier de résidence. Ce facteur urbain, l’exposition à
un environnement social défavorisé, semble produire un effet plus tangible que le premier, les
résultats de l’analyse de régression corroborant l’hypothèse de départ. Pour les deux groupes
d’actifs, le risque de chômage varie dans le sens prédit avec le degré de pauvreté et de chômage
observé dans le quartier de résidence.
Pour l’actif-type de catégorie moyenne ou supérieure, la probabilité d’être au chômage, qui
s’élève à 7,47% dans les quartiers « favorisés », progresse à mesure que le profil socio-
économique du quartier de résidence se dégrade : elle s’établit à 7,78% dans les quartiers où
l’environnement social est « moyen » ; elle atteint 7,81% dans les quartiers où l’environnement
social est « médiocre » ; et s’élève à 8,56% dans les quartiers où l’environnement social est
« défavorisé », et jusqu’à 10,37% dans les quartiers « très défavorisés ». Autrement dit, pour un
français entre 35 et 50 ans, diplômé d’un bac+2, de profession intermédiaire et disposant d’une
voiture, la probabilité de se trouver au chômage peut croître d’un tiers selon son quartier
d’habitation (de 7,47% à 10,37%). Néanmoins, les coefficients estimés ne sont pas significatifs
pour des risques d’erreur inférieurs à 5%.
En revanche, pour un actif des classes populaires, cette variation du risque de chômage selon la
localisation résidentielle se montre non seulement significative mais bien plus importante. Pour un
actif aux mêmes caractéristiques mais détenteur du bac (plutôt qu’un bac+2) et employé
administratif (plutôt que profession intermédiaire), la probabilité d’être au chômage varie
quasiment du simple au double : de 8,89% dans les quartiers défavorisés à 16,01% dans les
quartiers très défavorisés. Les actifs des classes populaires apparaissent beaucoup plus sensibles à
l’effet de l’environnement social sur leur destin professionnel.
Au regard de ces résultats, résider dans un quartier présentant une pauvreté et à un chômage
importants et récurrents semble aggraver les conditions d’accès à l’emploi des actifs. Mais les
9candidats à l’emploi des classes populaires apparaissent deux fois plus vulnérables aux
externalités de quartier que leurs homologues des classes moyennes et supérieures. Toutes choses
égales par ailleurs, les actifs semblent en passer plus souvent par le chômage lorsqu’ils résident
dans des environnements sociaux difficiles plutôt qu’en quartiers plus ordinaires ou plus
favorisés, mais ce contexte est plus spécialement pénalisant pour les classes populaires. Ces
résultats sont concordants avec ceux des autres recherches précitées qui, quelles que soient la
variable à expliquer (taux de chômage, durée du chômage, etc.) et les variables explicatives
utilisées pour traduire l’environnement social (taux de chômage, taux de mères célibataires, taux
de propriétaires, appartenance du quartier à une ZUS, etc.) observent les signes d’un effet de
quartier.
Une interprétation délicate
L’existence potentielle de corrélations
L’analyse économétrique du lien entre situation d’emploi des actifs et caractéristique de leur lieu
de résidence en région parisienne indique que le risque de chômage des actifs est positivement
corrélé à leur proximité résidentielle aux modèles d’exclusion sociale, mais négativement corrélé
à l’éloignement résidentiel des opportunités d’emploi. Ces deux constats apparaissent très
robustes pour le groupe des employés et ouvriers, mais beaucoup moins assurés pour le groupe
des cadres et professions intermédiaires. Ces résultats peuvent être interprétés dans le sens d’un
lien de causalité entre les variables mises en présence (conforme ou contraire à nos hypothèses
liminaires) et refléter effectivement la non dépendance du chômage au degré d’accessibilité des
actifs aux emplois, d’un côté, mais l’influence réelle du quartier sur le destin professionnel et
social de leurs habitants, de l’autre.
Concernant l’accès physique à l’emploi, l’absence de lien entre la moindre accessibilité et les
difficultés d’emploi peut s’expliquer par le contexte francilien. En Ile-de-France, certains actifs
subissent certes une sous-accessibilité à l’emploi en comparaison de ceux qui bénéficient des
positions les plus centrales ou disposent librement d’une voiture, mais, en moyenne, cette moindre
accessibilité n’est pas une faible accessibilité : elle n’est peut-être pas de nature à provoquer des
difficultés supplémentaires dans l’accès à l’emploi des actifs. L’accès à la voiture est certes
différencié mais largement banalisé, le système de transports collectifs et routiers est de grande
qualité et l’organisation urbaine, malgré la tendance à l’étalement, reste relativement compacte et
dense. Le tout assure à l’ensemble des actifs une offre d’emplois accessibles relativement
abondante, y compris aux employés et ouvriers que les contraintes financières conduisent à
habiter les lieux les plus excentrés ou les moins bien desservis.
De la même façon, concernant le rôle du voisinage, la possibilité d’une influence préjudiciable de
certains environnements sociaux défavorisés sur les chances d’accès à l’emploi peut se trouver
parfaitement avérée. En moyenne, dans ces quartiers, une personne sur dix vit dans un ménage
disposant de moins de 2 700 euros de revenus imposables annuels par unité de consommation et
près d’un actif sur trois est touché par le chômage. Ces chiffres témoignent d’un environnement
social où la pauvreté et le chômage ne sont jamais très loin, et on peut bien croire que les
mécanismes évoqués précédemment y soient à l’œuvre et que les habitants de ces quartiers soient
effectivement confrontés aux conséquences diverses de l’exposition durable à un tel
environnement.
La conséquence potentielle de partis pris méthodologiques
Au total, la contrainte résidentielle serait peu en cause dans l’inégalité sociale face au chômage
s’agissant du degré d’accessibilité caractérisant l’habitat des actifs, mais le serait pour les
catégories populaires, s’agissant du profil social des quartiers. Pourtant, symétriquement, les
10résultats obtenus peuvent être mis en doute parce que considérés comme de purs artefacts des
caractéristiques méthodologiques de l’analyse.
En effet, l’indicateur d’accessibilité élaboré est susceptible de mal mesurer l’accessibilité réelle.
(i) Il néglige la question des représentations subjectives de la distance (sentiment de légitimité à
occuper et à parcourir les espaces, par exemple) ; (ii) il distingue grossièrement les catégories
d’emplois ; (iii) il mesure l’accessibilité à l’aune de l’ensemble des emplois occupés, et non à
pourvoir. Dans leur recherche sur Bordeaux, Gaschet et Gaussier (2003) tentent de déjouer ce
problème en recourant à des données qui cependant en posent d’autres, les offres d’emploi
enregistrées par l’ANPE ne représentant approximativement qu’un quart de l’offre réelle du
marché (Jayet, 2000). La correction de certaines des imperfections de l’indicateur d’accessibilité
pourrait peut-être modifier le constat d’une indépendance statistique entre chômage et
accessibilité chez les actifs des catégories moyennes et supérieures et d’une corrélation qui
apparaît « à contresens » pour les plus modestes.
L’analyse de l’influence de l’environnement social élargi peut faire l’objet de commentaires
similaires. Une des grandes faiblesses de l’analyse quantitative conçue « toutes choses égales par
ailleurs » est de s’exposer à d’importants biais de sélection. L’analyse menée suggère que deux
individus de même profil social mais résidant dans des quartiers différents en termes
d’environnement social encourent des risques de chômage inégaux. Cette démarche occulte le fait
que deux individus habitant deux quartiers différents de la ville ne sont sans doute jamais
identiques socialement, la différence de leurs lieux de résidence révélant précisément leurs
différences sociales. Pour l’individu qui réside dans le quartier défavorisé, cette localisation
résidentielle a une forte probabilité de traduire une position sociale relative inférieure, en dépit de
l’apparence des caractéristiques observées, et dont l’explication réside dans des caractéristiques
« cachées » (moindres ressources économiques, sociales ou symboliques, origine sociale plus
modeste, absence de patrimoine familial, statut familial, etc.) que l’on assimile ici à un effet
« environnemental ». Ce qui est considéré comme lié à l’exposition durable à un environnement
social défavorisé peut tout simplement relever d’un effet « social » supplémentaire, lié aux
caractéristiques individuelles non-observées ou mal observées, indépendant de l’environnement
résidentiel.
Il est extrêmement difficile de se prémunir contre ce biais de sélection et, incontestablement, nos
résultats en sont potentiellement affectés. On trouve, dans les recherches antérieures, des
tentatives méthodologiques pour le déjouer mais le remède n’apparaît pas toujours idoine.
Dujardin, Selod et Thomas (2004), par exemple, proposent de restreindre le champ de l’analyse
aux seuls jeunes actifs résidant encore chez leurs parents. Une telle restriction aurait pour effet de
neutraliser le biais de sélection dans la mesure où le choix de localisation résidentielle devient
alors exogène aux individus retenus pour l’analyse (puisque le choix du lieu de résidence n’est pas
accompli par les jeunes eux-mêmes). D’après les auteurs, dans ces conditions, les localisations
résidentielles sont « aléatoires » au sens où les jeunes n’y sont pour rien et le biais de sélection est
donc neutralisé : on peut dès lors considérer identiques socialement deux jeunes habitant des
quartiers très différents. Aux sociologues, ce procédé apparaît illusoire car il revient à concevoir
l’identité sociale des enfants comme indépendante de celle des parents.
Une des pistes sans doute les plus fécondes pour évaluer le risque de biais de sélection qui pèse
sur ces résultats ou pour tester le poids des représentations sur la définition d’une accessibilité
individuelle passe par des recherches qualitatives, davantage monographiques. Des résultats
convergents avec ceux de nos recherches quantitatives pourraient permettre de lever la suspicion
que l’on a soulignée.
L’interprétation potentielle des corrélations observées
Ceci étant, une fois précisées les conditions méthodologiques de leur production, spécifiques mais
rigoureuses, nos résultats peuvent légitimement être considérés comme consistants tout en
11Vous pouvez aussi lire