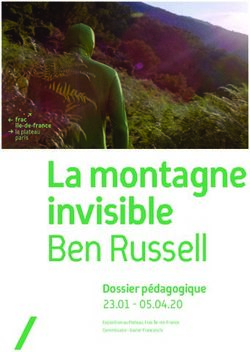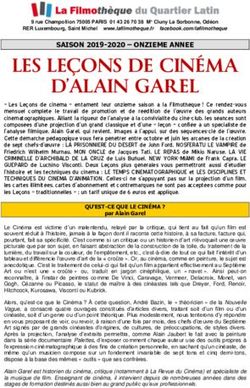Éditorial : un siècle d'hispanisme (1920-2020) - OpenEdition ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Mélanges de la Casa de Velázquez
Nouvelle série
50-1 | 2020
Genre, sexualités et démocratie
Éditorial
Éditorial : un siècle d’hispanisme (1920-2020)
Michel Bertrand
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/mcv/12122
ISSN : 2173-1306
Éditeur
Casa de Velázquez
Édition imprimée
Date de publication : 15 avril 2020
Pagination : 7-12
ISBN : 978-84-9096-310-4
ISSN : 0076-230X
Référence électronique
Michel Bertrand, « Éditorial : un siècle d’hispanisme (1920-2020) », Mélanges de la Casa de Velázquez
[En ligne], 50-1 | 2020, mis en ligne le 06 mars 2020, consulté le 11 mars 2020. URL : http://
journals.openedition.org/mcv/12122
La revue Mélanges de la Casa de Velázquez est mise à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.Éditorial
Un siècle d’hispanisme
(1920-2020)
L’année 2020 voit coïncider — en partie par la grâce du hasard — deux dates 7
anniversaires significatives de l’histoire de la Casa de Velázquez. Remontons
le temps. En 1965, à l’initiative du directeur d’alors, Henri Terrasse, naissait
la revue des Mélanges de la Casa de Velázquez. Comme l’écrivait ce même
Henri Terrasse dans son avant-propos au premier numéro, la revue ne se fixait
que peu d’ambitions si ce n’est une, clairement revendiquée :
Maintenant que notre maison a atteint son plein développement
(après la réouverture de 1959), il m’a semblé qu’elle pouvait demander
aux chercheurs qui vivent sous son toit, ainsi qu’à ses anciens, de lui
donner quelques-uns de leurs travaux, prémices de leurs recherches
ou témoignage de leur fidélité. Ainsi les hispanisants de tous pays
apprécieront mieux ce que la Casa apporte à la connaissance du
monde ibérique1.
Cinquante numéros plus tard, la revue franchit un cap symbolique qui
témoigne de son installation dans son champ scientifique. Après bien des évo-
lutions dans la conception même d’une revue qui s’est profondément trans-
formée pour gagner en cohérence, en visibilité et en légitimité scientifiques,
l’objectif reste fondamentalement le même. Comme le précise le texte actuel de
positionnement scientifique de la revue, outre le fait que le vivier des auteurs
se soit largement amplifié et surtout internationalisé, celle-ci couvre
un large éventail de champs disciplinaires (histoire, archéologie,
littérature, géographie, sociologie, anthropologie…) et présente[nt]
des résultats de recherche inédits sur la péninsule Ibérique, le
Maghreb et l’espace atlantique ibérique, suivant des critères scienti-
fiques rigoureux. […] Tant l’espace africain que l’espace atlantique
sont abordés, non pas pour eux-mêmes, mais par le biais des liens
1
Souligné par nos soins.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.numéro 50 un siècle d’hispanisme
séculaires qu’ils ont tissés avec la péninsule Ibérique. […] Dans
les dossiers thématiques et articles de Miscellanées, les approches
diachroniques, multiscalaires et interdisciplinaires sont favorisées,
dans le sens où elles permettent l’exploration de voies inédites, la
mise en avant de dynamiques nouvelles et le croisement de diffé-
rentes approches.
En un demi-siècle, les Mélanges de la Casa de Velázquez sont venus s’ajouter
aux revues, plus anciennes et vénérables pour certaines, qui ont contribué à
l’affirmation de l’hispanisme dans le monde académique français à compter
de la fin du xixe siècle. À une différence près cependant : alors que Henri
Terrasse s’adressait aux « hispanisants », les Mélanges sont devenus la revue
de tous ceux, indépendamment de leur discipline universitaire inscrite dans le
champ des sciences sociales, qui peuvent légitimement se considérer comme
« hispanistes », « lusistes » ou encore « américanistes » du fait de l’inscription
de leur objet de recherche dans ces « aires culturelles ». Les Mélanges sont
8 donc une revue qui s’assume pleinement comme pluridisciplinaire et dont les
indices actuels de classement, tant en Espagne qu’en France, confirment la
place qui est la sienne désormais pour les recherches menées sur les mondes
ibériques et ibéro-américains pour lesquelles elle est incontestablement l’une
des revues de référence.
Précisément, c’est à ce lent processus de structuration de cette spécialité
universitaire regroupant initialement ceux qui l’on qualifie d’« hispanisants2 »
avant d’adopter plus tard le qualificatif d’« hispanistes » — et que longtemps
la tradition avait réduit, sans doute abusivement, aux seuls spécialistes de la
langue espagnole — que renvoie la seconde date sur laquelle nous souhaitons
maintenant nous arrêter : 1920, année de signature du décret de création de
la Casa de Velázquez suivi peu après par la pose de la première pierre. Même
si cette création ne se concrétise effectivement qu’en 1928 avec l’accueil de la
première promotion de pensionnaires, 1920 constitue en quelque sorte l’acte de
naissance de la cinquième et dernière-née des Écoles françaises à l’étranger. À
ce titre, il nous a semblé, avec la commission du Centenaire mise en place dès
2017 sous la présidence de notre collègue Pierre Civil, que le moment pouvait
opportunément servir à engager une réflexion sur les conditions, les orienta-
tions successives et le déploiement qui ont accompagné la structuration d’une
spécialité universitaire au départ philologique pour couvrir, un siècle plus tard,
tout le champ des sciences humaines et sociales.
La création à Madrid — sur le modèle des Écoles françaises conçu au milieu
du xixe siècle pour celles d’Athènes ou de Rome — d’une École à vocation
délibérément ibérique venait couronner le processus de légitimation d’une
nouvelle spécialité universitaire initiée en 1886 avec l’installation d’une pre-
mière chaire française d’Études hispaniques dans la faculté des Lettres de
2
Comme en témoigne notamment la correspondance de Pierre Paris avec ou à propos de
ceux qu’il qualifie ainsi.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.éditorial
l’université de Toulouse3. Son premier titulaire n’est autre qu’Ernest Mérimée,
lui-même fondateur d’une lignée d’hispanistes, qui aura par la suite des liens
étroits avec la Casa de Velázquez. Dans la foulée de cette première création,
la nouvelle spécialité s’enracine dans l’université française. En 1894-1895 un
« certificat d’aptitude en espagnol » est créé, que seule Toulouse, dans un
premier temps, est habilitée à délivrer dans le cadre optionnel d’une licence
de Lettres. Entre 1898 et 1901, l’habilitation s’étend aux universités de Bor-
deaux puis de Montpellier et enfin de Paris où, en 1906, est créée une chaire
d’Espagnol dans la faculté des Lettres. Dans le même temps, l’avance prise
par Toulouse sur ses concurrentes méridionales et la reconnaissance dont elle
jouit dans cette nouvelle spécialité sont indéniables : en juillet 1900, quand
se tient à Paris la première session de l’agrégation d’espagnol, le toulousain
Mérimée est toujours l’unique professeur d’Études hispaniques de l’univer-
sité française parmi les membres du jury. Cependant, grâce au concours, et
malgré la faiblesse du nombre de postes offerts, l’agrégation vient donner une
forte impulsion à l’enseignement de la langue espagnole, dans l’enseignement 9
secondaire comme à l’université.
Cette première étape, proprement institutionnelle et strictement universi-
taire, s’accompagne de la création de deux premières revues à vocation his-
panisante. Dès 1894, à l’initiative de Raymond Foulché-Delbosc, son premier
directeur, est fondée à Paris la Revue hispanique. Cinq ans plus tard, Ernest
Mérimée est parmi les fondateurs et membres de la direction collégiale du
Bulletin hispanique, publié dans le cadre des Annales de la Faculté des Lettres
de Bordeaux et des Universités du Midi. Associant les trois universités méri-
dionales — Toulouse, Montpellier et Bordeaux —, ce bulletin invitait dans
son premier numéro « à mettre fin, du côté français, aux préjugés injurieux
et à la commode ignorance [envers l’Espagne] ». Ainsi, entre les années 1880
et les années 1900, se mettent en place en France deux pôles de l’hispanisme,
l’un parisien et l’autre méridional, de plus en plus visibles et qui, après s’être
combattus, choisissent longtemps de s’ignorer. Et c’est dans ce contexte que,
dans les années 1910, Pierre Paris, alors professeur d’Archéologie à la faculté
des Lettres de Bordeaux lance, depuis son université, ses premières initiatives
qui débouchent en 1920 sur la création de la Casa de Velázquez.
Ce bref rappel des grandes étapes qui, en une cinquantaine d’années à che-
val sur deux siècles, ont installé l’« hispanisme » — dans son acception la plus
large — dans le paysage universitaire français montre l’intérêt à se pencher sur
une histoire dans laquelle la Casa occupe une place bien particulière : à la fois
probablement l’un de ses fruits parmi les plus prestigieux, promu aujourd’hui
au rang d’acteur incontournable. Dans cette réflexion à laquelle nous invitons
3
En réalité, dès 1879 avait été créée à l’École supérieure des Lettres d’Alger une première
chaire d’Études hispaniques occupée par Alfred Paul Victor Morel-Fatio. Voir le curriculum
vitae de Marcel Bataillon, p. 75 de ce dossier.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.numéro 50 un siècle d’hispanisme
autour de la genèse et du développement de cette École française à l’étranger,
loin de nous l’idée d’une célébration, ou encore moins celle de l’ébauche d’un
quelconque bilan, à la pertinence l’un comme l’autre probablement discutable.
Par le choix d’une perspective de nature historiographique et épistémologique,
le propos est plutôt de s’essayer à dessiner les lignes de force de l’« hispanisme »
d’aujourd’hui dans toutes ses diversités — thématiques, géographiques comme
disciplinaires —, ses héritages et, bien sûr, ses perspectives d’avenir. À l’image
d’un Pierre Paris, qui se revendique archéologue du monde ibérique bien que
non-hispanisant, on ne peut s’empêcher de penser que ce sont ces croisements
disciplinaires, tant en termes de méthodes et de questionnements que de résul-
tats, qui ont contribué aux principales avancées dont l’« hispanisme » a été le
vecteur4. À compter de l’année 2020, les programmes de la Casa de Velázquez
octroieront ainsi une place significative à diverses activités et manifestations
qui auront notamment comme finalité de répondre à cet objectif ambitieux
qui n’est autre qu’une invitation faite à tous ceux dont l’objet d’étude renvoie
10 à cette aire culturelle péninsulaire et à ses prolongements américains à réflé-
chir au processus séculaire de sa construction et de son insertion dans leurs
disciplines respectives.
Ce n’est pas le lieu ici de détailler l’ensemble des projets qui, dès à présent,
ont été lancés et sont appelés à être menés et concrétisés au long des années
à venir. Précisons simplement les principales orientations que prendront les
réalisations liées à cette commémoration. Comme pour le centenaire de la
présence des archéologues français, autour de Pierre Paris, sur le site de Baelo
Claudia, un site Internet a été conçu spécifiquement pour accompagner et
diffuser les résultats des opérations menées. Ce site sera lancé le 20 mai 2020,
date anniversaire de la pose de la première pierre de l’école récemment fon-
dée. Il accueillera des publications et supports divers, tous en rapport avec
le centenaire, à commencer par la mise en ligne du livre Memoria gráfica,
complété par Jean-Marc Delaunay pour atteindre le centenaire. Par ailleurs,
un Abécédaire de la Casa de Velázquez, conçu dans l’esprit de celui imaginé
par Gilles Deleuze, sera également déposé sur le site. Construit autour de
mots-clefs synthétisant les principaux apports intellectuels et artistiques des
recherches menées à ou en lien avec la Casa de Velázquez, cet Abécédaire
prétend dessiner une géographie aussi large que possible de l’hispanisme à
partir de textes et d’entretiens réalisés avec des chercheurs provenant de tous
horizons, disciplinaires comme géographiques, et ayant contribué de façon
décisive à des débats collectifs autour de notions majeures et transversales en
lien avec les recherches menées dans l’institution.
Dans la perspective d’une réflexion sur la construction séculaire d’un objet
ou d’un champ d’étude, la concordance de la date du centenaire et la sortie du
numéro 50 de la revue Mélanges de la Casa de Velázquez nous a semblé une
4
Voir notamment à ce propos la correspondance de Pierre Paris avec Emil Hübner ou
encore François Dumas.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.éditorial
bonne opportunité pour lancer symboliquement cette décennie commémo-
rative. Dans ce premier dossier anniversaire, nous proposons au lecteur trois
textes qui illustrent quelques-uns des traits qui ont contribué à l’affirmation
de l’« hispanisme » dans le monde universitaire. Le premier se propose de
réfléchir précisément à la définition du terme. À quoi cette notion d’« his-
panisme » renvoie-t-elle dans le monde académique ? Que recouvre-t-elle ?
Comment se décline-t-elle, en France d’abord, mais aussi hors de l’hexagone ?
On peut d’ailleurs formuler le souhait que cette première contribution per-
mette d’engager une réflexion — et des débats ? — sur cette catégorie et ses
usages. Un second texte concerne une réflexion critique sur le rôle joué par les
revues dans cette construction de l’« hispanisme », phénomène qu’une thèse
récente s’est attachée à mesurer et analyser. Enfin, un dernier texte donne
la parole à celui qui reste l’un des plus grands hispanistes français, Marcel
Bataillon, qui plus est accueilli au sein de l’EHEHI en 1920. Philologue reven-
diqué, comme en témoigne la présentation de sa méthode de travail lors de
sa leçon inaugurale au Collège de France, c’est à une connaissance de l’his- 11
panité appréhendée comme une civilisation qu’il prétend. En ce sens, son
passage de l’espace péninsulaire aux territoires américains est inscrit dans
la logique d’une réflexion qui se veut totalisante. Nous inscrivant dans cette
même approche globale de l’« hispanisme » qui convoque tout le champ des
sciences humaines et sociales, ce sont les premiers pas de l’hispaniste Marcel
Bataillon au Mexique que nous proposons au lecteur de découvrir en publiant
un ensemble de documents relatifs à cette première mission outre-atlantique,
dont le texte — resté inédit dans sa version française — de sa conférence
prononcée au Colegio de México qui l’accueillit à cette occasion5. À cette
date, « pour la plupart des hispanistes français, l’Amérique est alors une zone
mineure où l’on peut certes se faire entendre, mais non pas des pays où il serait
important de dialoguer d’égal à égal6 ». Tel n’est pas le sentiment de Marcel
Bataillon pour qui, selon son fils Claude, ce voyage constitua non seulement
une bouffée d’oxygène mais aussi un plaisir et un espoir de nouvelles perspec-
tives de dialogues et de collaborations avec des « intellectuels attentifs à ses
recherches sur le monde religieux et littéraire de l’Espagne du xvie siècle7 ».
Au moment de conclure cette introduction qui ouvre la période de com-
mémoration de notre création, tournons-nous vers le futur dans lequel la
revue restera, n’en doutons pas, l’un des principaux instruments de diffusion
de nos activités scientifiques. Depuis la fin de l’année passée, la revue est
entrée dans une nouvelle étape de son histoire éditoriale par le recours au
5
Ce premier voyage outre-Atlantique a fait l’objet d’une première étude par son fils Claude
Bataillon, publiée en 2006 dans le n° 87 de Caravelle, pp. 159-193, sous le titre « Un hispa-
niste découvre le nouveau Monde : Marcel Bataillon en 1948 ». Il y réunit la correspondance
adressée par Marcel Bataillon à son épouse au long de ce séjour complétée de ses notes rédi-
gées dans une sorte de carnet de voyage.
6
Claude Bataillon, introduction au dossier (ibid., p. 159).
7
Ibid., p. 160.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.numéro 50 un siècle d’hispanisme
POD. C’est là une discrète mais profonde « révolution », occasion de lancer
son nouvel habillage graphique : plus moderne, plus dynamique, il s’adapte
aux contraintes de l’impression à la demande. Cette dernière permet ainsi
à la revue d’être toujours éventuellement disponible sur papier tout en se
doublant d’une version numérique en libre accès sur OpenEdition. L’enjeu
est simple mais non moins essentiel pour son avenir : lui offrir la possibilité
d’une présence accrue, physique et en ligne, afin d’élargir toujours plus sa
visibilité au service de la diffusion des résultats de nos recherches sans pour
autant remettre en cause sa pérennité ni l’accessibilité à l’ensemble de la col-
lection. Cette évolution technologique, aujourd’hui menée à bien, en prépare
probablement d’autres, plus radicales encore, dont tout spécialement l’adop-
tion de nouveaux supports qui accorderont une place aux formats audio
ou vidéo dans le cadre de publications dites « complexes » ou « hybrides ».
C’est dans cet esprit que la rubrique « Débats » ou encore celle accueillant
les recensions vont progressivement évoluer. En combinant ainsi formes
12 et supports, il s’agit d’apporter au lecteur une plus grande variété d’outils
d’analyse en lien avec des connaissances aux formats toujours plus divers,
tous au service d’une réflexion multiple. Aujourd’hui, Les Mélanges de la
Casa de Velázquez sont prêts pour accompagner cette transition numérique
que connaît, en ce début de xxie siècle, l’édition scientifique sans pour autant
s’y précipiter aveuglément8.
Michel Bertrand
Directeur de la Casa de Velázquez
8
Sur les enjeux complexes auxquels se heurte aujourd’hui l’édition scientifique, nous ren-
voyons à deux récents rapports qui en offrent une présentation complémentaire : Jean-Yves
Mérindol, L’avenir de l'édition scientifique en France et la science ouverte - Comment favo-
riser le dialogue ? Comment organiser la consultation ?, rapport remis à Frédérique Vidal,
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, novembre 2019 ;
Florence Le Borgne (chef de projet), Étude sur l’économie des revues françaises en sciences
humaines et sociales, rapport final, Phases 1 et 2, étude réalisée pour le ministère de la Culture
(DGMIC/Service du livre et de la lecture) dans le cadre des travaux du Comité de suivi de
l’édition scientifique, janvier 2020.
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 50 (1), 2020, pp. 7-12. ISSN : 0076-230X. © Casa de Velázquez.Vous pouvez aussi lire