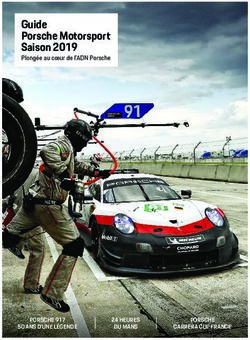L'homme-machine, paradoxe sportif
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
J.-C. BEAUNE, Faculté de philosophie, Université Jean-Moulin Lyon - BP 0638 - 69239
Lyon Cedex. Tél : 72 72 20 92
L'homme-machine, paradoxe sportif
INTRODUCTION
Depuis l'origine de notre civilisation, dans la Grèce de Platon d'abord, l'homme se voit
affecté d'une double désignation: il est un esprit (une âme), il a un corps qui est comme
la possession ou l'expression de celui-ci. D'autre part, ce que l'on nomme alors
«praxis» (plus tard: les arts mécaniques) est sous la dépendance des arts libéraux. Les
relations entre corps et machine, l'assimilation de ces deux entités du point de vue de
l'esprit ne sont donc pas un phénomène strictement cartésien mais le résultat d'une
antique coïncidence qui, malgré quelques exceptions peut être (Les Jeux Olympiques
et certaine esthétique hellénistique) définit un modèle culturel avec lequel l'éducation
physique et sportive dut composer et auquel elle doit souvent s'opposer. C'est un débat
immense dont nous intéresse ici ce qui relève d'abord de sa tradition philosophique - et
à travers elle, cet ensemble de dualismes (âme/corps, normal/pathologique,
nature/artifice, vie/mort) qui gouvernent nos valeurs et que le corps-machine investit
comme s'il se situait «entre les deux notions» - au delà même de sa propre mécanicité,
machine à jouer avec l'imaginaire et l'automatisme, expression d'un «troisième monde»
qui puise dans des significations profondes de ce rapport au monde, là où le corps
propre phénoménologique conserve son expression native qui le relie à des notions
décisives (nouveauté et répétition, sublimation peut-être). A travers cet enjeu de la
technicité sportive, c'est une image très contemporaine de la relativité qui nous est
proposée, celle qui rapporte l'homme, comme en bien d'autres domaines (physique,
biologie moléculaire, cosmologie, psychanalyse...) à une interrogation sur le temps, le
grand inconnu (ou mal connu) sans doute de cette civilisation du corps désenchanté.
On a dit que le débat était d'abord d'ordre philosophique. Descartes, en particulier,
réussit l'exploit intellectuel qui consiste à présenter, dans le Traité de l'homme, un
modèle parfaitement mécaniste du corps et à dépasser dans les Principes la dualité
stricte de ce corps et de l'âme pour conquérir une «troisième substance» - paradoxe
qui, à sa manière et dans son langage, anticipe sur nombre de paradoxes à venir
(Descartes, 1963, 379). Le corps-machine conçu par Descartes est une belle machine
de théâtre, un résumé efficace et qui touche profond. Qui touche en particulier un point
fort sensible, aujourd'hui encore plus qu'hier sans doute.La machine et la mort La symbolique de la mort est aujourd'hui un thème central pour les questions de bioéthique et leur formulation actuelle, qui d'autre part met en jeu la validité naturaliste et positiviste du sport de haut niveau parce que la mort et la machine possèdent des affinités réelles et symboliques, parce que le sportif et plus généralement l'«homme physique» est amené à la rencontrer de manière symbolique, ne serait-ce que par l'hygiénisme réel ou factice qu'il est supposé véhiculer, dont il est le chantre et le prophète, parce que la connaissance du corps (ou plutôt sa méconnaissance) est un domaine dont le sport est un révélateur privilégié. On retrouve alors quelques séquences historiques et philosophiques célèbres, qu'il est facile de traduire dans leur expression médicale. Car, après tout, pour soigner, il faut un corps et le sport est d'abord, comme la pratique des greffes d'organes ou autres problèmes actuels, un domaine d'expérimentation sur l'homme - l'homme vivant, mais aussi l'homme mort ou à demi-mort. A l'âge classique, la montre, l'horloge désignent de vraies machines, cohérentes, efficaces depuis plusieurs siècles déjà: on évoque alors la célèbre définition de la mort au chap. 6 du Traité des Passions : « Le corps d'un homme vivant diffère autant de celui d'un homme mort que fait une montre ou autre automate lorsqu'elle est montée et qu'elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre ou autre machine lorsqu'elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d'agir» (Descartes, 1973b, 955). Quant au processus de la mort, il ne se produit jamais « par faute de l'âme mais parce que quelqu'une des principales parties du corps se corrompt » (ibid.). Le contexte est certes fort différent, mais Hegel, parlant de la maladie au paragraphe 374 de l'Encyclopédie déclare que « l'animal se trouve engagé avec une puissance inorganique et arrêté dans un de ses systèmes ou organes particuliers à l'encontre de l'unité de sa vitalité » (Hegel, 1967, 213). Son organisme peut se servir de la force qu'il contient pour différer le pire mais il peut aussi « être vaincu par (la division) et y trouver son genre de mort ». Plus précisément, il y a maladie lorsque l'un des systèmes ou organes (de l'être vivant) « s'attache à soi et persiste à diriger son activité particulière contre celle de l'ensemble dont la fluidité et le processus passant à travers tous les moments se trouvent ainsi arrêtés » (paragraphe 371). Les deux définitions semblent relativement convergentes. De fait, il est facile de donner de la mort «en suspens» une image mécaniste. La montre possède quelque privilège bien que l'on pense «naturellement» à d'autres machines, des machines industrielles ou préindustrielles, porteuses au moins symboliquement de cette «fluidité» qui apparaît comme l'attribut principal du vivant. Les machines à vapeur de Newcomen et Watt, en particulier, rajeunissent l'automate cartésien, fait de figures et mouvements, dont persiste une figure de mort institutionnelle: la guillotine. Conçues à la fin du XVIIIe siècle, les machines industrielles ne représentent pas une série tout à fait «nouvelle»: ainsi la machine à vapeur est-elle une réponse lointaine mais fidèle à la question de la sortie de l'eau des mines posée depuis longtemps et qui suscita quelques monstres mécaniques intéressants. En fait, à la fin du XVIIe siècle, deux ensembles techniques se superposent et se croisent: les «méchaniques» d'une part
restent des abréviations plus ou moins réussies du cosmos revu et corrigé par l'homme (à cet égard, la montre occupe une place spéciale); d'autre part, de nouvelles machines apparemment plus dépendantes du «milieu automatique» (elles doivent en particulier y puiser l'énergie dont elles dépendent), gagnent une «nature» c'est-à-dire une organisation, acquièrent le pouvoir d'essaimer, de changer aussi de vocation et de conditions matérielles d'exercice comme la machine à vapeur qui, après quelques épisodes parfois humoristiques (on a pensé plusieurs années que le «glissement» du fer sur fer rendait, par défaut d'accrochage, tout mouvement impossible), trouve ses rails pour devenir locomotive. Ces machines, que l'on se réfère à un contexte sidérurgique ou textile, supposent non seulement des formes et des individus exemplaires mais un milieu socio-ergonomique adéquat. L'opposition du naturel et de l'artificiel se complexifie: il devient bien difficile de n'accorder à ces ensembles cohérents et «fluides» que de strictes qualités artificielles ou formelles. D'ailleurs la morale officielle et patronale aura pour tâche de convaincre les hommes, les femmes et les enfants voués au service de ces machines de la nouvelle «nature» qu'ils ont gagnée, au prix de pas mal de misères s'entend. Au XVIIe siècle, cette «nature» n'est pas acquise - les «états de nature» n'ont pas encore perdu tous leurs charmes, qui deviennent désuets lorsque Hegel inscrit la mort dans la strate primordiale de la culture humaine. La mort, au XVIIe siècle, est encore «longue et proche» pour reprendre l'expression d'Ariès (1981) qui traduit l'incertitude, l'embarras où l'on se trouve. La «Nature» constitue donc le terme synthétique entre mort et machine, celui par lequel l'homme préindustriel acquiert une nouvelle connaissance de lui-même qui lui fixe un destin différent. Ce retour sur soi n'est plus directement perçu en tenues de cogito - d'ailleurs pour suivre toujours Ariès, on valorise la «mort de toi» et non plus, comme au XVIIe siècle, la «mort de soi » . L'homme doit conquérir le monde, le transcender, le déplacer de son registre supposé originel s'il veut prendre en compte ce nouvel abîme; la machine industrielle est d'abord une machine capable de s'approprier l'énergie de la matière première, ainsi l'eau - sa forme élémentaire, voir les anciens moulins - soumise aux turbines et barrages, le charbon qui suppose d'ailleurs de l'air et de l'eau pour être extrait dans des conditions vivables, le feu asservi à une métallurgie rayonnante, l'atome plus tard. L'énergie alors gagnée est reversée à l'homme, « humanisée » mais pas totalement et les maladies qui accompagnent ce processus le prouvent: manque d'air: tuberculose et phtisie pulmonaire; «cristallisation»: silicose; pourrissement: syphilis; maladies dermiques et cancers: dessèchement et brûlures. Les maladies d'une époque sont révélatrices de l'état technique des hommes concernés par elles. Elles supposent un rapport « naturaliste » à l'élément, à la qualité énergétique de celui-ci plutôt. C'est un jeu de forces qui régit l'ensemble, non plus une structure géométrique. Un jeu de forces où le sport trouve naturellement sa place. Il en est résulté, au XXe siècle, par exemple une nouvelle définition de la mort (caractérisée non plus par l'arrêt cardiaque mais par deux électro-encéphalogrammes plats à plusieurs heures de distance) à travers laquelle on retrouverait sans trop de peine les anciennes ambiguïtés. On sait qu'elles donnent lieu à des situations parfois mal maîtrisées : comas dépassés, comas neurovégétatifs, maintien artificiel d'individus en état de vie suspendue pour des raisons politiques ou plus simplement; inversement,
problèmes liés à l'euthanasie. A l'autre bout de la vie, les différentes techniques liées à
la séparation entre fécondation, gestation et procréation donnent à la naissance une
nouvelle profondeur. Les juristes tentent de codifier ces embarras et les moralistes,
médecins ou philosophes sont amenés à repenser tout simplement la vie, selon
d'autres critères. Mais toutes ces techniques concernent d'abord la mort logiquement et
techniquement première et c'est de sa qualité inédite, de toutes les parts de mort que le
vivant porte et doit assumer en lui pour vivre que procède la dialectique contemporaine.
Entre métaphysique, sciences et techniques, de nombreux liens impensables il y a peu
se déroulent. L'homme contemporain, soumis à des traitements médicaux, psychiques,
à une technique de vie beaucoup plus exigeante qu'autrefois doit concilier en lui, pour
sa propre survie, ces zones de vie et de mort qui le hantent. C'est un effort physique
mais aussi psychique et philosophique. La mort n'est plus tout à fait la fin, le passage
vers un ailleurs absolu. Elle est devenue une voisine, une complice, une part intime de
notre être avec laquelle nous devons composer dans ce «troisième règne», encore plus
indifférent s'il se peut aux nuances savantes entre nature et artifice, qui est aujourd'hui
le nôtre. La machine est notre ombre portée, sous toutes ses formes, des plus militaires
et tragiques jusqu'au remède quotidien, au dopage toléré, au tranquillisant familier.
L'homme devient-il ainsi meilleur ou pire ? Nous n'en savons rien.
L'appel à l'Ethique sert aujourd'hui surtout à neutraliser certains problèmes, bien
techniques et concrets au profit d'une vision du progrès et plus généralement de
l'Homme (évidemment !) qui, de fait, accentue le cynisme ou l'irresponsabilité du
médecin au profit du « grand automate» enveloppé d'éthique qui se rit un peu plus
encore de l'individu pour mieux se consacrer au rêve de l'espèce. La conquête des
dilemmes techno-médicaux par la biologie scientiste est flagrante et la fonction
principale de l'éthique consiste en général à arrondir les angles, à justifier les moyens
par les fins. L'euthanasie à la portée de tous: le dernier sourire de l'automate mortifère
? Constatant l'abandon de toute sociabilité de la mort, P. Ariès affirme, à la fin de
e
L'homme devant la mort: «au XX siècle, la technique grignote le domaine de la mort
jusqu'à l'illuson de la supprimer. La zone de la mort inversée est aussi celle de la plus
forte croyance en l'efficacité de la technique et de son pouvoir de transformer l'homme
et la nature ». Si l'on pousse un peu plus loin l'idée, on constate que la technique a
gagné une «fluidité» qui lui permet de gouverner «en douceur» les corps et les âmes.
Descartes et Hegel sont dépassés sans doute par la logique qu'ils ont, un instant,
côtoyée: pour la post-modernité (ou quelque chose de ce genre), l'euthanasie
potentielle est devenue peut-être la forme quotidienne de l'immortalité.
Le sport, systématisé, hygiénisé et devenu barbiturique héroïque participe de ce même
confluent du mythe et de l'utopie, en lequel «le technique» retrouve, à travers par
exemple une réflexion sur l'euthanasie, un sens philosophique acceptable. On pourrait
évoquer, bien sûr, le rapport du sport au travail pour lequel le corps-machine fut
également décisif. Mais il faut d'abord examiner dans quelle mesure l'image mécanique
peut de manière exacte représenter le corps.L'image du corps-machine
Examinons en conséquence la mécanisation et la standardisation des actes humains
dont le sport fait apparaître la vertu mais aussi les embûches. On aimerait, à ce propos,
rappeler la pensée de G. Canguilhem (1965) montrant combien Descartes, à qui l'on
attribue généralement la paternité de l'image initiale de l'homme-machine, n'a pas
réduit l'homme à un ensemble de mouvements purs et durs, n'a pas supprimé la finalité
vitale de la représentation mais l'a concentrée en l'acte originel, celui où les deux
substances procèdent de la même inspiration métaphysique et divine. Descartes n'a
pas réduit la vie à la machine - il s'est servi du modèle, de la fiction médicaux pour
exprimer le vivant (c'est une méthode fort moderne qu'il inscrit dans la pensée).
Canguilhem marque également à quel point l'homme de Vésale (1968) devra attendre
la fin du XIXe siècle pour trouver enfin sa vraie possibilité logique - alors que l'homme
de Copernic, perdu par son narcissisme, décentré au sens propre, gagne étrangement
une importance sans rapport avec ces peu gratifiantes images. Mais l'intention de
Canguilhem est ailleurs et son oeuvre en témoigne :
1) refaire à sa manière le trajet cartésien en posant le mouvement du corps sous
sa forme la plus brève, la mieux physiologiquement constituée: le réflexe - d'où son
texte « L'analyse du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles » (Canguilhem, 1955)
en lequel il marque combien cette interrogation ne détruit pas le vitalisme primordial ;
2) interroger fondamentalement les rapports entre le normal et le pathologique
mécaniques, source de tous les problèmes connexes (y compris art et nature) et
parvenir à cette formule: il n'y a pas de pathologique mécanique ; il n'y a pas de
machine-monstre. Pourtant, J. Biache (1984) l'a bien vu dans un texte qu'il m'a
aimablement communiqué: tout le portrait du sportif tient à cette ambiguïté: entre
machine et monstre, il est «un peu» le troisième terme obligé. Et ce troisième terme, on
a la faiblesse de le voir selon une image qui nous tient à coeur (et qu'on ne doit jamais
réduire à une image purement mécanique), celle de l'automate.
Cette image propose donc une lecture épistémologique du sportif, de son «idée» - mais
aussi un accès à ces qualités symboliques que notre mentalité a répertoriées.
Considérons quelques éléments de cette fresque - en revenant rapidement à l'origine
des images.
Et d'abord à l'origine du corps.
« Je suppose, dit Descartes, que le corps n'est autre chose qu'une machine de terre,
que Dieu forme tout exprès pour la rendre plus semblable à nous qu'il est possible: en
sorte que non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos
membres mais aussi qu'il met au-dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire
qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire et enfin qu'elle imite toutes celles de nos
fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que de la
disposition des organes» (Descartes, 1963). Ce texte étrange a suscité de nombreux
commentaires. On se borne à constater que l'automate est le mythe profond de son
mécanisme épuré. L'histoire nous renseigne. Les appareils d'Hippocrate, le premier
mécaniste sans doute, serviront d'inspiration aux machines médicales et machines à
torturer de la Renaissance. Le mouvement perpétuel se donne à voir dans les grandes
horloges à jacquemarts des cathédrales où le temps humain redouble le temps divin, etdans les moulins à vent que Lynn White (1969) considère comme les premières machines énergétiques de l'humanité en genèse. C'est contre ces moulins qu'en 1615 (date approximative des premiers textes de Descartes), Don Quichotte combat au nom de la tradition avec son armure et son cheval de bois - coïncidence trop belle pour être tout à lait innocente - Don Quichotte, la caricature de l'ancienne image à laquelle Descartes en l'an 1633 - année du procès de Galilée, autre coïncidence - oppose le Traité de l'homme. Le passage de l'ancienne image au modèle effectif permet encore, selon Lynn White, de surmonter les difficultés d'ordre sensible que l'homme éprouve pour saisir et accepter la transformation d'un mouvement rotatif (celui des mondes) en un mouvement alternatif (celui du corps humain). Il y a un schème de bielle-manivelle dans toute machine médicale et sportive. Sur le plan psychologique, dans le Traité des Passions de Descartes, «l'âme ne peut entièrement disposer» du corps et des esprits animaux (Art. 46) (Descartes, 1973b, 989). Le modèle automatique permet de décrire et classer les passions mais même de leur proposer un «remède général» (Art. 211). Ce remède est pragmatique et intellectuel à la fois puisqu'il consiste, quand «on sent le sang ému», à se défier de l'imagination, à laisser faire le temps et retomber l'émotion, si «on dispose de quelque délai». Ce remède (rudimentaire sans doute) est conforme à l'image automatique première et au premier projet de Descartes. Le temps propre de l'automate s'affirme contre la mathématique spatiale des figures et mouvements. C'est dans ces étranges machines que l'auteur a puisé son inspiration et c'est à partir d'elles qu'il construit son modèle. Fort intéressé par les horloges, les moulins mais aussi les « fontaines d'où sort un monstre marin», il affirme: «l'âme raisonnable sera en cette machine, elle y aura son siège principal dans le cerveau et sera là comme le fontainier qui doit être dans tous les regards où vont se rendre tous le tuyaux de ces machines quand il veut exciter où empêcher ou changer en quelque façon leurs mouvement». La thérapeutique cartésienne pourra-t-elle empêcher totalement le fontainier de devenir l'« arroseur arrosé» ? L'âme ne peut qu'amortir cette causalité réciproque du corps qui permet alors à M. Guéroult (1970) de dire que Descartes fut l'«inventeur de la cybernétique». L'automatisme demeure dans tous les cas le fondement de ce mécanisme par lequel une auto-thérapeutique s'enracine dans ce qui n'est plus une pure philosophie de la volonté mais un «compromis» où se dessine une psychologie et même une psychiatrie qui, au nom de ce principe, peut aller jusqu'à utiliser le modèle contre lui-même. Le modèle s’est en quelque sorte dépassé lui-même: son caractère théorique débouche sur une attitude plus pratique, pas trop éloignée de ce que peut évoquer, toute référence moliéresque à part, certaine technicité médicale (qui pourtant, en raison de la normalité décisive de l'homme considéré, peut en droit se passer de médecin - ou plutôt pour laquelle chacun est encore son propre médecin). Une médecine hygiéniste et sportive pourquoi pas ? Le modèle cartésien engendre bien des semblables, directs ou non. On pense à Thomas Willis, médecin et chimiste (Canguilhem, 1955). Au composé des figures et mouvements, à la fontaine cartésienne succède «une substance explosive et élastique». L'involontaire, effleuré par Descartes, devient le levier d'une vision de l'animation qui ne présuppose plus l'intégrité physique de l'organisme. Autant d'images
que de physiologues : Croone, Berkeley, Haller, Hartley, La Mettrie et Diderot lui- même, plus tard Unzer et Prochaska en attendant Jackson et... Freud. Le «microscope théorique» de l’homme-machine cartésien permet d'envisager d'autres visées qui modifient en retour ce modèle assez simpliste. L'expérimentation solidifie ses règles. Borelli mesure la force broyante du gésier des dindons en introduisant en eux des boules de verre. Hoffmann et Stahl, Helvetius aussi tentent de concilier trituration mécanique et fermentation chimique et le Canard de Vaucanson simule même la digestion et l'excrétion (Chapuis, 1947). Des modèles successifs naissent de séries d'images qui deviennent des protocoles d'expérience. Le fil automatique n'est jamais perdu ; c'est lui qui garantit la solidité de cet ensemble, jusque dans l'expression la plus philosophique de ces simulacres : la statue de Condillac (dont on ouvre peu à peu tous les sens) et l'homme de la nature de Rousseau. L'automate ambulatoire Pourtant une question ouverte par le premier modèle demeure. L'homme-machine, sous ses diverses apparences, sert de prétexte et de texte même à la définition des grandes fonctions de l'organisme mais la psychologie la médecine mentale n'en tirent pas de leçon très convaincante. On a dit déjà que le trajet de l'histoire des sciences était loin de se présenter à nous comme rectiligne. C'est en redevenant image, au sens le plus empirique et le plus archaïque du terme, que l'homme-machine ressort comme un diable de sa boîte à la fin du XIXe siècle à travers des questions urgentes de médecine mentale. Image, c'est-à-dire copie simplifiée, leurre et leurre du leurre: je pense au nouvel homme-machine que propose Charcot, entre 1885 et 1890 à la Salpétrière et qu'il qualifie dans ses Leçons du Mardi d'automate ambulatoire, notion qui s'applique d'abord, en cet âge industriel très exigeant, à un individu typique: le Vagabond. Un concept médical et social donc pour une investigation très différente de celle de Descartes: c'est un vrai patricien qui parle, depuis sa «clinique», qui fait défiler concrètement des sujets vivants (ou supposés tels). Mais l'automatisme et l'involontaire cristallisent encore dans l'image. Freud qui pensait à l'hystérie a assisté à ces défilés avant de rejoindre, en 1889, Bernheim à Nancy. L'automate ambulatoire, comme son nom l'indique, est pour Charcot une image synthétique, celle d'un type biologique et social et l'équivocité du lien entre ces deux attributs constitue l'un des intérêts majeurs de cette séquence. Charcot décrit le nouvel homme-machine : «(le malade) est sujet à des accès consistant en ce que, tout à coup, au milieu de ses occupations habituelles, sans prodromes bien marqués, il perd la conscience de ses actes, se met en marche résolument sans savoir cependant où il va, à la manière d'un automate et ne reprend sa lucidité qu'au bout d'une période de temps dont la durée peut varier de quelques heures à quelques jours» (Charcot, 1988-89). Somnambulisme, rêve éveillé, hypnose même, tout y passe dans ces descriptions d'un malade qui, comme l'esclave antique, est machine par la répétition des gestes (symptomatologie très superficielle) et parce qu'il est, encore, imprévisible. En tant que tel, il déroge à la loi du travail et de la société bien réglés.
L'automate ambulatoire ne contrôle pas son temps et d'abord son temps d'«absence», son temps de flânerie dira un peu plus tard Taylor, soucieux d'identifier rationalité du travail et contrôle du temps libre. Taylor en effet, en 1911, raisonne sur des bases assez voisines (Taylor, 1967). Il propose, pour supprimer la perte de temps, de ramener les gestes de l'ouvrier à des données simples (5 gestes au lieu de 18 pour construire un mur de briques) et de favoriser la répétition mécanique de ceux-ci jusqu'à obtenir un «automatisme» parfait. Certaine contradiction de l'époque, enfermée dans cette nouvelle image, surgit alors dans ce dialogue à distance entre le médecin psychiatre et l'ingénieur social. Leurs principes sont les mêmes, l'image-mère est partagée mais la maladie de l'un devient le remède de l'autre. L'automatisme de base peut donc apparaître comme la meilleure ou la pire des choses, selon que l'individu contrôle ou ne contrôle pas son temps de vie - Descartes disait-il autre chose ? On sait la suite: l'ingénieur lucide et rationnel doit contrôler le temps total des ouvriers, d'abord pour en éliminer les vagabonds, les déchets irrécupérables, mais surtout pour inscrire en eux, de la naissance à la mort, la morale mécanique et la dogmatique de la répétition par lesquelles ils acquièrent les mêmes vertus que certains dévoyés exhibent comme une tare irréversible. On voit que le corps ne dit pas grand chose pour lui même dans ces discours qui le visent. De leur côté, les médecins, pendant la période 1880-1920 (et au-delà) se voient placés devant un choix difficile. D'un côté, une objectivité scientifique mais fondée sur cette imagerie régressive et vite épuisée; de l'autre, le renoncement au modèle mécanique qui enjoint de découvrir d'autres principes. L'homme-machine devient l'occasion d'une alternative qui s'adresse aux principes mêmes de la médecine. Ceux qui choisissent la première optique s'enferment dans la sécurité d'un destin biologique et héréditaire, ultime image en miroir de la mécanicité «darwinisée». Les autres, freudiens et psychanalystes souvent, pensent que l'on doit repartir du «rien de sûr», du «ça», d'une autre définition de l'homme. Abandonnent-ils ainsi l'image mécaniste ? Le modèle semble avoir perdu, au premier abord en tout cas, ses puissances premières, sa fécondité: on n'a bientôt plus que l'illustration légendaire d'une symptomatologie assez fruste et qui se dessèche encore - comme si la psychiatrie moderne avait besoin de ce retour à zéro pour se présenter libérée. On peut suivre en effet quelques instants ce resserrement de l'image. Un disciple de Charcot, le Docteur Pitres, en 1896, précise: «On appelle sous le nom d'automatisme ambulatoire ou de vagabondage compulsif une maladie ou un syndrome maladif essentiellement constitué par des accès intermittents d'impulsions irrésistibles à la marche». L'auteur décrit des fugues, ni plus ni moins. Le cas s'est encore simplifié. Le Juge Chanteau, en 1899, tente de distinguer vagabonds et mendiants et d'isoler parmi eux «les professionnels » des «pathologiques». «Aux premiers, dit-il, doivent être réservées les rigueurs de la loi, aux seconds les bienfaits de l'assistance publique ou privée»...«Le législateur.. réservera aux paresseux, aux révoltés l'ablation du chirurgien» (Chanteau, 1910). Si la charge sociale se confirme, le portrait clinique ne se précise guère. Pour A. Pagnier, le vagabond est «extra-social»... « Vacher l'assassin-vagabond, tuait dans un but rénovateur» (Pagnier, 1910). De fait, dès 1886, la revue fondée par le Play, La Réforme Sociale, pose un portrait psychologique: «Le pauvre, honnête et laborieux, cherche à se relever quand il tend la main, quand il mendie, c’est un regret, souvent honteux, le vagabond a renoncé aux
voies régulières. La mendicité est pour lui une profession, une industrie». De l'absence de sens moral à la potentialité du crime, le portrait rencontre d'autre; errances mécaniques, ainsi la prostituée que le Docteur Simonot en 1911 (l'année même de la parution de l'ouvrage de Taylor) qualifie: «Il y a des familles de prostituées comme il y a des famille de podagres ou de graveleux» (Simonot, 1911). L'hérédité est devenue le cheval de bataille et le célibataire lui-même se voit rangé sous la bannière de la fatalité biologique qui s’est peu à peu substituée à la description mécaniste. La science ne peut qu'entériner les rigueurs de la nature et, en 1890, les Docteurs Marie et Meunier présentent un nouveau vagabond exemplaire: le Juif errant (Marie et Meunier, 1908). Inutile d'insister cette littérature dont on peut multiplier les exemple. Alexis Carrel n'est pas loin. Quelques mots cependant sur l'aspect proprement médical de la question. Avec le Docteur Dubourdieu (1894) l'image de Charcot s'est un peu précisée: l'automate ambulatoire est devenu un «dromomane dégénéré», genre dont les espèces sont la neurasthénie, l'épilepsie, l'hystérie, la kleptomanie et la dipsomanie. De la décadence sociale à la dégénérescence biologique, en ce temps comme en d'autres, le pas est vite franchi. Charcot, présentant deux dégénérés et déséquilibrés, tente de rapporter leur cas à ce qu'il nomme la «diathèse hystérique» et conclut que cette maladie caractérise des hommes féminisés, atteints de «suffocation utérine». On voit émerger pourtant à travers ces tristes images sans recours les développements de la tendance psychiatrique modeme. Janet, en 1889, remodélise en quelque sorte l'image d'Epinal trop gratifiante, et cite Leuret: «L'homme a perdu son unité... Il est dominé, il est esclave, son corps est une machine obéissant à une volonté qui n'est pas la sienne» (Janet, 1899). Il nuance le jugement et rapporte ces actes à des individus «désagrégés», semi-conscients et comme à demi-possédés par une volonté extérieure. Le docteur Benedikt, de Vienne, a des soucis pédagogiques pour les enfants abandonnés, déclassés où se recrute la majorité des vagabonds. Enfin, pour en terminer avec ces flashes un peu répétitifs, Janet et Raymond, en 1911, dépassent la vieille imagerie et rapportent ces conduites à l'automatisme mental et au processus général du rêve considéré comme structurel (Beaune, 1983). Descartes est retourné pour de bon cette fois - mais il a fallu bien des détours. L'automatisme ne vise plus le corps mais l'esprit et la brèche ouverte par le Traité des Passions engendre enfin d'autres modèles. La part de Freud dans la nouvelle définition en genèse est trop connue pour que l'on insiste. Freud contourne l'obstacle mécaniste mais en tire le meilleur parti: le modèle symbolique est devenu vraiment opératoire, à moins que la pulsion de mort le reconstitue «en substance», comme une concession au déterminisme biologique ? Jean Laplanche voit dans cet épisode une nouvelle jeunesse théorique: «Des termes entièrement nouveaux apparaissent: Eros, pulsion de mort, compulsion et répétition...dans cette grande fresque métapsychologique, métaphysique et métabiologique» (Laplanche, 1970, 163). Il s'agissait pour Freud, pense-t-il, face au triomphe de la vie et de l'homéostatique, d'affirmer «une sorte d'anti- vie» primaire, de lutter contre le débordement originaire du ça avec les armes de celui- ci. Il a fallu bien des «réductions» souvent simplistes pour que le «grossissement» cartésien aboutisse et se dialectise. La psychiatrie est arrivée à retrouver l'image
mécanique de l'homme et à condenser ainsi un processus long de trois siècles dont on a esquissé quelques traits. Le modèle «par la mort» est devenu un modèle «pour la mort» à mesure que la neurophysiologie l'a emporté sur l'anatomie et que l'esprit s'est affronté à sa propre mécanicité. La pulsion de mort qui étreint Joey l'«enfant-machine» ressemble à ce premier terme logiquement nécessaire auquel la vie libidinale doit s'affronter pour se recomposer dans le Moi. Le modèle a changé de valeur sans changer de structure: ce faux changement nous semble avoir puissamment aidé à la constitution des sciences psychiatriques et neurologiques contemporaines - et aux développements de la psychanalyse. A l’application, on le souhaite d’un « principe de relativité » à la mécanicité sportive. En effet, la tentation profonde du sport de haute compétition mais aussi du sport-loisir parfaitement «intégré à la nature» se constitue bien autour du rêve d'une enfance absolue qui laisserait enfin parler le corps pour lui- même, en sa propre assomption - jusqu'aux limite; de son humanité. Certain journalisme sportif épris de «records mondiaux», la collaboration exaltée de soi-même à sa propre souffrance, le culte phénoménologique d'un sujet dépassé mais toujours là: autant d'ingrédients à cette quête qui transcende le sport lui-même mais qui fournit en retour à celui-ci, par le biais du corps-machine, un outil capable d’analyser cet ensemble symbolique. On peut dire d'ailleurs les choses autrement: suffirait-il aujourd'hui de conférer au corps mécanisé les anciens privilèges de l'esprit pour réaliser un idéal tient on a perçu la vanité millénaire? Le nouvel homme-machine Qu'est devenu en effet l'homme-machine dans ce dédale ? Nous est-il encore perceptible aujourd'hui ? Le contexte technique a encore changé : il est aujourd'hui « naturellement» artificiel, médiatique, sportif, cybernétique et informatique. Mais l'automate mythique tient bon. Du jouet électronique ou sportif jusqu'à la dernière opération post-mortem (ou presque), l'homme intègre de mieux en mieux ses jeux de miroirs et d'automates. «L'automatisme mental» en particulier a encore gagné en efficience. Car si les images mécaniques du corps ont été patiemment déléguées à l'individu par la médecine des prothèses, par le travail, le sport, par les technologies et paramédecines des corps, par la généralisation des machines à calculer numériques puis des machines analogiques, le développement actuel des machines-transferts sondées non seulement sur le principe de feed-back mais sur un rapport étroit entre hasard et liberté a conduit, depuis l'homéostat d'Ashby, à d'autres rêves. L'inversion des rapports entre esprit et corps semble parfois accomplie. L'automate voué à la matière des corps par la dualité des substances cartésiennes a conquis l'esprit jusqu'à suggérer un détournement du sens traditionnel de notre culture. Si l'on raisonne à son sujet en termes de paradigme ou de simulateur, il nous semble que l'on imite plus facilement aujourd’hui l'esprit que le corps, que la distance métaphysique est en conséquence non supprimée mais renversée. Une machine compte, calcule, cherche et trouve plus vite et plus sûrement que l'homme : il «suffit» de la bien programmer - et l'on peut concevoir des systèmes robotisés repoussant assez loin l’intervention humaine. Réciproquement, une machine peut-elle, même parfaitement programmée,
dire sa douleur, sa faim, sa tristesse devait l'aléatoire autrement que de manière dérisoire ? On en doute malgré les performance; psychologiques de certains montages. Le corps mécanisé est devenu sans doute plus confus que l’esprit, surtout si celui-ci est supposé ramené à des norme; rationnelles et mathématiques. Le paradoxe engagé repose, celle fois encore pensons-nous, sur la confusion constante que maintient notre civilisation entre rationalité scientifique et efficacité technique. L'automate incarne cette confusion, il n'est peut-être rien d'autre qu'elle. Si l'on pose la question toute simple (mais blasphématoire) : la machine peut-elle penser ?, on ne sait trop que dire. Tout dépend des relations préalablement établies entre homme et machine et de la définition des deux espèces. Ainsi l'homme-machine ou la machine- humaine sont-ils, plus que jamais, voués à une logique de la fidélité première, de la mimésis qui donne d'ailleurs au robot son aspect hyper-conventionnel. Mais le robot n'est qu'un esclave. Il répète et reproduit. Si l'on traduit les performances des machines dans le domaine intellectuel, depuis les travaux de Von Neumann (1966, 1992), qui parlait, lui, de « reproduction autonome» des machines (Beaune, 1983), l'image de l'homme se brouille un peu mais continue de constituer l'image de référence, le modèle au sens scripturaire du texte. Le paradigme de l'imitation se mue alors en une sorte de contrat de non-agression entre deux réalités de moins en moins repérables à mesure que leurs performances se croisent. En ressort une mixité utopique qui, comme l'actuelle mixité de la vie et de la mort, nous rappelle à distance l'âge des lumières où le goût des automates spectaculaires et des anatomies mouvantes s'accommodait mal des ambiguïtés quant à la définition de la Mort (voir l'article « mort» dans l’Encyclopédie (dû au médecin Menuret, de l'école de Montpellier), qui explique que nous mourons deux lois, lorsque coeur et respiration cessent et lorsque la pourriture intervient : entre ces deux moments, nous continuons à vivre d'une vie larvaire, discrète mais réelle, ce que Ariès nomme « la mort longue et proche »). Cette image ultime de l'homme machine nous lait penser aujourd'hui non seulement aux incertitudes quant à la naissance et la procréation artificielle ou aux coma; dépassés mais à cet ensemble de parts de mort et de vie que l'automatisme quotidien inscrit dans nos exigences. Ces doses de travail aliéné, de sport prescrit et de remède; angoissants, de neuroleptiques, tranquillisants et autres ingrédients sont en partie gouvernées par l'ingénieur des âmes qu'est devenu le médecin neurologue et psychiatre ou l'entraîneur des disciplines de haute compétition. Lorsque névroses, dépressions, malaises banaux et angoisses s'introduisent dans nos êtres, ils ne se contentent plus de bloquer des mouvements, de suspendre des fonctions: ce sont des parts de limbes qui cherchent et trouvent parfois leur équilibre, comme lorsqu'un système dissipatif cherche et trouve parfois sa régularité, son équilibre, par le jeu de l'aléatoire et du nécessaire. L'homme-machine contemporain n'est donc plus simple image ou modèle. C'est un simulateur un vrai paradigme en lequel la logique la plus directe (celle de l'imitation) se voit ressuscitée par la nouvelle technique sous un mode qui n'a pas changé de syntaxe puisque celle-ci demeure celle de l'automate, de l'« automation » comme on dit aujourd'hui. Cette nouvelle sphère d'influence technologique n'est pas un « simple » surplus mais un composant ordinaire de notre être. Pour situer historiquement la
question, on se rappelle que l'homme contemporain est le descendant direct du tayloriste des sociétés industrielles classiques. Lorsqu'on part du principe qu'un travailleur est d'autant plus rentable qu'il ne connaît de la machine, du milieu où il évolue que le minimum indispensable, non seulement ses conditions psychologiques de vie en souffrent mais en retour, la machine, structure globale, récupère symboliquement le savoir dont il se voit frustré et devient, selon son image anthropomorphique, plus «libre», c'est-à-dire, elle aussi, mieux « automatisée ». Cette image s'applique, s'appliquait en tout cas, à certaine conception de la condition sportive lorsqu'on concevait l'effort comme la capacité à reproduire mécaniquement un acte. Alors le sportif est à la fois l'occasion de l'image projective et l'occasion d'une bien fatale réalité. En tant qu'automate ou homme-machine actuel, artifice déclaré et pourtant simulateur d'une nature revitalisée, il se présente dans le monde trouble des limbes à la fois comme le plus universel des modèles et la plus singulière des images (on le baptise, on lui prête une psychologie, il vit, il meurt parfois comme dans les films). Mais cette définition correspond aussi à la plus universelle des conditions et au plus singulier des états, celui où l'individu se réalise enfin. Cet automate est un être des confins et des lisières, porteur de l'ambiguïté insoluble qui jamais ne s'épuise mais se nourrit d'infra-raison et de sur-raison, de mythe et d'utopie. Au-delà de la technique en miettes, il rêve à son autonomie et maintient l'altérité essentielle que Maelzel d'E. Poë avait, par sa ruse, sublimée. L'automate culmine dans la science et la technologie contemporaine où ses expressions se dédoublent, se décuplent jusqu'à perdre parfois leur matérialité technique au profit d'une dénomination mathématique supérieure. Et notre comportement psychique, pathologique mais aussi normal, est affecté en profondeur, avec ou sans notre complicité. Considérons rapidement une « faculté » comme la mémoire. Intellectuelle et physique, c'est elle qui produit les conditionnements indispensables à toute pratique de haut niveau, entre autres choses. Or, elle a connu de nombreuses images, depuis les perspectives philosophiques de Platon, Locke, C. Wolf, W. James jusqu'au «comportementalisme» de Skinner qui n'est qu'un néo-matérialisme puisque, dans ce modèle, le comportement de l'individu est fonction de ses effets et du renforcement que produit la réponse. Un néo-mécanisme aussi : il n'existe pas d'âme, d'intériorité et il n'y a rien à voir au-dedans de l'homme mental. Intelligence et mémoire ne sont alors que des modifications de l'état du système physique et nerveux en fonction du renforcement du milieu. La peau n'est pas une frontière : entre l'homme et le monde renaît la vieille union envisagée par certains présocratiques. La psychologie cognitiviste de Piaget (renforcée par Chomsky sur le plan du langage) repose, elle, sur une image informatique : la mémoire et l'ensemble des actes intellectuels relevant de la reconnaissance fonctionnent comme un ordinateur classique composé de trois « stores » (sensoriel, à court terme, à long terme) et d'un système de contrôle qui règle le flux d'informations lorsque l'on passe de l'un à l'autre des « stores ». Nouvel homme- machine : l'architecture des modèles cognitivistes est fidèle à celle des machines cybernétiques depuis Wiener et Von Neumann : système des entrées, unité centrale, mémoire proprement dite. On peut envisager trois opérations : acquérir, traiter,
conserver l'information (il est remarquable que cette structure ternaire soit déjà celle qui apparaît chez les médecins arabes du IXe siècle : fantasia, cognitio, memoria). On obtient ainsi un modèle à réseau relevant de l'auto-organisation ou plus précisément des automates à seuil, dont le grand-père (puisqu'on parle en termes de « générations ») est sans doute l'homéostat d'Ashby en 1955, prototype de l'automate et de l'homme- machine contemporains. Un ensemble d'automates dont on change de manière aléatoire les connexions est capable, sans aide extérieure, de retrouver son équilibre dans un temps aléatoire : il faut alors choisir entre l'hypothèse d'un déterminisme caché et celle d'un hasard organisateur qui remet en cause les fondements de la rationalité technologique classique et transfère à la machine, par extension à l'homme, une autre vie par laquelle il relève du troisième monde aperçu. Les automates contemporains (êtres théoriques et pratiques) créent des images nouvelles, « à la limite » des êtres nouveaux, comme des images de synthèse. Par des classes particulières d'algorithmes (suites finies d'instructions exprimées dans un langage codé), un automate peut s'appliquer à lui-même de manière réitérée jusqu'à obtenir un équilibre stable. Si la réalité matérielle de l'automate a changé, sa définition première est restée la même. Ces réseaux, dont chaque sommet est lui-même un automate, transforment l'information et, à partir d'un fonctionnement aléatoire, permettent d'atteindre des régularités convergeant sur la notion de seuil : chaque sommet calcule son état selon les informations qu'il reçoit à partir d'un seuil et décrit ainsi des situations diverses. Le modèle s'applique alors aux mécanismes de la mémoire associative : un neurone (correspondant à un automate booléen) possède plusieurs entrées (synapses) mais une seule sortie (axone) qui transmet le signal dans le réseau. Les synapses assurent les connexions et fournissent aux entrées des autres neurones un signal dérivé du signal de sortie, jusqu'à obtenir une « fonction à seuil» et un sous-ensemble stable correspondant à la fonction de reconnaissance. La mémoire, ainsi conçue, fonctionne comme un robot théorique et technique à la fois (ce modèle s'applique aussi à la structure de certains verres et cristaux... et d'autres « synthèses » techniques). Le troisième monde automatique mnémonique trouve dans le sport et ses apprentissages, dans la culture corporelle et technique son meilleur paradigme : la prétendue spontanéité n'a jamais mieux expérimenté sa limite que dans le domaine où le fonctionnel l'emporte toujours sur le naturel. On apprend à marcher d'abord, avant d'apprendre à lire et si l'on apprend à lire comme on a appris à marcher, ce n'est pas seulement parce que nos langues sont linéaires parce qu'alphabétiques. Le troisième monde Qu'est devenu enfin le modèle de l'homme-machine dans ces nouveaux états ? Par rapport à l'image humaine, ces machine; sont-elles vivantes ou mortes, naturelles ou artificielles ? Le problème a-t-il encore un sens ? Le sport, cette fois encore, sert de paradigme efficace. Si sans sombrer dans des rêves de science-fiction, on admet que tout ou partie du mouvement corporel et mental de l'homme relève de telles descriptions, nous retrouvons la zone intermédiaire de demi-vie, demi-mort, une zone de spectres plastiques et prothétiques qui modélise chaque jour un peu plus notre être. Ces
Vous pouvez aussi lire