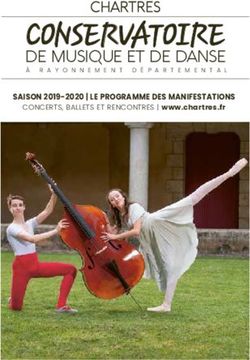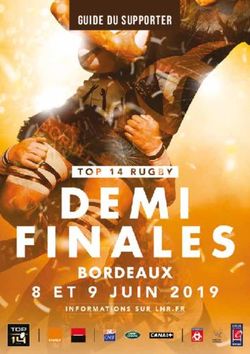" À la française " - Programme - Geneviève Pirotte, PIANO Sylvain Cremers, HAUTBOIS Vincent Dujardin, NARRATION - Les Arts Entrelacés
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
“À la française” - Programme
Geneviève Pirotte, PIANO
Sylvain Cremers, HAUTBOIS
Vincent Dujardin, NARRATION Du côté de chez Swann – À la recherche du temps perdu de Marcel PROUST (1873-1922) Le récital emmène les spectateurs à Paris, à la fin du 19ème siècle. En compagnie des artistes, soyez maintenant les invités privilégiés à la fête de Madame de Saint-Euverte, allez à la rencontre de Swann et de la Princesse des Laumes (mieux connue sous le titre de Duchesse de Guermantes!) et laissez- vous gagner par cet humour si fin, si vrai, si délectable, … en un mot, si… proustien! Sonate pour hautbois et piano (Andantino – Allegretto - Molto allegro) de Camille SAINT-SAENS (1835-1921) Grâce rococo, goût pastoral, harmonies savoureuses ; spirituel et charmeur, du véritable Poulenc avant la lettre, quelques virtuosités. Etude transcendante « Chasse sauvage » de Franz LISZT (1811-1886) Imitations de cors, claquements de fouets, rythmes syncopés ; cette étude passe tel l’ouragan d’un équipage nocturne et démoniaque Fantaisie-Impromptu opus 66 en do# mineur de Frédéric CHOPIN (1810-1849) Moment heureux de création dans l’œuvre de Chopin, instant de joie, délicatesse ; tendresse amoureuse dans le Moderato central au thème discret et poétique Le petit nègre de Claude DEBUSSY (1862-1918) Pochade dont Debussy reprendra le thème pour évoquer le soldat anglais dans la Boite à joujoux
Estampes (Pagodes - Soirée dans Grenade - Jardins sous la pluie) de Claude DEBUSSY (1862-1918) Prétextes à des évocations magiques: langage pianistique révolutionnaire. Pagodes nous mène en Indonésie, enthousiasme de la découverte, à l’Exposition universelle de 1889, des résonances cristallines des gongs, cloches, cymbales et autres percussions balinaises; Soirée dans Grenade, torpide et obsédante habanera au lourd parfum, à la fois tendre et fière; “force d’évocation concentrée…écrite par un étranger guidé par la seule vision de son génie”; Jardins sous la pluie, vent cinglant et aigrelet de Paris, “Nous n’irons plus au bois”, “Do, do, l’enfant Do”, bruissements, éclaircie et gazouillis de mille oiseaux frileux. Berceuse héroïque de Claude DEBUSSY (1862-1918) Premier hiver de la guerre; le Daily Telegraph prépare un album en hommage au roi des Belges Albert Ier dans lequel on retrouvera aussi Elgar, Messager et Monet ; simplicité tragique, émotion sobre et grave, morne décor des tranchées des Flandres noyées par les brumes de novembre ; appels de trompettes ; citation discrète et fière de la Brabançonne. Sonate pour hautbois et piano (Elégie – Scherzo - Déploration) de Francis POULENC (1899-1963) À la mémoire de Serge Prokofieff ; paix ; puis tout s’anime progressivement et débouche sur un dialogue rythmé ; scherzo animé et enjoué où s’affirme un piano percutant ; déploration, calme, chant mélancolique.
GENEVIEVE PIROTTE
Après de brillantes études au Conservatoire de Huy, Geneviève Pirotte obtient
successivement un Premier Prix de Piano, d’Harmonie Ecrite, d’Harmonie Pratique et
un Diplôme Supérieur de Piano au Conservatoire Royal de Musique de Liège.
Elle décroche ensuite un Premier Prix d’Accompagnement avec Distinction au
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles
ainsi que le Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’enseignement.
Elle est finaliste des Concours Jeunes Talents et Günther, du Concours
National du Crédit Communal et détient le Grand Prix du Concours Andrée Charlier.
Diplômée de l’Institut Musical Européen de Besançon première nommée, elle a
aussi obtenu le Grand Prix Marie-Antoinette Breways-Schussler au Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles, ainsi que le Diplôme d’Honneur au Tournoi
International de la Musique.
Elle donne de très nombreux concerts en tant que soliste, chambriste et
accompagnatrice notamment aux Printemps de Silly, au Château de Chimay, au
Festival des Raspes, au Cercle Royal Gaulois, aux Centres Culturels de Famenne-
Ardennes, de Huy, de Berghem-Sainte-Agathe, d’Andenne, de Woluwé-Saint-
Pierre…, à l’asbl Reform, Pianissimo, au Duo d’Avril, au Brussel’s Summer Festival,
au Festival Monteverdi…, au Festival de Ravello (Italie), à la Villa Paladienne (Jura),
au Musée de la Ville de Trier,… et s’est produit souvent avec l’Orchestre Pro Musica
de Welkenraedt, l’Orchestre Nuove Musiche, l’Orchestre National de Belgique, Les
Muses et Sammartini Consort.
Après neuf années passées au Conservatoire Royal de Mons comme
accompagnatrice et chargée de cours de Johan Schmidt, elle est actuellement
professeur de clavier-chanteur au Conservatoire Royal de Bruxelles ainsi que
professeur de piano aux Académies de Woluwé-Saint-Pierre et Ciney.
C’est avec bonheur qu’elle rencontre toujours régulièrement son Professeur et
Maître Wolfgang Manz à Nürnberg.
“Léger ou puissant, son jeu touche au cœur comme l’onde marine,
si apaisante quelle que soit sa force.” D. PiletteSYLVAIN CREMERS
Sylvain Cremers nait près de Verviers (Belgique ) en 1970.
Il entreprend ses études musicales supérieures au Conservatoire Royal de
Musique de Liège où il obtient successivement le premier prix de hautbois avec la
plus grande distinction, le premier prix de musique de chambre et enfin le Diplôme
Supérieur de hautbois avec la plus grande distinction.
Il se perfectionne ensuite à la « Musikhochschule » de Cologne ainsi qu’auprès
de Monsieur Jean-Louis Capezzali à Paris.
Lauréat du Concours National Axion Classics (« Pro ci Vitate ») de Belgique,
il a également participé aux concours internationaux de Munich ( ARD) et de
Bayreuth (Pacem in Terris).
Il devient successivement professeur de hautbois à l’Académie de Musique de
la Communauté Germanophone de Belgique entre 1991 et 1997, à l’Institut Supérieur
de Musique et Pédagogie de Namur (Imep) de 1994 à 1998, au Conservatoire Royal
de Musique de Bruxelles (1997 à 2000), au Conservatoire Royal de Musique de
Mons depuis 2000 et à nouveau à l'IMEP depuis 2011.
Depuis 1994, Sylvain Cremers occupe le poste de hautbois-solo à l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège Wallonie Bruxelles.
Il s’est produit en soliste avec différents orchestres de chambre, avec
l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre Philharmonique de Liège, Sinfonietta
Köln et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
Il est régulièrement invité comme professeur à différents masterclasses :
Libramont, Malonne, Dinant, Conservatoire de Pekin (en 2002), Antwerpen etc…VINCENT DUJARDIN
Vincent Dujardin commence très tôt l’étude de l’art dramatique. En 1993, il
réussit l’examen d’entrée au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans la
classe d’André Debaar. C’est sous l’oeil de Bernard Marbaix qu’il obtient le premier
prix trois ans plus tard.
Durant toutes ces années, Il dirige de front ses études et ses débuts de
comédien sur les scènes professionnelles.
Au théâtre, il interprète entre autres Musset, Tchékhov, Feydeau, Jarry, Proust,
Tardieu...
Plus volontiers metteur en scène, Vincent Dujardin travaille pour divers
théâtres et compagnies.
Dans le cadre des festivités liées à la réouverture de l’Opéra Royal de
Wallonie, il met en scène L’Officier de fortune de Grétry, une partition inédite.
Pour l’Atelier Théâtral Jean Vilar, il assure la création mondiale de Moi, je
crois pas! de Jean-Claude Grumberg.
Pour la Comédie Claude Volter, outre les spectacles La pitié dangereuse de
Stefan Zweig, Conversations après un enterrement de Yasmina Reza, il réalise la
mise en scène de Il était une fois la Belgique d’après Patrick Roegiers - reprises au
Festival de théâtre de Spa et au Théâtre Jean Vilar -, Menus-Plaisirs d’après le
Théâtre de chambre de Tardieu et Georges Dandin de Molière.
Très friand du répertoire classique, Vincent Dujardin met en scène
Shakespeare, Goldoni, Hugo, Maupassant, Mauriac, Wilde, Garcia Lorca, Brecht,
Ionesco, Anouilh... Il s’intéresse aussi à certains auteurs plus contemporains tels
Ayckbourne, Calaferte, Foissy, Horovitz, Bonal, Blasband, Schmitt ou Lagarce...
Vincent Dujardin est également musicien. Sa passion pour l’opéra lui a permis
d’aborder à la scène des œuvres de Mozart, Verdi, Puccini et Poulenc.
D’autre part, attiré par l’écriture, Vincent Dujardin adapte pour le théâtre, le
roman Pierre et Jean et la nouvelle La maison Tellier, deux œuvres de Maupassant.
Vincent Dujardin est licencié en Arts du spectacle du Centre d’études
théâtrales (Faculté de Philosophie et Lettres) à Louvain-la-Neuve.À propos du récit
Marcel Proust renouvelle un genre littéraire: le roman. Il y a, dans l’histoire de la littérature,
un avant et un après Proust.
Véritable comédie humaine, La recherche du temps perdu doit une grande partie de son
succès à sa galerie de portraits hauts en couleur. Les musiciens - et la musique - sont notamment
pour l’auteur une grande source d’inspiration; il aime les classiques et les romantiques, est un
admirateur de Chopin, de Wagner et César Franck... Reynaldo Hahn est son intime...
Un des rares plaisirs de Proust lui-même était de lire, devant quelques amis, des pages de la
Recherche. Il devait donc, comme Flaubert, penser que la littérature est faite pour être lue à haute
voix.
Par l’évocation d’une soirée musicale dans un salon parisien très «fin de siècle», les artistes
proposent un regard teinté d’humour et de finesse sur une époque à la fois spirituelle et triviale,
moqueuse et sensible... Porté par une mise en scène très simple, le spectacle laisse donc une grande
place à l’imagination et, surtout, à la beauté du répertoire musical choisi.
Et puis, comme l’affirme Marcel Proust «le véritable voyage de découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.» Voire de nouvelles oreilles...
Du côté de chez Swann (1913)
Du côté de chez Swann est le premier des sept volumes qui constituent À la recherche du
temps perdu.
Dès la première partie, intitulée Combray, l’auteur y fait parler le narrateur (qui est
essentiellement Proust lui-même). Figure centrale et «héros passif» de la Recherche, c’est celui qui
écrit «je». Grâce à la saveur d'une madeleine trempée dans du thé, il retrouve alors les joies et les
angoisses liées à sa propre enfance.
Dans la deuxième partie, intitulée Un amour de Swann, est narrée longuement la passion
vécue, bien avant la naissance du narrateur, par un voisin de Combray, Charles Swann, figure en
vue du faubourg Saint-Germain à qui la rencontre d'Odette de Crécy donne l'occasiond'expérimenter douloureusement les débordements d'une jalousie en laquelle se concentre tout son
amour. Swann découvre du même coup les milieux bourgeois (le «clan» Verdurin) et
aristocratiques (le monde des Guermantes).
À la française est constitué d’extraits de la deuxième partie et relate quelques moments de la
soirée musicale passé par Swann chez les de Saint-Euverte - aristocrates en vue tenant salon à Paris.
À travers son narrateur, Proust ne cesse d'explorer la fine mécanique des logiques sociales
telles qu'elles peuvent apparaître à un œil exercé. Il scrute sans trêve la manière dont les
personnages singuliers se débrouillent dans l'enchevêtrement des causes et des effets, et ne peut
déguiser le plaisir qu'il prend aux ratages que connaissent des êtres peu aptes à ajuster dans leurs
conduites un code d'action à un autre.
Mais ce qui inspire le plus vivement le narrateur est d'une autre dimension. On parlerait
volontiers ici de «microsociologies» qui s'élaborent autour de personnages en situation momentanée
(plusieurs sont de simples figurants dans le roman). S'amorce avec chacun d'eux un petit récit qui
démêle les éléments de la logique à laquelle le personnage se conforme. Or, à chaque coup, il s'agit
d'une conduite paradoxale.
En chaque cas, se donne à voir une discordance entre effet recherché et effet obtenu; pour le
moins biscornue, elle peut tenir du gag.
En somme, le plaisir de Proust est d'expérimenter les limites des logiques comportementales.
Tantôt pour constater que les engrenages se grippent. Tantôt pour noter que, à force de détours et
de complications, les trajectoires les mieux programmées aboutissent à des solutions absurdes.
Un amour de Swann et la musique
Proust avait appris à jouer du piano et savait lire une partition. Il ne s'est jamais dépris de la
musique. Elle est pour lui à la fois un sujet qu'il traite et un objet qu'il intègre à son œuvre; elle est
aussi un modèle et implique de grandes structures et de grandes formes sans autre contenu que celui
qui est immédiatement sensible. De plus, dans la Recherche, on peut clairement qualifier de«musicales» l’amplitude générale de l'œuvre et la phrase elle-même (ne parle-t-on pas de «la
musique de la phrase proustienne»?).
De plus, le rapport entre l’homme et la musique est un thème longuement exploré par
Marcel Proust au sein de son œuvre; et lui-même de reconnaître que la musique crée en lui une
émotion qu'il lui est très difficile de comprendre ou d'identifier. Dès lors, par le biais de son
écriture, il tâche constamment de traduire la nature de l'effet que peut parfois produire le langage
musical sur la vie des êtres humains.
Le récital met en scène quelques personnages haut en couleur et présents au concert organisé
par la marquise de Saint-Euverte. Comme dans le roman, on découvre alors comment l’un et l’autre
vibrent à l’écoute de tel ou tel morceau de musique, comment chacun réagit de façon personnelle,
avec plus ou moins de bonheur.
Par exemple, si la marquise de Cambremer, en femme qui «a reçu une forte éducation
musicale» s’applique surtout à montrer qu’elle est fine connaisseuse (or, plus la marquise tend vers
le monde des duchesses, plus elle s'adonne à l'art le plus misérabiliste!), si la vicomtesse de
Franquetot, admire d’abord la performance «sportive» du pianiste qui interprète Liszt, Swann, lui,
en quête d’un bonheur enfui, se comporte de manière beaucoup plus paradoxale. En effet, d'un côté
la musique l’attire parce qu'il retrouve le temps perdu en l'écoutant et, d’un autre, elle lui fait aussi
ressentir le souvenir de son amour perdu (et Proust de décrire alors la souffrance de son héros
obligé de côtoyer des êtres dont la bêtise et les travers ridicules le frappent vigoureusement.)
Bref, quand on sait que pour l’auteur la musique «ouvre plus largement l'âme», l’évocation
d’un épisode particulièrement significatif et la description de comportements qu’engendre une
situation originale permet sans doute de mieux faire comprendre le rôle important qu’elle peut tenir
dans cette partie de À la recherche du temps perdu.
Correspondances musicales et littéraires
Tant par l’évocation de compositeurs disparus à l’époque à laquelle Proust élabore son récit
(Chopin, Fauré, Saint-Saëns, … ) que par la présentation d’œuvres d’artistes qui lui sontdirectement contemporains ou le suivront (Debussy, Pierné, Poulenc, …), À la française offre un
bel éventail d’extraits musicaux.
Frédéric CHOPIN (1810-1849)
En 1896, Marcel Proust évoque le compositeur d’origine polonaise. Chopin qui, ça et là
dans La Recherche, émaille le récit de sa présence passée et nourrit les personnages par son éternel
génie musical…
Chopin, mer de soupirs, de larmes, de sanglots
Qu’un vol de papillons sans se poser traverse
Jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots.
Rêve, aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce,
Toujours tu fais courir entre chaque douleur
L’oubli vertigineux et doux de ton caprice
Comme les papillons volent de fleur en fleur ;
De ton chagrin alors ta joie est la complice :
L’ardeur du tourbillon accroît la soif des pleurs.
De la lune et des eaux pâle et doux camarade,
Prince du désespoir ou grand seigneur trahi,
Tu t’exaltes encore, plus beau d’être pâli,
Du soleil inondant ta chambre de malade
Qui pleure à lui sourire et souffre de le voir…
Sourire du regret et larmes de l’Espoir !
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
Saint-Saëns est bien connu de Proust. À en croire l’écrivain, c’est te compositeur qui lui
inspire l’évocation de la sonate de Vinteuil, avec sa fameuse « petite phrase » qui perturbe tant
Swann en fin de soirée, chez Madame de Saint-Euverte. Comme Vinteuil, le musicien imaginé par
l’auteur, Saint-Saëns appartient à la génération des précurseurs, ceux qui amorcent ce qu'on appelle
le «renouveau de la musique française» (Saint-Saëns est né en en 1835 et, dans le récit, Vinteuil une
dizaine d'années plus tôt). La principale différence tient dans leur succès, puisque Saint-Saëns est
devenu très jeune une gloire mondiale, tandis que Vinteuil est resté un compositeur obscur, simple
professeur de piano. Proust va jusqu'à préciser, dans une lettre à Jacques de Lacretelle, que Saint-
Saëns a bel et bien fourni le modèle de la sonate de Vinteuil : «Dans la faible mesure où la réalité
m'a servi, mesure très faible à vrai dire, la «petite phrase» de cette sonate, et je ne l'ai jamais dit àpersonne, est (pour commencer par la fin) dans la soirée de Saint-Euverte, la phrase charmante mais
enfin médiocre d'une sonate pour piano et violon de Saint-Saëns, musicien que je n'aime pas».
Témoignage capital et amusant s’il en est, puisque Proust avoue qu'une musique médiocre à ses
yeux lui a inspiré la sublime petite phrase !
Franz LISZT (1811-1886)
Déjà dans Les Plaisirs et les Jours, son premier livre publié (1896), l’écrivain fait allusion à
ses compositeurs favoris. Sorte de pot-pourri rassemblant une bonne partie des textes que Proust
rédige depuis sa sortie du lycée, ce volume comprend des portraits de musiciens structurés en bouts-
rimés. Comme Chopin, Franz Liszt est directement cité dans l’extrait déclamé. Sous la plume de
l’auteur, certains personnages écoutant sa musique font preuve d’un comportement mêlant à la fois
grâce et bêtise! Le comique alors parle de lui-même.
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Le point commun entre Marcel Proust et Claude Debussy est leur originalité: leur monde est
complet, il ne ressemble à aucun autre. Debussy ne devient lui-même qu'à presque 40 ans, Proust
aussi. C'est ainsi que chacun a pu inventer son propre langage. Ils expriment une époque à laquelle
leurs œuvres ont survécu, et ils partagent, sinon une esthétique, du moins une culture qui est celle
du symbolisme, plus encore que de l'impressionnisme. Ils appartiennent à une génération qui met
au-dessus de tout la quête de l'absolu par le langage, et l'idée qu'il faut aller au-delà des apparences.
La musique de Debussy n'est jamais sentimentale. La littérature de Proust non plus. Il décrit des
sentiments mais, au-delà des mots, des faits, des signes, Proust et Debussy sont en quête d'une
profondeur symbolique. Au-delà des notes, il y a quelque chose «d'englouti»
Francis POULENC (1899-1963)
Il est difficile de convenir du fait que Poulenc et Proust se soient un jour côtoyés. Lucien
Daudet, fils du romancier Léon Daudet et lui-même écrivain, peut d’une certaine manière être
considéré comme le lien entre les deux artistes. En effet, camarade, entre autres, de Proust,
Cocteau, Max Jacob et de l’ancienne impératrice Eugénie, Lucien fait aussi partie, à la fin de sa vie,
de la fameuse Bande des dîners du samedi, avec Poulenc, Milhaud ou encore Auric… Sans doute
Poulenc y entend-il alors Daudet évoquer le génial écrivain de La Recherche? De plus, il est
piquant de noter que la comtesse Adhéaume de Chévigné, la grand-mère de Marie-Laure de
Noailles, grande intime de Francis Poulenc, servit de modèle à Proust pour la duchesse de
Guermantes, personnage évoqué dans le récital.L'asbl « Les Arts Entrelacés »remercie chaleureusement le Directeur du Conservatoire Edouard Bastin de Ciney, Monsieur Bernard FRANCO, d'avoir mis gracieusement à notre disposition la grande salle du Château St Roch.
Vous pouvez aussi lire