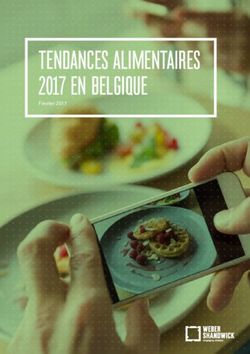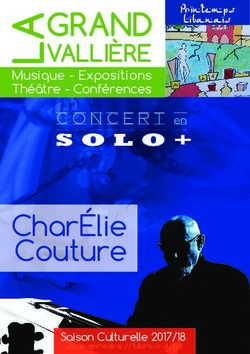La question de l'immigration et le problème de l'intégration des étrangers en Belgique
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
La question de l'immigration et le
problème de l’intégration des
étrangers en Belgique
Conférence délivrée le 2 juillet 2011 à l’Abbaye de Forest, à Bruxelles, à l’invitation de l’ASBL-Libéral.
Franklin Nyamsi
Professeur Agrégé
Docteur en Philosophie de l’Université Charles de Gaulle-Lille 3
L’objet de notre réflexion est quelque peu volatile. Nous devrons
concentrer nos premiers efforts à nous focaliser sur tout ce qu’il a de
complexe. L’intitulé de la présente conférence laisse à penser que
l’immigration est une question et que l’intégration des étrangers pose
problème en Belgique. Quelle question se cache-t-elle donc derrière le
fait d’immigrer ? Quel problème le fait d’intégrer des étrangers en
Belgique pose-t-il ? Et comment l’histoire de l’accueil des étrangers en
Belgique est-elle solidaire finalement de l’histoire contemporaine du
rapport de la nation belge envers elle-même ? Nous avons donc trois
précautions méthodologiques à prendre, afin de nous lancer à bras-le-
corps dans l’analyse de notre objet de pensée.
Une précaution sur la notion d’immigration, une autre sur celle
d’intégration, mais aussi un regard circonstancié sur l’histoire
contemporaine de la Belgique, car comme vous le devinez, une nation qui
s’interroge sur son identité est sans doute davantage questionnée par
l’identité de ceux qui veulent ou pourraient s’identifier à elle. Car
l’actualité de notre questionnement tient précisément à la coïncidence,
dans le cas de la Belgique, de la question de son image d’elle-même ou
identité propre, avec la question de sa différence, de son rapport même à
l’altérité.Le paradoxe atteint son comble quand on se demande alors : qu’est-
ce que devenir belge pour ces immigrés et ces étrangers si être belge en
soi pose désormais problème comme les tentations de partition du
royaume le laissent accroire ? Peut-on, pour emprunter une métaphore,
tenter de se sauver d’une noyade en s’accrochant à la queue d’un serpent
qui lui-même se noie ? Les immigrés et les étrangers peuvent-ils encore
croire en la Belgique ?
Une ultime indication de méthode. J’aborde bien sûr ces questions,
non pas simplement en historien du social, mais bien en philosophe de
l’histoire contemporaine. J’essaie de passer de l’événementiel au réflexif,
et du réflexif au conceptuel, en m’inspirant de la triple distinction
hégélienne de l’histoire événementielle, de l’histoire réfléchie et de
l’histoire philosophique.
I
La question de l’immigration
On ne peut la comprendre que si l’on a au préalable défini ce qu’est
l’immigration. C’est en saisissant le sens de ce mot que nous nous
laisserons questionner par lui. On entend précisément par immigration,
l’entrée dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l’extérieur
et qui viennent s’y établir, y chercher un emploi. L’immigré est donc bien
souvent quelqu’un qui est venu de l’étranger, souvent d’un pays peu
développé, et qui s’établit dans un pays industrialisé. Ces descriptions
sommaires de termes immigration et immigré nous laissent pourtant sur
notre faim. Tout semble aller de soi, si l’on s’en tenait à ce qui précède.
On immigre comme le vent souffle où il peut. On suit naturellement les
opportunités de l’espace et du temps, comme les oiseaux migrateurs ou
toutes les autres espèces animales connues. L’immigration humaine ne
serait-elle pas tout simplement un phénomène naturel ? Non, justement,
et c’est là la raison profonde de la question de l’immigration.
L’immigration renvoie aux problèmes de survie, non de la nature, mais
bien de la culture ou civilisation, ou tout simplement de l’humanité
comme espèce douée de vie symbolique. C’est après et malgré tout, une
stratégie de sauvegarde du sens.
On explique la question profonde de l’immigration par la
notion d’interdépendance inégale entre les différentes régions dumonde. C’est l’inégale répartition des conditions d’accès à l’alimentation,
à la santé, à l’éducation, au logement, à l’emploi, au transport, au luxe,
qui explique les mouvements migratoires humains. Sous la cendre des
mouvements de populations, apprenons à percevoir le feu pressant du
besoin et du désir. C’est le manque du nécessaire qui pousse l’humain à
quérir d’autres cieux et d’autres terres, comme les autres animaux. Mais
à la différence de tous, l’humain est mû par le désir, c’est-à-dire la quête
d’une vie qui ne s’assoupisse pas seulement dans le rassasiement de
l’affamé, mais s’affirme aussi à un étage supérieur, celui du sens, celui de
la reconnaissance par l’autre. Car si le besoin ne crée que des rapports
utilitaires, le désir quand à lui crée des rapports symboliques. C’est grâce
à lui que vivre veut dire quelque chose, puisqu’il ouvre la dimension de
l’espoir, du projet, du rêve, de la réalisation de soi-même comme œuvre.
L’immigration répond au désir de s’accomplir ailleurs que là où les
hasards de l’existence sociale de l’humanité nous ont fait naître. Elle est
projection du proche vers le lointain, comme pour boucher le trou du
présent proche par l’appel du lointain futur. L’appel du large. Je me
souviens de ces nuits camerounaises où pour leurs enfants qui partaient
en Europe, des familles entières entraient en transe vers l’horizon, l’envol
de l’avion qui emmenait leurs enfants était l’envol de leur espoir, comme
une bouteille jetée à la mer. Question donc. Comment creuser ce désir
d’immigration ? Comment en rendre compte ?
Dans trois directions, la question de l’immigration nous prend
d’assaut. La question de l’immigration est la question de la société d’où
partent les migrants. Elle nous impose d’être attentifs aux mécanismes
en vertu desquels se produit la pulsion migratoire, le désir d’émigrer et
d’être immigré. On découvre alors que la structure mondiale de
l’interdépendance inégale des régions a son pendant local. Ce sont les
rapports socioéconomiques locaux qui déterminent d’ores et déjà les
contours internationaux de l’immigration. Les inégalités locales, qu’elles
soient infrastructurelles (état des infrastructures matérielles,
économiques, éducatives) ou superstructurelles (niveau de culture des
individus et des familles, motivations religieuses, projets divers) sont le
moteur des pulsions migratoires. Du palais de la république au taudis du
bidonville, riches et pauvres en pays de pauvreté et de domination,
individus issus des classes moyennes, lorgnent plus d’une fois dans leur
vie du côté de la frontière. Mais selon le statut socioéconomique, mais
aussi culturel et civique de sa famille, le degré de couverture étatique
dont il bénéficie ou pas de la part de l’Etat de son pays d’origine,
l’immigré n’arrive pas aux abords des frontières étrangères avec les
mêmes hypothèques.Il y a ensuite la question du statut de l’immigré lui-même : que
vaut-il économiquement, culturellement, politiquement ? De quoi sont
faits ses bagages matériels, mentaux, spirituels, culturels ? Ou sera-t-il en
mesure d’accrocher son sac dans la société d’accueil ?
Enfin, la question de l’immigration est celle de la société d’accueil,
supposée réceptrice de l’immigrant. Le choisit-elle ? Le subit-elle ? Le
tolère-t-elle tout juste ? Est-elle pré-formatée pour le rejeter ? Y a-t-il
seulement une place chez elle pour quelqu’un comme elle ou lui ? Car il
existe des sociétés qui attendent des immigrés, mais évidemment, ce
n’est pas vous, monsieur Hamza, mademoiselle Diallo, ou monsieur
Kamga, ou madame Gisiga, qu’elles attendent. Mais c’est vous qui venez,
et on doit faire avec. D’où, problème.
Voilà donc pourquoi l’immigration est décrite dans des termes qui
connotent l’intrusion, l’invasion, la pénétration sans préliminaire, y
compris par des chercheurs qu’on peut croire avertis. Une chercheure de
l’Union Européenne, Catherine Wihtol de Wenden nous indique les
grands axes de la question de l’immigration, telle qu’elle se pose sur le
continent blanc. Vous serez cependant attentif à la conclusion qu’elle
donne à cette question, conclusion que nous faisons ici notre, pour ce qui
est de la Belgique :
Une double pression venue du sud et de l’est s’exerce sur l’Europe
qui demeure un pôle important d’immigration. Au sud, les pays
méditerranéens (Maghreb, Turquie) et l’Afrique sahélienne continuent
d’exporter de la main d’œuvre vers les pays européens malgré la
fermeture des frontières survenue en 1973-1974. Cette pression
migratoire ne semble pas près de cesser, car il n’existe souvent aucun
substitut durable à la migration : l’expansion démographique, le sous-
emploi, l’attrait du libéralisme politique et culturel sont autant de
facteurs qui contribuent à alimenter les filières de départ. Les flux de
clandestins, de demandeurs d’asile ou d’étudiants en témoignent. […]
Que l’action soit mis sur une Charte sociale ou sur le renforcement des
mécanismes de contrôle, il apparaît que le problème de l’immigration est
inséparable, dans la mesure où les flux avec les pays extérieurs à la
Communauté prennent une importance croissante, d’un réexamen des
rapports avec le Tiers Monde et de la définition d’un nouvel ordre
international. [1]La puissance de la métaphore de la pression dans ce texte est lisible.
L’immigration, selon ce texte, a d’abord et est d’abord une affaire
exogène. Un dehors d’ailleurs qui vient perturber le dedans d’ici. Mais,
quand on va plus loin, l’énoncé qui précède établit donc clairement ce
que nous avons voulu montrer en étalant ce qui fait problème dans
l’immigration. A l’origine, elle provient d’une injustice économique,
politique, sociale, culturelle que l’on veut réparer par l’insertion dans un
contexte meilleur. Ainsi, à la fois dans le processus du transfert du
migrant et dans le processus de son accueil, le problème de l’inégalité de
départ se double d’un problème d’inégalité à l’arrivée. L’immigrant est
paradoxalement souvent le non-voulu d’ailleurs qu’on ne veut pas trop
ici, au cœur d’un double rejet, comme ballotté entre deux camps
adverses. L’immigré est comme ces âmes avec lesquelles, dit-on dans les
mythes, le diable joue à la balle entre deux murs. Nous comprenons donc
que la question de l’immigration n’étant pas résolue, puisque le nouvel
ordre égalitaire international tarde à s’installer, sa seule alternative ne
reste qu’à affronter le fameux problème de l’intégration, comme un
manchot à qui l’on demande de prendre son courage à deux mains.
La question de l’immigration se solde donc comme le long serpent
de mer de la justice économique et politique internationale,
contrairement aux préjugés nombrilistes des extrêmes-droites
européennes, qui s’acharnent à faire de l’immigration une affaire de
personnes et de pays particuliers contre lesquels le sort de l’immigration
étrangère s’acharnerait malgré toutes leurs incantations exorcisantes. De
fait, les migrants finissent en grand nombre par entrer en Belgique,
comme partout ailleurs dans la Communauté européenne dont la
Belgique est membre. Comment intégrer ces gens-là ? Nous y sommes.
II
Le problème de l’intégration des étrangers en
Belgique : enquête sur un concept malin.
Alors même que son étymologie latine, du verbe integrere, signifie
se renouveler, la notion d’intégration a été détournée, rendue maligne
par les pratiques des politiques de la société dans le mondecontemporain. Ce qui frappe dans la notion sociale d’intégration, c’est
son caractère littéralement stomacal. Elle me rappelle de façon sidérante
les mythes africains sur les mangeurs d’âme, ces sorciers qui à la tombée
de la nuit, viennent en traîtres vider les corps de leur sang et de leur
fécondité, les psychismes de leur mémoire et de leur identité. Ces
psychopompes qui viennent dans l’ombre vampiriser les innocents,
lobotomiser ceux que leurs familles ont eu l’imprudence de ne pas faire
blinder par un puissant guérisseur. Ne sont-ce pas les lois et règlements
de l’intégration qui sont nos vampires modernes ? Quand j’entends le
mot intégration, je sens qu’on prépare les couverts, qu’il y en a un qui va
passer à table. Comment vivre sereinement cette affaire ? Les peurs
archaïques de la dévoration s’éveillent inexorablement. Intégration, vous
avez dit ? Elle renvoie à une métaphore alimentaire qui laisse à penser
que l’étranger qui débarque doit passer par un processus comparable à
celui du bol alimentaire. L’aliment cru ou cuit, l’étranger donc, n’est pas
bon pour être mangé comme les autres. Il subit un procès d’insertion
dans la communauté nationale sous les modalités précises de
l’assimilation. Le moulin à écraser de la société d’accueil en raffole.
Broyer de l’étranger est une justification extraordinaire de toutes les
administrations de la terre.
Intégrer, c’est assimiler, faire sien, incorporer, prendre en soi,
phagocyter, avaler. Intégrer c’est nier l’intégré pour reconstituer
l’intégralité de la communauté d’accueil. Mieux, c’est désintégrer
l’immigré pour le soumettre à une nouvelle intégrité. L’intégration,
dans son idée même de processus d’aspiration de l’inconnu vers le
connu, se livre comme un système qui prend l’intrus en le niant comme
tel, qui le broie et le plie, le rompt et au besoin le corrompt, le malaxe, le
mélange, le tord jusque dans ses boyaux pour qu’il rentre goulument et
comme naturellement dans l’animal social qui l’ingère et veut s’assurer
qu’il pourra le digérer. Or il y a des étrangers indigestibles car ils sont
restés trop crus ou sauvages, durs et revêches, impropres à la
consommation, au propre comme au figuré. Vous voulez comprendre ? Il
y a ceux à qui on parle à peine, voire qu’on ne peut pas écouter parce
qu’on ne se fait jamais à leur accent. Il y a ceux qu’on ne touche jamais,
ceux à qui on évite de faire la bise, ceux près desquels on ne s’assied ni
dans le bus, ni dans le train, encore moins dans la salle d’attente chez le
médecin ou dans une salle de classe. Ils sont si crasseux ! Il y a ceux
qu’on ne peut pas sentir car ils sentent trop mauvais, ceux qu’on ne peut
pas voir parce qu’ils sont trop visibles, les fameux gens de couleurs qui
n’en changent pourtant pas beaucoup, tellement ils sont foncés et
cachent leurs états d’âme sous leur ténébreux épiderme.Dans sa notion conceptuelle même, l’intégration pose triplement
problème. D’un point de vue esthétique, elle affirme la suprématie d’une
certaine forme de corporéité dominante. L’idéal esthétique du pays
intégrant, c’est bien sûr le mâle ou la femelle de couleur d’épiderme
majoritaire dans la société. La mécanique ethnocentrique tourne ici à
plein régime avec l’écume des préjugés raciaux. En Belgique, le belge et
la belge idéaux seront sans doute blancs et miraculeusement noir, métis
ou jaune. Le corps normal, celui qui passe inaperçu dans l’espace, aura
aussi des modes vestimentaires, des modes d’expression, des références
comportementales rattachables à l’histoire supposée très ancienne du
pays.
A un second niveau, l’intégration pose le problème psychique de
l’acculturation, puisqu’en se posant comme la condition du devenir belge,
elle suppose la Belgique éternelle, archétype fixé dans le ciel des Idées
platoniciennes, immuable, ne demandant qu’à être rejoint et adopté sans
autre forme de procès. Dans un tel contexte, l’immigré de couleur doit
apprendre à se néantiser, à se moquer de ses origines, à singer l’intégrant
pour être intégré. On entre alors dans les pathologies de la double
personnalité si bien décrites par les livres d’Albert Memmi et de Franz
Fanon.
A un troisième niveau, on coupe l’immigré, sous couvert de
l’intégrer, de la conscience du processus sociopolitique qui a rendu
possible sa condition même de migrant. En l’assimilant, en le mettant en
demeure de ressembler comme sosie à ceux qui l’accueillent, on lui prête
des réflexes de dominant envers ceux du pays d’où il vient. On lui fait
mimer le rapport de forces à l’origine de l’interdépendance inégale et il
devient ainsi un belge comme les autres, c’est-à-dire quelqu’un qui a plus
ou moins conscience du rapport qu’il y a entre la pression migratoire sur
l’Europe et l’injustice de l’ordre économique international dont profite
précisément cette même Europe.
Le tour semble être joué. L’intégré, nous dit-on, est celui qui parle
correctement, se comporte poliment, s’habille comme ses accueillants,
respecte les lois du pays d’accueil, cherche et trouve un travail correct,
réussit à se soigner et se nourrir à ses propres frais, éduque correctement
ses enfants, respecte les droits de sa femme et de sa fille, n’importe pas
ostentatoirement les mœurs de son pays d’origine ici. L’intégré, c’est
supposé être quelqu’un de rangé, qui se tait souvent et qui sait filer droit.
Un homme sans histoires, sans problème et sans prétention. Et si en
plus, il ou elle a épousé une femme ou un homme de souche du pays, il y
a une bonne raison de plus pour lui de se taire. N’est-ce pas une faveur ?Ne doit-il pas à ce pacte les grâces divines de la naturalisation ? Les
grandes douleurs, comme les grandes faveurs, doivent rester muettes.
Voilà ce qu’on exige de notre intégré. Une transparence exemplaire. Il
doit être quelqu’un de bien. Quelqu’un qui sait se fondre dans la belle
masse des gens ordinaires, ratant autant que faire se peu l’occasion de
l’ouvrir sans qu’on le lui ait demandé. Après tout, il a de la chance. Et
quelque soit le boulot de merde qu’on lui refile, quelle que soit
l’orientation à la con qu’on propose à ses gosses, la reconnaissance infinie
envers tout et tous doit être sa marque déposée. L’intégré, souvenez-vous
de la métaphore alimentaire, c’est un vrai bol digérable, tout mou, tout
lisse. Il faut qu’il coule de source, qu’il se glisse imperceptiblement dans
les entrailles, invisible comme les chauves-souris endormies dans une
grotte obscure. Un immigré intégré est en fait un immigré mort,
amnésique, rendu légume par la pression identitaire. Un immigré intégré
est un immigré désintégré.
L’intégration ainsi éclairée est une opération hautement morbide.
Elle invite l’immigré au suicide identitaire, or l’immigration toute entière
est basée sur le désir de bien vivre, de vivre autrement que sur le mode
du survivre, de mieux vivre que jamais, de sauver sa mémoire. Tel est le
choc frontal qui rouvre la plaie de départ, reliant ainsi le problème de
l’intégration à la question de l’immigration. D’une inégalité locale
originelle qui, là-bas, bien souvent dans les profondeurs d’un pays mal
famé du sud de la planète, l’a littéralement délogé et jeté sur les routes de
l’exil, voici notre immigré confronté par le mythe de l’intégration – car
c’est un mythe fort ancien – à une nouvelle inégalité locale, cette fois-ci
téléologique. La cause rejoint la conséquence, l’immigration entraîne
l’intégration et l’intégration ravive la question de l’immigration, en un
parfait cercle vicieux.
Or c’est là que le bât blesse. Parce qu’on lui demande de mourir à
soi, l’immigré en quête d’intégration agonise de ne pas pouvoir
suffisamment cesser d’être lui-même. Il n’en fait jamais assez, il a encore
des progrès à faire. Il fait face au fameux plafond de verre des sociétés
discriminatoires. A côté de l’idéal égalitaire proclamé ex cathedra par les
maîtres du catéchisme républicain et du radotage bien-pensant,
l’immigré jamais assez intégrable, prend conscience qu’il vivra
éternellement dans un monde parallèle à celui des gens bien du pays. Ses
rêves se dépeuplent de tous les espoirs de culminer au faîte de la
reconnaissance dans son pays d’accueil. La discrimination à l’emploi, la
discrimination au logement, la discrimination dans les services publics,
la discrimination dans le droit de la famille, la discrimination sexuelle, la
discrimination de peau, voilà son monde de carcans savammentrafistolés au fil des ans par ceux qui, tout en l’enfermant dans quantité de
ghettos administratifs cyniquement ourdis, lui clament que tout
s’arrangera bien un jour s’il poursuit ses efforts sans faiblir. Pédale,
immigré, pédale, car l’intégration est une route longue en pente raide.
Pédale, sinon, te revoilà au ban de la civilisation, de retour dans la
barbarie où autrefois tu vécus.
Au fond, la question de l’intégration n’est-elle par définition l’un de
ces faux problèmes qui aboutissent toujours à de fausses solutions ?
N’eût-il pas été plus simple pour toutes ces démocraties occidentales
innervées, nous dit-on de l’esprit du christianisme et averties des
impasses de l’hypocrisie administrative, de parler de politiques
nationales d’accueil ou de renouvellement social au lieu d’inventer ce
monstre conceptuel dit de l’intégration ? Ne faudrait-il pas convoquer ici
la belle métaphore africaine qui dit que si vous vous baignez dans une
rivière, ayant laissé vos vêtements sur la berge, ne courez pas tout nu
après le fou qui vous les a volés, sinon vous passerez vous-mêmes pour
un fou ? Le problème de l’intégration ne ressemble-t-il pas à ce doigt qui
pointe la lune tandis que l’imbécile regarde le doigt, comme le dit un
proverbe chinois ? Il nous faut en montrer toute la vacuité en le situant,
dans le cas de la Belgique, dans l’histoire concrète de son rapport à elle-
même et de son rapport à ses étrangers, dans la dialectique de l’identité
et de la différence en Belgique. On comprendra alors la pertinence
conceptuelle des élaborations ci-dessus et par conséquent la nécessité de
concevoir la question étrangère en Belgique sous le prisme strict d’un
Etat de droit égalitaire et résolument armé contre les pratiques
discriminatoires. On parlera alors d’une démocratie multiculturelle pour
comprendre le monde postcolonial qui s’impose sous nos yeux.
III
Histoire et géographie de l’identité et de la
différence anthropologique en Belgique.
Nous entendons par histoire et géographie les repères
spatiotemporels de la construction de l’identité nationale belge dans son
rapport aux non-belges de toutes les origines. Ne nous faut-il pas en
venir aux faits sociaux eux-mêmes, qui sont comme ces choses parlesquelles l’analyse sociale s’ancre dans l’épaisseur de l’évidence
concrète ? On pourrait avec raison essayer de nous objecter que la
critique conceptuelle des concepts d’immigration et d’intégration que
nous opérions dans les deux moments précédents est faite a priori et
qu’elle pourrait à ce titre ne rien avoir de singulier avec l’histoire de la
nation belge. Pour parer cette objection, rien de mieux que de consacrer
le dernier moment de notre conférence aux empirismes historiques
belges, dont nous montrerons qu’ils confirment tout ce que nous avons
établi dans la critique conceptuelle des notions d’immigration et
d’intégration, de telle sorte que l’oreille qui les entend après cette critique
ne peut plus se contenter de leur instrumentalisation politicienne. Pour
présenter les données empiriques de la question de l’immigration et du
problème de l’intégration en Belgique, j’ai consulté des chercheurs et
instituts de recherche scientifique sur la question, avec profit. Les
développements que qui constituent le troisième moment de la présente
conférence s’appuient en particulier sur les travaux de Nathalie Bolland,
mais aussi de Bonaventure Kagné & Martinielli Marco. La première
auteure citée dont l’article intitulé « La situation des Noirs de Belgique au
regard du passé colonial belge » (article du 29 juin 2006,
in www.mrax.be) nous paraît être remarquablement fouillé et
cohérent, nous permettra en particulier d’entrer dans les arcanes du
rapport du belge blanc aux immigrés noirs d’Afrique subsaharienne. Le
couple de chercheur que nous lirons ensuite, a produit des travaux de
référence, notamment des données quantitatives décisives, dans le cadre
du CRISP (Centre de recherches et d’informations sociopolitiques), dont
nous exploitons justement le Courrier Hebdomadaire / 16, n°1721, p.5-
49.
L’article de Nathalie Bolland est structuré autour d’une thèse
essentielle : il est possible, nous dit-elle, d’établir un lien entre Images
stéréotypées du Noir d’hier et Images stigmatisantes, voire racistes qui
accompagnent le processus d’intégration des Noirs d’aujourd’hui en
Belgique. Pour établir cette thèse fondamentale, Nathalie Bolland
procède en trois moments. Dans le premier, elle analyse en ses grandes
lignes les spécificités de la Belgique dans ses rapports avec la spécificité
noire. Dans le deuxième moment de son étude, elle fixe les
représentations émergentes de la propagande coloniale sur les Noirs en
Belgique. Le troisième et dernier moment établit des liens solides entre
les représentations passées et les représentations présentes, en pointant
à travers la mise en évidence de ses paradoxes, les limites intrinsèques du
discours belge sur l’immigration et l’intégration.Nathalie Bolland nous fait observer que ce qui caractérise la relation
originelle belgo-africaine, c’est précisément le fait que les autorités
coloniales belges s’organisèrent dès le départ à éviter des contacts entre
les belges métropolitains et les habitants de leurs colonies. Par la censure
systématique des informations coloniales, par l’empêchement d’une
immigration congolaise vers la Belgique pendant la période coloniale, les
autorités d’alors créèrent entre la Belgique et l’Afrique, le redoutable
écran du préjugé, des images surfaites et des fantasmes en tous genres.
S’appuyant sur les travaux de Pascal Blanchard et Nicolas Bancel
dans Zoos humains. Au temps des exhibitions, Nathalie Bollang exhume
le clivage primitiviste élaboré par cette politique coloniale belge du
19èm e siècle qui réduit les Noirs au statut d’objets exotiques, afin d’asseoir
le mythe de la supériorité raciale blanche dans l’imaginaire populaire
métropolitain. L’exhibition des nègres, unique mode de contact avec eux,
cultive ainsi une indifférence matricielle dans l’interaction belgo-
africaine, de telle façon que le belge soit le sujet et le noir l’objet, ou
plutôt, dans le meilleur des cas, un sujet/objet, une quasi-personne, une
demi-chose. Les images, les films, les affiches de l’ère des exhibitions
vont survivre à ces dernières et prolonger leur travail de sape de
l’imaginaire, après la 3ème exhibition fatale de nègres en 1897 en Belgique.
Deuxième remarque essentielle. L’absence de soldats africains sur le
sol belge durant les deux guerres mondiales va accentuer l’indifférence
entre la communauté métropolitaine coloniale et la communauté
africaine colonisée. Les troupes coloniales belges n’ayant combattu qu’en
Afrique, le peuple belge est l’un des rares peuples occidentaux à n’avoir
pas vu l’héroïsme des africains au cœur de l’Europe, pour l’Europe et
pour toute l’humanité révoltée contre le nazisme. Cette absence de
communauté de souffrance explique le vide de sympathie, la froide
indifférence qui préside au développement séparé des peuples belge et
africain depuis l’ère coloniale, y compris dans la distribution
géographique urbaine des populations d’origine africaine dans la cité
belge elle-même. L’histoire accouche ici d’une géographie de la Ville
Cruelle, pour emprunter la métaphore du grand écrivain camerounais
Mongo Beti dans son roman célèbre de 1954. La ville cruelle belge, c’est
la ville divisée, la ville où les africains vivent en à la fois hors d’Afrique
car logés dans des conditions qui dérégulent leurs traditions
communautaires et les déracinent, mais aussi hors de Belgique car le
parcage des immigrés subsahariens dans les logements sociaux exprime
précisément une topologie du rejet et du déchet. Une déjection de l’Autre
par son éviction des lieux prisés de la ville. La dialectique centre-
périphérie qui préside à l’échange inégal que Samir Amin étudia à
l’échelle planétaire se matérialise dans l’urbanité des villes occidentalespar la dialectique des centres-villes et des banlieues, des quartiers chics
et des quartiers chocs, des quartiers hypersécurisés et des quartiers à
hauts risques. « Tanga Nord, Tanga Sud, deux villes, deux destins » disait
Mongo Beti de la Ville Cruelle.
Troisième remarque essentielle de Nathalie Bolland : la politique
coloniale belge de l’éducation opéra dans les jusque dans les âmes le
schisme social matérialisé dans la géographie urbaine que nous venons
de décrire sommairement. Eduquer en colonie, c’était reproduire la
subalternité par une instrumentalisation de l’orientation des formations
intellectuelles. La Belgique préféra former des prêtres, des ouvriers, des
commis congolais, burundais ou rwandais, mais se méfia pendant
longtemps de former des intellectuels. Dans les universités belges des
19èm e et première moitié du 20 ème siècles, les étudiants africains furent
longtemps rarissimes. En confisquant la production du savoir, le pouvoir
colonial voulait maintenir sous sa férule le pouvoir d’action, voire de
nuisance que l’acquisition des sciences et des techniques induit dans tous
les peuples et tous les individus à travers l’histoire. On ne s’étonnera pas
non plus que des sous-citoyens ainsi sous-formés aient été ténus
longtemps à l’écart de la satisfaction des besoins belges d’une
immigration de travail. A l’immigration de travail africaine
subsaharienne, la Belgique préférera l’immigration blanche européenne
et l’immigration métisse des pays du Maghreb, notamment du Maroc. La
chose était, on ne peut avoir manqué de le voir, marquée au coin de
l’inconscient du mépris racial instillé par l’esclavage des noirs et par la
colonisation brutale de l’Afrique subsaharienne.
On peut donc, sans risque de se tromper, conclure avec
l’auteure que la politique de ségrégation continentale pratiquée par les
colonisateurs belges est l’arrière-fond souvent impensé et non-dit des
politiques d’immigration et d’intégration qui concerneront plus tard les
africains en Belgique. Faut-il rappeler que la colonisation fut de fond en
comble un projet d’hégémonie politique pour des intérêts économiques ?
Nathalie Bolland insiste de façon intéressante sur l’épitaphe du
monument du Spetz, à Arlon, ou sous un Léopold II imposant, il est
écrit : « J’ai entrepris l’œuvre du Congo dans l’intérêt de la Civilisation et
pour le bien de la Belgique ». Le bien ou les biens, ne peut-on s’empêcher
de s’interroger, quand on observe avec quelle singulière voracité les
multinationales belges dépècent le Congo[2] depuis le 19èm e siècle. Pire
encore, le discours de l’immigration et de l’intégration est hanté en
Belgique par le recours étatique récurrent par le passé et rémanent entre
les lignes, aux théories raciales d’allure objective qui proliférèrent avec la
soi-disant anthropologie physique et avec le positivisme du 19 ème siècle.Fixés sur de nombreux supports : photos de presse, gravures, BD,
affiches publicitaires, emballages commerciaux, manuels scolaires,
roman exotique ou colonial, revues missionnaires ou scientifiques, presse
écrite ou cinéma, etc. Ces alluvions du mépris racial traînent des clichés
hygiéniques, psychologiques, économiques, sexuels, qui sédimentent les
comportements quotidiens jusqu’à ce jour.
L’auteure peut alors conclure sur le lien paradoxal entre le passé
colonial et le présent du discours de l’immigration et de l’intégration.
S’appuyant sur les travaux de Luk Vandenhoek[3], elle pointe trois
contradictions étonnantes dans le discours quotidien en Belgique. On
accuse d’une part les étrangers de ne pas vouloir travailler et de vouloir
systématiquement parasiter la société en profitant des avantages du
chômage et de la sécurité sociale. Mais par ailleurs, on accuse ces mêmes
étrangers de vouloir voler ou de voler le travail des belges de souche.
Autre contradiction : on attribue aux noirs la consanguinité de la
musique et des sports, mais en même temps on trouve qu’ils en jouissent
trop quand des stars noires en tirent un fric fou. Ultime exemple, on
estime que les noirs sont misérables et qu’il faut les aider, mais on fait
mine d’oublier que c’est l’alliance des multinationales occidentales avec
les régimes de dictateurs africains qui spolie gravement les peuples noirs.
La situation contemporaine des africains subsahariens en Belgique est
donc marquée par toutes ces pesanteurs et ces ambiguïtés qui se
traduisent en traumatismes désormais mesurables.
Non seulement il apparaît de toutes les études que la population
subsaharienne en Belgique a un niveau de scolarisation
exceptionnellement élevé, on entend moult discours officiels suggérer
que les politiques de sensibilisation et d’intégration devraient élever le
niveau de formation des immigrés pour les rendre employables. Or de
fait, beaucoup d’immigrés africains hautement qualifiés acceptent des
emplois sous-qualifiés pour survivre en attendant des lendemains
meilleurs qui ne se pressent pourtant pas. Discriminations à l’emploi,
discriminations au logement (une étude du MRAX a établi que 66% des
africains subsahariens en Belgique disent avoir été souvent discriminés),
discriminations sémantiques sous le concept de non-intégration comme
mécanisme d’exclusion en cercle vicieux, voilà le lot quotidien de
l’interaction belgo-africaine contemporaine, à quelques exceptions
toujours près, bien sûr. Mais l’exception, ici, ne fait pas la règle. On l’a
deviné.
Venons-en, pour conclure cette troisième partie de notre étude, à
des empirismes encore plus récents et quantifiables, ceux que nousexpose l’étude très fouillée de Bonaventure Kagne et de Martinielli
Marco. Leur étude propose une introduction à la présence africaine en
Belgique, une analyse sociodémographique de cette présence, une mise
en perspective de la dynamique associative des africains en Belgique, à la
fois du point de vue fonctionnel et organisationnel. On y apprend
précisément que l’immigration africaine en Belgique est fort récente,
datant principalement des années 60, avec une forte exclusivité
d’immigrants étudiants congolais au départ, puis une diversification
subsaharienne progressive. Ce premier indice montre que la Belgique a
souvent choisi d’accueillir sur son sol les africains les mieux formés, et
donc qu’elle organise volontiers ou inconsciemment une fuite des
matières grises qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la fuite des
matières premières. Et tant qu’on sépare l’une de l’autre, on rate et la
question de l’immigration, et le problème de l’intégration. Comment
mettre fin à la montée en puissance de la première si la Belgique ne
soutient pas vigoureusement les sociétés civiles en lutte contre les
régimes despotiques en Afrique, au nom précisément d’un nouvel ordre
international ? Comment résoudre le problème de l’intégration si la
Belgique nie dès leur arrivée sur son sol que les migrants auxquels elle a
affaire sont dans leur écrasante majorité des sujets entièrement au fait
des normes de la modernité civilisationnelle internationale ?
Le chapitre 2 de l’analyse de Kagne et Marco comporte des pépites
d’illustrations pour notre propos, en toutes ses articulations
précédentes. Les auteurs nous livrent, en guise d’analyse
sociodémographique, les données générales en rapport avec la
population belge, la répartition spatiale de la population africaine en
Belgique, la répartition par régions, par provinces, par âge, sexe, la
multiplicité des statuts sociaux. On apprend par exemple que sur 367619
étrangers en 1945, la Belgique ne comptait que 1838 africains parmi
lesquels 10 congolais. La race des belgicains est donc fort récente. On
apprend aussi, sur la base d’une auscultation des données de la période
1970-2000, que l’immigration africaine demeure largement inférieure à
l’immigration non-africaine en Belgique. En 2000, 63% des étrangers de
Belgique étaient européens, 37% extra-européens. Alors que 58% des
belges sont en région flamande, 32, 6 % en région wallonne et 9,4% en
région Bruxelles-Capitale, on apprend qu’en 2000, 36,8% des 897.110
étrangers de Belgique vivaient en Wallonie, 32% en Flandres et 30% en
région Bruxelles-Capitale. Marocains et turcs sont les plus grosses
communautés non-européennes de Belgique, les africains subsahariens
ne venant qu’en 4èm e place, après les asiatiques. Les chiffres prouvent
ainsi que la majorité des étrangers présents en Belgique provient de pays
membres de l’Union Européenne. La proportion des ressortissantsd’Afrique subsaharienne est minime, quelle que soit la province prise en
compte.
IV
Conclusion
Osons conclure cette étude. La question de l’immigration n’est pas
encore bien posée par les politiques, elle nous pendra donc longtemps
encore au nez. Tant que la politique étrangère de l’Europe privilégiera la
quasi-gratuité des matières premières africaines via les dictatures au
soutien des sociétés civiles africaines en lutte pour la démocratie,
l’égalité, la transparence et le bien-être, la pression migratoire se
poursuivra, tel un effet de dominos. Le problème de l’intégration est
quant à lui une véritable farce identitaire, car il cache l’antique rejet et
mépris colonial de l’Autre, et notamment les rémanences de l’impensé de
la supériorité raciale blanche sur les autres peuples de la terre.
Tant qu’une lutte républicaine acharnée contre les discriminations à
l’emploi, au logement, à la représentation politique, à l’éducation, à la
santé, à la dignité, ne sera pas âprement menée par des autorités
étatiques débarrassées des stigmates du primitivisme d’Etat belge, on
continuera de gloser à perte de vue sur les nombreux plafonds de verres
que le discours moralisateur et bien-pensant de l’intégration rend
invisibles. La question et le problème de la Belgique relèvent du domaine
de la révolution citoyenne et républicaine planétaire, et sans l’unification
de son regard sur elle-même par le dépassement des incohérences de
l’universalisme démocratique démenti au quotidien par le particularisme
chauviniste, la Belgique, malade d’elle-même, ne pourra pas accomplir le
sursaut par lequel les politiques d’immigration et d’intégration d’antan se
mueront en politiques de solidarité démocratique internationale, en
politiques nationales d’accueil et de renouvellement. Je vous rappelle
qu’en sa racine latine, le verbe intégrer vient d’integrere, qui signifie
renouveler. Il s’agit bel et bien, ici et ailleurs, de renouveler la politique
au feu spirituel du souci bienveillant de l’altérité. Une éthique de la
reconnaissance mutuelle s’impose aujourd’hui, pour déraciner les
tentacules de la bouc-émissarisation et les risques de voir de nouveau
prospérer les affres de l’esprit de vengeance, entre le Nord et le Sud, dans
le Nord et dans le Sud.[1] Catherine Withol de Wenden, article « Immigrés » in Enclyclopedia Universalis, Paris, 1996, Vol. 11, pp.954- 957. [2] DE MOOR, Françoise, JACQUEMIN, Jean-Pierre, Notre Congo/Onze Kongo, La propagande coloniale belge :fragments d’une étude critique, Bruxelles, CEC, 2000, p.6. [3] VANDENHOEK, Luc, « De l’indigène à l’immigré », in Racisme Ob scur. Clichés, stéréotypes, phantasmes à propos des Noirs dans le Royaume de Belgique, Bruxelles, CEC, 1991, p.113-131.
Vous pouvez aussi lire