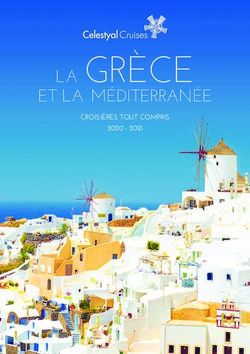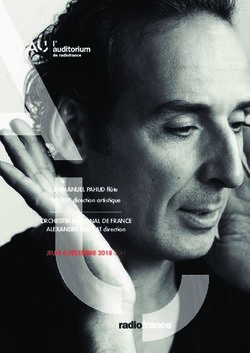REVUE DE PRESSE ET DES RESEAUX SOCIAUX - Mercredi 20 juin 2018 Outre-mer - mayotte.pref.gouv.fr
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
A LA UNE
ASSISES DES OUTRE-MER;
Pages, 61 à 64.
La Réunion, la Région s’allie à l’ensemble des acteurs
économiques. Région et patrons parlent d’une même voix.
SOCIETE HOMOSEXUALITE;
Pages, 8 à 12, 65.
Outre-mer, la haine anti-LGBT, plus virulente que dans
l'Hexagone, selon un rapport.
REFERENDUM;
Pages, 14, 46 à 48.
Nouvelle-Calédonie, 5 partis politiques habilités à faire
campagne pour le référendum de novembre. La précampagne
du référendum sur les rails.
AGRICULTURE;
Pages, 68 à 70.
La Réunion, non à la baisse des aides européennes. Les
agriculteurs de l’UPNA se sont mobilisés.
2En Outre-mer, la haine anti-LGBT plus virulente que dans l'Hexagone
Paris, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 14:21 UTC+3 | 385 mots
La haine anti-LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) est "plus virulente" dans les Outre-mer que dans l'Hexagone,
et aggravée par le poids de la famille, de la religion, des préjugés sexistes et de l'insularité, révèle mardi un
rapport de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée.
Les auteurs, les députés Laurence Vanceneubrock-Mialon (Allier), Raphaël Gérard (Charente-Maritime) et
Gabriel Serville (Guyane), font le constat dans les Outre-mer "d'une haine anti-LGBT et d’un rejet latent", "plus
marquée en Outre-mer que dans le territoire national", a expliqué Raphaël Gérard devant la délégation.
Un "constat cruel", sur un sujet qui manque de données statistiques, que ce soit en matière de plaintes,
d'agressions recensées, de témoignages de discriminations ou de nombre d’unions de même sexe, a-t-il dit.
Il fait état de "multiples actes de violence en direction des personnes homosexuelles", verbales, psychologiques
et physiques, comme l'agression d’un jeune Guadeloupéen séquestré puis torturé en janvier 2016 par un groupe
de jeunes à l’aide d’un fer à repasser.
Le rapport note aussi "des violences homophobes intrafamiliales répandues" et "culturellement admises", et
"une tolérance vis-à-vis de l’homosexualité toujours conditionnée à son invisibilité".
Pour Laurence Vanceneubrock-Mialon, "le poids de la colonisation" peut expliquer cette haine. "Les sociétés
pré-coloniales était plus ouvertes", mais "le processus de colonisation" et "un mouvement d'évangélisation
a systématisé l'homophobie dans les sociétés ultramarines".
Paradoxalement, dans ces territoires, l’homosexualité est aujourd'hui souvent "perçue comme une donnée
culturelle exogène", les populations caribéennes ou afro-descendantes l’imputant à "quelque chose qui
appartiendrait à la +civilisation blanche+", notent les rapporteurs.
Les auteurs mettent en avant le "poids de l’insularité, de l'interconnaissance et de la rumeur", dans des
territoires exigus "où "l'anonymat n'existe pas", mais aussi "le poids des traditions religieuses" et "des
stéréotypes de genre", comme la "valorisation d'une forme de virilité sexuelle" dans les populations antillaises.
Ils constatent également "la faiblesse des associations", souvent peu visibles voire inexistantes, et un "manque
de soutien de la part des élus et des collectivités locales". "La teneur des discours de certains élus ou
personnalités publiques en Outre-mer participe parfois à la légitimation de violences homophobes", notent-ils.
En début de séance, le président de la délégation Olivier Serva, député LREM de Guadeloupe, qui lors de la
campagne des législatives de 2012 avait eu des propos homophobes, a réitéré ses excuses, disant regretter "le
mal que ses propos ont pu causer".
caz/ggy/phc
Les Echos
8La haine anti-LGBT, plus virulente en Outre-mer que dans l'Hexagone, selon un rapport
Papier d'angle Paris, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 16:03 UTC+3 | par Cécile AZZARO
Un jeune homosexuel torturé en Guadeloupe, un autre jeune rejeté par sa famille à Mayotte, une femme
licenciée pour avoir été vue embrassant sa compagne à La Réunion: dans les Outre-mer, la haine anti LGBT
(lesbiennes, gays, bi et trans) est "plus virulente" que dans l'Hexagone. Un rapport des députés Laurence
Vanceneubrock-Mialon (Allier), Raphaël Gérard (Charente-maritime) et Gabriel Serville (Guyane), fait le
constat dans les Outre-mer "d'une haine anti-LGBT plus marquée" et "d'un rejet latent", renforcés par "le poids
de la famille, de la religion, des préjugées sexistes et de l'insularité", dans des territoires où "l'anonymat n'existe
pas" et où "la loi du silence domine".
Un "constat cruel", sur un sujet qui manque de données, que ce soit en matière de plaintes, d'agressions
recensées, de témoignages de discriminations ou de chiffres sur les unions de même sexe, a expliqué Raphaël
Gérard. Il fait état de "multiples actes de violence en direction des personnes homosexuelles", comme
l'agression d’un jeune Guadeloupéen séquestré puis torturé pendant plusieurs jours en janvier 2016 par un
groupe de jeunes à l’aide d’un fer à repasser.
Une violence aussi verbale et psychologique: le rapport raconte les insultes et humiliations vécues par les
personnes qui affichent leur homosexualité, comme Julia, Réunionnaise licenciée pour avoir embrassé sa
compagne sur le parking de son entreprise, ou ces hommes insultés sur internet en Guyane après que leur
homosexualité a été révélée. Les rapporteurs notent aussi "des violences intrafamiliales répandues" (rupture des
liens de filiation, interdits d'exprimer son homosexualité, menaces de mort), avec une violence homophobe
"culturellement admise" liée au poids de l'honneur, et "de fréquentes expulsions du domicile familial", comme
pour ce jeune Antillais, "expulsé par son père sous la menace d'un coutelas", ou ce Mahorais rejeté par les siens
pour avoir embrassé son petit ami.
- Exode vers l'Hexagone -
La tolérance vis-à-vis de l’homosexualité est toujours conditionnée à son "invisibilité au sein des sociétés
ultramarines", constate le rapport, ce qui pousse les personnes LGBT à la clandestinité, et à un "exode vers
l’Hexagone pour pouvoir vivre librement leur identité sexuelle ou de genre". Pour Laurence Vanceneubrock-
Mialon, "le poids de la colonisation" peut expliquer cette haine. "Les sociétés pré-coloniales était plus
ouvertes", mais la colonisation et l'évangélisation ont "systématisé l'homophobie dans les sociétés
ultramarines". Paradoxalement, dans ces territoires, l’homosexualité est aujourd'hui souvent "perçue comme
une donnée culturelle exogène", les populations caribéennes ou afro-descendantes l’imputant à "quelque chose
qui appartiendrait à la +civilisation blanche+", notent les auteurs.
Ils mettent aussi en avant le poids de "l’insularité, de l'interconnaissance et de la rumeur", et "la honte du regard
des autres". "Quand ils ont appris que j'étais homosexuel, j'étais quelqu'un de rejeté (...)", témoigne dans le
rapport Julien, 42 ans. Ses parents ont aussi souffert: "ils ont eu beaucoup de :+ton enfant n'est pas normal (...),
tu n'es pas capable d'élever tes enfants+". Les auteurs évoquent "de graves atteintes aux droits", notamment sur
le plan de la justice - difficulté à porter plainte-, de la santé ou du droit d’asile-, et des "formes insidieuses de
discriminations" (harcèlement à l'école, marginalisation, etc.).
Ils constatent également "la faiblesse des associations", souvent peu visibles voire inexistantes, et un "manque
de soutien des élus et des collectivités locales". "La teneur des discours de certains élus ou personnalités
publiques en Outre-mer participe parfois à la légitimation de violences homophobes", notent-ils. En début de
séance, le président de la délégation Olivier Serva, député LREM de Guadeloupe, qui lors de la campagne des
législatives de 2012 avait eu des propos homophobes, a réitéré ses excuses, disant regretter "le mal que ses
propos ont pu causer". Le rapport préconise notamment de "mieux documenter les LGBT phobies en Outre-
mer", "renforcer la prévention en milieu scolaire", renforcer le tissu associatif local, sensibiliser le grand public
et libérer la parole, via par exemple des lignes d'écoute locales.
"Mais le chemin qui reste à faire est difficile tant les préjugés sont prégnants", a reconnu Gabriel Serville.
caz/chr/sd
919/06/2018
En Outre-mer, la haine anti-LGBT plus virulente que dans l'Hexagone
Trois députés, dont Gabriel Serville, député de Guyane, ont remis mardi un rapport sur l'homophobie dans les
Outre-mer. La haine anti-LGBT y est, selon eux, "plus virulente" que dans l'Hexagone.
© D.R. Le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté gay.
La haine anti-LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) est "plus virulente"
dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, et aggravée par le poids de
la famille, de la religion, des préjugés sexistes et de l'insularité,
révèle mardi un rapport de la délégation aux Outre-mer de
l'Assemblée.
Violences et rejet
Les auteurs, les députés Laurence Vanceneubrock-Mialon (Allier), Raphaël Gérard (Charente-Maritime) et Gabriel
Serville (Guyane), font le constat dans les Outre-mer "d'une haine anti-LGBT et d'un rejet latent", "plus marquée en
Outre-mer que dans le territoire national", a expliqué Raphaël Gérard devant la délégation.
Un "constat cruel", sur un sujet qui manque de données statistiques, que ce soit en matière de plaintes, d'agressions
recensées, de témoignages de discriminations ou de nombre d'unions de même sexe, a-t-il dit.
Il fait état de "multiples actes de violence en direction des personnes homosexuelles", verbales, psychologiques et
physiques, comme l'agression d'un jeune Guadeloupéen séquestré puis torturé en janvier 2016 par un groupe de jeunes
à l'aide d'un fer à repasser.
Le rapport note aussi "des violences homophobes intrafamiliales répandues" et "culturellement admises", et "une
tolérance vis-à-vis de l'homosexualité toujours conditionnée à son invisibilité".
Poids de la colonisation
Pour Laurence Vanceneubrock-Mialon, "le poids de la colonisation" peut expliquer cette haine. "Les sociétés pré-
coloniales était plus ouvertes", mais "le processus de colonisation" et "un mouvement d'évangélisation a systématisé
l'homophobie dans les sociétés ultramarines". Paradoxalement, dans ces territoires, l'homosexualité est aujourd'hui
souvent "perçue comme une donnée culturelle exogène", les populations caribéennes ou afro-descendantes l'imputant à
"quelque chose qui appartiendrait à la civilisation blanche", notent les rapporteurs.
Stéréotypes de genre
Les auteurs mettent en avant le "poids de l'insularité, de l'interconnaissance et de la rumeur", dans des territoires exigus
où "l'anonymat n'existe pas", mais aussi "le poids des traditions religieuses" et "des stéréotypes de genre", comme la
"valorisation d'une forme de virilité sexuelle" dans les populations antillaises.
Ils constatent également "la faiblesse des associations", souvent peu visibles voire inexistantes, et un "manque de
soutien de la part des élus et des collectivités locales". "La teneur des discours de certains élus ou personnalités publiques
en Outre-mer participe parfois à la légitimation de violences homophobes", notent-ils.
En début de séance, le président de la délégation Olivier Serva, député LREM de Guadeloupe, qui lors de la campagne
des législatives de 2012 avait eu des propos homophobes, a réitéré ses excuses, disant regretter "le mal que ses propos
ont pu causer".
1119/06/2018
Lutte contre les discriminations anti-LGBT Outre-mer:
Un rapport « pionnier » à « portée historique »
Ce mardi matin à l’Assemblée nationale, la Délégation aux Outre-
mer a procédé à l’examen du rapport sur la lutte contre les
discriminations anti-LGBT en Outre-mer, mené par les députés
Raphael Gérard (Charente-Maritime, LREM), Laurence
Vanceunebrock-Mialon (Allier, LREM) et Gabriel Serville (GDR,
Guyane). Qualifié de « pionnier en la matière » et de « portée
historique », ce rapport sera la « première partie d’un grand livre sur
les discriminations » en Outre-mer.
La discrimination anti-LGBT en Outre-mer est « plus marquée que dans le reste du territoire national », a
constaté Raphael Gérard, lors de cet examen par la Délégation aux Outre-mer. Après avoir mené une enquête
sur le terrain, en Guadeloupe notamment, le député de Charente-Maritime note une « loi du silence » à
« briser », et un « manque d’ambition de la part de l’Etat dans le domaine ». En raison des « spécificités
culturelles », Raphael Gérard regrette « un état des lieux difficile » malgré des sources associatives,
institutionnelles et officielles importantes, qui ont pu aider à la rédaction de ce rapport de près de 80 pages.
Laurence Vanceunebrock-Mialon dresse le même constat. Il est « plus difficile de vivre son homosexualité ou
sa transexualité en Outre-mer, en raison des spécificités culturelles » : la colonisation, l’évangélisation ou
encore, le « poids de l’inter-connaissance, de l’insularité et de la rumeur ». « Tout le monde se connait » dit-
elle, et la « honte du regard des gens » joue en faveur de la fameuse « loi du silence ». Comme un effet inverse,
les décolonisations ont eu pour issue un rejet d’une pratique qui serait venue des anciens colonisateurs, alors
même que dans certains Outre-mer comme la Polynésie, les transexualités font aussi partie de l’identité
culturelle (« raerae », « mahu »). Les rapporteurs ont également constaté des disparités selon les Outre-mer: à
La Réunion, les luttes LGBT sont plus avancées au contraire de Wallis et Futuna, par exemple, où « l’insularité
dans l’insularité » renforce un combat à la peine.
« Quelle suite donner à ce rapport ? » s’est interrogé Gabriel Serville. « Comment faire pour que les
préconisations et recommandations soient prises en considération ? (…) Comment faire pour éviter de
stigmatiser davantage ? » et surtout, « comment la représentation nationale pourrait s’emparer de la suite du
rapport ? ». Outre un « constat cruel », ce rapport dresse des recommandations: 29 plus précisément, réparties
sur plusieurs thématiques. Parmi elles: mieux documenter les LGBT phobies en Outre-mer et renforcer les
actions de sensibilisation contre celles-ci, renforcer la prévention en milieu scolaire, mieux former les agents et
fonctionnaires ultramarins, sensibiliser le grand public, renforcer le tissu associatif local ou encore, libérer la
parole.
Gabriel Serville a également préconisé la « possibilité de faire intervenir des artistes » alors que Maud Petit
(LREM, Val-de-Marne) plaide pour « une médiation non-violente en milieu scolaire ». Il faut « redonner son
rôle à l’éducation nationale » et « s’attacher à éduquer la génération qui est en train de grandir », ajoute
Laurence Vanceunebrock-Mialon. En conclusion, le rapport a été adopté « à l’unanimité » par les quelques
députés présents: Olivier Serva, les trois rapporteurs, Maud Petit et Josette Manin. « Un problème de
calendrier » reconnait Raphael Gérard qui assure: « certains de nos collègues ont déjà pris position dans une
tribune publiée récemment ». Revenant sur ses propos des Législatives de 2012, qui avaient fait polémique aux
Législatives de 2017, Olivier Serva, Président de la délégation aux Outre-mer, a quant à lui dit son intention
« d’agir en donnant du sens à mon action politique ». Réitérant ses regrets, il a rappelé ces nombreux entretiens
avec la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les haines anti-LGBT, et
souhaite faire de ce rapport un « acte essentiel, certainement le premier dans le cadre réglementaire ».
1213
N-Calédonie: 5 partis politiques habilités à faire campagne pour le référendum de novembre
Paris, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 21:03 UTC+3 | 156 mots
Cinq partis politiques calédoniens ont été habilités à participer à la campagne officielle pour le référendum sur
l'indépendance du 4 novembre prochain, a annoncé mardi le Haut-commissariat dans un communiqué. La
commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation s'est réunie mardi "afin de
statuer sur les demandes des partis et groupements politiques souhaitant participer à la campagne officielle" du
référendum.
Cinq partis ou groupements "sont habilités à participer à la campagne officielle": trois groupements loyalistes,
le parti et groupement "Républicains calédoniens", le groupement "Les Républicains - Rassemblement -
Mouvement Populaire Calédonien" et le parti "Calédonie ensemble", et deux groupements indépendantistes, le
groupement "Union Nationale pour l'Indépendance" et le groupement "UC-FNLKS et Nationalistes".
Depuis 20 ans, un processus de décolonisation par étapes est en place en Nouvelle-Calédonie et doit déboucher
sur un référendum lors duquel les électeurs devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la
pleine souveraineté et devienne indépendante".
caz/chr/jcc
Rodolphe Alexandre demande le transfert de l'école de santé des armées en Guyane
Paris, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 18:41 UTC+3 | 349 mots
Le président de la collectivité territoriale de Guyane Rodolphe Alexandre a demandé, dans une lettre au
président de la République dont l'AFP a eu copie, le transfert de l'Ecole du service de santé des armées en
Guyane.
"Je souhaitais vous proposer de bien vouloir réfléchir à une opportunité qui, je le crois, permettrait certainement
de contribuer à un regain d'attractivité de la Guyane vis-à-vis des professionnels de santé: il s'agit du transfert à
Cayenne de l'Ecole du service de santé des armées, actuellement installée à Lyon et pour partie à Bordeaux",
écrit Rodolphe Alexandre. Ce transfert "aurait l'avantage de garantir la présence d'un corps enseignant médical
affecté aussi bien à des tâches pédagogiques qu'hospitalières" au Centre hospitalier de Cayenne, "mais aussi un
nombre important d'étudiants en médecine et d'internes susceptibles de répondre au besoin des hôpitaux et des
dispensaires en sites isolées", souligne-t-il.
"Le problème de sous-effectif chronique de médecins s'en trouverait, de fait, réglé", insiste-t-il.
Selon lui, le préjudice pour la métropole lyonnaise serait "moindre", car elle abrite "déjà des universités
médicales de qualité". Pour la Guyane, cela constituerait "un excellent signal envoyé tant à une population qu'à
une communauté médicale qui en ont extrêmement besoin". Elle apporterait en outre "une réponse de proximité
aux besoins des deux régiments d'infanterie, de la base aérienne et de la base navale présents sur le territoire
ainsi qu'aux escadrons de gendarmerie régulièrement déployés notamment dans le cadre de la lutte contre
l'orpaillage clandestin".
Enfin, un tel transfert aurait "pour avantage de doper considérablement la recherche universitaire guyanaise",
souligne M. Alexandre, qui rappelle "la grave crise sanitaire qui secoue la Guyane et plus particulièrement son
principal hôpital, le Centre Hospitalier Andrée-Rosemon (CHAR)" à Cayenne, en "situation d'extrême urgence"
depuis la démission collective début mai de 17 médecins du service des urgences. Dix-sept médecins
urgentistes ont déposé depuis le 3 mai leurs lettres de démission ou demandé leur mise en disponibilité à la
direction du CHAR pour dénoncer leurs conditions de travail dégradées par le manque de moyens humains et
l'inaction de leurs responsables hiérarchiques. Leur démission sera effective début juillet.
caz/are/phc
14Cayenne : le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre un policier de
Cayenne soupçonné d'avoir fui au Brésil
Cayenne, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 23:45 UTC+3 | 308 mots
Le procureur de la République de Cayenne Eric Vaillant a requis lundi l’ouverture d’une information judiciaire
à l’encontre d'un policier du commissariat de la ville, Marcelo Louveau de La Guigneraye.
Le policier est accusé de "travail dissimulé par dissimulation d’activité, recel d’abus de biens sociaux,
blanchiment de fraude fiscale aggravée, abus de confiance, falsification de chèque et usage", a-t-on appris
mardi de source judiciaire. "Marcelo Louveau de la Guigneraye est soupçonné, notamment, d’exercer des
activités de comptabilité auprès de plusieurs personnes, établissements et sociétés sans procéder aux
déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux." a indiqué le procureur
Le policier affecté à la brigade de nuit est suspecté de liens avec des bars de la Crique, un quartier réputé mal
famé de Cayenne auquel Emmanuel Macron avait rendu une visite impromptue fin 2017 à la place d'un rendez-
vous programmé au commissariat devant lequel l'attendait un cortège de manifestants. Dans cette affaire
"l’IGPN a été saisie le 30 janvier 2016 au cours de l’enquête préliminaire initiée par le commissariat de police
de Cayenne à la suite de contrôles de débits de boissons de la Crique en 2015." note encore le procureur.
Fin mai dernier, alors que l'IGPN était en Guyane et s'intéressait aux contacts du policier, celui-ci est soupçonné
d'avoir fui au Brésil. Les autorités brésiliennes ont confirmé aux autorités françaises que le passeport de
l'intéressé "a été tamponné le mardi 29 mai à Oiapoque (ville brésilienne à la frontière de la Guyane)", avait
confirmé ces dernières semaines le procureur à la presse locale alors qu'une de ses proches avait porté plainte
pour "disparition inquiétante".
"Le parquet a requis la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Marcelo Louveau de la Guigneraye en
vue d’une diffusion au niveau international via le canal Interpol." a encore indiqué le procureur. L'enquête va
désormais passer entre les mains d'un juge d'instruction.
ff/jcc
Martinique : plainte pour détournement de fonds publics contre la SME
Fort-de-France, France | AFP | mardi 19/06/2018 - 23:54 UTC+3 | 225 mots
Une plainte pénale pour détournement de fonds publics à l’encontre de la Société Martiniquaises des Eaux
(SME) a été déposée lundi, devant le procureur de la République au TGI de Fort-de-France, apprend-on mardi
auprès des plaignants. Elle émane du front républicain d’intervention contre la corruption (FRICC) et de
l’association française pour le contrat mondial de l’eau (ACME).
Les deux associations se fondent sur un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) Antilles-Guyane
du 20 octobre 2016 sur la "gestion de la délégation de service public de l'eau et de l’assainissement avec la
SME", filiale du groupe Suez Environnement. Elles estiment qu’un "certain nombre d’éléments" contenus dans
ce rapport "sur les années 2009 et suivantes" peuvent "répondre à la qualification de détournement de fonds
publics tel que prévu à l’article 431-15 du code pénal".
Les auteurs de la plainte relèvent entre autres "une augmentation constante et injustifiée du prix de l’eau", "une
augmentation opaque des charges" et "des méthodes comptables" douteuses mises en lumière par la CRC. Sur
ce dernier point, ils soulignent que la chambre régionale des comptes "fait ressortir qu’avec des méthodes
normales, le résultat de la délégation sur les années 2009-2014 ne serait pas déficitaire de 400.000 euros mais
bénéficiaire de 4,2 millions d’euros".
Selon le FRICC et l'ACME, ces "anomalies sont trop nombreuses pour n'y voir qu'une simple erreur ou
négligence".
jpl/jcc
1516
17
L’OUTRE-MER
DANS LA PRESSE
LOCALE
18LES UNES DE LA PRESSE LOCALE
19LES UNES DE LA PRESSE LOCALE
20GUADELOUPE
2122
GUYANE 23
24
18/06/2018
En Guyane, les Amérindiens disent non à la mine de la Montagne d'or
Le débat sur la mine de la Montagne d’or en Guyane touche à sa fin avec une dernière réunion publique, ce
lundi, à Saint-Laurent-du-Maroni. Début avril, un premier débat public a été très virulent. Les Amérindiens se
mobilisent. Reportage d'Anne-Laure Barral.
Sur la piste de la montagne d’or en Guyane © Radio
France / Anne-Laure Barral
Ce projet de méga-mine, avec une fosse grande
comme 32 stades de France en pleine forêt
amazonienne, devrait ouvrir en 2022 pour extraire 85
tonnes d’or au moins pendant douze ans. Reste à
obtenir l'autorisation pour ce projet qui divise la
Guyane mais aussi l’exécutif. Emmanuel Macron y
est plutôt favorable, alors que le ministre de la
Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, non
!
L'entreprise aux capitaux russes et canadiens promet 750 emplois.
Parmi les opposants, la communauté amérindienne s’est mobilisée, en particulier les jeunes, qui y voient plus
qu’un combat environnemental : un combat culturel.
Le chef coutumier et Bernard, un habitant du
village Pierre © Radio France / Laurent Macchietti
Au bord du fleuve Maroni, le village
amérindien Village Pierre, quelques maisons
en bois sur pilotis, une école en préfabriqué,
une salle commune. Bernard vit ici avec sa
femme et ses deux enfants. Il ne veut pas du
projet de la Montagne d’or, situé pourtant à
100 kilomètres.
A 31 ans, Bernard parle comme s’il avait 500
ans de comptes à régler avec l’Histoire. Car ce
projet ravive les tensions d’une communauté qui se sent déconsidérée, à l'image de Tony, chef coutumier du
village de Prospérité.
Les enfants du Village Pierre © Radio France / Laurent Macchietti
Il ne faut pas imaginer ces Amérindiens en chasseurs-cueilleurs vêtus de pagnes. Ils possèdent des smartphones
et suivent aussi les matchs de la Coupe du monde de football sur leur télé. Mais beaucoup se sentent coincés
entre deux cultures
Avec un taux de suicide dix fois plus élevé chez les Amérindiens de Guyane que dans le reste du pays, en
particulier chez les jeunes.
2518/06/2018
Carlos s’est donné la mort en laissant une lettre :
"Si nos ancêtres revenaient ici aujourd’hui,
je suppose qu’ils penseraient s’être trompés
de village. Nous, les jeunes, on s’est habitués
à tout acheter. Du coup, on ne sait plus rien
faire. Ils se disent fiers d’être Amérindiens,
mais ils rêvent d’être comme les Blancs et de
posséder les mêmes choses. Dans quelques
années, cela ne voudra plus rien dire parce
qu’ils ne sauront rien de notre passé, de nos
ancêtres, de notre culture."
Son ami Christophe Pierre a 25 ans. Responsable de l’association des jeunesses autochtones de Guyane, il a
choisi un nom amérindien, "Yanuwana", qui veut dire "grand condor". Pour lui, le projet minier va contre son
identité culturelle.
Un atout économique
Pour la plupart des élus de Guyane, la mine, ses 750 emplois et ses infrastructures sont des opportunités de
développement. Les responsables de la compagnie minière estiment que ceux qui ne veulent pas du projet ne
sont qu’une minorité. D'ailleurs, les Amérindiens ne sont que 15 000.
Marie Fleury, ethno-botaniste au Muséum d’histoire naturelle à Cayenne, rappelle : "D'un côté, on a une vision
qui va exploiter les ressources du sous-sol et, de l'autre côté, on a des populations qui on toujours vécu dans la
forêt et de la forêt. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est simplement un état d'esprit qui fait qu'on vit sans
impacter un élément naturel. Les habitants font partie de cette forêt ; c'est ça la différence essentielle."
Les jeunes mobilisés
Ce lundi soir encore, pour le dernier débat à Saint-Laurent-du-Maroni, les jeunesses autochtones disent "non à
la montagne d’or" et sont prêtes à poursuivre le combat au fin fond de la forêt s’il le faut. Les personnes
mobilisées se demandent même si une ZAD (Zone A Défendre, sur le modèle de celle de Notre-Dame-des-
Landes) en Guyane, pourrait marcher...
Si vous souhaitez donner votre avis sur le projet, vous pouvez le faire jusqu’au 7 juillet, même si la dernière
réunion publique a bien lieu ce lundi 18 juin. C'est ici.
2627
28
29
MARTINIQUE
3031
32
19/06/2018
CEREGMIA, ODYSSI, SODEM, SME and Co : la "vakabonnagerie" érigée en système ?
Vakabonnajri
La Martinique n'est sans doute pas plus corrompue que la Sicile, mais elle ne l'est, hélas, pas moins. La seule
différence c'est que dans l'île méditerranéenne, on utilise fréquemment les armes à feu pour régler les problèmes
alors que dans l'île caribéenne, on préfère avoir recours au mensonge, à la calomnie, à la diffamation et à la
manipulation tous azimuts.
Prenons le cas du CEREGMIA, cet ex-groupe de recherches de l'Université des Antilles accusé par pas moins
de 4 rapports (Cour des comptes, Sénat, INAENER) d'avoir détourné entre 10 et 14 millions d'euros. Ceux qui
ont eu le courage de dénoncer ce scandale et qui ont fait pression sur la justice pour qu'elle se bouge un peu ont
été cinq ans durant vilipendés, stigmatisés, traînés dans la boue même. Ceci avec la complicité des grands
médias, sauf MARTINIQUE 1è (Rayi chien mé di dan'y blan !).
Ou encore le cas de la SODEM qui a vu des riverains, pour la plupart modestes, de l'avenue Maurice BISHOP
être dépossédés de leur parcelle de terrain ou être relogés sans recevoir de titres de propriété. Là encore, des
millions d'euros ont disparu dans la nature et cela ne semble provoquer aucune indignation populaire. Certes,
une enquête a été ouverte par la justice mais si elle traîne autant que celle concernant le CREDIT
MARTINIQUAIS ou le CEREGMIA, les responsables peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
Et maintenant, c'est au tour de la SME (Société Martiniquaise des Eaux) ! Le plus affligeant est que ce sont
deux structures hexagonales qui ont porté plainte et non des structures locales. Or, la SME, selon un rapport de
la Cour des comptes, a un passif de 23 millions d'euros. Du coup, le Front Républicain d'Intervention contre la
Corruption et l'Association pour un Contrat mondial de l'eau ont déposé plainte auprès du procureur de la
République à Fort-de-France contre la SME au motif de "détournements de fonds publics".
Du coup, on est contraint de se poser une question : la Martinique vit-elle sous le règne de la
"vakabonnagerie" organisée avec la complicité des uns et des autres ?...
33MAYOTTE 34
35
36
37
38
39
40
41
42
Lejournaldemayotte
20/06/2018
La délégation nationale de la CFDT dénonce l’irresponsabilité de certains élus à
Mayotte
Après avoir été attractive pour les scientifiques, ce sont les syndicats qui défilent à Mayotte : une délégation de
la CFDT est de passage pour assurer une formation, et donner un diagnostic sans tabou de la situation
économico-sociale de l’île. Détournements des politiques ou abus des défiscalisations sont dans le même
panier.
Par Anne PERZO
- Tsigoy Ben Salimi, Mohamed Soilihi Ahmed Fadul, Pascal Catto et
Ibrahima Dia
Comme pour les baleines, c’est une histoire de saison, celle des
élections des représentants syndicaux de la fonction publique en
l’occurrence, qui se tiendront le 6 décembre prochain. Après
Philippe Martinez et une délégation CGT du BTP ce lundi, c’est la
CFDT qui vient parler de ses priorités. Pascal Catto, Secrétaire
confédéral Délégué Outre-mer CFDT ne s’en cache pas, il est
notamment venu pour faire campagne : « Nous défendons la
qualité de vie au travail pour les agents des trois fonctions
publiques, en particulier quand on voit la file d’attente devant les dispensaires ici, et nous contestons le gel de
du point d’indice, étant donné la reprise de la croissance économique en France. »
Mais il est venu avec une délégation qui a notamment rencontré le préfet, et qui défend auprès des autorités en
général, d’autres priorités, celle du logement social est en bonne place. Ibrahima Dia, Secrétaire confédéral,
chargé du Logement et de la politique de la ville, déplore notamment l’insuffisance des budgets nationaux
envers l’outre-mer : « Nous poussons pour que le deuxième opérateur après la SIM, qu’est Action logement*,
fournisse un effort plus important pour répondre aux besoins, qu’il investisse davantage à Mayotte. Il n’y a
actuellement que 278 logements sociaux, impensable au regard des 260.000 habitants ! » La ministre des Outre-
mer a annoncé 400 logements dans ses 53 mesures, « mais il y a un problème opérationnel à Mayotte, et c’est
transversal à tous les dossiers : il y a les fonds, mais comment peuvent-ils être dépensés ? »
« Le calendrier du politique n’est pas celui du territoire »
Formation ce mardi matin pour les agents de la fonction publique
Un problème d’ingénierie soulevé par les leaders de la
mobilisation sociale, dans lequel ils s’engouffrent aisément : « On
accuse beaucoup l’Etat, mais les politiques locaux doivent prendre
leurs responsabilités, ils doivent flécher de manière honnête les
projets immobiliers. Ce qui s’est passé il y a 3 mois (le conflit
social, ndlr) doit les faire réfléchir ! » La réponse aux besoins en
logement notamment, doit se faire « avec un travail en commun
de tous les acteurs. » Des propos constructifs, qui sont pensés en
terme de territoire : « On nous dit que le locatif n’est pas habituel ici, car ‘le Mahorais est propriétaire’. Il
faudra pourtant faire des concessions pour pouvoir loger tout le monde. Cela doit se faire en concertation avec
la population. » La résidence Mangua Bé de Chirongui avec ses espaces aménagés en fonction de la culture
locale, pourrait servir d’exemple à suivre.
43Lejournaldemayotte
20/06/2018
Pascal Catto prend du recul : « Les mesures prises par le gouvernement vont dans le bon sens, mais il pourrait y
avoir des milliards, s’ils ne sont pas dépensés, rien ne bougera. Le calendrier des politiques n’est pas celui des
avancées du territoire, comme la mise en place d’une station d’épuration Pour que tout le monde s’active, il faut
une instance de dialogue social, qui pourrait être celle que prévoit le code du Travail, le CREFOP. Axée sur la
formation professionnelle, elle va obliger patronat et syndicat à travailler ensemble, le premier a obtenu des
allègements de charges sociales, il faut qu’il accompagne maintenant une montée en compétence des salariés, et
des contrats d’apprentissage. »
« Les outre-mer n’ont rien à envier aux paradis fiscaux »
Pascal Catto cible une instance paritaire pour accélérer les décisions
Une instance que l’Etat et les collectivités locales doivent intégrer, « il faut avant
tout réduire le chômage, en formant, et grâce à un dispositif dont nous a parlé le
préfet, la Garantie Jeunes** qui permet l’insertion de ceux qui sont en grande
précarité. Il faut aussi une montée en puissance des compétence ici, en formant des
cadres ». Mais il faut aussi éviter la fuite des cerveaux en garantissant une éducation
de qualité pour leurs enfants.
Sur les mesures de la ministre, « un comité de suivi est indispensable », il est
d’ailleurs mentionné aux 53 mesures, « c’est le mal français, on crée des politiques
mais on ne les évalue pas », déplore Pascal Catto. Sur le secteur public, même
montée en compétence des salariés des collectivités, dont certains errent parfois dans les couloirs, « il faut les
former sur les secteurs en besoin de l’accompagnement des jeunes ou sur la surveillance des lieux publics. »
Sur le sujet de l’immigration clandestine, la délégation CFDT dit son impuissance face au problème
diplomatique, et si elle appelle une lutte renforcée contre le travail informel, elle demande un traitement digne
pour les personnes à reconduire.
La lassitude règne à Mayotte sur les revendications de la vie chère, « la structure comparative des prix que nous
avions effectuée en 2011 pointait une partie transport allant de 3 à 15% d’influence sur la construction du prix.
Nous avions aussi demandé que les marges après arrivée des produits soient calculées sur le prix hors octroi de
mer une fois celui-ci prélevé, mais les lobbys de la grande distribution ont eu le dessus. Les outre-mer n’ont
rien à envier aux paradis fiscaux ! » Pour preuve, ils se scandalisent du montant consacré à la défiscalisation, un
milliard d’euros, « c’est la moitié du budget Outre-mer… » A chacun son « Longoni », donc !…
Les chantiers ne manquent pas donc, sans compter l’application du code du Travail, ou la transposition du code
de la Sécurité sociale, projet phare de la CFDT Mayotte pour les années à venir.
Anne Perzo-Lafond
Lejournaldemayotte.com
*Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, versée par
toutes les entreprises du secteur privé d’au moins 20 salariés, pour conduire ses deux missions principales :
accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, en proposant des services et des
aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi, construire et financer des logements
sociaux et des logements intermédiaires.
** La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude.
44NOUVELLE-CALÉDONIE
4546
47
48
49
19/06/21018
« L’alcool est présent dans 90% des affaires jugées par le tribunal »
Au tribunal, ce lundi encore, l’alcool était présent dans de nombreuses affaires jugées en comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité (CRDC). Un système qui sert à désengorger le tribunal correctionnel et
via lequel les prévenus rencontrent directement à huis clos les magistrats.
Malia Noukouan (SR)
Les affaires liées à l’alcool sont toujours aussi importantes, les audiences correctionnelles le démontrent. Une tendance
que le gouvernement veut inverser. Les élus du congrès ont voté jeudi dernier une loi de pays pour lutter contre
l’alcoolisme. Après la prévention, c’est donc la répression. Le but est de changer les mentalités mais le chemin sera
long. Au Palais de justice ce lundi, les prévenus interrogés se disent conscients d’avoir fauté mais reconnaissent avoir du
mal à se maîtriser lorsqu’ils sont sous l’emprise de l’alcool. Laurent, 37ans, comparaissait pour conduite en état
d’ivresse, excès de vitesse et refus d’obtempérer il y a deux mois à Nouméa. Aujourd’hui, il reconnaît ses tords, l’alcool
et problèmes personnels ne font pas bon ménage dit-il, « je voulais impressionner, faire comme les autres, mais
aujourd’hui je le regrette ».
222 condamnés incarcérés pour 100 000 habitants
Au Palais de justice, les magistrats sont débordés. Le procureur de la République rappelle les chiffres : « l’alcool est
présent dans 90% des affaires, le contentieux routier représente la moitié des condamnations du tribunal correctionnel,
les affaires de violences sont quasiment toutes liées à la consommation excessive d’alcool et la consommation de
cannabis, la délinquance liée aux cambriolages est aussi en rapport, bon nombre des personnes interpellées sont sous
l’emprise de l’alcool, les affaires de cambriolages, des vols qualifiés d’opportunité, sont aussi liées à l’alcool… » Autant
de dossiers qui mobilisent les magistrats. Souvent critiquée et qualifiée de laxiste, la justice tente, précise Alexis Bouroz,
le procureur de la République, d’apporter une réponse pénale adaptée. Le tribunal sait se montrer exemplaire ajoute-t-
il, « le taux de détention par habitant en Nouvelle-Calédonie est très important, 222 condamnés incarcérés pour 100
000 habitants, c’est plus du double que la moyenne européenne ». Pour lui, la répression ne règle pas tout, « le réseau
de prise en charge de l’addictologie est défaillant, c’est un problème de société, d’accès aux soins, c’est un problème de
justice seulement dans ses manifestations par un passage à l’acte ».
L’accompagnement et le suivi des personnes alcooliques, une solution qui peut s’avérer efficace, encore faut-il qu’il y ait
suffisamment de spécialistes. Thierry, 26 ans, l’un des témoins rencontré, avoue avoir changé sa relation à l’alcool
depuis qu’il est suivi par un addictologue. Sorti du Camp Est il y a 10 mois il tente de se reconstruire, dit-il. Ce lundi
matin, il accompagne sa sœur qui est convoquée, « Je ne veux pas qu’elle fasse les mêmes erreurs que moi ». Après
deux ans passés derrière les barreaux il regrette « j’aurais pu me former pendant ce temps, aujourd’hui je suis trop âgé
et c’est difficile de trouver du boulot ». Le jeune homme a mis l’alcool et ses mauvaises fréquentations de côté.
A partir de quel taux d’alcoolémie dans le sang est-on en infraction ?
Le taux contraventionnel : vous êtes en infraction à partir de 0,25 mg par litre d’air expiré, soit 0,50g d’alcool/litre de
sang.
Le taux délictuel : votre taux atteint 0,40mg/litre d’air expiré, soit 0,80g/litre de sang.
50POLYNÉSIE
5152
53
54
55
56
57
58
59
LA RÉUNION
60Le Quotidien de la Réunion 20/06/2018
61Le Journal de l’Ile Réunion 20/06/2018
62Le Journal de l’Ile Réunion 20/06/2018
6319/06/2018
Assises Outre-mer: La Région Réunion s'allie à l'ensemble des acteurs économiques
La Région Réunion et tous les acteurs économiques réunionnais se sont réunis dans un projet
commun. Ensemble, ils tendent vers un même modèle de territoire, une même ambition, en
vue des Assises de l'Outre-mer engagées par le Gouvernement.
Attractivité, compétitivité, internationalisation: voilà les
maîtres-mots de ce modèle économique réunionnais
partagé entre la Région et les différents acteurs
économiques. En créant cette fusion totale, ils
souhaitent prouver leur ambition et que leur cohésion
soit enfin entendue par le Gouvernement.
En effet, ils se sont alliés pour la constitution du livret
bleu des Outre-mer, dans le cadre des Assises de l'Outre-
mer. De manière générale, la Région veut sécuriser
l'enveloppe globale de 2,5 millards d'euros, consacrée au
développement économique de l'Outre-mer.
Ensemble, ils ont pour ambition de prouver la nécessité d'une meilleure attractivité du territoire, en passant
notamment par une fiscalité mieux adaptée ou encore une mise à niveau des infrastructures, comme le grand port de La
Réunion. Ils veulent vraiment passer un cap, en améliorant la compétitivité des entreprises réunionnaises.
Mais au-delà de favoriser le secteur économique réunionnais, ils tendent à une ouverture plus favorable à
l'international. Le but est notamment de miser sur certains secteurs, comme le digital, en améliorant les
investissements. Il faut un ancrage des politiques publiques plus important, afin d'accompagner les entreprises
réunionnaises notamment dans les secteurs du BTP, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire ou encore de
l'agrotourisme.
"Aujourd'hui La Réunion est à 3% de taux de croissance, mais elle peut encore mieux faire", confie Didier Robert,
Président de la Région Réunion. Pour ça, il faut également que ce besoin et cette envie d'un meilleur développement
économique soient combinés avec un impact environnemental totalement amoindri. Car économie et écologie sont
intiment liées.
Au-delà de son intérêt économique, la Région souhaite montrer son soutien en développant notamment une enveloppe
de 15 000 euros, qui permettra de finaliser les dossiers non aboutis à cause de la suppression des APL Accession.
Concernant les autres budgets, les élus signeront le contrat de confiance pour l'organisation financière à la prochaine
séance plénière la semaine prochaine.
Ces différents points seront transmis à la ministre des Outre-mer dans la journée avant de lui être officiellement remis
lundi. Des rendez-vous auront lieu à l'Elysée les 27 et 28 juin pour faire un premier point sur les Assises de l'Outre-mer.
S'en suivront ensuite au minimum 3 à 4 rencontres annuelles, avec un premier débriefing prévu en août. "A une
semaine des Assises, nous sommes dans un timing parfait pour nous faire entendre", confie Didier Robert.
Charline Bakowski
64Le Quotidien de la Réunion 20/06/2018
65Le Journal de l’Ile Réunion 20/06/2018
Le Quotidien de la Réunion 20/06/2018
66Le Quotidien de la Réunion 20/06/2018
67Le Journal de l’Ile Réunion 20/06/2018
68Le Quotidien de la Réunion 20/06/2018
6970
SAINT-MARTIN
SAINT-BARTHELEMY
7119/06/2018
Jean-Marc Mormeck vient soutenir les jeunes à Saint-Martin
Le délégué interministériel pour l’égalité des chances sera sur l’île du 20 au 22 juin.
Jean-Marc Mormeck se rend à Saint-Martin pour parrainer les journées sport et citoyenneté de L'Union sportive
de l'enseignement du premier degré (USEP) ainsi que soutenir et motiver les jeunes Saint-Martinois pour les
aider à se relever et poursuivre leur parcours.
Mercredi il rencontrera l’association Le Manteau puis les jeunes en chantiers d'insertion de l’association ACED
ainsi que les enfants suivis par Sandy Ground on the Move dans le cadre de l'accompagnement éducatif (aides
aux devoirs, accompagnement parental). Il lui sera aussi présenté le film Le Choix d’une vie réalisé par
Jeunesse Soualiga. Il rendra aussi visite aux Archiball et aux membres de l’association Mad Twoz Family.
Jeudi Jean-Marc Mormeck échangera avec des jeunes sapeurs pompiers et volontaires, les élèves de CM1/CM2
de l’école élémentaire Emile Choisy et visitera l’ULIS Autiste à l’école Hervé Williams. Une rencontre avec la
classe boxe de Monsieur Ansquer au collège du Mont des Accords est aussi prévue.
Il participera à des échanges avec des élèves de classes de 4ème sur la thématique entrepreneuriale au collège
du Mont des Accords organisée par l’association 100 000 entrepreneurs, Impact Partenaires qui ont pour objet
de transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en organisant des témoignages
d’entrepreneurs et de salariés intrapreneurs dans les établissements scolaires.
Enfin vendredi il ouvrira la Journée sport et citoyenneté de L'Union sportive de l'enseignement du premier
degré (USEP) au stade Vanterpool et rencontrera les membres Conseil territorial des Jeunes.
Estelle Gasnet
72Vous pouvez aussi lire