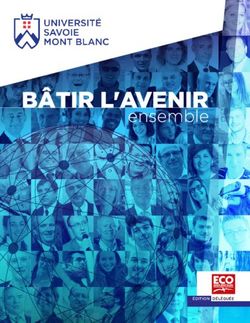Prospectives GIPSA-lab - Grenoble INP
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
311
Prospectives de l'unité
1 Introduction
La prospective porte sur la politique scienti
que, la structuration, le rayonnement, le position-
nement partenarial ainsi que sur le positionnement sur les plans local, national et international de
gipsa-lab.
gipsa-lab est né en 2007. Un premier quadriennal (2007-2010) porté par Jean Marc Chassery a
vu la construction de gipsa-lab autour de trois départements constitués de 12 équipes et des services
mutualisés. Le second quadriennal, démarré en janvier 2011 (2011-2015, mais sur période d'évaluation
2009- 30 juin 2014) est porté successivement par Jean Michel Dion (1 an) et Jean Marc Thiriet
(actuel directeur). Leurs actions s'inscrivent dans une consolidation de gipsa-lab en faisant disparaître
les aspects administratifs historiques qui subsistaient notamment dans les départements, pour
structurer, renforcer, professionnaliser les services et les missions d'accompagnement de la recherche.
Ces actions ont permis aux départements d'évoluer vers des structures d'animation scienti
ques, en
grande partie libérées des tâches administratives désormais transférées au niveau de gipsa-lab.
2 Analyse SWOT
Positif Négatif
FORCES
IDENTITE unique sur les thèmes Auto-Signal-
Images-Parole-Cognition FAIBLESSES
TAILLE du laboratoire.
Origine interne
HETEROGENEITE des tutelles
COUVERTURE thématique large avec prise en COMPLEXITE des procédures
compte de l'interdisciplinarité
Faible PRESENCE dans les structures d'ani-
ACTIVITE SCIENTIFIQUE mation : ISIS, MACS, I3, IM.
rayonnement et visibilité MANQUE DE RECUL face aux trop nom-
PRESENCE dans la recherche à l'UGA breuses sollicitations
Des SERVICES structurés et opérationnels
Liens avec la formation
MENACES
OPPORTUNITES
DISPERSION face aux sollicitations pluridisci-
Origine externe
plinaires et/ou en matière de projets, cohérence
UGA/Idex et sa DYNAMIQUE
scienti
que
NOUVEAU PAYSAGE de la formation
Recrutements et promotions contraints
REGROUPEMENT géographique
ELOIGNEMENT géographique forma-
H2020 tion/recherche
Dispositif ZRR312 Prospectives de l'unité
3 Présentation du projet Gipsa-3
Gispa-Lab est désormais un très gros laboratoire de plus de 400 personnes. La future direction
souhaite inscrire le projet GIPSA-3 dans la continuité des politiques menées par Jean Marc
Chassery, Jean Michel Dion et Jean Marc Thiriet pour faire du gipsa-lab, autour de notre identité,
une place forte, reconnue localement, nationalement et internationalement dans les disciplines du
traitement du signal et des images, de l'automatique ou des recherches en parole et cognition.
Fortement ancré sur ses trois disciplines "piliers", gipsa-lab est parfaitement identi
é par ces
instituts de rattachement (INS2I et INSHS). Très impliqué dans l'acquisition, la gestion des mesures,
des données, des observations provenant de nos plates-formes, des systèmes physiques, biologiques,
cognitifs ou autour du langage, gipsa-lab développe des recherches théoriques et appliquées sur les
signaux et les systèmes produits et échangés par l'homme, ou par ses environnements naturels et
technologiques.
La ligne directrice que nous proposons est de poursuivre les activités fondamentales et appli-
quées autour de l'information (observation, mesure, signal, parole, image, perception) et des systèmes
(commande, contrôle, traitement, analyse, cognition) en confortant l'approche pluridisciplinaire. En
s'appuyant sur la richesse des résultats issus des deux premiers quadriennaux, sur l'originalité scienti-
que de gipsa-lab, et sur les structures actuelles, l'équipe de direction souhaite poursuivre les eorts
et apporter des ajustements pour rendre encore plus performantes, visibles et attractives les activités
du laboratoire.
4 Structuration du projet Gipsa-3
La structure de gipsa-lab autour de ses trois communautés scienti
ques pérennes, doit être
conservée. Il est important de préserver cette visibilité scienti
que vis-à-vis des tutelles, de nos
collègues universitaires autant au niveau national et international qu'auprès de nos partenaires indus-
triels. Pour le prochain quinquennal nous souhaitons maintenir la structuration en 3 départements
(Signal-Image, Automatique, Parole-Cognition). Ces derniers, garants des disciplines auxquelles ils
se réfèrent, doivent jouer un rôle d'animation scienti
ques et de coordination en association étroite
avec la commission scienti
que. Autour de ces 3 départements et des 13 équipes- lieu de base de
la recherche scienti
que, la colonne vertébrale technique du laboratoire, composée de l'ensemble
renforcé des services maintenant complètement opérationnels accompagnera par ses missions, les
recherches de gipsa-lab.
Quelques mouvements au sein des équipes se sont déclarés, mais sans aucune mesure par rapport
au dernier quadriennal ou des divisions, des fusions d'équipes étaient apparues. Associée aux très
bons résultats de GIPSA, ceci montre que les équipes ont trouvé une stabilité scienti
que.
Les quelques changements sont :
L'équipe PCMD du DPC garde son acronyme qui se décline d'une autre façon pour Perception,
Contrôle, Multimodalité, Dynamiques de la Parole . Elle est renforcé par 2 permanents (1PR,
1CR-34) venants de l'ex-équipe MAGIC, contrebalancé par les départs de 2 CR-34 (à l'extérieur
de gipsa-lab).
L'équipe MAGIC du DPC devient l'équipe CRISSP pour Cognitive Robotics, Interactive
Systems, and Speech Processing avec le départ de 2 permanents vers l'équipe PCMD.
L'équipe SLD qui devient VSLD pour Voix, Systèmes linguistiques et Dialectologie pour prendre
en compte la composante physiologique de la voix.Structuration du projet Gipsa-3 313
L'équipe CICS du DIS intègre 1 permanent (PR 27) venant de l'équipe AGPIG.
Les deux principales nouveautés du projet GIPSA-3 qui impacteront le laboratoire sont :
1. L'émergence d'axes thématiques transversaux dont le rôle sera de promouvoir des actions scien-
ti
ques e
caces et souples au travers des départements, qui impacteraient plusieurs personnes,
de plusieurs équipes sur deux départements au moins. Une enveloppe
nancière sera disponible
pour faire vivre ces axes (missions pour inviter des personnalités extérieures,
nancement de
stages de M2R si besoin pour initier des travaux collaboratifs). Le nombre d'axes, leur durée,
les demandes
nancières seront à dé
nir en relation avec la commission scienti
que et le CDL.
A ce jour et suites aux journées prospectives menées au laboratoire, 2 axes sont référencés dans
le projet Gipsa-3.
Le premier se positionnera autour des activités ayant pour objet d'étude le cerveau. Nom-
breuses et très diverses, elles concernent les équipes MAGIC, PCMD, AGPIG,VIBS, CICS,
SAIGA. La mise en place d'un axe cerveau, dénommé cerveau@gipsa, vise à fédérer et faire
émerger des recherches autour du cerveau dans le laboratoire en intégrant par exemple
des actions méthodologiques issus des 3 ERCs présentes à gipsa-lab (CHESS, DECODA
SPEECH UNIT), en renforçant nos collaborations avec des acteurs du secteur (Pôle Cogni-
tion, GIN-Grenoble Institute of Neuroscience, LPNC, Lidilem, CHU, CEA-CLinatec etc.)
pour faire de l'UGA une place forte sur le thème Cerveau. Une des missions de l'axe
cerveau@gipsa sera de réaliser l'interface entre les acteurs du laboratoire et les acteurs
grenoblois, notamment vers l'application clinique, développée par ailleurs au sein du DHU
Grenoblois (épilepsie, troubles neuropsychologiques résistants, vieillissement, . . . )
Les thèmes scienti
ques au sein de gipsa-lab se groupent clairement en quatre points :
Neurosciences et cognition ( autour de l'in
uence des fonctions sensorimotrices sur la
plasticité, la gestion de la parole ou sur les gestes, la perception visuelle, . . . )
Méthodologies pour les signaux et images issus des neurosciences (séparation et lo-
calisation de sources, apprentissage arti
ciel, traitement statistique du signal et des
images, modèles graphiques, théorie de l'information, . . . )
Neurosciences computationnelles (modèles de réseaux de neurones et propagation de
l'information, in
uence des
uctuations dans les systèmes nonlinéairesneurones et
réseaux)
Applications en BCI et analyse du neurofeedback
Deux propositions principales d'action ont émergées :
Une journée annuelle et un séminaire trimestriel permettant de faire venir parler des
personnalités locales, nationales, internationales.
une réunion récurrente (mensuelle) courte informelles ayant vocation à faire avancer
les thèmes scienti
ques et créer des liens en suscitant la présence de collègues exté-
rieurs. Ces manifestations formeront le terreau sur lequel des collaborations pourront
se développer et semblent donc essentiellement à la réalisation de l'axe
Le deuxième axe thématique transversal est intitulé robotiques@gipsa se propose de fédérer
les multiples recherches menées au GIPSA-Lab sur le thème robotique au sens large.
Le dénominateur commun de ces recherches est l'étude et le développement de systèmes
de perception, de systèmes d'acquisition et de compréhension de scènes complexes et des
systèmes de commande pour l'action, que ce soit pour contrôler des robots en milieu natu-
rel (intérieur et extérieur) ou augmenter/suppléer les capacités sensori-motrices humaines
par des artefacts. Un grand nombre d'acteurs au laboratoire partagent les mêmes pro-
blématiques de modélisation, de boucles dynamiques, d'apprentissage de comportement,314 Prospectives de l'unité
d'implémentations temps-réel et d'expérimentations en situation. la laboratoire est de plus,
doté de plusieurs plate-formes complètement dédiés à des actions scienti
ques autour de la
robotique (robots volants, robots humanoides, robots marcheurs, . . . ). Une ambition com-
mune est 1) de faire évoluer ces robots dans des environnements de plus en plus complexes,
2) de confronter ces dispositifs entre eux et à des agents humains, et 3) de les doter de
capacités d'interaction et de comportements sociaux adaptés.
L'objectif de politique scienti
que est de renforcer la visibilité du laboratoire et de l'UGA
sur une thématique en plein essor : en eet, de part l'ensemble des disciplines conviées
(traitement des signaux et des images, automatique, contrôle moteur et biomécanique,
cognition individuelle et sociale. . . ), les acteurs sont éclatés dans de nombreuses équipes
et au sein de multiples laboratoires de la place (LIG, LJK, INRIA Montbonnot, TIMC,
GSCOP, etc). Nous essayerons en outre de renforcer nos liens au niveau régional, notam-
ment lyonnais, où le tissu industriel est plus important malgré un nombre plus restreint
d'acteurs académiques.
2. La probable création d'une nouvelle équipe commune INRIA baptisée CROCO pour Calcul
et contrôle pour des Robots Collaborateur qui intégrera + 3 personnes de l'INRIA et 1 perma-
nent de l'équipe Sysco. L'équipe Croco réunit des compétences en automatique, optimisation
numérique, fusion de capteurs, vision par ordinateur pour aborder de façon globale cette pro-
blématique de la perception et de la décision au c÷ur de l'action lorsque des robots collaborant
e
cacement avec l'homme doivent faire face à des tâches complexes dans des environnements
non contrôlés. Ce point est actuellement en ré
exion.
5 Organisation de Gipsa-3
La structure de Gipsa-3 est calquée sur l'actuel organigramme de gipsa-lab c'est-à-dire avec 3
départements, 13 équipes (dont 1 nouvelle). La légère diérence se fera dans l'organisation de la
gouvernance ou quelques changements sont à prévoir.
1. Au niveau de la Direction & Direction-Adjointe où deux personnes (J. Mars Directeur et N.
Marchand Dir. Adjoint) assureront les missions actuellement portées par J.M. Thiriet (Liens
avec les tutelles et structures, Organisation de l'ensemble des activités opérationnelles adaptées
aux objectifs scienti
ques dé
nis dans le projet, Stratégie et cohérence des activités scienti-
ques et techniques, Cohésion de l'unité, Diusion des connaissances et des savoir-faire, Grands
chantiers etc.). Ils se feront aider par une secrétaire générale qui pilotera auprès du directeur
et/ou directeur adjoint, les services d'appui technique (plateforme projet, informatique), service
nancier et RH pour permettre le développement de la recherche.
2. Au niveau des responsables de département. Ils auront un rôle scienti
que fort auprès leur
communauté scienti
que dont ils seront les représentants légitimes. Comme dans les précédents
quadriennaux, ils assureront la qualité et l'équité scienti
que dans leur département. Une mission
nouvelle sera de de mettre en place et d'animer la commission scienti
que du laboratoire.
3. Dotée d'une capacité
nancière (autour d'une centaine de ke, le rôle de cette commission
scienti
que sera de proposer, d'aider au montage de projets (déjà déposé, ou sans guichet visible
ou fortement exploratoire), de dégager des actions pour répondre aux objectifs scienti
ques
du laboratoire, par exemple encourager et promouvoir les projet européens. Cette commission
assistera la direction pour la mise en place d'une politique scienti
que cohérente validée par le
CDL.Challenge et Objectifs de Gipsa-3 315
4. Au niveau des équipes et du management des services : La mise en place et la montée en
responsabilité de jeunes scienti
ques à la tête des équipes avec des binômes responsable et
responsable adjoint doit être poursuivie. La continuité des actions dans et entre les services
pour assurer un fonctionnement e
cace et reconnu par tous (RH, Finance, Informatique, Plates-
formes, Communication, Documentation) doit être poursuivie et une incitation à participation
aux formations managériales sera faite.
5. Un grand laboratoire comme gipsa-lab, pourrait se doter d'une instance nouvelle extérieure,
appelée Scienti
c Advisory Board (SAB) et composée de scienti
ques reconnus de réputation
internationale ; qui se réunirait à mi-parcours pour examiner et conseiller les diérents pro-
grammes scienti
ques proposés dans gipsa-lab.
6. L'organisation du laboratoire sera complétée avec 3 chargés de mission.
Le premier sera chargé des relations avec l'Institut INSHS. Il aura pour rôle d'assurera
représentation du laboratoire auprès des institutions CNRS-INSHS et de l'Université de
Stendhal.
Le deuxième aura pour rôle de promouvoir la participation à des projets européens (veille
diusion des appels à projets, communications, liens avec les cellules Europe du CNRS et
des établissements.
Le troisième sera référent pour les doctorants et postdoctorants
6 Challenge et Objectifs de Gipsa-3
Un des challenges sera d'a
rmer le positionnement du laboratoire gipsa-lab par rapport aux
thèmes prioritaires du site grenoblois (UGA, Ecoles, UFR/IUT, Pôles, Labex etc.), ainsi que par
rapport aux enjeux nationaux et européens dé
nis par les instances. Des eorts doivent être faits
aussi bien sur la formation que sur la recherche : Un objectif sera de faire que gipsa-lab soit connu et
reconnu comme un acteur majeur au niveau grenoblois, au niveau national, européen et international.
6.1 Objectifs : gipsa-lab en interne
Au-delà des politiques scienti
ques des équipes et des Départements, le laboratoire souhaite mener
diérentes actions sur le quinquennat.
6.1.1 Stratégie scienti
que
Le laboratoire s'appui sur trois départements scienti
quement solides. Chacun de ces départements
souhaite poursuivre les recherches initiées ces dernières années. Une prospective plus approfondie sera
produite en collaboration avec les futurs responsables de départements dont l'élection est prévue au
mois d'octobre 2014.
Nous voulons poursuivre et encourager les partenariats inter-équipes (conférences et séminaires
communs). Une des actions sera la mise en place d'axes transverses qui doit permettre une émulation
scienti
que à travers le laboratoire sur des thèmes identi
és. Ceci devra se concrétiser par la mise en
place d'une animation scienti
que e
cace dans le laboratoire, soutenue par une commission scienti-
que qui identi
era des projets innovants autour de la Robotique, de la Santé, du Langage et de la
Perception par exemple et dans les diérents domaines tels que l'énergie, le vivant, l'environnement).
Nous devons également poursuivre et maintenir la qualité de nos publications et de nos partenariats
locaux, nationaux et internationaux. Encourager, promouvoir la diusion et la communication de nos
résultats vers les établissements et les tutelles doit être une action forte. Nous souhaitons nous appuyer316 Prospectives de l'unité
sur le SAB (Scienti
c Advisory Board) pour valider nos actions scienti
ques au cours du quinquen-
nat. Une action primordiale doit également se faire vis à vis de la communauté des doctorants et des
stagiaires, pour les intégrer au mieux à la vie du laboratoire. La promotion, la communication inter-
doctorants, l'ouverture d'esprit scienti
que, ainsi que le rayonnement à l'international du laboratoire
doit être un objectif permanent.
6.1.2 Stratégies et actions organisationnelles structurantes
Nous voulons poursuivre la politique de valorisation, et d'e
cacité des services et de nos plates-
formes à l'intérieur et à l'extérieur de gipsa-lab en y associant étroitement les administratifs, les
techniciens & ingénieurs et les chercheurs. Pour répondre aux besoins des personnels permanents et
non-permanents, la politique d'accompagnement à l'évolution des carrières des agents, poursuivie par
la future direction s'appuiera sur des plans de formations notamment celle de management pour les
chefs de service. Cette politique sera intégrée dans le plan de formation de l'unité. Dans le cadre du
contexte contraint que nous connaissons, il est important de s'inscrire dans une vision pluriannuelle
des besoins. Pour cela, les chefs de service pourront contribuer à la préparation de la prospective
d'emploi du laboratoire (anticiper les départs, maîtriser la problématique des CDD sur ressources
propres qui se multiplient, poursuivre la politique de promotion interne. . . ). gipsa-lab est composée
de personnels de statuts diérents, avec des fonctions variées, employés par l'une de nos quatre tutelles
ou par les
liales partenaires de gipsa-lab. C'est à la fois une richesse et une grande communauté qui
conduit à la dé
nition d'une stratégie de communication interne. Elle pourra s'appuyer sur la création
de trois espaces d'échanges et de remue-méninges : un espace de dialogue ITA/IAT de type AG, un
espace inter-services pour que les chefs de services et les chargées de mission travaillent sur des
projets communs ou améliorent leur connaissance des activités des uns et des autres pour favoriser
les démarches collectives. En
n, un troisième espace intra laboratoire pour multiplier les moments de
rencontres entre les services et les équipes.
6.1.3 Quelques grands chantiers communs
Porté par la direction, le laboratoire s'engage dans un processus d'amélioration continue. Cette
démarche vient tout juste d'être engagée et devra se déployer progressivement sur l'ensemble du péri-
mètre qui comprend des processus de gouvernance, de recherche, d'enseignement - formation, d'exper-
tise - transfert et de support, accompagnement et soutien. Les objectifs sont nombreux : optimiser le
fonctionnement et le pilotage du laboratoire, s'adapter à l'évolution permanente de l'environnement de
travail, garantir la sécurité des résultats de la recherche. . . Cette démarche s'accompagnera de la mise
en place d'une GED (Gestion Electronique des Documents), de contrôles internes notamment pour
garantir la conformité des dossiers en rapport avec les règles de gestion de la comptabilité publique
ou
abiliser les données des diérentes applications du système d'information (SI) du laboratoire. Ce
dernier est au c÷ur d'un autre grand chantier qui prévoit la révision du SI actuel et la mise a dispo-
sition d'une interface web complète pour l'intra et l'extranet. Cette action vise à mettre en cohérence
l'existant, et à repenser une architecture globale, capable d'intégrer de nouvelles briques et conçue
pour simpli
er la démarche de l'utilisateur. En
n, le SI permettra le suivi d'indicateurs notamment
pour le pilotage du laboratoire, le fonctionnement des services et le suivi de processus par exemple.
En
n, pour répondre à la problématique de la gestion et de l'utilisation du patrimoine informatique et
du patrimoine scienti
que, il s'agira d'élaborer par exemple une politique de conservation des archives
documentaires et du patrimoine scienti
que, et de créer une application pour gérer l'inventaire, la mu-
tualisation des matériels et la valorisation de nos plates-formes. Un chantier important à poursuivre
est répondre à la demande constante d'une communication e
cace vers les instituts et les tutelles,
vers les agents de gipsa-lab, les utilisateurs, le grand public. . .Challenge et Objectifs de Gipsa-3 317
6.1.4 Focus sur les plates-formes
Pour le prochain quinquennat, le service plates-formes et projets a plusieurs dé
s à relever. Les
nombreux stagiaires, doctorants ou autres non-permanents de passage développent ou participent au
développement de logiciels. Il s'agit donc de réussir à capitaliser cette connaissance. Dans le contexte
du déménagement de gipsa-lab et de la mise en place de la politique de zone à régime restrictif, le
service organisera le regroupement géographique des pôles de plates-formes. En
n, le service élaborera
une politique et une procédure d'ouverture des plates-formes en lien avec la démarche engagée par
certaines tutelles. Ces actions contribueront à la cohérence et la visibilité des plates-formes de gipsa-
lab et tendent à renforcer les collaborations avec le monde industriel
6.2 Objectifs : gipsa-lab et l'UGA
Un des challenges sera de renforcer le positionnement du laboratoire gipsa-lab par rapport aux
thèmes scienti
ques prioritaires du site grenoblois (UGA, ses pôles de recherche MSTIC, ALLSHS,
PAGE etc. et ses axes transverses), de conforter notre position dans les Labex(s) et de promouvoir
nos intérêts de formation vis-à-vis des tutelles. Il est important que nos sections majoritaires (61,
27, 07 et 34) soient également reconnus à travers gipsa-lab. Une attention particulière sera faite sur
les aspects patrimoniaux pour que l'on garde notre entité et visibilité de grand laboratoire "signal -
systèmes".
Du point de vue scienti
que, le succès de notre laboratoire aux réponses des diérents AAPs
de Persyval-lab, Osug@2020, AGIR etc., met en lumière nos compétences et nos interfaces avec les
autres laboratoires (LIG, LJK, IF CEA, ISTERRE, LTHE etc.). Plusieurs actions sont néanmoins à
poursuivre :
Le laboratoire commun avec le CEA-Leti. Cette collaboration a été très fructueuse jusqu'ici
(docteurs, publications jointes, brevets) mais n'a néanmoins pas encore donné lieu avec succès à
des soumissions de projet ANR ou auprès de l'Europe. C'est un des points qui reste à renforcer
pour les prochaines années.
Les collaborations doivent être renforcées avec les acteurs de la Santé, de la Cognition et du Cer-
veau (Grenoble Institut des Neurosciences, CHU, CEA-clinatec avec l'objectif de développer ou
promouvoir le développement de techniques innovantes, faire surgir de nouvelles problématiques,
de nouveaux champs d'applications des compétences de GIPSA-Lab.
Le développement de liens scienti
ques forts avec les acteurs locaux de l'énergie et de l'environ-
nement doit être pérennisé (G2ELABb, CEA, LEGI, G-SCOP, LTHE, 3SR etc).
Un autre challenge qui demande l'implication de tous est la participation à l'ore de formation des
structures. gipsa-lab participe à des enseignements spéci
ques en masters,
lières d'écoles d'ingénieurs
et d'IUT concernant l'ensemble des domaines de ses activités en formation par la recherche et accueille,
en moyenne, 70 stagiaires par an dont certains poursuivent en thèse.
Dans un contexte très défavorable en matière de recrutement d'EC, l'objectif est de renforcer
notre potentiel de formation mais aussi d'attractivité. Le développement, la participation à des pro-
grammes nouveaux de formation, ou masters internationaux, l'a
chage, la promotion de nos thèmes
de recherche, de nos PFE et master est essentiel pour attirer de bons étudiants et de bons doctorants.
6.3 Objectifs : gipsa-lab et le National
La diversité des programmes ANR, l'incitation à participation ont favorisé les réponses à ces
derniers au détriment des projets européens. Même si un eort doit être fait sur l'Europe et les
actions d'échanges à l'international, Il faut continuer à :318 Prospectives de l'unité
Encourager le dépôt d'ANR et les collaborations avec les laboratoires nationaux notamment en
s'appuyant sur les jeunes C-EC du laboratoire,
Encourager la valorisation et l'utilisation de nos plates-formes.
Encourager et redynamiser les actions avec les communautés nationales (GDRs, réseaux etc.),
Encourager les relations et partenariats industriels par la signature d'accord cadre ou autre.
6.4 Objectifs : gipsa-lab et l'International
On constate que la complexité de montage et du suivi des dossiers européens peuvent être un
frein aux dépôts des projets européens, malgré le nombre important de Réseaux d'Excellence où les
membres de gipsa-lab sont présents. Un eort doit être fait sur l'Europe et les actions d'échanges
à l'international- Il faut donc encourager le développement de projets Européens en suivant en cela
la politique de l'INS2I, et faire que gipsa-lab soit davantage présent sur L'Europe. Nous sommes
déjà impliqués à plusieurs niveaux (3 ERCs, et des projets européens), et il est impératif de saisir
cette opportunité avec une incitation interne à gipsa-lab (chargé de mission, commission scienti
que)
qui disposera de tous les atouts pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, si gipsa-lab est présent
sur diérents pays, la stratégie porte sur l'identi
cation de partenaires privilégiés avec des thèses en
cotutelle.
7 Conclusion
Avant de prendre la décision de porter le projet Gipsa-3, j'ai visité plusieurs laboratoires en
France choisis selon des critères particuliers (même taille, même historique de regroupements, même
a
nités scienti
ques). J'ai pu établir avec eux une discussion autour des points suivants (organisation
structurelle, budget, rôle des instances et des services, doctorants, etc.). En pleine conscience, ceci
m'a permis de constater que gipsa-lab est très bien reconnu et identi
é. Qu'il est perçu comme un
poids lourd dans nos domaines de compétence. J'ai pu me rendre compte aussi que gipsa-lab est un
des laboratoires à avoir cette richesse dans les services et les actions.
Les dernières années ont été extrêmement riches en restructuration sur Grenoble et au plan natio-
nal, que ce soit vers la recherche (Labex (s) ou vers la formation (nouvelle écoles, etc). Même si, les
perspectives de recrutements se sont dégradées, la précarité des emplois (surtout dans les fonctions
support) s'est accrue, les budgets stagnent quand ils ne baissent pas : gipsa-lab posséde les atouts
pour faire face collectivement à cette nouvelle conjoncture et rentrer à présent dans une dimension
européenne tout en restant très vigilants pour rester performants et attractifs.
7.1 Un challenge : Mouvements et besoins en personnels
D'ici 2020 il y aura 8 départs à la retraite d'enseignants-chercheurs (1, ENSE3, 3 Phelma, 2 Po-
lytech, 2 IUT-1), 6 de DR CNRS section 07, ainsi que 5 d'IT-IATOS. Certains de ces futurs départs,
du moins les plus précoces, sont décrits dans les prospectives des départements. La politique sera
de maintenir ces postes au sein du laboratoire, parfois en les redéployant au travers des départe-
ments, comme ceci a été réalisé au précédent quadriennal. Pour ce qui concerne les chercheurs, nous
poursuivons notre recherche de candidats extérieurs et souhaitons que les instituts nous entendent.
7.2 Un challenge : Les locaux
Dans le cadre de recon
gurations des locaux liées à la politique de site (Plan Campus, déména-
gement de ENSE3, attribution du bâtiment B à l'ENSIMAG, sortie du périmètre de Grenoble-INP,Axe transversal cerveau 319
du bâtiment D où se trouve la totalité du DIS, et du bâtiment E), il est prévu le redéploiement du
Département DIS et des plates-formes du bat E dans le bâtiment B du site Ampère en partenariat
avec Grenoble-INP. Malgré un nième déménagement, des travaux associés et des transitoires parfois
complexes à assurer, le laboratoire a conscience de l'opportunité de ce regroupement, qui lui per-
mettra à la fois d'améliorer son fonctionnement global en favorisant pour chacun la proximité entre
équipes de recherche et services mutualisés. C'est aussi une occasion d'améliorer son identité à la fois
interne (plus grande proximité géographique entre chercheurs . . . ) et externe (1 bâtiment accueillant
1 grand laboratoire Grenoblois en Signaux et Systèmes). Nous resterons très vigilants sur ce dossier
en prenant garde à ce que le gipsa-lab soit accueilli dans des locaux fonctionnels dans la lignée de ce
qui a été fait par les Directions précédentes et actuelle et ce avec un impact
nancier nul ou limité,
le laboratoire ayant déjà largement participé lors des 8 dernières années à l'amélioration des locaux.
8 Axe transversal cerveau
Les activités ayant pour objet d'étude le cerveau sont nombreuses et très diverses dans gipsa-lab.
Elles concernent les équipes MAGIC, PCMD, AGPIG,VIBS, CICS, SAIGA. La mise en place d'un
axe cerveau, dénommé cerveau@gipsa, vise à fédérer et faire émerger des recherches autour du cerveau
dans le laboratoire.
De nombreuses structures travaillant autour du cerveau existent à Grenoble. Le GIN (Grenoble
Institute of Neuroscience) est évidemment la structure phare entièrement dévoué aux neurosciences.
Des applications cliniques sont évidemment développées au CHU mais également dans Clinatec. No-
tons en
n des laboratoires où la cognition est très présente (LPNC). La structure pôle Grenoble
cognition fédère les activités en science cognitive à l'échelle grenobloise.
Une des missions de l'axe cerveau@gipsa sera également de réaliser l'interface entre les acteurs du
laboratoire et les acteurs grenoblois.
Les thèmes scienti
ques au sein de gipsa-lab se groupent assez clairement en quatre points distincts
que l'on peut quali
er par :
1. neuroscience et cognition (plusieurs thèmes autour de l'in
uence des fonctions sensorimotrices
sur la plasticité que ce soit sur la gestion de la parole ou sur les gestes, perception visuelle, . . . )
2. méthodologies pour les signaux et images issus des neurosciences (séparation et localisation de
sources, apprentissage arti
ciel, traitement statistique du signal et des images, modèles gra-
phiques, théorie de l'information)
3. Neurosciences computationnelles (modèles de réseaux de neurones et propagation de l'informa-
tion, in
uence des
uctuations dans les systèmes nonlinéairesneurones et réseaux)
4. Applications en BCI et analyse du neurofeedback
Un point commun important à divers acteurs est l'application clinique, souvent développée par ailleurs
au sein du DHU Grenoblois (épilepsie, troubles neuropsychologiques résistants, vieillissement, . . . )
La structuration d'un axe transversal ne peut se réaliser sans des actions e
caces, mais également
souples. Deux propositions principales d'action ont émergé :
un séminaire annuel commun aux trois départements et concernant le thème transversal. Ce
séminaire pourrait par ailleurs être un séminaire trimestriel partagé avec les autres thèmes
transversaux et permettre de faire venir parler des personalités nationales/européennes.
des réunions récurrentes (mensuelles) courtes durant lesquelles une personne présente un travail,
une idée, un papier, bref, quelques choses liées à ses recherches dans le thème. Ces réunions quise veulent informelles auront vocation à faire connaissance et possiblement créer des liens. Dans
le cadre de ces réunions, nous envisageons également de convier des collègues extérieurs.
Nous sommes conscient que l'ajout de ces réunions dans le planning chargé des acteurs est un
risque. Mais elles formeront le terreau sur lequel des collaborations pourront se développer et
semblent donc essentielles à la réalisation de l'axe.
Les réunions mensuelles ont lieu depuis mars 2014.
Pour que l'axe puisse se développer, outre les actions individuelles, il faut pouvoir disposer de
quelques moyens. Cerveau@gipsa ne revendique pas pour le moment un budget bien dé
ni, mais doit
avoir l'assurance que des moyens seront alloués au
l de l'eau lorsque des demandes justi
ées seront
faites. Ces moyens concerneront quelques missions pour inviter des personnalités extérieures, quelques
nancement de stages de M2R si besoin pour initier des travaux collaboratifs.
9 Axe transversal robotique
L'axe thématique transversal robotique@gipsa se propose de fédérer les multiples recherches me-
nées au gipsa-lab sur le thème robotique . Le dénominateur commun de ces recherches est l'étude
et le développement de systèmes de perception et de compréhension de scènes complexes et des sys-
tèmes de commande pour l'action, que ce soit pour contrôler des robots en milieu naturel (intérieur et
extérieur) ou augmenter/suppléer les capacités sensori-motrices humaines par des artefacts. Les ac-
teurs partagent les mêmes problématiques de modélisation, de boucles dynamiques, d'apprentissage
de comportement, d'implémentations temps-réel et d'expérimentations en situation. L'autre ambi-
tion commune est de confronter ces dispositifs entre eux et à des agents humains, et de les doter
de capacités d'interaction et de comportements sociaux adaptés. L'objectif de politique scienti
que
est de renforcer la visibilité du laboratoire et de l'UGA sur une thématique en plein essor : en ef-
fet, de part l'ensemble des disciplines conviées (traitement des signaux et des images, automatique,
contrôle moteur et biomécanique, cognition individuelle et sociale. . . ), les acteurs sont éclatés dans de
nombreuses équipes et au sein de multiples laboratoires de la place (LIG, LJK, INRIA Montbonnot,
TIMC, GSCOP, etc). Nous essayerons en outre de renforcer nos liens au niveau régional, notam-
ment lyonnais, où le tissu industriel est plus important malgré un nombre plus restreint d'acteurs
académiques.Prospectives des équipes
323
Prospectives des équipes
Sommaire
1 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe AGPIG . . . . . . . . . . . . . . . . 317
1.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
1.2 Prospectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
2 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe CICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
2.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
2.2 Prospectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
3 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe GAMA . . . . . . . . . . . . . . . . 325
3.1 Analysis of strong and weak points of the research team . . . . . . . . . . . . 325
3.2 Prospectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
4 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe MAGIC . . . . . . . . . . . . . . . . 327
4.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
4.2 Prospective / évolution pour le prochain contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
5 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe NeCS . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
5.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
5.2 Prospectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
6 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe PCMD . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
6.1 Une nouvelle aventure scienti
que, entre continuités thématiques et nou-
veaux enjeux scienti
ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
6.2 Deux dé
s scienti
ques majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
6.3 L'identité d'une équipe à travers la multiplicité de ses intérêts . . . . . . . . 336
7 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe SAIGA . . . . . . . . . . . . . . . . 339
7.1 Analyse stratégique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
7.2 Perspectives scienti
ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
8 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe SIGMAPHY . . . . . . . . . . . . . 343
8.1 Axe Signal et Acoustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
8.2 Télédétection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
8.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
9 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe SLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.1 Analyse SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.2 Prospective / évolution pour le prochain contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
10 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe SLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
10.1 Thèmes scienti
ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
10.2 Domaines d'applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
11 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe SysCo . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
11.1 Domaines théoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361324 Prospectives des équipes
11.2 Domaines applicatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
12 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe ViBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe AGPIG 325
1 Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe AGPIG
Responsables : Dominique Attali (DR CNRS) & Michèle Rombaut (PR UJF)
Composition de l'équipe : L'équipe AGPIG comprendra dans le prochain quinquennal 19 perma-
nents : Dominique Attali (DR CNRS, 07), Pascal Bertolino (MCF UPMF, 27), Laurent Bonnaud
(MCF UPMF, 27), Alice Caplier (PR INPG, 61), Jean-Marc Chassery (DR CNRS, 07), Laurent
Condat (CR CNRS, 07), Pierre-Yves Coulon (PR INPG, 61), Vincent Fristot (MCF INPG, 61),
Cédric Gérot (MCF UPMF, 27), José-Ernesto Gomez-Balderas (MCF UJF, 61), Dominique
Houzet (PR INPG, 61), Sylvain Huet (MCF INPG, 61), Patricia Ladret (MCF UJF, 61), Fran-
cis Lazarus (CR CNRS, 06), Annick Montanvert (PR UPMF, 27), Denis Pellerin (PR UJF, 61),
Michèle Rombaut (PR UJF, 61), Isabelle Sivignon (CR CNRS, 07), Kai Wang (CR CNRS, 07).
Modi
cations dans l'équipe : Michel Desvignes (PR INPG) quitte l'équipe AGPIG et rejoint
l'équipe CICS pour s'impliquer dans le traitement de signaux issus de données biomédicales.
Vincent Fristot (MCF INPG) a été élu au conseil municipal de la ville de Grenoble en mars 2014
et exercera ses activités d'enseignant-chercheur à mi-temps. Jean-Marc Chassery (DR CNRS)
a obtenu un éméritat en octobre 2013 et restera dans l'équipe au moins jusqu'au début du
prochain quinquennal.
1.1 Analyse SWOT
Positif Négatif
FAIBLESSES
FORCES
La moitié des permanents a plus de 45 ans et
Équipe de taille importante dont les membres beaucoup de permanents ont de lourdes respon-
Origine interne
couvrent un large spectre scienti
que sabilités
Participation à l'encadrement de formations Pas d'ingénieur alors que l'équipe a une im-
variées plication forte dans le développement de pla-
Equipe structurée en trois thèmes teformes logicielles et matérielles (ARCHI,
MOVE)
Bon équilibre entre recherches théoriques et re-
cherches appliquées Di
culté de recruter des doctorants du fait du
cloisonnement des écoles doctorales.
MENACES
OPPORTUNITES
Course aux indicateurs qui défavorisent les tra-
Origine externe
vaux de longues haleines et/ou présentant un
Collaborations variées aux niveaux local, natio-
risque
nal et international.
Di
culté de recruter de nouveaux enseignants-
Capacité à proposer des projets avec des par-
chercheurs (aucune création de postes)
tenaires académiques et/ou industriels
Complexi
cation croissante des structures et
Attractivité au niveau des candidatures CNRS
accumulation des requêtes morcelant le temps
de travail.
1.2 Prospectives
Depuis le quinquennat précédent, les activités scienti
ques de l'équipe AGPIG sont structurées
autour de 3 thèmes. Pour le prochain quinquennal, nous conserverons ces trois thèmes, à savoir :
Géométrie et Formes (G&F) (correspondant : Cédric Gérot (MCF UPMF)) ;
Perception et Analyse d'Images et de Vidéos (PAVI) (correspondant : Denis Pellerin (PR
UJF)) ;326 Prospectives des équipes
Adéquation Algorithme Architecture (AAA) (correspondant : Dominique Houzet (PR INPG)).
En terme de forces en présence, le thème G&F concerne 5 permanents, le thème PAVI 10 permanents
et le thème AAA 4 permanents. A noter que de nombreux permanents travaillent à l'interface de deux
thèmes et la majorité se retrouvent sur des axes transversaux à ces trois thèmes tels que par exemple
l'e
cacité des mises en ÷uvre, la modélisation, la qualité des objets, la reconstruction d'information
à partir de données partielles. Actuellement, 16 thèses sont en cours dans l'équipe et nous prévoyons
qu'au 1 octobre 2014, 7 nouvelles thèses démarrent, de même qu'au 1 octobre 2013.
1.2.1 Géométrie et Formes
Dans le thème Géométrie et Formes, nous poursuivrons le développement de concepts mathé-
matiques et d'outils algorithmiques pour la manipulation et le traitement des formes géométriques
sur ordinateur. Nous concentrerons nos eorts autour de trois axes décrits ci-après.
Inférence d'informations géométriques et topologiques. Lorsque l'on cherche à représenter et à traiter
des formes géométriques, on se trouve confronté à un problème de discrétisation du monde réel. En
eet, les données dont on dispose résultent souvent d'un échantillonnage des formes et sont partielles,
voire bruitées. Dans ces conditions, comment extraire à partir des données des informations géomé-
triques et topologiques
ables ? Quel sens donner aux quantités calculées en terme de
délité par
rapport aux quantités réelles ? Nous continuerons à étudier ces questions d'inférences d'informations
géométriques et topologiques. En particulier, nous prendrons en compte la complexité croissante des
données. Ces travaux s'inscriront en partie dans le cadre du projet ANR TopData Analyse Topolo-
gique des Données : Méthodes Statistiques et Estimation qui a démarré en octobre 2013.
Structures combinatoires et structures discrètes. Le deuxième axe concerne l'étude de supports com-
binatoires utilisés pour représenter informatiquement les formes. Les complexes simpliciaux, de par
leur nature discrète, sont bien adaptés au calcul sur ordinateur. La géométrie discrète, quant à elle,
utilise directement la grille discrète pour représenter les objets. Ces structures discrètes peuvent être
étudiées pour elles-mêmes ou pour leurs liens avec les formes continues sous-jacentes qui ont motivé et
guidé leur construction. Nous poursuivrons aussi nos travaux autour des changements de représenta-
tion impliquant ces structures combinatoires et discrètes. Dans le cadre d'un projet AGIR (Grenoble
Innovation Recherche, 2014-2017), nous allons en particulier travailler sur la dé
nition et le calcul de
représentations hiérarchiques d'objets par union de boules en intégrant des garanties géométriques et
topologiques. Par ailleurs, nous poursuivrons l'étude des schémas de subdivision, procédés de construc-
tion itérative d'une suite d'objets topologiques discrets convergeant vers un objet continu lisse, et plus
particulièrement leur généralisation à des hiérarchies de maillages ou de grilles irrégulières.
Algorithmes et traitements pour la géométrie et la topologie. Dans le troisième axe, on s'intéressera au
développement de techniques et algorithmes pour réaliser e
cacement un certain nombre de traite-
ments sur les structures discrètes évoquées dans la section précédente. On s'intéressera à l'optimalité
du résultat des traitements considérés en relation avec la complexité algorithmique des algorithmes
proposés. Pour chaque traitement, il s'agira donc :
soit de concevoir des algorithmes optimaux en terme de complexité et de résultat du traitement ;
soit de montrer que le problème est NP-complet, et, le cas échéant, de proposer des algorithmes
de faible complexité algorithmique calculant une approximation garantie du résultat optimal.
Nous travaillerons également sur les hypothèses de modélisation des objets continus permettant des
traitements plus e
caces comme, par exemple, les conditions portant sur une famille de Box-splines
pour l'implémentation en place du schéma de subdivision stationnaire associé.Stratégie et perspectives scienti
ques de l'équipe AGPIG 327
1.2.2 Perception et Analyse d'Images et de Vidéos
Dans le thème PAVI, nous continuerons à développer des méthodes pour traiter, analyser et in-
terpréter les images et les vidéos. Les techniques mises en jeu s'appuieront à la fois sur des outils
mathématiques et des mécanismes inspirés de la vision humaine. Dans un premier temps, nous pré-
sentons les travaux que nous voulons réaliser autour de la restauration des images, de la segmentation
et de la mesure de la qualité. Dans un deuxième temps, nous décrivons des travaux guidés par des ap-
plications mettant en jeu les humains, que cela soit pour l'analyse d'images de visages ou de personnes
ou encore pour le développement de systèmes pouvant interagir avec les humains.
1.2.2.1 Méthodes pour les images et les vidéos
Reconstruction et restauration d'images. Les imageurs modernes fournissent des données de très
grande taille et à la structure complexe (images hyperspectrales, multimodales...). Pour améliorer
la reconstruction et la restauration de telles données, nous continuerons nos travaux basés sur une
modélisation
ne de la structure, à l'aide par exemple d'a priori de parcimonie ou de rang faible.
D'autre part, les problèmes de traitement de données se ramènent souvent à la minimisation de fonc-
tions, qui peuvent être non lisses ou non convexes. Malgré des avancées récentes en optimisation, nous
comptons nous investir dans l'étude, actuellement très peu développée, des vitesses de convergence
des algorithmes proximaux. En
n, le traitement d'images couleurs nécessite d'approfondir la notion
de couleur, tant du point de vue physique que perceptuel. En particulier, nous développerons des
méthodes non linéaires de calibration et de correction de la colorimétrie pour les appareils photos
numériques.
Segmentation d'images. Pour améliorer la segmentation de vidéos, nous chercherons à combiner les
informations provenant d'une image couleur haute résolution et d'une image de profondeur basse
résolution. Parmi les approches possibles, on envisage l'utilisation d'une coupe de graphes adaptée
à ce contexte et la prise en compte de caractéristiques de plus haut niveau (reconstruction d'une
géométrie 2,5D, a priori sur le premier plan constitué de personnes). Une application importante
concerne le cinéma et la prévisualisation d'eets spéciaux incrustés au moment du tournage, avec une
contrainte temps réel forte (projet PREVIZ, thèse de Timothée de Goussencourt). Pour les scènes
d'extérieur, la caméra de profondeur, inutilisable, pourra être remplacée par une caméra à faible
profondeur de champ permettant par une variation rapide de la mise au point et par étude du
ou
associé, d'obtenir également une information de profondeur, au prix d'une fréquence temporelle plus
faible.
Mesures de qualité. Nous continuerons nos travaux sur l'évaluation objective de la qualité perceptuelle
d'objets, que ces objets soient des images stéréoscopiques, des maillages 3D, voire des contenus multi-
média. Concernant la qualité d'images stéréoscopiques, nous chercherons des métriques objectives qui
combinent qualité 2D, réalisme et confort visuel. Concernant les maillages statiques et dynamiques,
nous développerons des métriques objectives de type bottom-up fondées sur les résultats d'expé-
riences psycho-visuelles à mener. Une autre piste de recherche est de développer des métriques de
types avec référence réduite et sans référence en utilisant les descripteurs locaux et globaux de
formes 3D.
1.2.2.2 Systèmes intelligents au service des humains
Captation et interprétation du mouvement de l'humain et de son environnement. Nous continuerons
de développer notre savoir-faire dans l'analyse et la reconnaissance de visages humains et d'expressions
humaines. Nous concentrerons nos eorts autour de trois applications. Tout d'abord, nous chercherons
à mettre au point des techniques d'identi
cation de visages par la biométrie qui soient robustes aux
leurres. En parallèle, nous chercherons à identi
er de façon automatique les expressions faciales qui
témoignent d'un état d'hypovigilance. Une autre application concerne l'évaluation de la qualité d'uneVous pouvez aussi lire