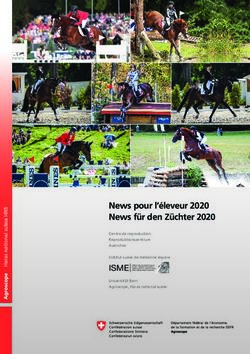HOTSPOT - La mesure de la biodiversité Dialogue entre recherche et pratique Informations du Forum Biodiversité Suisse 28 | 2013 - Sciences ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
HOTSPOT
La mesure de la biodiversité
Dialogue entre recherche et pratique
Informations du Forum Biodiversité Suisse
28 | 2013Auteurs
Matthias Albrecht, écologiste, travaille à titre de Anne-Laure Gourmand élabore des program- Edward Mitchell dirige depuis 2009 le Labora-
collaborateur scientifique dans le groupe Paysage mes scientifiques pour le projet «Vigie-Nature» du toire de biologie du sol de l’Université de Neuchâ-
agricole et biodiversité de la station de recherche Muséum national d’histoire naturelle de Paris et tel et codirige, depuis 2011, le Jardin botanique
Agroscope Reckenholz-Tänikon; il participe au les met en œuvre avec le concours d’acteurs lo- de Neuchâtel. Il s’intéresse notamment à l’écologie
projet européen FP7 QUESSA. Ses travaux portent caux. Elle coordonne l’observatoire STELI, qui suit et à la biodiversité des organismes du sol, et en
principalement sur la biodiversité et les services l’évolution des populations de libellules en France. particulier aux protozoaires.
écosystémiques en milieu agricole et les moyens
Gabriela Hofer, biologiste, travaille à la station Marco Moretti est écologiste et chef de groupe à
de les y promouvoir.
de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon dans l’institut fédéral de recherche WSL de Bellinzona. Il
Ariel Bergamini, est botaniste et dirige le groupe le groupe Paysage agricole et biodiversité. Elle met s’intéresse depuis 10 ans à divers aspects de la
de recherche Dynamique écosystémique à au point des concepts pour représenter la dyna- biodiversité et aux biocénoses ainsi qu’à leur rela-
l’institut fédéral de recherche WSL ainsi que le mique des espèces et des milieux du paysage agri- tion avec les processus et services écosystémiques
projet «Suivi des effets de la protection des bio- cole et la contribution des surfaces de compensa- tout au long de divers gradients environnemen-
topes en Suisse». Par ailleurs, il s’intéresse aux tion écologique à la sauvegarde de la diversité taux, en conditions contrôlées.
questions liées à la biologie de la protection de la spécifique.
Jan Pawlowski dirige le Laboratoire d’évolution
nature chez les plantes à fleurs et les mousses.
Rolf Holderegger est professeur à l’EPF Zurich; il moléculaire des protistes au Département de gé-
Simon Birrer dirige le département Conservation dirige l’unité de recherche Biodiversité et biologie nétique et évolution de l’Université de Genève. Il
des oiseaux à la Station ornithologique suisse de de la protection de la nature à l’institut fédéral de explore la genèse des eucaryotes. Il dirige en outre
Sempach. Ses travaux se concentrent notamment recherche WSL. Il est chargé de la direction admi- le réseau «Swiss Barcode of Life» (SwissBOL).
sur des projets appliqués au domaine de l’agri nistrative du «Suivi des effets de la protection des
Lukas Pfiffner est agro-écologiste et dirige, à
culture et de la forêt. biotopes en Suisse».
l’Institut de recherche en agriculture biologique
Stefan Eggenberg a étudié la botanique systé- Markus Jenny est biologiste et dirige des projets (FiBL), des projets liés à la protection de la biodi-
matique et la phytoécologie. Il a ensuite suivi une agricoles à la Station ornithologique de Sempach, versité et de la nature, la priorité allant à
formation de dessinateur scientifique. Ancien co à l’interface entre recherche, mise en œuvre, mar- l’optimisation écologique et aux interactions trit-
propriétaire de l’atelier pour la protection de la ché et politique. Il préside l’association «Vision rophiques entre arthropodes et animaux vivant
nature et les questions environnementales UNA, à Landwirtschaft», atelier de réflexion réunissant dans le sol, et ce dans différents systèmes de cul-
Berne, il dirige aujourd’hui Info Flora, centre de des experts agronomes indépendants. ture.
données et d’informations sur la flore suisse.
Marc Kéry est spécialiste en écologie des popula- Benedikt Schmidt travaille au Centre de coordi-
Lisa Garnier a obtenu un doctorat en écologie. tions à la Station ornithologique suisse. Ses tra- nation pour la protection des amphibiens et des
Journaliste scientifique, écrivaine et coordinatrice vaux de recherche portent principalement sur la reptiles de Suisse (karch); il est aussi responsable
de projet, elle s’est spécialisée dans la transmission modélisation à grande échelle de la distribution et de groupe de recherche à l’Université de Zurich. Il
d’informations sur la biodiversité à l’attention des effectifs d’espèces d’oiseaux, les modèles de combine ainsi recherche et pratique dans l’objectif
d’un grand public. Elle gère le blog «Vigie-Natu- population et la modélisation de processus d’er de contribuer à une protection de la nature fon-
re» du Muséum national d’histoire naturelle de reur de mesures dans les enquêtes écologiques sur dée sur les faits.
Paris et met au point des expériences scientifiques le terrain.
Eva Spehn est collaboratrice scientifique au Fo-
interactives.
Meinrad Küchler participe au groupe de recher- rum Biodiversité et directrice du réseau internatio-
Christian Ginzler, biologiste, travaille à l’institut che Dynamique des milieux à l’institut fédéral de nal «Global Mountain Biodiversity Assessment»,
fédéral de recherche WSL. Il y dirige l’unité de recherche WSL. L’analyse statistique des données qui gère un portail en ligne de données liées à la
télé
détection et s’intéresse avant tout à l’in ter et la modélisation des changements écologiques biodiversité en montagne (www.mountainbiodi-
prétation des photos aériennes, à la photogram- observés dans divers milieux de Suisse constituent versity.org). Elle est membre de la commission
métrie et à l’analyse d’images, afin de pouvoir la dominante de son activité. GBIF-CH et déléguée GBIF de DIVERSITAS.
mesurer l’évolution du paysage.
Enrique Lara est chercheur à l’Université de Neu Sibylle Stöckli est responsable de projet dans le
Yves Gonseth dirige le Centre suisse de cartogra- châtel et examine les micro-eucaryotes (algues, domaine de la biodiversité, du changement clima-
phie de la faune. Il entretient des contacts avec les champignons, divers organismes unicellulaires). Il tique et des fonctions écosystémiques, en particu-
chercheurs de terrain (le plus souvent entomolo- s’intéresse notamment à leur genèse, leur écolo- lier en entomologie et protection phytosanitaire
gistes), les offices cantonaux et fédéraux liés à la gie, leur répartition géographique et leur gigan- au FiBL.
protection des espèces et des milieux, ainsi que les tesque diversité.
Silvia Stofer dirige le groupe Recensement de la
institutions de l’étranger qui s’intéressent à ces
Lukas Mathys est biologiste et travaille chez Sig- biodiversité au sein de l’unité Biodiversité et biolo-
mêmes thèmes.
maplan en tant que chef de projet. Il a participé à gie de la protection de la nature à l’institut fédéral
divers projets portant sur les aspects techniques et de recherche WSL. Elle est notamment responsa
thématiques liés à la saisie, au dépouillement et à ble de la conservation et de l’entretien de la
la communication d’informations relatives à la banque nationale de données sur les lichens de
biodiversité. Suisse (SwissLichens).
IMPRESSUM Le Forum Biodiversité Suisse encou- en allemand, 1100 ex. en français, 1000 ex. en anglais.
rage l’échange de connaissances entre la recherche, Contact: Forum Biodiversité Suisse, Schwarztorstr. 9, CH–
l’administration, la pratique, la politique et la société. 3007 Berne, tél. +41 (0)31 312 02 75, biodiversity@scnat.
HOTSPOT est l’un des instruments de cet échange. HOT- ch, www.-biodiversity.ch. Directrice: Daniela Pauli. Coût
SPOT paraît deux fois par an en allemand et en français: de production: 15 CHF/exemplaire.
il est disponible au format PDF sur le site www.biodiver- Pour que le savoir sur la biodiversité soit accessible à toutes
sity.ch. HOTSPOT 29|2014 paraîtra en mai 2014 et sera les personnes intéressées, nous souhaitons maintenir la
consacré au thème «Energie et biodiversité» Editeur: © gratuité de HOTSPOT. Mais toute contribution sera bienve-
Forum Biodiversité Suisse, Berne, novembre 2013. Rédac- nue. Compte postal: CP 302040406. Les manuscrits sont
tion: Gregor Klaus (gk), Daniela Pauli (dp). Traduction en soumis à un traitement rédactionnel. Ils ne doivent pas Page de titre (de haut en bas):
français: Henri-Daniel Wibaut, Lausanne. Mise en page: forcément refléter l’opinion de la rédaction. La forme mas- 1. Divers micro-organismes (Photo Edward A. D. Mitchell);
Esther Schreier, Bâle. Photos: les photographies sont ac- culine est utilisée dans le présent document pour faciliter 2. Détermination de la diversité des pommes (Photo Pro-
compagnées de l’indication de leur auteur. Impression: la lecture. Cette disposition ne reflète en rien une discrimi- SpecieRara Bâle); 3. La diversité des papillons archivée
Print Media Works, Schopfheim im Wiesental. Papier: nation basée sur le genre et les termes s’appliquent aussi (Photo Beat Ernst Bâle); 4. Biologistes sur de terrain (Photo
Circle matt 115 g/m2, 100% Recycling. Tirage: 3300 ex. bien au genre féminin qu’au genre masculin. Edi Stöckli)
2 HOTSPOT 28 | 2013Editorial La mesure de la biodiversité
04 Introduction
Le recensement et la surveillance de la biodiversité sont la base de sa conservation,
de sa promotion et de son exploitation durable.
La difficulté de mesurer la biodiversité se
07 Indicateurs de la biodiversité
Qui dit diversité biologique dit diversité des informations. Les indicateurs aident
à simplifier cette diversité, à la quantifier, à la standardiser et à la communiquer.
révéla en 2010, à l’occasion de l’Année
internationale de la biodiversité: il
s’agissait d’évaluer si l’appauvrissement
de la biodiversité avait au moins ralenti. 08 Les principes d’un bon monitoring
Le choix des échantillons et la réduction de l’erreur de mesure revêtent une impor-
tance cruciale.
Pourtant, la recherche de mesures appro-
priées s’avéra extrêmement difficile. Il ne
fut pas possible de réunir un ensemble
satisfaisant d’indicateurs susceptibles
d’être utilisés dans tous les pays. En Sui
10 Info Species
Plus de 15 millions d’observations sont transmises et stockées dans les centres de
données et d’informations floristiques et faunistiques de Suisse.
sse, environ 80 scientifiques rassemb-
12
lèrent, sous l’égide du Forum Biodiversité, Collections de données mondiales
les meilleures données disponibles sur Un gigantesque savoir numérisé et mis en réseau.
l’évolution des populations, la distributi-
on des espèces ainsi que la surface et la
qualité des écosystèmes, dans le cadre
d’un processus indiciel. Il apparut que
14 50 000, 70 000 ou 500 000?
La diversité des espèces est nettement sous-estimée en Suisse.
nous étions en Suisse dans une situation
confortable en comparaison avec d›autres
pays en matière de données sur la biodi- 15 Aspects fonctionnels de la biodiversité
Indicateurs des conséquences des réaffectations du sol.
versité, malgré la présence d’incontes
tables lacunes. Cette situation revient,
d’une part, au mérite des multiples con-
naisseurs qui, le plus souvent à titre hono-
16 Listes rouges
Comment le danger est-il mesuré?
17
rifique, communiquent leurs découvertes Indicateurs agro-environnementaux
aux centres collecteurs de données. Diversité spécifique et écosystémique dans le paysage rural
D’autre part, la Suisse dispose de nomb-
reux programmes de monitoring qui mes-
urent la diversité biologique directement
ou indirectement et permettent ainsi des
18 Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse
Analyses des photos aériennes et relevés sur le terrain, sources de données.
constats fondés sur des statistiques. Ce-
pendant, une certaine gêne subsiste. Ne se
pourrait-il pas que, malgré toutes ces don- 20 «La qualité des données est capitale»
Interview de Sarah Pearson et Jean-Michel Gardaz, de l’Office fédéral de
l’environnement
nées recensées, nous ignorions des déve-
loppements importants en matière de
biodiversité? Mesurons-nous effective-
ment ce qui est important? Il est essentiel
de vérifier les programmes de monitoring
23 Citizen Science
Sensibilisation du public et source d’information pour la recherche
24
à intervalles réguliers et de les compléter Les paysans mesurent la biodiversité
ou perfectionner le cas échéant sur la base Comment constater la compatibilité biodiversitaire d’une exploitation.
des acquis scientifiques. Actuellement,
l’OFEV met au point un système de sur-
veillance intégrale, réunissant l’ensemble
des programmes existants et comblant en Rubriques
même temps les lacunes. La Suisse est sur
la bonne voie… du moins en ce qui con- 25 Forum Biodiversité Suisse
cerne la surveillance de sa biodiversité. Donner accès au savoir
26 Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées CPC
La banque de données nationale donne une vue d’ensemble de la diversité des variétés
Dr. Daniela Pauli
Directrice du Forum Biodiversité 28 La carte de la biodiversité
daniela.pauli@scnat.ch Répartition des botanistes à titre honorifique
HOTSPOT 28 | 2013 3Introduction
Qui vit là?
Gregor Klaus, rédacteur, et Daniela Pauli, directrice du Forum Biodiversité Suisse, daniela.pauli@scnat.ch
Fin 2012, la population suisse comptait à
peu près 8 036 900 habitants, dont 49,4%
étaient des hommes, 35,5% avaient entre
40 et 64 ans et 7,9% étaient divorcés. La
Suisse a quatre langues nationales, mais
une partie des groupes d’immigrés conti-
nuent de parler leur propre langue (9% de
la population). Un quart de la population
vit en montagne, soit sur deux tiers de la
superficie du territoire suisse. Nous
connaissons notre âge moyen, le nombre
d’enfants par foyer, l’âge auquel on se ma-
rie le plus souvent et quel prénom est le
plus répandu. Nous sommes parfaitement
informés en ce qui concerne l’Homo sa-
piens, mais que savons-nous des dizaines
de milliers d’autres espèces de notre pays,
qui nous entourent et constituent notre
environnement? En toute franchise, notre
ignorance à leur sujet est étonnante.
Pourtant, le recensement et la surveillance
de la biodiversité constituent la base de sa
conservation, de sa promotion et de son
exploitation durable. Faute de données et
de faits concernant la situation et l’évolu-
tion de la diversité biologique, il n’y aurait
aucun dépistage possible de nouveaux pro-
blèmes, aucun objectif, aucun besoin d’in-
tervention, ni aucune mesure de protec-
tion. La Stratégie Biodiversité Suisse (SBS), L’homme domine la Terre, mais il n’est pas seul. Sa survie dépend des services rendus par les écosys
adoptée en 2012 par le Conseil fédéral, est tèmes, dont le moteur est la diversité biologique. Pourtant, nous ne savons même pas combien d’espèces
la réponse politique aux mises en garde vivent dans le sol d’une prairie maigre. Photos Beat Ernst, Basel
des scientifiques: pendant des années, les
chercheurs ont souligné sans relâche le
mauvais état et le déclin persistant de la milliards d’individus; la diversité géné- cultivées, le nombre d’espèces présentes
diversité biologique en Suisse en étayant tique à l’intérieur des populations d’une sur une surface donnée, la taille de la po-
leur thèse par des chiffres. même espèce, et entre elles, est d’une ri- pulation, l’aire de distribution d’une es-
chesse déconcertante. Ces espèces vivent pèce, le schéma temporel de la fréquence
Que mesurer? sur non moins de 235 types de milieux, et de la répartition, la composition et les
La Suisse possède toute une série de sys- tels que forêts de chênes pubescents, caractéristiques de biocénoses, la qualité
tèmes de surveillance de longue durée steppes rocheuses alpines, prairies à moli- d’un milieu ou la diversité fonctionnelle
(programmes dits de monitoring) et de sui- nie et communautés à characées, et y (cf. p. 15). En général, on tient compte en
vis de l’impact des mesures de protection constituent des biocénoses complexes. même temps de groupes d’organismes vi-
de la nature, qui recensent la biodiversité Comme il ne sera jamais possible de recen- sibles et faciles à déterminer, tels que les
directement ou indirectement. Ils ont tous ser la totalité de la biodiversité, il faut s’en végétaux et les oiseaux. La grande majori-
en commun de ne mesurer qu’une petite tenir à l’évaluation de son état grâce à la té des espèces discrètes restent discrètes.
partie de la diversité biologique. Ce n’est mesure de certains aspects représentatifs, Mais comme, en cas de détérioration de la
pas étonnant en soi, car la biodiversité est permettant de formuler des énoncés sur qualité d’un écosystème, de nombreux as-
un système extrêmement complexe: notre son évolution. Ces mesures (ou indica- pects différents sont pris en compte, il suf-
seul pays compte – micro-organismes non teurs) sont, par exemple, la diversité géné- fit en général de se concentrer sur certains
compris – au moins 46 000 espèces, repré- tique à l’intérieur des populations et entre groupes d’organismes jouant un rôle d’in-
sentant des millions de populations et des elles, la diversité des variétés de plantes dicateurs.
4 HOTSPOT 28 | 2013Causes, p. ex.
Mesures, p. ex. > Industrialisation
> Promulgation et adaptation de > Mécanisation
lois et d’ordonnances > Evolution démographique
> Mise en œuvre conséquente des > Consommation des ressources Contraintes, p. ex.
bases légales naturelles
> Consommation de surface
> Listes rouges (bilans du degré de > Besoin en surface habitable
> Intensification de l’exploitation
menace) > Exploitation agricole et forestière
> Drainage
> Création de zones protégées > Mobilité
> Imperméabilisation
> Inventaires > Améliorations foncières
> Surfertilisation
> Compensation écologique de > Loisirs et tourisme
> Epandage de pesticides
qualité > Chasse et pêche
> Embroussaillement
> Recolonisations > Changement climatique
> Construction de routes Etat, p. ex.
> Revitalisations > Politique de subvention
> Dérangements > Diminution de la surface et de la
> Renaturations, mises en valeur > Commerce international
> Apport d’azote atmosphérique qualité des habitats
> Mises en réseau et investissements
> Emissions lumineuses > Appauvrissement de la diversité des
> Programmes de conservation > Systèmes de valeurs
> Micropollutions structures et des utilisations
des espèces > Invasions biologiques
> Zones de tranquillité > Abaissement de la densité des
populations
> Passerelles à gibier et corridors
> Disparition de populations
pour petits animaux
> Rétrécissement des aires de distri-
> Mise en valeur de zones de
bution
détente et d’espaces verts
Incidences, p. ex > Déclin de la diversité génétique
> Sauvegarde de races de bétail et
> Dépérissement local, régional ou
de variétés de plantes cultivées > Réduction des services écosysté-
national des espèces
> Recherche et formation miques
> Appauvrissement des biocénoses
> Monitoring > Mise en péril de la santé et du bien-
> Uniformisation de la composition
> Augmentation du budget de être
spécifique des biocénoses
protection de la nature > Abaissement de la qualité du paysage
> Interruption des corridors migra-
> Adaptation de la politique de > Diminution de la résilience des éco-
toires
subventionnement systèmes
> Coopération suprasectorielle > Accroissement du risque d’érosion,
de crue et de chute de pierres
> Diminution de la qualité de l’eau
potable
> Perte d’identification
Par quoi la biodiversité est-elle influencée? Quels changements subit-elle? Comment ces changements se répercutent-ils? Comment l’homme réagit-il à cette évolution? Le
modèle international courant DPSIR («Drivers/causes, Pressures/contraintes, State/état, Impact/incidence, Responses/mesures») permet de sélectionner et de regrouper des champs
d’observation ou des indicateurs potentiels pour des programmes de monitoring.
L’espèce, principale unité de mesure tique s’appauvrit, il faut plutôt parler d’un protégées ou l’apport en azote atmosphé-
La plupart des programmes de monitoring déclin de la biodiversité. Seule l’analyse de rique dans les écosystèmes.
graviteront encore dans un proche avenir divers indicateurs relatifs aux différents
autour de l’espèce, parce qu’elle repré- aspects de la biodiversité permet d’établir Des indicateurs éloquents
sente l’unité la plus facile à mesurer. L’in- un diagnostic de son évolution globale. Les programmes modernes de monitoring
dicateur «nombre d’espèces» est donc sou- La surveillance de l’évolution des espèces déduisent généralement leurs champs
vent mis en avant pour décrire l’évolution repose sur la saisie des variations de leurs d’observation et leurs indicateurs de mo-
de la biodiversité. Il est pourtant loin d’ex- effectifs. Comme il est en général impos- dèles qui représentent les causes de l’ap-
primer la réalité. D’une part, le nombre sible de dénombrer tous les individus pauvrissement, les mises à contribution
des espèces connues ne cesse de croître d’une population, les relevés se fondent des écosystèmes, l’état de la biodiversité,
dans le monde, car de plus en plus de taxi- sur des échantillonnages. Il n’est possible l’impact sur l’être humain et sur l’envi-
nomistes décrivent de nouvelles espèces. d’en dériver des affirmations statistique- ronnement ainsi que les mesures de sauve-
D’autre part, il peut également croître ment étayées que si la sélection des échan- garde et de promotion de la diversité biolo-
dans la mesure où des espèces exogènes tillons est effectuée avec soin et selon des gique (cf. graphique). Les divers indica-
ont été introduites ou que des espèces au- critères scientifiques (cf. p. 8). Bien que ce- teurs permettent d’énoncer des constats
trefois disparues se sont réinstallées. L’ac- la ne permette de mesurer qu’un volet de sur des situations complexes et de rendre
croissement du nombre d’espèces dans un la biodiversité, ces relevés exigent déjà un identifiables et communicables des ten-
pays n’est donc pas forcément une nou- temps considérable et beaucoup de per- dances et des corrélations (cf. p. 7). Ils ne
velle positive; si, en même temps, des po- sonnel, ce qui les rend coûteux. C’est pour- révèlent pas seulement l’évolution géné-
pulations disparaissent chez la plupart des quoi, le plus souvent, on a recours à des rale de la biodiversité, mais aussi les be-
espèces rares et que leurs effectifs dimi- données subsidiaires qui suggèrent indi- soins d’intervention.
nuent, que la quantité et la qualité des ha- rectement l’évolution de la biodiversité, Les suivis, en revanche, renseignent sur la
bitats décroissent et que la diversité géné- comme par exemple la surface des zones mise en œuvre de certaines mesures, l’uti-
HOTSPOT 28 | 2013 Dossier La mesure de la biodiversité 5lisation efficace des moyens mis en œuvre gé, douze ans après son lancement (cf. in- versité. Les partenaires du «Group on
et la réalisation des objectifs. Au contraire terview p. 20). A l’heure actuelle, l’OFEV Earth Observations – Biodiversity Obser-
des programmes de monitoring, ils sont définit un système global de surveillance vation Network» (GEO BON) recherchent
conçus en fonction des projets et ne sont de la biodiversité, qu’il entend mettre en donc un consensus autour de ce qu’ils ap-
poursuivis que jusqu’à l’achèvement des œuvre d’ici 2014. Son objectif consiste à pellent les variables essentielles de la bio-
projets. Dans l’idéal, le suivi complète le assurer la surveillance des écosystèmes, diversité, qui pourraient constituer la base
monitoring. des espèces et de la diversité génétique d’un programme de monitoring plané-
jusqu’en 2020. En réalité, la surveillance taire (Pereira et al. 2013).
Equiper le monitoring de la biodiversité de la biodiversité en Suisse offre encore un Aujourd’hui déjà, des chercheurs ana-
pour l’avenir bon potentiel d’amélioration. Certains in- lysent les données de divers points de vue,
L’ordonnance sur la protection de la na- dicateurs spécifiques font défaut pour des afin de mettre en évidence les tendances
ture et du paysage exige explicitement un aspects importants de la biodiversité. Les et corrélations écologiques mondiales. Ils
monitoring et la mise en réseau avec divers programmes de monitoring font en sont tributaires de la numérisation et de
d’autres programmes (OPN art. 27a): outre parfois double emploi et la saisie des l’accessibilité des données collectées dans
«L’OFEV veille à la surveillance de la diver- données par les centres de données et les le monde (cf. p. 12). Cela permettra égale-
sité biologique et l’harmonise avec les organisations s’avère hétérogène. Globale- ment d’éliminer progressivement des sy-
autres mesures d’observation de l’envi- ment, le manque de coordination se fait nonymes de noms d’espèces jusque-là
ronnement. Les cantons peuvent complé- sentir, y compris au niveau de la commu- ignorés. Ainsi, Costello et al. (2013) sup-
ter cette surveillance.» A l’inverse de la nication. Il en résulte que les messages sur posent que le nombre des espèces détermi-
plupart des pays, il existe en Suisse un la situation de la nation en matière de bio- nées et décrites jusqu’à présent n’est pas
monitoring de la biodiversité (MBD), qui diversité ont paru contradictoires, non de 1,9 million, mais «seulement» de 1,5
fonctionne depuis 2001. seulement pour les profanes. million environ; 20% pourraient être des
Le MBD entretient deux réseaux de me- La fusion des centres de données au sein synonymes ignorés.
sure, constitués de 500 surfaces d’échan- du réseau Info Species constitue une pre- La base de calcul de tous les indicateurs et
tillonnage de 1 km2 réparties sur le terri- mière étape importante vers un système donc de toutes les connaissances acquises
toire suisse, et de 1600 surfaces de 10 m2, de surveillance intégral (cf. p. 10). Et grâce sur l’évolution de la biodiversité, les
destinées à l’observation de la diversité au nouveau Suivi des effets de la protec- causes de changement et le besoin d’inter-
spécifique des paysages et des divers mi- tion des biotopes en Suisse (cf. p. 18) ainsi vention sont des données biologiques d’ex-
lieux. En adoptant ce programme doté de qu’aux nouveaux indicateurs agro-envi- cellente qualité relevées sur le terrain. Il
bases scientifiques, la Suisse a accompli un ronnementaux ALL-EMA (cf. p. 17), deux est d’autant plus regrettable que les don-
travail de pionnier sur le plan internatio- lacunes ont été comblées dans le réseau de nées relevées dans le cadre d’études scien-
nal. Les deux réseaux de mesure peuvent mesure. L’OFEV a mis au point des indica- tifiques servent souvent exclusivement à
mettre en évidence à long terme l’évolu- teurs pour certains services écosysté- des évaluations statistiques. Les données
tion des espèces fréquentes et répandues. miques. De nouvelles méthodes de mesure brutes disparaissent et ne sont plus à la
Les quelque 30 autres indicateurs relatifs à permettent désormais de recenser la diver- disposition des scientifiques et des poli-
l’état, aux influences et aux mesures se sité microbienne (cf. p. 14). Il est ainsi pos- tiques. Il est grand temps qu’un principe
fondent principalement sur d’autres pro- sible d’intégrer d’autres aspects de la bio- soit appliqué par l’ensemble des cher-
grammes de monitoring généralement in- diversité dans le système de surveillance, cheurs en biodiversité: si des données sont
dépendants. Les indications concernant et de répondre ainsi à des questions aux- relevées sur un quelconque aspect de la
les espèces rares, par exemple, pro- quelles personne ne pensait encore lors de biodiversité, elles doivent être impérative-
viennent des listes rouges, disponibles la création du MBD. ment communiquées aux centres de don-
pour 27 groupes d’organismes et se con nées et ainsi rendues accessibles aux scien-
centrent sur ces 36% d’espèces qui Données en réseau tifiques et aux praticiens en vue d’analyses
risquent de disparaître de notre pays. De- Le regroupement des données relatives à ultérieures.
puis 2000, les listes rouges sont établies la biodiversité et la coordination des diffé-
selon les critères de l’Union internationale rents réseaux ne constituent pas seule-
pour la conservation de la nature (UICN), ment en Suisse une mission délicate et im- Bibliographie et liste des principaux pro-
dans le cadre d’un processus pluriannuel, portante. Pour pouvoir formuler des énon- grammes de monitoring de Suisse
assorti de campagnes sur le terrain parfois cés scientifiques valables à l’échelle mon- www.biodiversity.ch > Publications
coûteuses (cf. p. 16). diale, il faut un système d’observation
Dans le cadre de la Stratégie Biodiversité harmonisé, capable de fournir des don-
Suisse, le MBD se verra complété et corri- nées actualisées sur l’évolution de la biodi-
6 HOTSPOT 28 | 2013Indicateurs de la biodiversité:
Quantifier, standardiser, communiquer
Lukas Mathys, Sigmaplan AG, CH-3006 Berne, lukas.mathys@sigmaplan.ch
Les bases d’informations relatives à la
biodiversité et à l’ensemble de ses élé-
ments et de ses interactions sont essen-
tielles à sa conservation et à sa promo-
Indicateur de la biodiversité
tion, mais constituent en même temps un
Communication
défi, car la diversité biologique implique
une diversité des informations. Pour pou-
voir toutefois formuler des énoncés sur
l’état et l’évolution de la biodiversité, il
est nécessaire de réduire cette multipli- Evaluation
cité d’informations. C’est à cela que
servent les indicateurs de la biodiversité.
Les indicateurs de la biodiversité sont des
mesures qui se basent sur des données vé- Données
rifiables et fournissent des informations
globales, scientifiquement fondées (BIP
2011). Cela permet de simplifier les infor-
mations sur la biodiversité, de les quanti-
fier, de les standardiser méthodiquement Au sens large du terme, les indicateurs de la biodiversité se composent de trois éléments qui englobent également la
et de les communiquer de manière com- communication des résultats. Photo Lukas Mathys
préhensible (SBSTTA 2003). Les indicateurs
de la biodiversité se composent, au sens
large du terme, de trois éléments: les don- biodiversité (MBD), par exemple, docu- données devraient fournir une reproduc-
nées, leur évaluation et la communication mente les divers aspects de la biodiversité tion globale et homogène du système bio-
des résultats (cf. illustration). à l’aide d’une série d’indicateurs. Les indi- diversitaire. C’est à cette condition que les
Au sens strict du terme, les indicateurs de cateurs de base contiennent la diversité divers indicateurs qui en sont dérivés
la biodiversité se réfèrent à l’évaluation des espèces et des groupes d’organismes. peuvent être combinés et comparés. La vi-
des données, sur laquelle se fondent les Un certain nombre d’autres institutions et sion du futur consiste donc en une base de
chiffres produits. A cet effet, il faut une programmes produisent en Suisse des in- données cohérente sur la biodiversité, per-
base de données (existante ou à constituer) dicateurs de la biodiversité à titre opéra- mettant de fournir les indicateurs appro-
et les chiffres résultants doivent être com- tionnel, pour fournir des informations priés à différents groupes cibles.
muniqués sous une forme appropriée. pertinentes à leurs groupes cibles. Au plan
Faute de quoi un indicateur ne sera ni ef- international, les trois indicateurs les plus Bibliographie
fectif ni complet. fréquents, établis dans le cadre de la mise www.biodiversity.ch > Publications
L’indicateur unique, intégral et général de en œuvre de la Convention sur la biodiver-
la biodiversité n’existe pas, car des groupes sité (CBD), sont la surface des zones proté-
cibles différents ont des accès différents à gées, la surface de la forêt et des types de
la biodiversité et donc d’autres exigences forêts, ainsi que les espèces invasives
envers l’indicateur. Un indicateur appro- (Bubb et al. 2011).
prié doit par conséquent être compréhen- De nombreux indicateurs de la biodiversi-
sible pour le groupe cible et pertinent té sont destinés aux spécialistes et à l’ad-
(SBSTTA 2003, Feller-Länzlinger 2010). ministration, qui représentent des groupes
L’élaboration d’un indicateur de la biodi- cibles importants. Mais il existe un grand
versité débute donc par l’identification du nombre d’autres groupes cibles, atteints
groupe cible et ses attentes, qui détermi- pour d’autres thèmes d’évaluation et sur-
neront par la suite le mode de communi- tout par d’autres formes de communica-
cation, les méthodes possibles d’évalua- tion. Le défi consiste donc à joindre égale-
tion de l’indicateur et les données requises ment et à impliquer ces groupes cibles à
(BIP 2011). l’aide d’indicateurs appropriés.
Il existe déjà plusieurs indicateurs de la Tandis que l’évaluation et la communica-
biodiversité. En Suisse, le Monitoring de la tion sont axées sur des groupes cibles, les
HOTSPOT 28 | 2013 Dossier La mesure de la biodiversité 7Fondements scientifiques
Principes d’un bon monitoring
Marc Kéry, Station ornithologique suisse, CH-6204 Sempach, marc.kery@vogelwarte.ch; Benedikt R. Schmidt, Centre de coordina
tion pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), CH-2000 Neuchâtel, benedikt.schmidt@unine.ch
Si un monitoring respecte certaines
règles, il permettra de formuler des énon- Sélection des
échantillons
cés fiables sur l’état et l’évolution des Processus
d’observation
effectifs des organismes étudiés. La sélec-
tion scrupuleuse des échantillons et la Population totale N Z
réduction de l’erreur de mesure revêtent
une importance capitale. Echantillon Conclusion
La biodiversité est un concept vaste, qui Conclusion
englobe la diversité naturel des gènes, des
individus, des populations, des espèces,
Fig. 1: Echantillonnage à deux niveaux. N = Effectifs; Z = Recensement
des habitats et des biocénoses. La mesure
de la biodiversité repose en premier lieu
sur le choix des aspects de la biodiversité tillons. Autrement dit, on choisit une par- Exemple
susceptibles d’être déterminés de la ma- tie d’un tout selon certaines règles La mesure de la biodiversité dans un es-
nière la plus profitable, la plus précise et (l’échantillon proprement dit), on l’ana- pace donné doit être envisagée comme un
la moins coûteuse. La population est d’une lyse, on le décrit et on en tire, sur la base processus d’échantillonnage de deux
importance capitale, c’est-à-dire l’en- des lois de la statistique (en l’occurrence étapes (fig. 1). La première étape consiste à
semble des individus d’une espèce dans une extrapolation), une conclusion appli- définir la population totale à propos de la-
une région. La description la plus directe cable à l’ensemble (la population totale). quelle un énoncé doit être formulé: par
de la population est sa taille, également Ce n’est pas simplement souhaitable et exemple, les effectifs de la mésange char-
désignée par les termes d’abondance ou destiné à satisfaire des attentes acadé- bonnière en Suisse. Il faut ensuite définir
d’effectifs, suivie par la distribution et les miques; il s’agit uniquement de garantir une unité d’échantillonnage (carrés de 1
schémas temporels de son abondance et la possibilité de formuler des énoncés km2, p. ex.) et en sélectionner un certain
de sa distribution (tendance). Ces trois fiables au sujet de la biodiversité. nombre, afin d’obtenir un premier échan-
données sont capitales en matière de mo- tillon géographique. Chaque carré pré-
nitoring de la biodiversité (Yoccoz et al. Correction des erreurs de mesure sente une certaine population N, que l’on
2001). Les principes énoncés ici s’ap- Au contraire de nombreux échantillon- peut mesurer dans un second temps, en
pliquent toutefois aussi au nombre d’es- nages (en économie ou en sociologie, p. observant par exemple le nombre de terri-
pèces, autre valeur souvent utilisée par ex.), la confrontation avec des erreurs de toires de mésange (Z). Ce recensement
rapport à la biodiversité. mesure systématiques est pratiquement constitue le deuxième échantillon. L’ob-
inévitable dans le cas des populations servabilité des mésanges est inférieure à
Les lois de la statistique d’ani
maux ou de végétaux; elles sont 100%; par conséquent, Z ≤ N. Il convient
La distribution et les effectifs sont sou- avant tout imputables au fait que des indi- donc de décrire le processus d’observation
vent traités comme des données séparées, vidus ou des espèces ne sont pas vus. La à l’aide de modèles statistiques, pour obte-
mais la distribution n’est qu’une fonction probabilité de découvrir des espèces sur le nir une estimation sans biais de l’état N
de l’abondance, avec une teneur moindre terrain est ainsi généralement inférieure à dans le carré sur la base de la mesure Z. Il
en information: une espèce est présente là 100% (Kéry 2008). Ni la distribution ni sera ensuite possible d’en dériver une esti-
où ses effectifs sont supérieurs à zéro. Si l’abondance ne peut être observée directe- mation de la population nationale des mé-
l’on connaît les effectifs sur chaque site ment sans risque d’erreur. Ce constat tri- sanges charbonnières.
d’une région, on connaîtra la distribution vial, connu sans doute de tout observateur Prenons un exemple de calcul simple et
de l’espèce, mais l’inverse n’est pas vrai. de la nature, n’est pas sans conséquences supposons que nous ayons sélectionné au
En dépit de cette équivalence, il est sou- pour le type d’échantillonnage et l’évalua- hasard 1000 km2 sur les quelque 42 000
vent judicieux, pour des raisons pratiques, tion des échantillons. Si l’on veut mesurer, km2 de la Suisse et que nous y ayons trou-
de considérer séparément les deux don- par comptage, dans la nature, l’abondance vé 8000 territoires de mésanges charbon-
nées, car leurs protocoles de collecte et absolue ou la présence réelle d’une espèce, nières. Admettons en outre que nous
leurs méthodes d’analyse statistique il faut toujours prendre en compte cette ayons omis en moyenne 2 territoires sur
peuvent différer. erreur de mesure systématique dans le 10, c’est-à-dire qu’un territoire n’apparaît
Il est fondamental de savoir que des va- processus d’échantillonnage, pour pou- dans l’échantillon Z qu’avec une probabi-
leurs comme l’abondance et la distribu- voir ensuite l’éliminer sur le plan statis- lité d’observation de 0,8, et que le proces-
tion devraient être mesurées selon les tique. sus d’observation ne comporte aucun
principes d’un relevé statistique d’échan- autre facteur important (doublons, p. ex.).
8 HOTSPOT 28 | 2013Fig. 2: Probabilité d’observation de lézards des murailles et de coronelles lisses (avec
1.0
intervalle de confiance bayésien). Les deux espèces présentent des probabilités
d’observation différentes par visite (environ 0,7 et 0,2). En cas de visites multiples,
on atteint, pour le lézard des murailles, après trois visites, une probabilité cumulée
supérieure à 0,95, de sorte que l’espèce est normalement trouvée si elle est présente. La 0.8
Probabilité d’observation cumulée
coronelle lisse requiert par contre beaucoup plus de visites. Le nombre de visites requis
par site n’est guère chiffrable; le risque est donc grand que l’on n’observe pas l’espèce
bien qu’elle soit présente. Il vaut donc la peine d’employer des méthodes statistiques 0.6
susceptibles d’estimer correctement l’abondance et la distribution.
0.4
0.2
Lézard des murailles
0.0 Coronelle lisse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Coronelle lisse. Photo Thomas Ott, Bubendorf Nombre de visites
L’abondance des mésanges charbonnières la probabilité d’observation n’est pas dances absolues. Si les règles décrites sont
peut ainsi être estimée à ((8000 : 1000) : 0.8) constante, même dans des programme de respectées, un programme de monitoring
3 42 000 = 420 000 territoires. Il importe monitoring fortement standardisés. L’esti- fournira de bonnes informations; cela
également de calculer un intervalle de mation de l’observabilité requiert norma- s’applique aussi aux programmes réalisés
confiance, qui indique la fiabilité de la va- lement plusieurs visites du même site. Un avec des volontaires.
leur estimée. exemple simple pourra l’illustrer: si une
espèce effectivement présente est obser- Conclusion
L’échantillonnage vée lors de la première visite, mais ne l’est Les principes d’un bon monitoring se résu-
La représentation explicite des mesures de pas lors de la seconde, il est permis de dire ment rapidement. D’abord, il faut bien ré-
l’abondance et de la distribution en tant que la probabilité d’observation est de 0,5. fléchir aux questions que le monitoring
que processus d’échantillonnage met en La figure 2 présente des probabilités d’ob- doit élucider. Par exemple, «combien de
évidence que les deux échantillons doivent servation empiriques pour le lézard des mésanges charbonnières y a-t-il en
être effectués selon certaines règles pour murailles et la coronelle lisse; les données Suisse?». Ensuite, il faut décider quelles
que les conclusions puissent être tirées sur ont été collectées dans le cadre de la mise à mesures sont appropriées pour pouvoir
la base des lois de la statistique. Le prin- jour de la Liste rouge des reptiles de 2005. répondre à ces questions. Selon nous,
cipe le plus important de la première Malheureusement, la plupart des pro- l’abondance et la distribution sont des me-
étape est l’échantillonnage aléatoire; c’est grammes de monitoring présentent des sures importantes pour la pratique. Enfin,
la condition requise pour obtenir un carences dans l’une ou l’autre des compo- il faut procéder à une bonne sélection des
échantillonnage représentatif. santes d’échantillonnage décrites. Parmi échantillons et à un protocole de collecte
Le traitement adéquat du processus d’ob- les bons exemples de programmes tenant permettant de réduire le plus possible les
servation suppose également le respect de compte des deux composantes figurent le inévitables erreurs de mesure, que ce soit
quelques règles. Une certaine standardisa- Monitoring de la biodiversité en Suisse sur le terrain ou, par la suite, lors de l’ana-
tion de la mesure est essentielle, par rap- (MBD) (Weber et al. 2004) et le Monitoring lyse des données. Dans le cas d’un échan-
port à l’unité spatiotemporelle d’échan- des oiseaux nicheurs répandus de Suisse tillonnage aléatoire et d’une prise en
tillonnage, les méthodes utilisées et les (Kéry et Schmidt 2008). De même, à l’occa- compte de l’observabilité partielle, le mo-
conditions d’observation, par exemple. sion de la mise à jour de la Liste rouge des nitoring permettra de formuler des énon-
Cependant, des méthodes standard ne suf- amphibiens, les principes énoncés ici ont cés fiables, de sorte que les bonnes déci-
fisent pas pour obtenir des mesures fiables été respectés (cf. p. 16). Dans tous les cas, sions pourront être prises sur le plan de la
de la biodiversité, car l’expérience montre un échantillonnage aléatoire géogra- protection de la nature.
qu’il est impossible d’éliminer totalement phique a été étudié plusieurs fois par sai-
de nombreux facteurs d’influence (diffé- son à l’aide de méthodes permettant
rences dans l’expérience des observateurs d’évaluer la probabilité d’observation et Bibliographie
ou les densités de population, p. ex.) et que donc les aires de distribution et les abon- www.biodiversity.ch > Publications
HOTSPOT 28 | 2013 Dossier La mesure de la biodiversité 9Centres de données
Savoir en réseau
Stefan Eggenberg, Info Flora, c/o Jardin botanique, CH-3013 Berne, stefan.eggenberg@infoflora.ch; Silvia Stofer, SwissLichens – Centre national
de données sur les lichens de Suisse, Institut fédéral de recherche WSL, CH-8903 Birmensdorf; Yves Gonseth, Centre suisse de cartographie de
la faune, CH-2000 Neuchâtel
Les centres de données floristiques et les usagers de la protection de la nature ou Cette vérification des données est plus im-
faunistiques de Suisse se sont regroupés de la recherche. Plus le réseau de couver- portante que jamais. L’agrandissement du
au sein du réseau «Info Species». Plus de ture des données se densifie, plus les don- cercle des observateurs grâce aux nou-
15 millions d’observations sont stockées nées fourniront une idée précise de la di- veaux outils de saisie séduisants est certes
dans leurs banques de données. Des di- versité spécifique d’une région. Le besoin fantastique, mais les centres sont d’autant
rectives communes en matière d’utilisa- en informations sur l’ensemble des plus tenus de bien séparer les informa-
tion des données garantissent une poli- groupes d’organismes ne cesse de croître. tions erronées des observations correctes.
tique ciblée et transparente en la matière. Oiseaux, champignons, chauves-souris, Cela s’avère tout particulièrement diffi-
amphibiens, papillons: tout ce qui est pré- cile, parfois même impossible, en ce qui
Durant les dernières semaines, quelques sent dans un canton, un parc naturel ou concerne l’évaluation de l’indication des
milliers d’observations ont encore été en- un type de milieu inventorié intéresse l’ad- espèces, quand il s’agit d’observations
registrées en provenance du canton de Zu- ministration, la recherche, la direction des d’espèces difficiles à reconnaître, pour les-
rich. Michael Jutzi, d’Info Flora, affiche le parcs ou les bureaux d’études environne- quelles aucun justificatif n’est fourni à
tableau à l’écran et parcourt les données mentales. Les centres de données se sont l’appui. Toutefois, là aussi, les possibilités
d’un œil attentif. «C’est incroyable», dit-il, donc regroupés dans une fédération natio- d’évaluation existent, car les espèces ne
«le nombre de botanistes bénévoles, pro- nale appelée «Info Species» (www.infospe- sont pas partout présentes selon la même
fessionnels ou amateurs, qui utilisent les cies.ch; cf. encadré), afin de se coordonner probabilité. Même les observations impos-
nouveaux outils de saisie en ligne!». Ce mutuellement et de mieux exploiter les sibles ou improbables font l’objet d’une
sont surtout les collaborateurs de l’inven- synergies. Avec Info Species, les centres ré- mention correspondante dans les banques
taire floristique du canton de Zurich qui gissent tous les contrats, élaborent des de données d’Info Species. «Une nouvelle
sont séduits. Ils ont tous un compte chez normes et des directives communes et re- observation dans une région appartient
Info Flora et inscrivent chaque mois les ob- groupent leurs ressources pour améliorer automatiquement aux observations néces-
servations qu’ils ont faites dans leur carré encore les outils de recensement existants. sitant une confirmation», explique Mi-
d’inventaire. En même temps, ils peuvent chael Jutzi. «On vérifie avec précision qui a
voir sur la carte les observations faites par Importance du contrôle de la qualité déclaré l’observation et on contacte en-
d’autres collaborateurs et suivre ainsi en Michael Jutzi, d’Info Flora, a établi entre- suite la personne en question pour lui de-
permanence l’évolution de l’inventaire. temps le tableau des dernières observa- mander des pièces à l’appui.»
Non seulement informative, cette ap- tions de l’inventaire zurichois. Il doit Pour de nombreuses espèces les preuves
proche incite à poursuivre la recherche. maintenant revérifier l’exhaustivité de photographiques constituent un élément
Thomas Wohlgemuth, un des directeurs toutes les données et les préparer en vue important pour le contrôle du nom de l’es-
de l’inventaire, est donc ravi de la coopéra- de leur plausibilisation ultérieure. Le nom pèce. Aujourd’hui, il est possible d’en-
tion avec les centres de données. C’est une du taxon observé, les coordonnées géogra- voyer aux centres de données des photos
situation dont les deux partenaires tirent phiques, la date de l’observation et le nom prises avec le smartphone, parfois même
bénéfice: les organisations qui établissent de l’observateur sont les indications mini- directement sur le site de l’observation.
des inventaires avec l’aide de volontaires males dont les centres ont besoin. De plus, Les centres de données n’enregistrent
et les centres de données, qui peuvent en- l’indication de la précision des coordon- donc plus seulement les données liées à
trer les données dans les banques de don- nées est fondamentale: ont-elles été calcu- l’observation mais aussi de plus en plus
nées. Le nombre de données d’Info Flora lées à l’aide d’un GPS ou estimées sur la souvent les photos y afférentes. Au CSCF
s’est ainsi accru de 60 000 en très peu de base d’une carte? Comment l’observateur (Info Fauna), par exemple, les photos en-
temps, pour atteindre désormais près de évalue-t-il l’imprécision de la mesure? Ces voyées sont immédiatement comparées
quatre millions d’observations. informations auront un rôle capital dans avec l’indication de l’espèce accompa-
l’interprétation des données. «Une brève gnant l’observation; la déclaration fait
Besoin d’information croissant description du site est également essen- ainsi l’objet d’un premier contrôle à l’en-
Dans les centres de données faunistiques tielle», précise Michael Jutzi. «Sinon, nous trée. A vrai dire, pour beaucoup de groupes
et les centres spécialisés dans les crypto- ne pourrons pas comparer ensuite les d’espèces (insectes, mousses, lichens,
games (mousses, lichens, champignons), le coordonnées avec le nom de la commune champignons), les photos ne suffisent sou-
nombre d’observations ne cessent de ou du lieu-dit et vérifier si une faute de vent pas pour pouvoir identifier les es-
croître également. Si l’on additionne les frappe ne s’est pas bêtement glissée dans pèces sans équivoque. En fonction du
observations de l’ensemble des centres de les indications de coordonnées. La localisa- centre de données, d’autres éléments jus-
données, on arrive aujourd’hui à un total tion de l’observation est ainsi contrôlée tificatifs sont nécessaires, par exemple des
de près de 15 millions de données dispo- dans un premier temps; la plausibilisation sonogrammes pour les chauves-souris, les
nibles. Voilà d’excellentes nouvelles pour du taxon suivra dans un second temps». criquets ou les cigales, des photos micro
10 HOTSPOT 28 | 2013Vous pouvez aussi lire