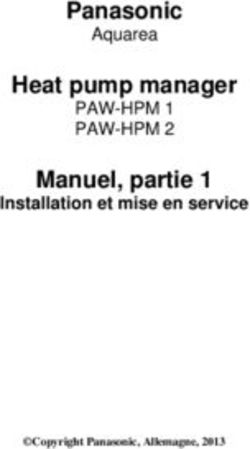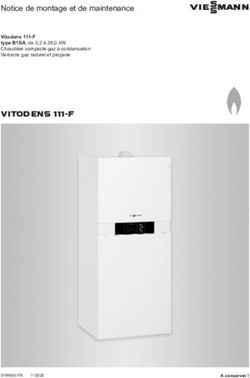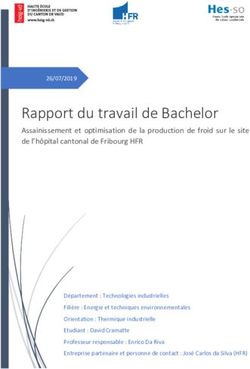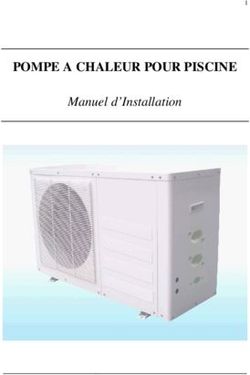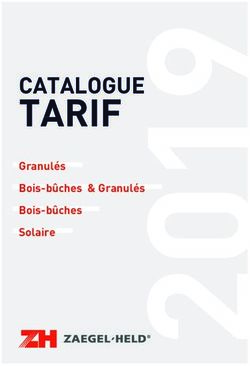La Pompe à Chaleur hybride - Quel avenir en maison individuelle ? - AFPAC
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Quel avenir
1
en maison individuelle ?
La Pompe à Chaleur hybrideL’AFPAC présente :
Les acteurs majeurs
de la filière de la Pompe à Chaleur
LISTE DES MEMBRES au 1er octobre 2016
Industriels/fabricants Contrôle/Certification
AERMEC France EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
ALDES AERAULIQUE Organisme National
ATLANTIC BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE SAS / E.L.M. LEBLANC
Production-Distribution d'Energie
CAREL France
EDF
CARRIER UTC/CIAT ENGIE
CHAFFOTEAUX SAS / ARISTON THERMO GROUP GrDF
DAIKIN
DE DIETRICH
Organisations syndicales
CAPEB/UNA CPC - Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
DELTA DORE
COCHEBAT - Syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage,
DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES SAS rafraîchissement et sanitaires
ELECTRA AIRCONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD FGME - Fédération des Grossistes en Matériel Electrique
FRANCE ENERGIE & Cie FNAS - Fédération nationale des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation
HAIER France et Canalisations
HELIOPAC SER - Syndicat des Energies Renouvelables
HITACHI AIR CONDITIONING Europe SAS SNEFCCA - Syndicat National des Entreprises du froid, d’Equipements de cuisines professionnelles
et du Conditionnement de l’Air
LG Electronics SYNASAV - Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique
MITSUBISHI ELECTRIC Syndicat ACR
NIBE ENERGY SYSTEMS France SAS UECF/FFB - Union des Entreprises de Génie Climatique et Energétique de France
PANASONIC France UNICLIMA - Syndicat des Industries Thermiques, Aérauliques et Frigorifiques
SANDEN International Europe Ltd - SANDEN
Démarche qualité
Environnement Solutions
STIEBEL ELTRON SAS
THERMATIS TECHNOLOGIES / SOFATH
de l’AFPAC
VIESSMANN France SAS
WEISHAUPT France SAS
ZODIAC POOL CARE EUROPE
Certification du matériel NF PAC
Associations
AFCE - Alliance Froid Climatisation Environnement 78 marques au 31/12/2015
AFF - Association Française du Froid 380 gammes (chauffage et chauffage + ECS)
PLATEFORMES
AFPG - Association Française des Professionnels
de la Géothermie
1 963 modèles 67 PÉDAGOGIQUES
AICVF - Association des Ingénieurs en Climatisation, Qualification des installateurs QualiPAC PAC
Ventilation et Froid
Association EQUILIBRE DES ENERGIES
Entreprises qualifiées QualiPAC
PROMOTELEC QualiPAC (chauffage + ECS) : 4 702 20 PLATEFORMES CET
Bureau d’Etudes QualiPAC CET : 205 PLATEFORMES
CARDONNEL INGENIERIE Qualiforage : 68 2 FORAGE
Centres Techniques Formation QualiPAC FORMATEURS AGRÉÉS
CETIAT - Centre Technique des Industries Aérauliques Stagiaires formés en 2015 : 74 PAC ECS
et Thermiques
COSTIC - Centre d’études et de formations génie climatique QualiPAC : 3 448
9 CET
et équipements techniques du bâtiment CET : 492
Qualiforage : 90 2 QUALIFORAGE
Novembre 2016
31 rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél. : +33(0) 1 42 93 52 25 - Fax : +33(0) 1 45 22 33 55
contact@afpac.org - www.afpac.orgCe document a été réalisé en collaboration avec :
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Avec le soutien de :
Les études ont été réalisées par :
3A propos de l’AFPAC
www.afpac.org
Créée en février 2002, l’Association Française pour les Pompes A
Chaleur, association de filière exclusivement dédiée à la PAC, est
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de tous les acteurs
du domaine des pompes à chaleur en France et en Europe, afin de faire
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
valoir l’intérêt énergétique et environnemental des systèmes de production
de chaleur par pompe à chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire), et
la contribution actuelle et future qu’ils apportent au développement des
énergies renouvelables.
En coordination avec ses membres – Energéticiens, Bureaux d’Etudes, Centres
d’Essais, Centres Techniques, de contrôle et certification, Industriels-fabricants,
Distributeurs, Installateurs, Associations, Organisations syndicales -, l’AFPAC suit
et contribue aux travaux réglementaires, de normalisation, de qualification
et de certification, françaises et européennes, sur les pompes à chaleur et
les systèmes les utilisant.
L’AFPAC s’assure à l’échelle européenne de la présence et de la cohérence
de la représentativité des acteurs de la filière PAC en France.
A ce titre l’AFPAC est l’interlocuteur privilégié de l’EHPA.
Par son expertise et sa représentativité, l’AFPAC crée, met en place et
active les conditions nécessaires à la promotion des PAC, à la qualité de
leur mise en œuvre et à la satisfaction de leurs utilisateurs.
5Préface du Président
Est-il nécessaire de rappeler la loi de transition énergétique,
pour laquelle la pompe à chaleur répond aux critères
d’économie d’énergie, d’énergie renouvelable, et d’économie
circulaire. Sans oublier les contributions de la pompe à chaleur
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
aux objectifs ambitieux de la stratégie nationale bas carbone,
qui sont de réduire de 87% les émissions directes de gaz à effet
de serre, à l’horizon 2050, pour les bâtiments.
Dans la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie - PPE publiée
cette fin d'année 2016, les objectifs de chaleur renouvelable
produite par les pompes à chaleur sont de 2 200 ktep en
2018, et sont compris entre 2 800 et 3 200 ktep pour 2023. Le
développement des pompes à chaleur hybrides fait partie des orientations
qui contribueront à l’atteinte de ces objectifs.
Le succès de l’hybridation ne peut résulter de la simple juxtaposition
des technologies ; il faut s’intéresser aux dimensionnements relatifs des
composants du système et à leur intégration en un système homogène régulé
par un pilotage simultané. C’est sous cette condition que les clients pourront
disposer de produits performants et financièrement compétitifs.
Devant la multitude de solutions disponibles, l’AFPAC a souhaité mettre à
disposition des industriels et de la filière, un certain nombre d’analyses et
d’informations qui permettront de guider leurs choix dans le développement
de cette technologie.
Thierry NILLE
Président de l’AFPAC
Association Française
pour les Pompes à Chaleur
7Sommaire
Introduction 11
1. Une pompe à chaleur hybride, c’est quoi ? 13
2. La pompe à chaleur hybride et son environnement 13
2.1. L’Ecodesign et l’Ecolabelling pour l’hybride 13
2.2. La normalisation relative à la PAC hybride 14
2.3. La réglementation thermique des bâtiments neufs RT2012 14
2.4. La certification des PAC hybrides 14
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
3. Marché potentiel pour la pompe à chaleur hybride 15
3.1. La maison individuelle neuve 15
3.2. La rénovation en maison individuelle 15
3.2.1. Avoir un temps de retour sur investissement acceptable 16
3.2.2. Être un élément incontournable de la transition énergétique 16
3.2.3. Faire preuve de flexibilité dans sa régulation 17
3.2.4. Être un facilitateur pour gérer le système électrique à venir 19
3.2.5. Être compatible avec la rénovation d’une maison énergivore 19
3.2.6. Anticiper pour être « connectable compatible » 22
4. Dimensionnement optimal d’une pompe à chaleur hybride 23
4.1. Périmètre de l’étude 24
4.2. Modélisation d’une PAC hybride en maison individuelle 25
4.2.1. Modélisation des bâtiments et usages 25
4.2.1.2. Bâtiment et scénarios d’usage 25
4.2.1.2. Méthode de calcul des besoins horaires 27
4.2.1.3. Synthèse des besoins thermiques des maisons 28
4.2.2. Modélisation des PAC hybrides 29
4.2.2.1. Principe de modélisation 29
4.2.2.2. Modélisation générique des PAC hydrides 29
4.2.2.3. Modélisation spécifique en micro-accumulation 30
4.2.2.4. Modélisation spécifique en accumulation 31
4.2.2.5. Modélisation des régulations «Ep» et «prix» 32
4.2.2.6. Préchauffage ECS par la PAC 32
4.2.3. Indicateurs analysés 33
4.2.3.1. Définition des indicateurs 33
4.2.3.2. Hypothèses économiques 34
4.3. Synthèse pour la maison individuelle existante fioul 35
4.4. Synthèse pour la maison individuelle existante gaz 37
4.5. Synthèse pour la maison individuelle neuve 39
94.6. Analyse de sensibilité et enseignements technologiques 41
4.6.1. Influence de la régulation énergie primaire / prix 41
4.6.2. Intérêt d’une régulation inverter pour les faibles puissances dans le neuf 42
4.6.3. Intérêt de la condensation pour une PAC hybride fioul dans l’existant 43
4.6.4. Intérêt d’une PAC plus performante et sensibilité de ses caractéristiques 44
4.6.5. Influence du niveau de température de la PAC dans l’existant 46
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
4.6.6. Influence du profil de besoin ECS dans le neuf 48
Conclusions 50
Annexe 1 : Résultats pour la MI existante au fioul 53
Annexe 2 : Résultats pour la MI existante au gaz 57
Annexe 3 : Résultats pour la MI neuve au gaz 61
10Introduction
P
our les installations existantes comportant une chaudière à combustible fossile,
depuis plusieurs années, il est tout à fait possible d’intégrer simplement une
pompe à chaleur qui deviendra alors le générateur de chauffage principal. Ce
type d’installation s’est beaucoup développé, avec plus ou moins de bonheur,
dans le début des années 80, pour disparaître ensuite et réapparaitre dans les années 2000.
La chaudière existante devient alors un générateur d’appoint pour les périodes où la pompe
à chaleur ne suffit plus, à elle seule, à couvrir la totalité des besoins de chauffage.
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Concrètement, durant la plus grande partie de l’hiver, la pompe à chaleur fonctionne seule
tant que son rendement est acceptable, c’est-à-dire au-dessus d’un seuil voisin de 0°C
(généralement compris entre -2°C / + 2°C). Lorsque les températures extérieures sont plus
basses, la chaudière fioul vient « l’épauler » en fournissant le complément. Grâce à cette
association des deux modes de chauffage, l’installation est optimale et sûre, quelles que
soient les conditions climatiques.
C’est ce type d’installation que nous connaissions jusqu’à maintenant, improprement
appelée « pompe à chaleur en relève de chaudière ». En effet, la pompe à chaleur assurant
un fonctionnement de base, c’est la chaudière qui vient en relève de la pompe à chaleur.
Depuis peu sont apparus des équipements appelés communément générateurs hybrides.
Cette appellation englobe tous les équipements quelque soit le dimensionnement de la part
thermodynamique.
Ce document est consacré à la pompe à chaleur hybride qui correspond à un générateur
hybride dont la part pompe à chaleur est prépondérante.
La pompe à chaleur hybride qui associe une pompe à chaleur et une chaudière à énergie
fossile, le plus souvent avec un module intérieur compact, est une technologie naissante.
Son innovation, c’est de posséder une régulation unique qui permet d’optimiser le pilotage
des générateurs en fonction de critères économiques ou environnementaux. On peut penser
que les jours les plus froids, c’est l’énergie fossile qui sera privilégiée.
Les hybrides futures intégreront une connectivité Linky. Associées à des tarifs dynamiques,
elles seront un levier de flexibilité simple à mettre en œuvre et sans contrainte pour le
client. Pilotées selon le coût des énergies, les hybrides permettent d’optimiser l’usage des
énergies en fonction de leurs cours respectifs.
Ce document vise à guider les industriels dans des choix technico-économiques pour
consolider ou faire évoluer ces équipements, en particulier vis-à-vis de leur dimensionnement
(puissances PAC et chaudière associée).
La puissance disponible de la PAC qu’il est possible de faire évoluer, avec une incidence sur
le coût d’investissement de la PAC hybride, peut avoir un impact direct sur les performances
énergétiques et environnementales, mais également sur le coût global.
11LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ? 12
1 Une pompe à chaleur hybride
c’est quoi ?
Une PAC hybride est un équipement qui rassemble une PAC et une
chaudière, avec une régulation qui assure le pilotage alterné et/ou
simultané des deux générateurs en fonction de différents critères
mesurés en entrée, en sortie, et/ou en interne au système, pour assurer
les fonctions de chauffage et de production d’ECS en maison individuelle
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
neuve ou existante.
Cette technologie trouve sa place également en tertiaire et en collectif. Ce
document ne concernera que la maison individuelle.
2 La pompe à chaleur hybride
et son environnement
2.1. L’Ecodesign et l’Ecolabelling pour l’hybride
Dans le cadre des directives Ecodesign et Ecolabelling, l’hybride peut être
traitée :
Soit comme une PAC Soit comme un package associant
avec appoint fossile 1PAC + 1 chaudière
132.2. La normalisation relative à la PAC hybride
POUR LA FONCTION CHAUFFAGE :
• L’efficacité saisonnière en chauffage est évaluée selon la norme EN 14825 ;
• L’appoint fossile est pris en compte par calcul en fonction du rendement de la
chaudière ;
• Une nouvelle version est prévue avec la prise en compte de la régulation
intelligente.
POUR LA PRODUCTION D’ECS :
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
• L’efficacité pour la production d’ECS est évaluée selon la norme pr EN 13203-5
avec les cycles de soutirage du règlement Ecoconception.
2.3. La réglementation thermique des bâtiments neufs RT2012
UN 1ER TITRE V EST PARU LE 29/10/2012 POUR LA FONCTION CHAUFFAGE :
• Calé pour fournir 5 kWh EnR ;
• Puissance PAC maxi de 5kW ;
• Bascule sur la température amont extérieure de la PAC ;
• Pas de valorisation de la régulation intelligente.
UN 2ÈME TITRE V EST PARU LE 13/10/2014; IL ABROGE ET REMPLACE LE 1ER EN
INTÉGRANT LA FONCTION ECS.
2.4. La certification des PAC hybrides
Selon le choix du fabricant :
CERTIFICATION NF PAC :
• Référentiel NF414 : PAC ;
• Obligation de démarrage à -15°C ;
• Performance en chauffage pour la PAC selon la norme EN14825 pour la
performance saisonnière ;
• Possibilité de certifier la performance ECS selon la norme EN16147.
CERTIFICATION NF MULTI ÉNERGIES :
• Référentiel NF462 : systèmes multi énergies ;
• Pas de limite de puissance à 5 kW pour la PAC ;
• Pas d’obligation de démarrage à -15°C pour la PAC ;
• Performances en chauffage pour la PAC selon la norme EN14511 pour la
matrice RT2012 ;
• Possibilité de certifier la performance ECS selon la norme pr EN 13203-5.
143 Marché potentiel
de la pompe à chaleur hybride
En maison individuelle, le marché potentiel pour la pompe à chaleur
hybride est le suivant :
• Un flux d’environ 150 000 maisons neuves par an ;
• Un parc de 3,3 millions de chaudières fioul ;
• Un parc de 500 000 chaudières GPL ;
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
• Un parc de 5,8 millions de chaudières gaz.
On peut identifier deux approches différentes en fonction du marché.
3.1. La maison individuelle neuve
Une approche réglementaire pour le neuf qui impose une Cep de 50 kWh/m²
an et 5 kWh/m² an d’EnR.
La pompe à chaleur produit les 5 kWh/m² an d’EnR. La chaudière prend le
relais de la PAC quand elle n’assure plus les besoins, et en majorité produit
l’eau chaude sanitaire.
Les avantages combinés de la pompe à chaleur et de la chaudière font que
l’hybride remplit les exigences réglementaires en assurant le confort.
3.2. La rénovation en maison individuelle
Une approche économique et « vertueuse » pour la rénovation grâce à une
économie sur la facture de chauffage avec un retour sur investissement
raisonnable, une réponse à la transition énergétique, des émissions de CO2
diminuées et une contribution EnR importante.
La pompe à chaleur conduit à une faible dépense en énergie, valorise
les EnR, baisse les émissions de CO2, et assure 60 à 80% des besoins de
chauffage. De son côté, la chaudière prend le relais de la PAC quand le COP
se dégrade.
Les avantages combinés de la pompe à chaleur et de la chaudière font
que l’hybride minimise la facture de chauffage, maximise l’efficacité
énergétique, minimise les émissions de CO2, et minimise la demande
d’électricité aux heures de pointe.
Pour s’imposer, la pompe à chaleur hybride doit relever plusieurs défis.
153.2.1. Avoir un temps de retour sur investissement acceptable
Deux axes sont à travailler :
• Faire baisser l’investissement en travaillant sur le coût du matériel et de
l’installation ;
• Faire baisser le coût d’exploitation annuelle en augmentant la performance de
la PAC hybride.
LE COÛT DES ÉQUIPEMENTS RÉDUIT POUR MINIMISER L’INVESTISSEMENT :
UN DIMENSIONNEMENT CORRECT DE LA PAC
UNE PUISSANCE INFÉRIEURE PAR RAPPORT À UNE PAC SEULE
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
UN PRODUIT COMPACT ET AUTO ADAPTATIF POUR STANDARDISER L’INSTALLATION
INVESTISSEMENT
ÉCONOMIE ANNUELLE
L’ÉCONOMIE D’EXPLOITATION ANNUELLE AUGMENTÉE :
UNE TEMPÉRATURE D’EAU ADAPTÉE À LA LOI D’EAU DE L’INSTALLATION
POUR MAXIMISER LE TAUX DE COUVERTURE DE LA PAC
Si le choix est fait d’investir dans une PAC hybride en remplacement d’une chaudière,
c’est parce que le « module PAC » de la PAC hybride améliore le coût d’exploitation
annuel. Afin de faire progresser ce coût d’exploitation, il paraît logique d’allonger
le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur dans de bonnes conditions.
Ce qui a pour conséquence d’augmenter son taux de couverture par rapport aux
besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
L’étude qui a été réalisée et dont les conclusions figurent dans le document, vise à
orienter les évolutions de la technologie « PAC hybride », afin d’agir sur le coût des
équipements tout en améliorant son taux de couverture.
3.2.2. Être un élément incontournable de la transition énergétique
La pompe à chaleur hybride doit participer :
• A la valorisation et à la contribution EnR ;
• A la réduction de la consommation d’énergie ;
• A la réduction des émissions de CO2.
163.2.3. Faire preuve de flexibilité dans sa régulation
La PAC hybride doit intégrer la possibilité de mettre en service la chaudière
quand les besoins sont supérieurs aux capacités de la pompe à chaleur ;
que ce soit en terme de puissance ou en terme de température.
T°C d’eau
T°C max PAC
T°C radiateurs
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
kW
Besoin de chauffage (kW th)
Puissance thermique PAC (kW th)
Chaudière
Puissance élec PAC
PAC
Température extérieure
La PAC hybride doit intégrer la possibilité de mettre en service la chaudière
et d’arrêter la pompe à chaleur quand le COP de la PAC induit une
consommation d’énergie primaire supérieure à celle de la chaudière.
kWh Ep / kWh Th
Critère de bascule = Conso Energie Primaire
Chaudière
PAC
T°C d’eau
T°C max PAC
T°C radiateurs
kW
Besoin de chauffage (kW th)
Puissance thermique PAC (kW th)
Chaudière
Puissance élec PAC
PAC
Température extérieure
17La PAC hybride doit intégrer la possibilité de mettre en service la chaudière
et d’arrêter la pompe à chaleur quand le COP de la PAC induit un coût du
kWh chaleur supérieur à celui obtenu avec la chaudière.
C / kWh Th
Chaudière
Critère de bascule = Coût de l’énergie
PAC
kWh Ep / kWh Th
Critère de bascule = Conso Energie Primaire
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Chaudière
PAC
T°C d’eau
T°C max PAC
T°C radiateurs
kW
Besoin de chauffage (kW th)
Puissance thermique PAC (kW th)
Chaudière
Puissance élec PAC
PAC
Température extérieure
Avec la règlementation environnementale en cours d’écriture, la PAC
hybride devra intégrer très prochainement un pilotage par le CO2.
183.2.4. Être un facilitateur pour gérer le système électrique à venir
Aujourd’hui, la production d’électricité doit s’adapter aux besoins générés
par les usages. Demain, les usages devront adapter leur consommation pour
participer à l’équilibre du réseau électrique afin de palier à la production
aléatoire d’électricité réalisée par les EnR (photovoltaïque et éolien).
Un effacement possible à tout moment
Une thermosensibilité réduite
15
kW
Puis. élec. (GW)
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
10
Chaudière
5
PAC
0
-5 0 5 10
T. ext. moy 24h (C°)
Température extérieure
Lors de son fonctionnement en » mode pompe à chaleur », la PAC hybride,
sur la demande du gestionnaire de réseau électrique, peut à tout moment
« effacer » la pompe à chaleur. La chaudière à combustible fossile prend
alors le relais (schéma de gauche).
Cet « effacement » se réalise également les jours les plus froids quand les
performances de la pompe à chaleur ne sont plus à un niveau suffisant,
ou quand celle-ci n’arrive plus à subvenir convenablement à l’ensemble
des besoins. Le réseau électrique se trouve alors délesté de puissances qui
contribuent à réduire les pointes de consommations (schéma de droite).
3.2.5. Etre compatible avec la rénovation d’une maison énergivore
Pour obtenir une performance optimale, il est impératif de dimensionner
au plus juste son système de chauffage par rapport aux besoins thermiques
du logement. Pour des raisons financières, la rénovation d’une maison
individuelle se réalise le plus souvent par tranche.
Avec une PAC hybride, si des travaux d’isolation interviennent
ultérieurement, la régulation adapte le fonctionnement de l’équipement
aux nouveaux besoins. Ainsi, l’ordre des travaux est sans impact sur le
résultat final.
Dans un premier temps, la chaudière se met en service quand les besoins
sont supérieurs aux capacités de la pompe à chaleur, que ce soit en terme
de puissance ou en terme de température. La chaudière disposera toujours
de la puissance suffisante pour assurer le chauffage les jours les plus froids.
19Pour les consommations, on identifie ci-dessous les consommations d’énergie fossile (en
rouge) qui se superposent aux kWh produits par la pompe à chaleur (en vert).
kW
Chaudière
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
PAC
Température extérieure
On peut procéder ensuite à une isolation de la maison. Ce qui a pour conséquence de
diminuer les besoins de chauffage en termes de puissance.
Le point de bascule de la pompe à chaleur se trouve décalé vers des températures
extérieures plus basses. La pompe à chaleur augmente son taux de couverture global sans
dégrader sa performance. Ce qui augmente la rentabilité de la PAC hybride.
20On constate les économies d’énergie liées aux travaux d’isolation sur le bâti (partie
haute du 2ème graphique ci-dessous), et également qu’une partie des consommations
d’énergie fossile est remplacée par des kWh de chaleur produits par la pompe à chaleur.
kW
Chaudière
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
PAC
Température extérieure
Lors de travaux d’isolation sur le
bâti, les consommations d’énergie
Conso par tranche de temp. ext. (kWh)
diminuent. De plus, la pompe
à chaleur augmente son taux
de couverture. Les économies
d’énergie se traduisent dans la
diminution des consommations
d’énergie fossile.
Température extérieure (°C)
30
élec. (MWhe)
Consommation moyenne chauffage
EnR (MWhth)
25
fioul (MWhpci)
20 La PAC hybride permet d’anticiper des
travaux sur le bâti sans pour autant
15
altérer les performances du système
T. ext. moy 24h (C°)
10 dans le temps, bien au contraire.
5
0
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
213.2.6. Anticiper pour être « connectable compatible »
Afin de jouer son rôle de flexibilité dans la gestion des réseaux électriques,
de bénéficier des offres tarifaires futures, d’être pilotable à distance pour
répondre au confort demandé tout en optimisant l’énergie consommée,
de bénéficier d’une e-maintenance, la PAC hybride devra très rapidement
être « connectable compatible ».
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
224 Dimensionnement optimal
d’une pompe à chaleur hybride
L’étude présentée dans ce rapport a été menée à la demande de l’AFPAC
par un consortium constitué de CARDONNEL Ingénierie, du CETIAT et du
COSTIC.
Une PAC hybride est un système qui rassemble une PAC et une chaudière,
avec une régulation qui assure le pilotage alterné et/ou simultané des deux
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
générateurs en fonction de différents critères mesurés en entrée, en sortie,
ou/et en interne au système, pour assurer les fonctions de chauffage et de
production d’ECS en maison individuelle neuve ou existante.
Cette étude vise à guider les industriels dans des choix technico-
économiques pour consolider ou faire évoluer ces systèmes, en particulier
vis-à-vis de leur dimensionnement (puissances PAC et chaudière associée).
La puissance disponible de la PAC qu’il est possible de faire évoluer, avec
une incidence sur le coût d’investissement de la PAC hybride, peut avoir
un impact direct sur les performances énergétiques et environnementales,
mais également sur le coût global. Cette étude vise ainsi à quantifier ces
impacts à travers la modélisation des PAC hybrides.
Les modèles développés ont permis de générer une base de données de
près de 5.000 études de cas, pour lesquelles les indicateurs suivants ont
été analysés :
• Part EnR ;
• Taux de couverture de la PAC ;
• Rendement en énergie primaire ;
• Coût annuel d’exploitation ;
• Coût global.
Ces modèles de calculs étant directement inspirés de la RT 2012, ils ne
prennent pas en compte des critères qui influent directement sur les
résultats des calculs. Les aspects liés aux performances réelles des produits,
à leur conception (position de la sonde de température dans le ballon,
position de l’échangeur, …), aux réglages (température de consigne ECS,
hystérésis pour la production ECS, …) font partie de ces critères.
23Cette étude donne des tendances sur les évolutions à prendre en compte
pour les matériels. Afin de confirmer ces tendances, des études de
sensibilité qui intègrent des « valeurs terrains » ont également été menées
en complément, pour simuler :
• Une évolution de la température maxi de l’eau produite par la PAC ;
• Une évolution du COP plus représentative des PAC à vitesse variable du
marché ;
• Un scénario de puisage d’ECS plus représentatif des relevés du terrain.
Ces résultats permettent de comparer des intérêts techniques, économiques
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
et environnementaux vis à vis des caractéristiques techniques propres aux
PAC hybrides (que sont par exemple la puissance de la PAC, le type de PAC,
le COP nominal, etc...).
Cette étude ne traite donc pas de l’intérêt technico-économique d’une PAC
hybride vis-à-vis d’autres solutions techniques.
4.1. Périmètre de l’étude
L’étude porte sur l’analyse des paramètres de dimensionnement d’une
PAC hybride pour la maison individuelle (MI), associant une PAC air/eau
et une chaudière, pour trois configurations spécifiques :
• MI neuve à énergie gaz et fioul ;
• MI existante à énergie gaz ;
• MI existante à énergie fioul.
Les niveaux de bâti des MI neuves et existantes ont été basés sur des
niveaux réglementaires, à savoir :
• MI existante : construction type RT 1974 et RT1988 ;
• MI neuve : construction type RT2012 et RT2012-20%.
La définition des PAC hybrides est basée sur :
• Le niveau de température maxi de la PAC (PAC basse température ou
haute température) ;
• Les puissances de PAC (2/4/6/8/10/15 kW) et de chaudière (15/25/30
kW) ;
• Le type d’émetteurs de chauffage (plancher chauffant ou radiateurs
basse température, moyenne température et haute température) ;
• Le type de production ECS (micro-accumulée et accumulée 200 l) ;
• Le mode de régulation (énergie primaire ou prix).
Enfin, l’analyse a été menée pour trois zones climatiques :
• H1b (Nancy) ;
• H2b (La Rochelle) ;
• H3 (Nice).
244.2. Modélisation d’une PAC hybride en maison individuelle
Les différentes hypothèses retenues dans le cadre de cette étude ont été
établies par une concertation préalable au sein d’un Groupe de Travail et
formulées à travers un cahier des charges.
Cette partie présente les principales hypothèses de ce cahier des charges,
complétées par les solutions mises en œuvre par le consortium en termes
de :
• Modélisation bâtiment (Cardonnel Ingénierie) ;
• Modélisation des PAC hybrides (COSTIC).
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Les modèles de bâtiment et PAC hybrides utilisées ont été confrontés à
des modèles « détaillés ». Cette confrontation a été réalisée par le CETIAT.
Les résultats de cette confrontation ont permis de confirmer les ordres de
grandeurs obtenus avec les modèles présentés dans cette partie.
4.2.1. Modélisation des bâtiments et usages
4.2.1.1. Bâtiment et scénarios d’usage
COEFFICIENTS DE DÉPERDITIONS
Pour répondre aux valeurs cibles de déperditions définies dans le cahier
des charges de l’étude, quatre types de maison individuelle ont été
étudiés. Voici ci-dessous un récapitulatif des coefficients de déperditions
(GV) obtenus :
Année RT GV obtenus (W/K)
Habitat existant 1974 : Niveau 1 386
1988 : Niveau 2 212
Habitat neuf 2012 : Niveau 3 149
2012 – 20% : Niveau 4 108
A partir des coefficients de déperditions précédents, il est possible de
déterminer les déperditions à la température extérieure de base des
différentes maisons avec une température intérieure de chauffage de
19°C :
Déperditions à la T° Zone climatique Zone climatique Zone climatique
extérieure de base (W) H1b H2b H3
Niveau 1 13132 9270 9656
Niveau 2 7211 5090 5303
Niveau 3 5084 3589 3739
Niveau 4 3688 2603 2712
25Avec les températures extérieures de base suivantes :
Zone climatique Zone climatique Zone climatique
H1b H2b H3
Température extérieure -15 -5 -6
de base (°C)
APPORTS GRATUITS
Les apports gratuits se décomposent en deux contributions que sont les
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
apports internes et les apports solaires.
Pour les apports internes, des hypothèses simplificatrices ont été prises
en compte :
• Une contribution constante de 40 W pour les équipements ;
• Une contribution de 90 W/personne ;
• 1 personne présente dans le bâtiment entre 9h inclus et 16h inclus les
jours de semaine ;
• 4 personnes présentes dans le bâtiment le reste du temps (jours de la
semaine et week-end).
Pour les apports solaires, ils sont calculés grâce :
• A la surface vitrée équivalente correspondant au produit d’un facteur
solaire moyen et de la surface vitrée du bâtiment pour chaque
orientation ;
• Au rayonnement solaire (W/m²), calculé lui-même pour chaque
orientation et pour une inclinaison verticale.
La méthode utilisée pour les différents calculs est la méthode de calcul de
la réglementation thermique 2012.
SCÉNARIO DE CHAUFFAGE ET DE CONSOMMATION D’EAU CHAUDE
SANITAIRE (ECS)
La période de chauffage est définie du 15 septembre inclus au 15 avril
inclus (saison hivernale). Pour la température de consigne de chauffage,
elle est de :
• 21°C entre 6h inclus et 22h inclus tous les jours de l’année ;
• 18°C entre 23h inclus et 5h inclus tous les jours de l’année.
Pour les besoins d’ECS, le profil de puisage L de la norme NF EN 16147 est
appliqué.
264.2.1.2. Méthode de calcul des besoins horaires
La méthode de calcul horaire présentée ci-après permet d’obtenir les
besoins horaires en ECS et en chauffage ainsi que les températures aller
et retour du réseau de chauffage qui seront par la suite utilisés pour les
études de cas.
CALCUL DES BESOINS DE CHAUFFAGE
Par application de la méthode ABC, la température de l’ambiance sans
apport de chauffage est calculée, en prenant en compte uniquement
l’inertie du bâtiment et les apports gratuits.
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
A partir de cette température d’ambiance, la puissance à apporter pour
amener cette température à la température de consigne du moment est
calculée, et cela en fonction du scénario de chauffage.
Cette puissance est par la suite limitée à la puissance maximale définie à
partir du coefficient de déperditions et des températures extérieure et de
consigne de base.
Et enfin, cette puissance est utilisée pour calculer la température finale de
l’ambiance suite aux apports de chauffage.
Cette température finale est utilisée comme température initiale de
l’ambiance au pas de temps suivant.
MODÉLISATION DE L’ÉMETTEUR
En fonction de la typologie d’émetteur (radiateur haute/moyenne/basse
température et plancher chauffant), les différents paramètres tels que le
coefficient d’émission de chauffage, la différence de température émetteur-
ambiance nominale et la température de départ maximal du réseau de
chauffage sont définis. En voici un récapitulatif :
Emetteur Plancher Radiateurs BT Radiateurs MT Radiateurs HT
coef n (-) 1,00 1,25 1,25 1,25
ΔTnom (K) 10 20 30 35
θdépart base (°C) 35 45 55 65
Grâce aux données précédentes, le débit nominal, la chute nominale de
température ainsi que les températures de départ et retour du réseau de
chauffage sont calculés en fonction du besoin de chauffage.
27Les hypothèses suivantes ont également été prises en compte en accord
avec la norme « NF EN 12831 Systèmes de chauffage dans les bâtiments -
Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base » :
• Pas de coefficient de surpuissance ;
• Température de consigne de base de 19°C ;
• Température extérieure de base de -15°C en zone climatique H1b, -5°C
en zone climatique H2b et -6°C en zone climatique H3.
CALCUL DES BESOINS D’ECS
Etant donné que les besoins d’ECS doivent être décrits sur un pas de temps
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
horaire et doivent dépendre de la température d’eau froide, propre à la
zone climatique, les besoins d’énergie du profil L ont été sommés pour
chaque heure de la journée puis convertis en volume d’ECS à 40°C avec
une température d’eau froide de 10°C.
A partir du volume d’ECS à 40°C à chaque pas de temps de la journée et
de la température d’eau froide horaire, les besoins d’ECS horaires sont
déduits. Le profil est identique tous les jours de l’année d’étude.
4.2.1.3. Synthèse des besoins thermiques des maisons
Des récapitulatifs des besoins de chauffage et d’ECS obtenus pour les
différentes MI en fonction de la zone climatique sont présentés ci-dessous.
Besoin chauffage Zone climatique Zone climatique Zone climatique
(kWh/an) H1b H2b H3
Niveau 1 23883 18838 14016
Niveau 2 11976 9281 6844
Niveau 3 7497 5622 4134
Niveau 4 4972 3670 2661
Besoin ECS Zone climatique Zone climatique Zone climatique
(kWh/an) H1b H2b H3
Profil L 4000 3562 3218
Les besoins ECS présentés ci-dessus correspondent aux besoins de puisage
d’ECS. Ceux-ci peuvent être plus importants si la génération comprend un
ballon de stockage d’ECS du fait des pertes thermiques de celui-ci.
284.2.2. Modélisation des PAC hybrides
4.2.2.1. Principe de modélisation
Les entrées principales du modèle PAC hybride sont les suivantes :
• Besoin horaire ECS (en Wh) et durée de puisage (en minute),
température de consigne ECS (en °C), température d’eau froide (en °C) ;
• Besoin horaire de chauffage (en Wh), températures moyennes horaires
du réseau d’émetteurs de chauffage (départ et retour) (en °C).
Les différents paramètres et entrées complémentaires sont présentés dans
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
les différentes parties du document.
Températures'
émetteurs o Coûts'exploitation
Modèle'de' Indicateurs'de' o Part'EnR
PAC'hybride performance o Rendement'ep
Besoins' o Taux'de'couverture'de'la'PAC
chauffage'et'ECS
4.2.2.2. Modélisation générique des PAC hydrides
Le modèle utilisé pour la PAC air/eau est celui de la méthode de calcul de
la réglementation thermique 2012. Ce modèle intègre :
• Les performances (puissance calorifique et COP) de la PAC à pleine
charge selon différentes conditions de fonctionnement (température
d’eau et température extérieure), sous une forme matricielle ;
• Les performances à charge partielle de la PAC ;
• La puissance de veille lorsqu’il n’y a aucun besoin.
Les matrices de performances à pleine charge sont établies à partir des
coefficients Cnn par défaut de la réglementation thermique 2012, à partir
de la caractérisation du point pivot. Les caractéristiques de charge partielle
sont celles définies par défaut dans la RT2012.
Le COP pivot est fixé :
• Pour une PAC BT (basse température) : à 4 au point 7°C (air) / 35°C (eau) ;
• Pour une PAC HT (haute température) : à 2,5 au point 7°C (air) / 55°C
(eau).
29Les propriétés suivantes sont utilisées :
Pour une PAC BT :
• Température de départ eau maxi : Tdmax PAC = 50°C
• Différence de température sur l’eau : Δ TPAC = 5k
Pour une PAC HT :
• Température de départ eau maxi : Tdmax PAC = 65°C
• Différence de température sur l’eau : Δ TPAC = 8k
Le modèle utilisé pour la chaudière est celui de la méthode de calcul de
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
la réglementation thermique 2012. Ce modèle intègre :
• Les propriétés de la chaudière à pleine charge selon la température
d’eau ;
• Les propriétés à charge partielle de la chaudière ;
• La puissance électrique des auxiliaires ;
• Les pertes à l’arrêt.
Dans le cas d’une chaudière fioul, celle-ci est de type basse température.
4.2.2.3. Modélisation spécifique en micro-accumulation
Les principales caractéristiques de la production à micro accumulation
sont les suivantes :
• Assemblage hydraulique du système : PAC et chaudière en parallèle ;
• Fonctionnement du système : production chauffage et ECS simultanée
possible (dans ce cas la PAC fonctionne en mode chauffage) ;
• Production chauffage : Td PAC = Td chaudière = Td émetteurs ;
• Production ECS : Uniquement par la chaudière.
Ballon ECS
micro-accumulation Chaudière
Brûleur Deux cas de figures se présentent pour définir la
Pompe à chaleur
température de sortie de la PAC :
• Td > TdmaxPac
la température de départ nécessaire est supérieure
à la température maximale de la PAC : la PAC est à
l’arrêt.
départ • Td ≤ TdmaxPac
chauffage
la température de départ nécessaire est inférieure
ou égale à la température maximale de la PAC. En
Retour
chauffage
fonction de la température de départ nécessaire, la
régulation EP/coût permet de déterminer le mode
de fonctionnement.
Sortie ECS Arrivée
eau froide
304.2.2.4. Modélisation spécifique en accumulation
Les principales caractéristiques de la production à accumulation sont les suivantes :
• Assemblage hydraulique du système : PAC et chaudière en série ;
• Fonctionnement du système : alterné en chauffage / ECS.
Le modèle utilisé pour le ballon est celui de la méthode de calcul de la réglementation
thermique 2012. Ce modèle repose sur :
Pompe à chaleur • Une discrétisation du volume sur 4 couches de
volume identique ;
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Chaudière • Un processus itératif au cours d’un même pas de
temps ;
• Un modèle physique de type « piston » ;
Brûleur • Un modèle de pertes thermiques ;
• Un modèle d’échangeur afin de déterminer la
température amont du générateur.
De plus les hypothèses suivantes sont utilisées :
• L’échangeur est situé dans la moitié inférieure
du volume du ballon ;
Sortie • Un différentiel de 5 K est utilisé pour définir
ECS l’enclenchement de la charge du ballon ;
• La sonde de température est située à
mi-hauteur du ballon ;
• Un temps de recharge du ballon est fixé à 45
minutes pour permettre d’assurer pendant
la période restante (15 minutes) la fourniture
de chaleur pour le chauffage. Si la puissance de
chauffage nécessaire ne peut pas être couverte
Départ Arrivée Retour
chauffage eau froide chauffage
dans les 15 minutes restantes, la puissance est
reportée au pas de temps suivant.
La PAC étant en amont de la chaudière, il est nécessaire
de déterminer la température de consigne de la PAC. Quel que soit le mode de
production (chauffage/ECS), la température de consigne de la PAC est fixée en
considérant deux cas de figures :
• Td > TdmaxPac : la température de départ nécessaire est supérieure à la
température maximale de la PAC.
• Td ≤ TdmaxPac : la température de départ nécessaire est inférieure ou égale à la
température maximale de la PAC.
314.2.2.5. Modélisation des régulations «Ep» et «prix»
Le critère de choix pour le fonctionnement de la PAC ou de la chaudière
repose sur un COP « de bascule » en-dessous duquel la pompe à chaleur
n’est pas autorisée à fonctionner et s’applique à chaque pas de temps
horaire.
Deux modes de régulation ont été modélisés :
Energie primaire consommée : en considérant le coefficient de
transformation de l’énergie primaire en énergie finale de 2,58 pour
l’électricité et de 1 pour le combustible gaz ou fioul. Tant que le COP de la
pompe à chaleur est supérieur à 2,58 multiplié par le rendement sur PCI1de
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
la chaudière, il est plus intéressant de la faire fonctionner. En dessous, la
pompe à chaleur est arrêtée au profit de la chaudière ;
COP «de bascule» = 2,58 x (Rendement sur PCI de la chaudière)
Coût de l’énergie : les prix du kWh de gaz ou de fioul et du kWh électrique
doivent alors être paramétrés. La détermination du point d’arrêt de la
pompe à chaleur se calcule en comparant le prix du kWh électrique au
prix du kWh de l’énergie utilisée par la chaudière. La pompe à chaleur
fonctionne tant que son COP est supérieur au COP « de bascule », défini
par la formule suivante :
Coût kWh électrique
COP «de bascule» = x (Rendement
Coût kWh gaz ou fioul de la chaudière)
Dans la formule ci-dessus, le rendement considéré doit être cohérent
avec le coût du kWh utilisé.
Un coût unique pour l’électricité est utilisé, il correspond au tarif sans
heures creuses.
4.2.2.6. Préchauffage ECS par la PAC
Dans le cadre de la modélisation, l’utilisation de la chaudière de 30 kW
n’autorise pas la production ECS par la PAC.
1
Pouvoir Calorifique inférieur
324.2.3. Indicateurs analysés
4.2.3.1. Définition des indicateurs
Les définitions des indicateurs analysés sont les suivantes :
Part EnR (kWhef) :
EPAC
Part EnR = Celec PAC ( -1)
Celec PAC
Avec
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
Celec PAC Consommation électrique annuelle de la PAC en énergie finale (kWhef/an)
EPAC Énergie thermique fournie par la PAC (kWh/an).
Taux de couverture de la PAC (%) :
EPAC
Taux couverture PAC =
Cth chauffage + Cth ECS
Avec
Cth chauffage Besoin thermique annuel de chauffage (kWh/an)
Cth ECS Besoin thermique annuel d’ECS (kWh/an)
Rendement en énergie primaire sur PCI (%) :
Cth chauffage + Cth ECS
ep
=
Cfioul/gaz (PCI) + 2.58 (Celec PAC + Celec chaudière )
Avec
Cfioul/gaz (PCI) Consommation annuelle de combustible (fioul ou gaz)
sur PCI (kWh(PCI)/an),
Celec chaudière Consommation électrique annuelle de la chaudière (kWh/an).
Coût d’exploitation annuel (€/an) :
Coût d’exploitation = Cfioul/gaz (PCI) prix fioul/gaz (PCI) + (Celec PAC + Celec chaudière ) prix électricité
Avec
prix fioul/gaz (PCI) Prix du combustible (fioul ou gaz) sur PCI (€/kWhPCI)
prixélectricité Prix de l’électricité (€/kWh)
Coût global sur 15 ans (€) :
Coût global = 15 x Coût d’exploitation + Coût PAC hybride
Avec
Coût PAC hybride Coût de la PAC hybride (€)
334.2.3.2. Hypothèses économiques
Les hypothèses économiques utilisées ne sont représentatives que d’une
situation à un instant «t». Les résultats économiques obtenus dans le cadre
de cette étude peuvent donc être sujets à une évolution en fonction des
variations des différents coûts : énergies et matériels.
Les prix des énergies sont à coût fixe (hors abonnement) :
• Electricité : 14,4 c€/kWh ;
• Gaz : 5,35 c€/kWhPCI ;
• Fioul : 7 c€/kwhPCI.
LA POMPE À CHALEUR HYBRIDE : QUEL AVENIR EN MAISON INDIVIDUELLE ?
La prise en compte de l’abonnement a une influence négligeable compte
tenu des objectifs de l’étude, en particulier, vis-à-vis des optima de coûts
globaux obtenus.
Un modèle de prix de PAC hybride a été fourni par l’AFPAC. Celui est
présenté à la figure suivante pour une chaudière de 25 kW en production
micro-accumulée gaz et accumulée pour le fioul. En production accumulée
gaz, 1 000 € sont à ajouter.
Coût d’investissement en € HT
CHAUDIERE 25 kW - PAC Basse Température (HT : +500€)
12000
11000
10000
Coût en € HT
9000
8000
7000 Gaz u accumulation
Gaz ECS accumulée
6000
Fioul ECS accumulée
5000
4000
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Puissance PAC (kW)
Pour les autres puissances de chaudières et les PAC HT, le coût est ajusté
selon les règles suivantes :
• 15 kW : - 150 € ;
• 30 kW : + 250 €.
• PAC HT : + 500 €.
34Vous pouvez aussi lire