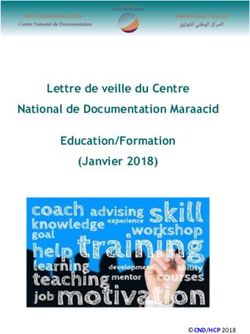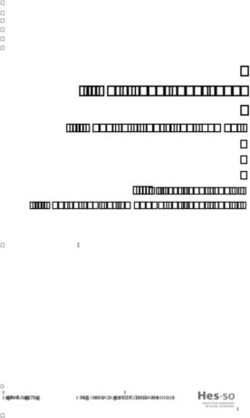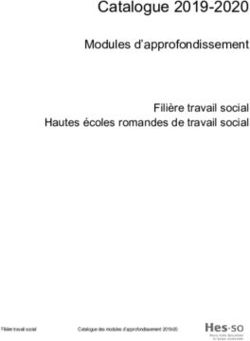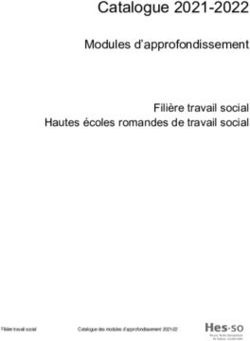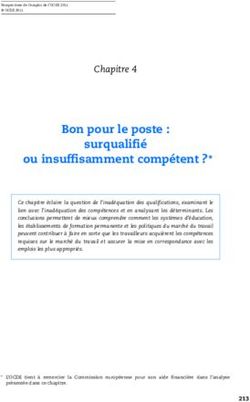MASTER 2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION PARCOURS PROFESSIONNALITÉ & SAVOIRS DANS LES MÉTIERS DE LA RELATION - UFR HSS
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
UFR HSS UNIVERSITE
HUMANITES CAEN
& SCIENCES SOCIALES NORMANDIE
MASTER 2
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
PARCOURS
PROFESSIONNALITÉ
& SAVOIRS DANS LES
MÉTIERS DE LA RELATION
GUIDE DES ÉTUDES
2019 – 2020
WWW . UNICAEN . FR / UFRHSSUNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
UFR HUMANITÉS ET SCIENCES SOCIALES
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5427-master-sciences-de-l-education-
parcours-professionnalite-et-savoirs-dans-les-metiers-de-la-relation?s=&r=
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/master/master-sciences-de-l-education/
3 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS LE MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION ..7
PRÉSENTATION DU MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION......................................................................................................................9
PROFESSIONNALITÉ ET SAVOIRS DANS LES MÉTIERS DE LA RELATION ...................................................................................................9
QUELLES SCIENCES ? .........................................................................................................................................................................................9
LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION POUR QUOI FAIRE ? ............................................................................................................................. 10
LES DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS PAR LE MASTER 1 et 2 ........................................................................................................ 10
STRUCTURE DU MASTER 2 ................................................................................................................................................................................ 12
ORGANISATION DE LA FORMATION ........................................................................................................................................................... 12
INFORMATIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................................................ 13
PRÉSENTATION DES DIRECTEURS DE MÉMOIRE, DE LEURS COMPÉTENCES ET CHAMP(S) DE RECHERCHE ................................. 15
MASTER 2 ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 3............................................................................................................................................... 19
UE1 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3) ..................................................................................................................... 20
UE2 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3) ..................................................................................................................... 22
UE3 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3) ..................................................................................................................... 25
UE4 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3) ..................................................................................................................... 27
MASTER 2 ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4............................................................................................................................................... 29
UE5 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 4) ..................................................................................................................... 30
UE6 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 4) ..................................................................................................................... 31
UE7 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 4) ..................................................................................................................... 33
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES - MCC ......................................................................................................................... 34
EMPLOI DU TEMPS.............................................................................................................................................................................................. 36
INFORMATIONS ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ................................................................................................................................. 37
LE DÉLIT DE PLAGIAT......................................................................................................................................................................................... 39
RÈGLEMENT DES ÉTUDES - MASTER ............................................................................................................................................................... 40
RÈGLEMENT DES DISPENSES D’ASSIDUITÉ ET DE CONTRÔLE CONTINU (UFR HSS) ........................................................................... 46
CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020................................................................................................................................ 48
LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ........................................................................................................................................................... 49
DÉPÔT UNIVERSITAIRE DES MÉMOIRES APRÈS SOUTENANCE - DUMAS ............................................................................................... 51
LE CLES .................................................................................................................................................................................................................. 52
PIX – NOUVELLE CERTIFICATION AUX COMPÉTENCES NUMÉRIQUES .................................................................................................... 53
INFORMATIONS UTILES ................................................................................................................................................................................... 54
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ............................................................................................................................................................................ 55
RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT ........................................................................................................................... 56
ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE – EOI ............................................................................................................................ 57
5 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
LISTE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS
INTERVENANT DANS LE MASTER SCIENCES DE L’ÉDUCATION
CONTACTS UNIVERSITAIRES
Nom Fonction Bureau Téléphone Mail
Professeur des
BÉZIAT Jacques DRS 30 jacques.beziat@unicaen.fr
Universités
Maître de
BOUDESSEUL Gérard SH 213 02 31 56 65 98 gerard.boudesseul@unicaen.fr
Conférences
DELALANDE Julie Professeur des
DRS 32 02 31 56 54 87 julie.delalande@unicaen.fr
(Co-Responsable M1 et M2) Universités
DUPONT Nathalie Maître de
DRS 31 02 31 56 63 82 nathalie.dupont01@unicaen.fr
(Responsable L3) Conférences
Maître de
FILISETTI Laurence DRS34 laurence.filisetti@unicaen.fr
Conférences
Professeur des
HARLÉ Isabelle isabelle.harle@unicaen.fr
Universités
HATANO-CHALVIDAN Maude Maître de
DRS 34 02 31 56 63 72 maude.hatano-chalvidan@unicaen.fr
(Co-Responsable M1 et M2) Conférences
Maître de Université
LAVILLE Matthieu matthieu.laville@univ-rouen.fr
conférences de Rouen
Maîtresse de
LE GUERN Anne-Laure ESPE anne-laure.leguern@unicaen.fr
Conférences
Professeur des
LESCOUARCH Laurent laurent.lescouarch@unicaen.fr
Universités
MICHEL Youenn Maître de
DRS 33 02 31 56 54 71 youenn.michel@unicaen.fr
(Responsable L1) Conférences
Maître de
PELLISSIER-FALL Anne DRS 32 02 31 56 54 87 anne.pellissier@unicaen.fr
Conférences
PIOT Thierry Professeur des
DRS 34 02 31 56 54 72 thierry.piot@unicaen.fr
(Directeur du CIRNEF) Universités
SAILLOT Éric Maître de
DRS 30 eric.saillot@unicaen.fr
(Responsable L2) Conférences
SEUX Christine Ingénieure d’études DRS 34 02 31 56 61 96 christine.seux@unicaen.fr
VERGNON Marie Maître de
DRS34 02 31 56 63 72 marie.vergnon@unicaen.fr
(Directrice du département) Conférences
7 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
CONTACTS PROFESSIONNELS
Nom Fonction Bureau Téléphone Mail
ANTONIN-BUSNEL Anne-Laure AB Conseil
annelaure@abconseilformation.fr
Formaton
AYAD Omar Centre
éducatif omar.ayad@laposte.net
fermé
BENSALEM Léïla Centre
i.bensalem@centre-inffo.fr
Inffo
DENDURA Laurence
laurence.dendura@ac-caen.fr
DREGE Laure CRESS
laure.drege@cressnormandie.org
DURANTOU Nathalie
nathalie.durantou@ac-caen.fr
GUILLOUET-LAMY Jocelyne
locelyne.guillouet-lamy@ac-caen.fr
VIELAJUS Alice Centre
a.vielajus@centre-inffo.fr
Inffo
8 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
PRÉSENTATION DU MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
PROFESSIONNALITÉ ET SAVOIRS DANS LES MÉTIERS DE LA RELATION
Avec la création, en 1967, d’une licence et d’une maîtrise de l’éducation, le fait marquant était
évidemment le nom donné à cette discipline nouvelle. La tradition française avait jusque-là retenu le
mot au singulier : « la Science de l’Éducation ». Mot que Bain avait employé le premier en 1878
(Education as a science) dans une perspective psychologisante, alors que Durkheim, occupant en 1902
une chaire de science de l’éducation ne reconnaissait dans cette science que la sociologie. Conflit
d’hégémonie ? Durkheim n’eut guère, sur ce point, de postérité immédiate. Le modèle français s’est
cantonné, dans les décennies suivantes, à la référence psychologique : la discipline censée traiter des
démarches pédagogiques éclairées par un savoir scientifique ne s’est-elle pas appelée ensuite, et en
France en tout cas, psychopédagogie ? Focalisation légitime, mais sans doute bien limitée, sur le thème
de l’apprentissage et ses corollaires relationnels.
QUELLES SCIENCES ?
Un changement profond s’est engagé avec le terme « sciences de l’éducation ». Ce pluriel révèle ici un
sens capital : les axes spécifiques se multiplient, les savoirs se diversifient, les voies d’approche
deviennent différentes au sein d’une « discipline » pourtant identique. Sans doute les sciences
humaines ont-elles acquis suffisamment de maîtrise et de sûreté pour promouvoir une lecture
plurielle du fait éducatif. Sans doute les « milieux » pédagogiques sont-ils devenus suffisamment
conscients de ces progrès pour attendre quelque « gain » d’une telle lecture plurielle. Avec la
constitution d’UFR ou de départements universitaires de sciences de l’éducation, la véritable
nouveauté est, en tout cas, de créer des lieux de réflexion, d’enseignement, de recherche dans
lesquels plusieurs approches scientifiques peuvent voisiner, voire se conforter, afin de mieux étayer
l’ensemble des gestes et des processus éducatifs.
Mais il faut bien mesurer le sens et les enjeux de cette pluralité. La première tentative est toujours
d’en dessiner les contours, d’en tracer les limites et d’énumérer une à une les sciences qui la
composent. Tentative utile sans doute qui montre le nombre de démarches scientifiques susceptibles
d’être ici retenues. Tentative vaine aussi qui révèle, à l’inverse, les limites des classifications vouées
aux énumérations et aux juxtapositions difficilement exhaustives. Tout au plus peut-on suggérer des
perspectives de regroupement. Les sciences de l’éducation pourraient ainsi comprendre :
Les sciences étudiant les phénomènes « macro-éducatifs » : phénomènes démographiques,
économiques, sociaux, institutionnels ou culturels, permettant d’embrasser l’éducation dans
de vastes solidarités d’ensemble. Les échelles prises ici en compte débordent toujours
l’individu.
Les sciences étudiant les phénomènes « micro-éducatifs » : phénomènes psychologiques et
biologiques entre autres, qui, de l’histoire individuelle aux processus cognitifs ou relationnels,
mettent en jeu le sujet de l’éducation.
La didactique des disciplines : savoirs étayant les méthodes de l’éducation et les mécanismes
de la transmission (soit très généraux, soit liés, au contraire, spécifiquement, à chaque
discipline d’enseignement).
Les approches scientifiques (ergonomiques, psychologiques, sociologiques,
ethnographiques…) s’appuyant sur une analyse fine des activités et des processus de
développement ou d’apprentissages qui en découlent pour le sujet. Ces courants de recherche
ont pour dénominateur commun l’entrée par l’analyse de l’activité.
9 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
Cette diversité est un facteur de richesse et de dynamisme. Richesse bien sûr dans la possibilité de
confrontations nouvelles, dans la volonté de varier les perspectives, dans cette finalité concrète de
travailler les pratiques selon plusieurs axes. Impossible de maintenir, dans ce cas, les savoirs figés ou
des repères étroits.
LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION POUR QUOI FAIRE ?
Le rôle des sciences de l’éducation a donc au moins deux versants : accroître les connaissances
pluridisciplinaires sur le phénomène éducatif, fournir des orientations praxéologiques pour mieux
assurer les actions entreprises dans ce champ. Les justifications données en 1967 lors de la création
universitaire de la discipline demeurent évidemment valables.
Les sciences de l’éducation répondent :
Aux exigences de la formation à la recherche en éducation de caractère interdisciplinaire,
À la nécessité d’une formation pédagogique approfondie des enseignants et des formateurs
à tous les niveaux,
Aux besoins qui s’expriment dans des milieux divers où se posent des problèmes d’animation
de groupe, du développement de compétences, de communication et de relation dans des
situations à caractère éducatif,
Aux demandes d’éducation permanente. (Texte du projet du département de sciences de
l’éducation de l’Université de Paris, 1968.)
Des intérêts se sont même accentués, qu’un tel texte n’évoque qu’indirectement : la formation des
formateurs d’adultes par exemple ou plus largement, celle de la formation de formateurs (et non
seulement d’enseignants). De même, les demandes elles-mêmes montrent aujourd’hui que le champ
des sciences de l’éducation s’étend à tous les milieux concernés par les problématiques éducatives ou
pédagogiques (ceux de l’intervention sociale, ceux de la thérapie, ceux de la communication, ceux du
travail social). L’évocation du rapport des sciences de l’éducation à la professionnalité (page 12 de ce
guide) repère d’autres demandes sociales encore.
[D’après l’ouvrage collectif de l’AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de
l’Education) : Les sciences de l’éducation, enjeux et finalités d’une discipline, Paris, 1993.]
LES DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS PAR LE MASTER 1 ET 2
Inscrit dans la continuité du master 1, les cours du master 2 ainsi que les sessions pratiques ont pour
objectif de développer un certain nombre de compétences. On peut distinguer six grands « domaines
de compétences » (DC)
DC 1 : Maîtriser les principaux éléments théoriques et méthodologiques d’une recherche en
sciences humaines et sociales et plus particulièrement en sciences de l’éducation
o Connaître et mettre en œuvre les principales étapes d’une recherche en sciences de
l’éducation
o Développer un savoir-faire et une culture de l'évaluation dans l'esprit "d'évaluer pour
évoluer"
o Développer des méthodologies, attitudes et savoirs d’enquête dans le cadre du
production scientifique ou professionnelle
o Maîtriser les grands concepts et théories des champs disciplinaires concernés par les
3 parcours
10 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
DC 2 : Piloter et coordonner des projets en éducation, formation, insertion et travail social et
recherche
o Proposer un diagnostic pluriel d’une situation problème à partir de l’analyse des
contextes et acteurs du champ des parcours
o Maîtriser la démarche de projet
o Développer une démarche d'ingénierie : Analyser, Concevoir, Réaliser et Evaluer
o Proposer des stratégies professionnelles de résolutions de problème
DC 3 : Rédiger un rapport professionnel, un mémoire professionnel ou de recherche s’appuyant
sur une analyse du terrain, des ressources théoriques et une capacité de problématisation et de
réflexivité
o Conduire et exposer une mission d’intervention, de conseil, de formation ou de
recherche lors de son stage avec une méthodologie appropriée.
o Repérer les différents écrits professionnels et scientifiques
o Adapter ses productions écrites aux contextes professionnels et scientifiques
DC 4 : Travailler en réseau en privilégiant la dimension collective du travail
o Construire un réseau professionnel
o Repérer et analyser les différents niveaux : ingénierie des politiques, ingénierie de
formation, ingénierie pédagogique.
o Animer un réseau professionnel
o Coordonner des actions collectives
DC 5 : Maîtriser et connaître les spécificités du travail avec autrui dans les champs de l’éducation,
de la formation, du social et de l’insertion
o Conduire un entretien
o Repérer et interroger les positions et postures professionnelles
o Maîtriser les outils et les dispositifs de conseils
o Maîtriser les outils et dispositifs d’accompagnement
DC 6 : Maîtriser les outils numériques de communication et de vieille scientifique et
professionnelle
o Repérer les différents écrits professionnels et scientifiques
o Réaliser une veille documentaire et une bibliographie
11 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
STRUCTURE DU MASTER 2
ORGANISATION DE LA FORMATION
Les cours du MASTER 2 se tiennent sur 7 mois puis suit une période de stage ou d’analyse de pratiques
professionnelles pour les personnes déjà en poste. Ils se dérouleront par ailleurs sur deux jours et
demis, en début de semaine, du lundi au mercredi. Par ailleurs, il est à noter que les étudiants
pourront être invités à participer à des manifestations scientifiques (colloques, séminaires…) qui
pourront se dérouler à n’importe quel moment de la semaine.
Condition d’admission en MASTER 2 :
Passage du Master 1 au Master 2 sous condition d’obtention d’au moins 10/20 de moyenne générale au Master 1 et de
10/20 au moins au travail de recherche demandé en master 1
Possibilité d’admission directement en M2 pour les salariés sous condition d’acceptation de leur candidature.
MASTER 2 mention Sciences de l’éducation
Parcours Professionnalité et savoirs dans les métiers de la relation
(Site de Caen)
Semestre 3 UE1 (60h/10 ECTS) optionnelle
Objets, questions vives et enjeux (2MED1)
(Les parcours optionnels n’ouvrent qu’à condition d’effectif minimum.)
OPTION A : En éducation et santé (2MED1A)
OU
OPTION B : En éducation hors l’école, dans l’école, formelle ou informelle (2MED1B)
OU
OPTION C : En éducation, formation et insertion (2MED1C)
UE2 (60h/10 ECTS) Tronc commun
Démarches de professionnalisation : métiers et pratiques (2MED21)
(Démarches de choix et préparation du stage, outils d’analyse réflexive, des discours et
des situations professionnelles)
UE3 A (42h/7 ECTS) Tronc commun
État de la recherche et production de la recherche (2MED31)
UE3 B (18h/3 ECTS) Tronc commun
Langue vivante : anglais (2MED3A)
Semestre 4 UE4 (36h/6 ECTS) optionnelle
Concepts et notions des champs des métiers de la relation (2MED4)
(Les parcours optionnels n’ouvrent qu’à condition d’effectif minimum.)
OPTION A : Professionnalités et groupes professionnels dans le champ du soin et de la
santé (2MED4A)
OU
OPTION B : Professionnalités, pratiques et cultures dans l’éducation hors l’école, dans
l’école, formelle et informelle (2MED4B)
OU
OPTION C : Sujets et groupes en situation de formation, insertion ou accompagnement
(2MED4C)
UE5 (420h/10 ECTS) Tronc commun
Analyse des pratiques professionnelles (STED2)
STAGE : 12 semaines, soit 420h
UE6 (84h/14ECTS) Tronc commun
Production et soutenance du mémoire (2MED61)
12 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
INFORMATIONS GÉNÉRALES
LES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont donnés par les enseignants-chercheurs du laboratoire CIRNEF auquel le
Master est adossé. La formation s’appuie également sur les interventions de nombreux professionnels
des champs de la formation, de l’insertion, de l’éducation, du soin, afin d’être au plus près des enjeux
et problématiques professionnels.
OFFRE DE FORMATION EN 2019-2020
Les UE proposées en option dans les parcours ne sont ouvertes qu’à la condition d’un nombre
d’étudiants seuil.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Pour chaque UE, les modalités d’évaluation sont indiquées dans ce présent livret. Elles seront
cependant à confirmer ou à préciser auprès des enseignants-chercheurs responsables ou
coordonnateurs d’UE en début de semestre.
LE MÉMOIRE
Voir la description de l’UE 6 pour plus de détail.
La formation permet à un étudiant de mener son propre projet en fonction de son objectif de
formation. Il développe une réflexion autour d’une question qui l’intéresse et articule la dimension
théorique et les enjeux professionnels, en privilégiant l’une ou l’autre en fonction de ses priorités.
Un seul mémoire est à rédiger pour la fin de la 2e année. En première année, il s'agit de travailler sur
sa problématique, sa bibliographie et éventuellement de réaliser une pré-enquête. En début d’année,
et même si possible dès le dépôt du dossier de candidature, le projet de mémoire est discuté avec le
directeur de mémoire. Un cahier des charges précisant les attentes concernant le mémoire est donné
aux étudiants.
LE STAGE
Voir la description de l’UE 5 pour plus de détail. Le stage est obligatoire, il participe à la
professionnalisation des étudiants, et étudiants/stagiaires. La préparation des stages ainsi que leur
compte rendu sous diverses formes font partie intégrante de la formation.
Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage (obligatoire) qui précise entre autres les modalités
d’accueil ainsi que les missions du stagiaire. Ces missions définissent donc la thématique du stage,
elles doivent être validées par l’ensemble des acteurs (stagiaire, enseignant référent –directeur(rice)
de mémoire, employeur). Elles doivent être en lien avec les compétences professionnelles visées par
le diplôme et peuvent faire l’objet de négociations.
A titre d’exemple, ces stages peuvent se dérouler en établissement scolaire, auprès d’enfant, dans des
structures ou associations s’occupant des activités périscolaires ou extrascolaires, dans les services
municipaux ou territoriaux centrés sur des questions éducatives. Dans un autre champ (formation au
sens large), les stages peuvent se dérouler dans des organismes de formation publics ou privés, dans
des services d’information, d’orientation sur les parcours et trajectoires professionnelles, dans des
associations d’insertion, de formation permanente, des centres d’accueil ou d’hébergement ou autres
structures travaillant à l’accueil et l’insertion de publics dits fragiles.
DURÉE DU STAGE (HEURES)
1 semaine = 35 h ; 1 jour = 7 h ; 1 mois = 22 jours
Master 1 sciences de l’éducation :
o Durée minimum 4 semaines, maximum 6 semaines donc 140 heures et 210 heures
Master 2 :
o Durée minimum 3 mois (12 semaines soit 420 heures), maximum 6 mois (24 semaines,
soit 840 heures). Le stage doit se dérouler du 1er septembre 2019 au 30 septembre
13 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
2020, de manière continue ou discontinue. L’étudiant peut également réaliser
plusieurs stages pour parvenir à effectuer les 420 heures exigées par la formation.
o NB : pour les professionnels, le « stage » peut s’effectuer sur leur lieu de travail et fait
ainsi l’objet d’un retour réflexif (cf. rubrique stage)
PÈRIODE DE DÉROULEMENT DU STAGE DANS L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
En master 1 : à préciser
En master 2 : du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020
14 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
PRÉSENTATION DES DIRECTEURS DE MÉMOIRE, DE LEURS
COMPÉTENCES ET CHAMP(S) DE RECHERCHE
L’année de Master 2 donne lieu à la production et la soutenance d’un mémoire à caractère
scientifique et/ou professionnel. Vous pouvez solliciter un(e) directeur(rice) de mémoire en
fonction de ses thématiques et méthodes de travail. Vous pouvez aussi être orienté par l’équipe
pédagogique vers un enseignant-chercheur e, fonction de vos thèmes de recherche.
Pour en savoir plus sur les enseignants-chercheurs, leurs publications et activités de recherche,
consulter le site du laboratoire CIRNEF : http://cirnef.normandie-univ.fr/.
JACQUES BÉZIAT
THÈMES : Technologies éducatives, formation ouverte et à distance, école primaire, pratiques et
dispositifs pédagogiques, formation des enseignants, questions éducatives en espaces francophones,
enseignement de l’informatique et culture numérique, formation d’adultes, ingénierie de formation.
MÉTHODE : Approches qualitatives : analyse de discours, observation et analyse de pratiques,
recherche-intervention, approche systémique, analyse ingénierique.
EXEMPLES : « Institutionnalisation scolaire : Forme d’implication parentale pour l’éducation au Congo
Brazzaville. Cas de la localité rurale de Nsomo », « De l’interaction entre ingénierie pédagogique et
enjeux organisationnels. Observation directe au sein d’une Ecole Supérieure Internationale de
Management Hôtelier », « Les usages du Géoweb sonore dans l’enseignement de la géographie en
classe de seconde : le cas de sorties de terrain en milieu urbain », « Intégration des Techniques de
l’Information et de la Communication dans l’enseignement collégial au Maroc, Délégation
d’enseignement de Salé. », « Réflexion sur les pratiques du dispositif ‘Plus de maîtres que de classe’
sur la réussite des élèves dans l’Académie de Limoges : focus co-intervention », « La robotique
pédagogique à l’école primaire : initiation aux concepts préliminaires de la science informatique ».
JULIE DELALANDE
THÈMES : 1. Thèmes liés au champ de la socio-anthropologie de l’enfance et de la jeunesse.
Représentation et statut de l’enfant et du jeune : évolutions historiques et diversités culturelles.
Relations entre pairs, cultures d’âge (culture enfantine, juvénile), socialisation horizontale. Relations
avec les adultes (parents et professionnels), modèles éducatifs et prises en compte du point de vue
des enfants et des jeunes. 2. Thèmes liés aux questions de culture au sens anthropologique :
représentations et pratiques culturelles propres à un groupe social, acculturation, interculturalité.
MÉTHODE : méthode ethnographique par immersion à partir d’observations et d’entretiens formels
et informels.
EXEMPLES : L'ennui du point de vue des élèves : immersion dans des classes de troisième. Le temps
libre d'enfants au collège : représentations et pratiques. Et si on demandait l'avis des enfants sur le
travail du soir ? Approche sociologique du sens donné par des enfants pour l'école hors l'école.
L'enfant, sujet actif dans le processus de socialisation et de formation des identités de genre. Les
pratiques des préadolescents avec les technologies numériques. Comment les étudiants étrangers
s'intègrent-ils à la société ? Le cas des étudiants sénégalais à Caen. L'entrée dans la vie adulte des
jeunes femmes d'origine maghrébine : des processus culturels complexes.
15 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
NATHALIE DUPONT
THÈMES et EXEMPLES :
- Les marqueurs de la jeunesse et les configurations des cultures des jeunes ; Intrusions", "infusions",
circulations des cultures juvéniles dans le monde scolaire ;
- Les enjeux des politiques culturelles et des politiques éducatives dans la société ;
- Les évolutions des usages et des fonctions des formes culturelles et artistiques ;
- Le statut que peuvent avoir les œuvres d’art qui entrent à l’école et le rôle que l’école fait jouer aux
œuvres ; - le rapport imaginaire-réel ;
- Le partenariat en formation : formes, mécanismes et enjeux ;
- Les enjeux des partenariats et des collaborations interprofessionnelles ;
- Les questions de multiculturalité, d’interculturalité, de pluriculturalisme ;
- Les projets de vie pour les enfants et leurs familles en situation de vulnérabilité ;
- Les enjeux des responsabilités en éducation : éthique d’une éducation partagée ;
- Les enjeux des relations intergénérationnelles au travail, dans les familles dans les projets de
vie et l’acculturation professionnelle des jeunes.
MÉTHODE : Approches qualitatives (analyse de discours, extraits d’histoire de vie).
LAURENCE FILISETTI
THÈMES : psychologie sociale appliquée au domaine de l'éducation. Plus spécifiquement,
compétences sociales des élèves : leurs causes et leurs conséquences/ La motivation sociale et
l'estime de soi à l'école / la politesse à l'école.
MÉTHODE : essentiellement méthode quantitative (construction et analyses de questionnaires).
EXEMPLES : Comment aider un élève à être mieux accepté(e) en classe ? Faut-il enseigner la politesse
à l'école ? L'estime de soi de l'élève est-elle un élément fondamental dans sa réussite scolaire ?
L'ensemble des thèmes peuvent bien entendu trouver un écho dans d'autres domaines que l'école : la
motivation dans le sport, au travail, dans les soins…/ La politesse à l’hôpital, au travail …
ISABELLE HARLÉ
THÈMES :
1.Les liens école-hors école : le rapport entre les contenus enseignés à l’école et la culture des élèves,
leurs pratiques sociales.
2.Les contenus enseignés à l’école dans et hors discipline : les dispositifs interdisciplinaires, les
parcours éducatifs, les éducations à…. (la citoyenneté, au développement durable, au numérique….).
Socio histoire des programmes scolaires : des prescriptions aux pratiques. Les innovations
pédagogiques.
3. Choix curriculaires, sens des apprentissages et difficulté scolaire. La conscience disciplinaire.
MÉTHODE : Approches qualitatives, entretiens et observations.
EXEMPLES : Motivation et « éducation à… ». L’éducation au développement durable : des
prescriptions aux pratiques. L’enseignement moral et civique : entre forme disciplinaire et éducation
à…Droits des élèves et éducation à la citoyenneté. Usage du temps scolaire entre discipline et
dispositifs transversaux. Socle commun et tradition disciplinaire. Obligation scolaire et parcours
individuel.
16 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
MAUDE HATANO-CHALVIDAN
THÈMES : formation des adultes, compétences professionnelles, transformation, évolution des
métiers et groupes professionnels, identités professionnelles.
MÉTHODE : Approches qualitatives, analyse des discours.
EXEMPLES : le métier de groom ; le dispositif du tutorat dans les contrats emploi-avenir,
l'engagement en formation des élèves de la filière équine, les mécanismes de l'implication dans le
travail des jeunes soignants ; le sens de l'expérience scolaire des élèves de lycée professionnel,
l’activité des conseillers en insertion, etc ...
YOUENN MICHEL
THÈMES : histoire et sociologie des acteurs et des institutions éducatives (plus particulièrement
d'enseignement), histoire des pédagogies et des savoirs scolaires, histoire de l'enfance, de la famille
et de la jeunesse.
MÉTHODE : approches qualitatives : entretiens, analyse des discours, analyse de sources historiques.
EXEMPLES : le rapport à l'insertion des étudiants, les représentations sociales des CPE sur les élèves
en échec, les politiques d’éducation prioritaire en France-Espagne et Grande-Bretagne, les mutations
de la violence scolaire dans les collèges, l’éducation des jeunes filles selon la presse catholique de
l’Entre-deux-guerres, la laïcité vue par les professeurs des écoles, l'histoire et la portée de la réforme
du collège unique, la lutte contre le surmenage scolaire à l’époque de la massification des collèges.
LAURENT LESCOUARCH
THÈMES : Les pratiques d'aides aux élèves en difficulté en milieu scolaire. Les approches
pédagogiques dans l'éducation non formelle, animation et périscolaire. Innovations et pédagogies
alternatives.
MÉTHODE : approche qualitative (descriptive et compréhensive par questionnaires, entretiens et
observations).
EXEMPLES : Les pratiques pédagogiques des enseignants et les enjeux de différenciation. La
mobilisation des enfants par les pédagogies de projets. Les innovations pédagogiques inspirées des
pédagogues de l’éducation nouvelle : Freinet, Montessori, Devroly.... Le développement des
pédagogies coopératives dans l'enseignement primaire et secondaire.
ANNE PELLISSIER-FALL
THÈMES : 1- santé (famille et santé ; éducation à la santé ; médicalisation et psychologisation des
difficultés scolaires ou d'insertion ; professionnels de santé...) 2- Les professionnels de la petite
enfance (assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture, agents auprès des enfants...)
3- Expérience du chômage du point de vue des chômeurs ou des professionnels 4- entrée dans l'âge
adulte.
MÉTHODE : méthodes qualitatives / possibilité d'une analyse secondaire des entretiens réalisés dans
le cadre de l'enquête longitudinale, menée de 1995 à 2008 "sociabilité et insertion sociale - Processus
d'entrée dans la vie adulte, insertion professionnelle et évolution des réseaux sociaux".
17 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
EXEMPLES : les pratiques de santé des familles ; la médicalisation des difficultés scolaires, les
relations des assistantes maternelles avec les parents ; le travail des chômeurs ; entrée dans la vie
adulte et transformation de la manière de se faire des amis.
THIERRY PIOT
THÈMES : activités, compétences et développement professionnel dans les métiers adressés à autrui
- formation initiale et continue.
MÉTHODE : observations et entretiens d'explicitation.
EXEMPLES : métiers de l'intervention sociale, du soin, de la formation des adultes et de
l'enseignement.
ÉRIC SAILLOT
THÈMES : les objets de recherche seront à construire autour des notions de posture professionnelle,
pédagogie, accompagnement, évaluation, différenciation, adaptation, motivation, climat scolaire,
bienveillance, care, empathie…
MÉTHODE : approche qualitative (descriptive et compréhensive), analyse de l’activité (didactique
professionnelle, ergonomie cognitive, psychologie du travail), partir d’observations filmées suivies
d’entretiens d’auto-confrontation simple ou croisée pour analyser l’activité réelle des professionnels
en situation. L’approche ergonomique permet d’appréhender la tâche prescrite (textes officiels) et
ses multiples redéfinitions par les acteurs (tâche attendue, redéfinie, effective). Des entretiens croisés
ou focus groupes sont également possibles.
EXEMPLES : analyse des pratiques d’accompagnement des conseillers pédagogiques, caractérisation
d’une posture professionnelle d’étayage, analyse des pratiques d’évaluation et de différenciation
pédagogique : comment « conforter une école bienveillante et exigeante » conformément aux
prescriptions ?
MARIE VERGNON
THÈMES : histoire des idées éducatives dans et hors l’école ; pédagogues, penseurs et philosophie de
l’éducation ; pratiques pédagogiques et représentations des acteurs en contexte scolaire et
périsolaire
MÉTHODE : approches historique et herméneutique ; approches qualitatives (données invoquées et
suscitées)
EXEMPLES : la pédagogie de Carleton Washburne ; la notion d’intérêt de l’enfant chez les pédagogues
de l’éducation nouvelle ; l’évolution des représentations et des valeurs dans la prise en charge du
mineur délinquant ; les enjeux de l’éducation en contexte périscolaire ; les animateurs et la question
de l’autorité ; etc.
18 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
MASTER 2
ENSEIGNEMENTS DU
SEMESTRE 3
19 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
UE1 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3)
OBJETS, QUESTIONS VIVES ET ENJEUX - 2MED1
3 OPTIONS AU CHOIX
L’effectif actuel du master 2 ne permet pas actuellement d’ouvrir les options telles qu’elles avaient
été conçues et annoncées dans la maquette.
Un parcours unique visant les mêmes compétences et reprenant des thématiques communes au
secteur de l’éducation, la formation, l’insertion, l’animation, le travail social et la santé est donc
proposé.
OPTION A : EN ÉDUCATION ET SANTÉ (2MED1A)
OPTION B : EN ÉDUCATION HORS L’ÉCOLE, DANS L’ÉCOLE, FORMELLE OU INFORMELLE
(2MED1B)
OPTION C : OBJETS, QUESTIONS VIVES ET ENJEUX EN ÉDUCATION, FORMATION ET
INSERTION (2MED1C)
PARCOURS INTÉGRÉ
Volume horaire reçu par l’étudiant : 60 h (total)
Forme d’enseignement : 30 h CM, 30 h TD (18 h présentiel et 12 h FOAD)
ECTS : 10 - coefficient : 2
Titre du cours : Projets et coopération en éducation, formation et insertion
Enseignants : J. Béziat, N. Dupont, M. Hatano-Chalvidan, T.Piot Intervenants professionnels : A-L
Antonin Busnel, L. Bensalem, J. Guillouet-Lamy, Laure Drege
Les compétences visées par les cours de cette UE sont :
- Comprendre les logiques d’action et d’intervention des professionnels impliqués dans des
projets d’éducation, de formation, d’insertion dans des contextes à la fois nationaux et
internationaux.
- Appréhender les enjeux partenariaux dans des contextes éducatifs à l’international.
- Comprendre des logiques de territoires et de cultures sur les activités des métiers adressés à
autrui.
- Maîtriser des outils de coordination et de gestion de compétences collectives nécessaires à
tout projet de développement.
- Maîtriser les nouvelles donnes des pratiques d’accompagnement et d’ingénierie de parcours.
Les interventions seront assurées à la fois par des enseignants-chercheurs et des professionnels-
consultants
Modalités d’évaluation
Présence obligatoire
Un dossier personnel en fin de séminaire
20 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
Bibliographie indicative
CARRE, P. ET CASPAR, P. (1999). Traité des sciences et des techniques de la Formation. Paris : Dunod.
CHAILLOT, C. (dir.) (2003). L’usage des réseaux pour l’éducation en Afrique. Actes des rencontres
RESAFAD-TICE. Paris : RESAFAD-TICE, ADPF ministère des Affaires étrangères, UNESCO.
CORTESERO, R. (dir.) (2018). Territorialisation des politiques éducatives et multiplicité des espaces de
socialisation : vers un nouveau paradigme ? Les Sciences de l’éducation – Pour l’ère nouvelle, 51(1).
DEPOVER, C. ET WALLET, J. (dir.) (2006). Formation à distance, multiples Sud. Distances et Savoirs,
6(2).
DUMOULIN, P., DUMONT, R., BROSS, N. ET MASCLET, G. (2015). Travailler en réseau. Méthodes et
pratiques en intervention sociale. Paris : Dunod.
LEGUY, P., BREMAUD, L., MORIN, J. ET PINEAU, G. (2005). Se former à l’ingénierie de formation. Paris
: L’Harmattan.
OILLO, D. ET MVE-ONDO, B. (dir.) (2006). Fracture dans la société de la connaissance. Hermès, 45.
SAUQUET, M. ET AL. (dir.) (2004). L’idiot du village mondial. Les citoyens de la planète face à l’explosion
des outils de communication : subir ou maîtriser ? Paris : Editions Charles Léopold Mayer.
VERGNIOUX, A. (2013). Traité d’ingénierie de la formation. Problématiques, orientations, méthodes.
Paris : L’Harmattan.
21 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
UE2 - MASTER 2 SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SEMESTRE 3)
DÉMARCHES DE PROFESSIONNALISATION : MÉTIERS ET PRATIQUES
(OUTILS D’ANALYSE REFLEXIVE, DES DISCOURS ET DES SITUATIONS
PROFESSIONNELLES) - 2MED21 (OBLIGATOIRE)
Titre du cours : Nouvelles injonctions autour du climat scolaire et de la bienveillance : vers un
élargissement des professionnalités
Enseignants : Éric Saillot (coordinateur, 27h), Matthieu Laville (15h), Anne Pelissier-Fall (6h)
Injonctions à la bienveillance dans les métiers adressés à autrui
Depuis quelques années de nouvelles injonctions apparaissent avec les réformes successives des
politiques éducatives. La refondation de l’école républicaine engagée depuis 2012 a placé au cœur des
débats deux nouvelles notions : le climat scolaire et la bienveillance. Ce cours ambitionne de
questionner ces deux nouvelles injonctions afin d’en comprendre les fondements, les enjeux, les
perspectives et les éventuelles limites ou paradoxes.
La notion de bienveillance en éducation a émergé à l’occasion de la concertation nationale pour la
refondation de l’école de la République de 2012. Elle a été mobilisée lors du renforcement de
l’éducation prioritaire (Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante) ou encore dans le guide
élaboré pour améliorer le climat scolaire : une école bienveillante face aux situations de mal-être des
élèves. Le climat scolaire est un objet d’étude complexe à appréhender car il est le fruit de multiples
variables impliquant l’ensemble des acteurs de la communauté éducative : élèves, personnels
enseignants et non enseignants, avec leurs différents partenaires dont les parents. Cette
responsabilité collective est la source soit du bien vivre et du bien-être pour les élèves et le personnel
de l’école, soit au contraire de stress et de conflits.
Nous proposons aux étudiants d’étudier le climat scolaire à partir de sept facteurs : les stratégies
d’équipe, les pratiques partenariales, la coéducation, la prévention des violences et du harcèlement,
la justice scolaire, la qualité de vie à l’école et les pédagogies de coopération. Ces sept dimensions
seront étudiées à travers l’étude d’articles scientifiques et des prescriptions officielles puis à travers
les problématiques professionnelles choisies par les étudiants, que ce soit dans le monde scolaire,
périscolaire ou non scolaire.
La transversalité de la bienveillance sera appréhendée dans sa filiation avec le care (Gilligan, 2008 ;
Laugier, 2005 ; Molinier, Laugier et Paperman, 2009 ; Tronto, 2009), qu'il s'agisse de son articulation
avec le cure dans le monde infirmier (Rothier-Bautzer, 2012) ou de ses reconfigurations dans les
situations d’éducation (Usclat, Hétier et Monjo, 2016). Nous nous appuierons notamment sur les
travaux de Noddings (1984) qui ne limite pas le caring à la morale et à des principes puisque l’éthique
s’expérimente dans une pratique relationnelle. Nous ne nous limiterons pas à l’école avec l’approche
du care dans l’éducation préscolaire (Rayna et Brougère, 2015) ou dans les métiers du social (Brugère,
2011), où l’« art de la relation » mobilise des compétences d’accompagnement (Paul, 2016). Cette
approche sera complétée par un regard complémentaire et critique sur l’élargissement des
professionnalités dans les métiers de la relation.
Care et bienveillance dans les métiers adressés à autrui : normes nouvelles ou pratiques
invisibles réalisées par des subalternes ?
Inversant la perspective précédente nous nous interrogerons, dans le cadre d’un court module, non
pas sur les effets de ces nouvelles injonctions sur les professionnalités mais sur la présence constante
et occultée du care dans les métiers adressés à autrui. Ce renversement de perspective s'appuie sur la
définition du care par Tronto comme « une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons
pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que
22 / 57UNICAEN UFR HSS SCIENCES DE L’ÉDUCATION GUIDE DES ÉTUDES 2019 – 2020
possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous
cherchons à relier en un réseau à complexe, en un soutien à la vie. »(Tronto, 2009) Dans cette optique, le
« care » ne se réduit pas aux pratiques relationnelles ou émotionnelles des professionnels
« légitimes » (par exemple, la manière dont un enseignant ou un soignant adopte un comportement
bienveillant... ) mais est constitué d'une kyrielle d'activités subalternes, marginalisées, considérées
comme insignifiantes (le « sale boulot ») et réalisées généralement par des catégories sociales
dominées (femmes de ménage, aides-soignantes, ATSEM, surveillants assistants d’éducation...)
Penser, au-delà des nouvelles injonctions, la présence constante du « care »au cœur du travail, c'est
interroger son inégale répartition (entre femmes en hommes, classes sociales, immigrés et
« nationaux », ...) et son invisibilité ; c'est remettre en question « les concepts et les pratiques
constitutifs de la civilisation du travail (compétences, spécialisation, évaluation, « improductivité » du
travail domestique) qui sont inadaptés pour valoriser le care et celles/ceux qui le font. » (Molinier, 2013)
Nous étudierons donc le care et la bienveillance « par le bas »,
« Normes organisationnelles » et élargissement des professionnalités
Depuis une trentaine d’années en France, l’injonction au professionnalisme s’est progressivement
généralisée à l’ensemble des groupes professionnels. Le professionnalisme n’est plus seulement la
traduction de « normes professionnelles » endogènes, émanant des milieux de travail et assurant ainsi
aux travailleurs une certaine autonomie professionnelle, il est aussi l’expression de « normes
organisationnelles » (nouveaux outils, nouveaux dispositifs de gestion, chartes de bienveillance…)
exogènes « résultant de l’injonction des organisations ou des clients » (Boussard, Demazière &
Milburn, 2010), imposées parfois au nom de la rationalité managériale (Bezes, 2009).
Ce module propose de réfléchir aux recompositions et aux tensions actuelles qui affectent les
« métiers adressés à autrui » (Maubant & Piot, 2011) : métiers des secteurs de l’éducation et de la
formation, de l’insertion et de l’orientation, du travail social et du soin. Dans quelles mesures les
nouvelles normes organisationnelles affectent-elles le cœur de ces métiers relationnels ? Comment
cet élargissement des « territoires tâches » (Abbott, 1988) est-il traduit in situ par les professionnels ?
En quoi cet élargissement peut-il conduire paradoxalement à une diminution de l’autonomie au travail
(Demailly & de la Broise, 2009) ? Peut-on au contraire envisager ces injonctions comme un vecteur du
développement professionnel propice à un accroissement de la professionnalité, i.e. à un
développement des compétences et des savoirs nécessaires à la pratique de ces métiers (Lang, 1999)
? Comment finalement les travailleurs se "(re)définissent" en tant que (bons) professionnels ?
Afin de saisir ces recompositions professionnelles, nous proposons, dans un premier temps,
d’apporter une connaissance théorique sur les principales approches de la sociologie des professions
(fonctionnalisme, interactionnisme, courant néo-wéberien). Puis, nous envisageons d’appréhender la
professionnalisation des métiers relationnels comme un processus dynamique qui « se joue au cœur
même du travail, dans les échanges entre des travailleurs cherchant à contrôler les contours de leur
travail, les manières de l’accomplir et les procédures d’évaluation, et leurs entourages […] qui sont
engagés dans les mêmes objectifs, et sur des registres variant de la coopération au conflit »
(Demazière & Le Lidec, 2014). Se focaliser sur l’aspect processuel de la professionnalisation rappelle
que cette dernière est intrinsèquement inachevée, ce qui évite de réifier cette notion en la réduisant
à son débouché (i.e. une profession instituée au sens anglo-saxon).
Modalités d’évaluation
Il s’agit de la construction d’un dossier « Care » qui fera l’objet d’un accompagnement des enseignants-
chercheurs.
Références bibliographiques indicatives
BOUSSARD, V., DEMAZIERE, D. & MILBURN, P. (Dir.) (2010). L’injonction au professionnalisme. Rennes :
PUR.
BRUGERE, F. (2011). L’éthique du care. Paris : Presses Universitaires de France.
DEMAILLY, L. & DE LA BROISE, P. (2009). Les enjeux de la déprofessionnalisation. Études de cas et
pistes de travail. Socio-logos. Revue de l'association française de sociologie, n° 4.
DEMAZIERE, D. & LE LIDEC (Dir.) (2014). Les mondes du travail politique. Rennes : PUR.
23 / 57Vous pouvez aussi lire