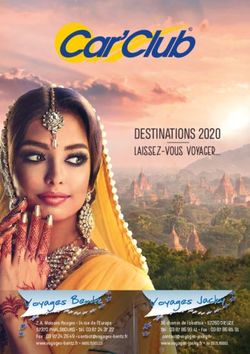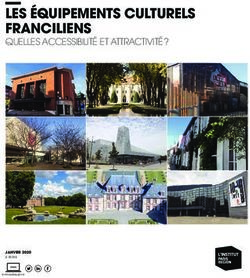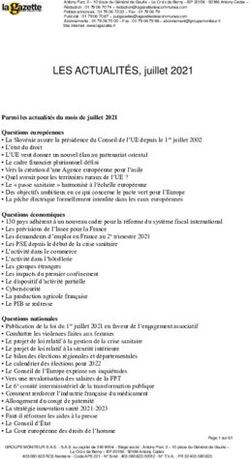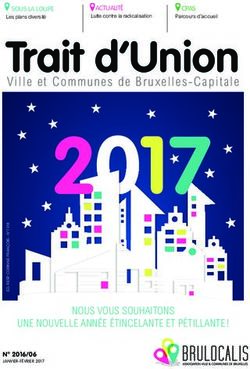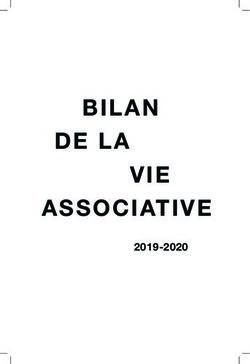Politique de la ville et quartiers populaires - Bibliographie analytique et sélective - Profession Banlieue
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Avril 2018
aBibliographie établie par : Adil Jazouli, sociologue, conseiller expert au CGET Avec la collaboration de : Vera Vidal-Beneyto, chargée de la coordination scientifique de la chaire Ville globale (FMSH-CGET) Mise en page : Citizen Press Avril 2018
Politique de la ville et quartiers populaires Bibliographie analytique et sélective
Préambule
Depuis ses origines, il y a près de quarante ans, la De nombreux ouvrages cités, ou brièvement résu-
politique de la ville a été, et est toujours, accompa- més, représentent les travaux de recherche les plus
gnée, par des travaux de recherche, des évaluations, importants de ces quarante dernières années autour
des diagnostics et des analyses couvrant un large des quartiers populaires et de leurs problématiques,
spectre des sciences sociales. Ceci lui a permis, nombreuses, passionnantes et qui posent des ques-
ainsi qu’à ses divers acteurs, tant au niveau national tions centrales à notre société, à nos capacités de
que local, d’affiner et d’ajuster régulièrement ses vivre ensemble, d’intégrer, de rendre réelle l’égalité
connaissances sur son principal objet : les quartiers des chances ainsi que la cohésion sociale et ter-
populaires et leurs habitants. Ce faisant elle a pu et ritoriale. Nous avons essayé de couvrir l’ensemble
su, grâce à ces travaux, adapter ses actions et ses du champ des sciences humaines et sociales (SHS)
dispositifs afin qu’ils répondent au mieux aux situa- appliquées aux territoires de la politique de la ville.
tions difficiles que rencontrent les populations de De même, nous avons prêté attention à ce que les
ces quartiers qui fondent sa géographie prioritaire. courants de pensée et d’analyses – parfois diver-
gentes – qui traversent ces disciplines soient repré-
Les relations entre le monde de la recherche et celui, sentés au mieux. Nous avons aussi mis en valeur
plus institutionnel, de la politique de la ville ne sont des travaux, plus nombreux qu’on ne le croit, qui
pas toujours faciles, l’indispensable liberté d’ana- établissent des comparaisons entre les situations de
lyse des chercheurs se heurtant parfois avec des nos quartiers populaires et des politiques publiques
politiques publiques dont ils pointent l’insuffisance, qui s’y déploient, et ce qui se passe dans des pays
voire l’inefficacité, ce qui provoque, depuis le début européens voisins ou aux États-Unis d’Amérique, afin
de la politique de la ville, certaines crispations et d’élargir notre vision et de nous inspirer des bonnes
incompréhensions. Mais nous savons depuis Max pratiques des uns et des autres.
Weber que les relations entre « Le savant et le poli-
tique » ne sont pas simples, et c’est justement ce La bibliographie sur la politique de la ville et les quar-
qui les rend indispensables. Plus que dans d’autres tiers populaires est beaucoup plus riche que celle
domaines, l’action publique en direction des quar- que nous présentons, nous le savons. Mais nous ne
tiers populaires a besoin d’éclairages et d’analyses pouvions pas, pour des raisons matérielles, en faire
qui l’aident à la recherche de plus d’efficacité, car la recension exhaustive. Ce patrimoine commun
elle se développe au bénéfice de populations fra- de savoirs fera l’objet d’un travail ultérieur afin qu’il
giles, cumulant les handicaps, , et dont il faut ren- soit mieux et plus partagé. Nous savons aussi qu’au
forcer les capacités d’émancipation individuelle et moment même où nous publions cette bibliographie,
d’organisation collective. de nombreux travaux sont en cours, conduits soit par
des chercheurs et des universitaires confirmés, soit
Une bonne partie des travaux de la bibliographie par des étudiants qui se passionnent, à raison, pour
sélective que nous vous proposons a marqué, tout nos thématiques. Gageons alors que cette première
au long de ces années écoulées, la politique de la publication ne sera pas la dernière.
ville et l’a aidée à mieux définir ses orientations et à
mieux cibler ses actions. Bonne lecture,
Adil Jazouli,
sociologue, conseiller expert au CGET
1Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Sommaire
1. Brève bibliographie analytique
Ensemble refaire la ville. Rapport au Premier ministre 6
Hubert Dubedout, Paris, éd. La Documentation française, 1983
L’État et les jeunes 8
François Dubet, Adil Jazouli et Didier Lapeyronnie, Paris, éd. Ouvrières, 1985
Banlieues en difficultés : la relégation - Rapport au ministre d’État 10
Jean-Marie Delarue, Paris, éd. Syros, 1991
Violences urbaines. Ascension et chute des classes moyennes 12
à travers cinquante ans de politique de la ville
Christian Bachmann et Nicole Leguennec, Paris, éd. Albin Michel, 1995
Une Saison en banlieue : courants et prospectives 14
dans les quartiers populaires
Adil Jazouli, Paris, éd. Plon, 1995
En marge de la ville, au coeur de la société. Ces quartiers dont on parle 16
Collectif*, éd. de l’Aube, 1997
Demain la ville. Rapport présenté au ministre de l’Emploi et de la Solidarité 18
Jean-Pierre Sueur, Paris, éd. La Documentation française, 1998
Intelligence des banlieues 20
Liane Mozère, Michel Peraldi, Henri Rey, éd. de L’Aube, 1999
Faire société : la politique de la ville aux États-Unis et en France 22
Jacques Donzelot, avec Anne Wyvekens et Catherine Mevel,
Paris, éd. du Seuil, 2003
Émeutes urbaines et protestations : une singularité française 24
Hugues Lagrange et Marco Oberti (dir.), Paris,
éd. Presses de Sciences Po, 2006
Sortir des banlieues : pour en finir avec la tyrannie des territoires 26
Sophie Body-Gendrot et Catherine Withol de Wenden, Paris,
éd. Autrement, 2007
Parias urbains. Ghetto, banlieues, État 28
Loïc Wacquant, Paris, éd. La Découverte, 2007
Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui 30
Didier Lapeyronnie, Paris, éd. Robert Laffont, 2008
Pour une histoire politique de la politique de la ville 34
Adil Jazouli et Henri Rey, éd. de L’Aube, 2015
2Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
2. Bibliographie sélective
1. Politique de la ville - Généralités 38
2. Rapports ministériels 39
3. Sociologie urbaine et quartiers 39
4. Prévention de la délinquance, sécurité et violences urbaines 41
5. Europe et international 42
6. Relégation et domaines connexes 42
7. Habitat et ségrégation spatiale 43
8. Histoire - Mémoire des quartiers 44
9. Culture(s) de banlieue 44
10. Éducation et quartiers populaires 45
11. Travail et banlieues 46
12. Participation et citoyenneté 46
13. Représentations de la banlieue 46
14. Observation et statistiques 46
3Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
4Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
1 Bbibliographie
rève
analytique
5Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Ensemble refaire la ville,
Rapport au Premier ministre, Hubert Dubedout,
Paris, éd. La Documentation française, 1983
Suite aux émeutes de l’été 1981 du quartier faire des habitants des acteurs du changement
des Minguettes à Vénissieux dans la banlieue afin de sortir d’une logique d’assistanat ;
lyonnaise, largement médiatisées et révélatrices rendre les collectivités locales responsables des
de la situation d’exclusion sociale des quartiers opérations, tout en incluant toutes les parties
d’habitat social, le Premier ministre crée, en concernées.
octobre 1981, la Commission nationale pour le
développement social des quartiers (CNDSQ). Sa La seconde partie du rapport se structure autour
présidence est confiée à Hubert Dubedout, alors des cinq grandes propositions pour une politique
député et maire de Grenoble, ville connue pour la de développement social des quartiers, à intégrer au
solide expérience de ses Groupes d’action muni- XIe plan en cours d’élaboration. Elle met l’accent sur
cipale (GAM). Cette commission a pour mission de une logique opérationnelle qui s’appuie sur la démo-
mieux comprendre les causes de la dégradation cratisation de la vie locale et de l’administration com-
physique et sociale de ces quartiers et de propo- munale, plutôt que sur les logiques fonctionnelles
ser au Gouvernement une feuille de route, le tout et sectorielles précédentes. L’échelon régional est
dans une démarche participative incluant les élus privilégié pour traiter des problèmes des quartiers
et les habitants. Le rapport Ensemble refaire la d’habitat social, via une commission régionale, mais
ville, publié en 1983, est la synthèse des actions l’État conserve son rôle d’impulsion, de recours et
menées pendant plus d’un an par la CNDSQ, se de garant.
déclinant en une mission opérationnelle, une expé- Le préalable à ces propositions est l’affirmation d’une
rimentation et la préparation à la prise en charge volonté politique par les municipalités, en coordina-
de cette politique par les Régions. tion avec les services extérieurs de l’État et le mou-
vement associatif. Cette volonté politique doit se
Le constat de départ est le suivant : la croissance traduire par la création de structures de conception
urbaine désordonnée n’est qu’une cause partielle et de gestion des programmes de développement
et non centrale de l’insécurité, de la dégradation social, pour une maîtrise d’ouvrage collective, ainsi
des logements et de la détérioration des rapports que par une réorganisation des services municipaux
sociaux. Les causes profondes en sont le chômage, pour les rapprocher des habitants. Ces derniers
l’insuffisance des acquis scolaires et les difficultés doivent être activement impliqués, avec les asso-
d’insertion sociale et culturelle des minorités. La ciations, dans la conception des actions.
crise est autant économique que sociale, culturelle
et urbaine. Les seules politiques de rénovation et de Les principales propositions du rapport sont les
réhabilitation du bâti, jusqu’alors timidement mises suivantes :
en place, sont donc insuffisantes pour y remédier.
1. équilibrer la composition sociale des quartiers.
La première partie du rapport propose un diagnostic Il peut être question de stopper temporairement le
des insuffisances – tant dans ses domaines d’appli- flux d’immigrés, mais il faut avant tout définir une
cation que dans son processus – de la procédure politique intercommunale incarnée dans des struc-
Habitat et Vie sociale (HVS), point de départ de ce tures de concertation, adapter les politiques d’attri-
qui deviendra par la suite la politique de la ville telle bution et de réservation des logements pour sortir
que nous la connaissons, initiée en 1977 pour réha- de la logique d’attribution par divers organismes
biliter un nombre limité de cités HLM. sans véritable responsabilité territoriale de gestion,
et favoriser l’expression des identités sociales et
De là découlent trois grandes orientations pour culturelles ;
l’action qui s’inscrivent dans la mise en œuvre des
grandes lois de la décentralisation, engagées au 2. insérer socialement et professionnellement les
début des années 80 : jeunes. Le rapport préconise de suivre les voies
agir tant sur les causes de la dégradation que sur d’action du rapport Schwartz de 1981 concernant
la dégradation elle-même ; les missions locales. Ces dernières doivent devenir
6Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
un lieu d’expérimentation de mesures d’insertion sionnelles, où des urbanistes mettent en place une
et un régulateur des acteurs sociaux sur le terrain, maîtrise d’ouvrage collective. Les opérations ponc-
afin d’adapter l’offre éducative aux demandes des tuelles de transformation urbaine doivent s’inscrire
jeunes. Il insiste aussi sur la nécessaire adaptation dans un plan d’ensemble à moyen terme et s’intégrer
de l’école et de l’amélioration des toutes nouvelles à des politiques communales et intercommunales
Zones d’éducation prioritaires (Zep) par une atten- qui garantissent la solidarité des partenaires, notam-
tion à la formation et aux nominations des ensei- ment grâce à des chartes ;
gnants, en incluant les parents au projet pédago-
gique ; 5. prévenir l’insécurité afin de pallier l’image néga-
tive qu’ont les habitants de leur propre quartier et
3. relier le développement social au développe- qui va souvent à l’encontre des statistiques. Plus que
ment économique local, par l’animation du tissu par le seul renforcement des moyens en personnel
économique local et la création de comités locaux îlotiers, c’est la mise en place d’un dispositif d’accueil
pour l’emploi. Il encourage aussi le développement des plaintes, une politique en faveur des victimes,
d’un secteur d’économie sociale et d’activités hors un plus grand travail avec les jeunes en difficultés et
marché, afin de favoriser des circuits courts pour la création d’un dispositif local de concertation qui
employer les résidents dans les secteurs des « ser- sont mis en avant.
vices urbains », de la production et la gestion du
cadre de vie ou les prestations spécifiques envers Le rapport de la CNDSQ signé par Hubert Dube-
les populations des quartiers d’habitat social ; dout est considéré encore aujourd’hui, et à juste titre,
comme l’un des textes fondateurs de la politique de
4. redonner une valeur urbaine aux quartiers, afin la ville. Nombre de ses orientations centrales conti-
que les habitants s’approprient leur environnement. nuent d’inspirer l’action publique en direction des
Ceci doit passer tout d’abord par une approche posi- quartiers populaires et de leurs habitants.
tive des quartiers et de nouvelles pratiques profes-
7Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
L’État et les jeunes,
François Dubet, Adil Jazouli et Didier Lapeyronnie,
Paris, éd. Ouvrières, 1985
L’État et les jeunes se propose d’analyser trois ini- Et les chiffres de la délinquance baissèrent effecti-
tiatives étatiques relevant des politiques sociales vement ces étés-là, même s’il est admis que plutôt
de la jeunesse du début des années 1980. Suite à qu’une diminution de la délinquance, il s’agit plutôt
l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, alors peu d’un déplacement, les comportements violents ayant
préparée à s’affronter à la question de l’insécurité, été reproduits dans les camps de vacances. L’opéra-
et aux incidents de l’été de cette même année, une tion peut être comprise comme un « coup » soit, mais
attention accrue est portée par le Gouvernement à c’est aussi une action rapide, innovante qui permet
la prévention de la délinquance et à l’insertion des d’expérimenter de nouvelles solutions avec des
jeunes des quartiers. acteurs inhabituels, notamment les associations. Le
Le choix des deux premières initiatives – les opéra- retentissement médiatique a permis d’avoir la visibi-
tions « anti-été chaud » et les stages 16-18 ans – fait lité escomptée en 1982, mais a aussi participé à stig-
suite à une mission d’évaluation de certains de ces matiser les populations visées. La routinisation, dès
dispositifs par le Centre d’analyse et d’intervention 1983, des opérations – où leur professionnalisation et
sociologiques (Cadis-EHESS), dont faisaient partie l’emprise municipale les ont transformées en source
les auteurs. Quant au choix de la troisième – les de financement supplémentaire d’activités prévues –
Conseils de prévention de la délinquance –, il permet ne leur permet pas de rénover le fonctionnement des
de mieux cerner comment s’élaborent les orienta- institutions. Enfin, ces opérations relèvent plus d’une
tions les plus larges et les plus cohérentes de la offre de services que d’une mobilisation du public
politique de prévention. des quartiers lui permettant de sortir d’une logique
d’assistance. Elles n’ont pas réellement permis de
Les enjeux auxquels ces politiques sociales de la renouveler le travail social, et amorcent même leur
jeunesse doivent répondre sont triples : déprofessionnalisation par l’introduction d’acteurs
• politique - mener une politique non répressive nouveaux, comme des jeunes des quartiers à des
mais ferme, qui soit visible pour avoir un effet sur postes d’animation.
l’opinion publique et sortir du binarisme répres-
sion/laxisme ; 2. Les stages 16-18 ans
• institutionnel - répondre à la crise de l’État pro- En suivant les recommandations du rapport
vidence en rationalisant les ressources, par le Schwartz, les institutions concernées cherchent à
travail interministériel et la décentralisation, et en répondre au défi d’insertion sociale et profession-
mobilisant des ressources nouvelles, en travaillant nelle des jeunes, qui subissent chômage et décro-
notamment avec les associations et les habitants ; chage scolaire et social. Les missions locales et les
• pédagogique - renouveler le travail social qui Permanences d’accueil, d’orientation et d’information
arrive à épuisement et est perçu par ses béné- servent d’intermédiaires entre des jeunes – sortis
ficiaires comme un instrument de contrôle dans du système scolaire et qui cherchent à sortir de la
une société à l’ordre intangible. « galère » ou à acquérir une formation profession-
nelle reconnue – et des organismes de formation.
Les trois initiatives : Ceux-ci délivrent trois types de stage : d’orientation
1. Les opérations « anti-été chaud » approfondie, d’insertion sociale et de qualification.
Lancée en 1982, l’action interministérielle cherchait Les modèles pédagogiques les plus efficaces sont
à répondre à un objectif précis : organiser pendant ceux qui ne reproduisent pas le schéma scolaire
les vacances d’été des animations locales et des mais qui permettent l’apprentissage d’un corps de
départs en vacances pour les jeunes des quartiers métier, et allient alors une qualification profession-
« chauds » autour de Paris, Lyon, Marseille et Lille. nelle adaptative à une qualification sociale ouverte
Les pouvoirs publics locaux définissaient orienta- et positive. Plutôt que de rénover le système édu-
tions et choix. Ils ont compté notamment sur des catif, les stages sont décrits comme une nouvelle
moyens matériels et humains de la police et de l’ar- filière pour un système dont ni les pratiques ni le
mée. Les auteurs estiment que 10 000 jeunes ont fonctionnement n’ont changé. Les stages ont néan-
bénéficié de l’opération en 1982 et 80 000 en 1983. moins des effets sociaux et éducatifs à court terme,
8Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
comme d’être une première étape vers une forma-
tion qualifiante, d’ouvrir sur les rapports concrets Ces trois initiatives ont eu le mérite d’ouvrir des
du travail et de permettre une structuration per- espaces d’expression aux jeunes qui en sont d’ha-
sonnelle. bitude privés et de leur faire confiance. Elles sont
3. Les Conseils de prévention à la délinquance néanmoins toutes les trois confrontées aux problé-
La nouveauté de ces Conseils est de penser la lutte matiques suivantes :
contre la délinquance en termes politiques et insti- une tension entre monopole professionnel du tra-
tutionnels plutôt qu’organisationnels et techniques, vail social et mobilisation autonome des jeunes.
c’est-à-dire que la prévention soit prise en charge Les trois approches reposent sur une critique du
par la collectivité, avec des objectifs définis par la travail social traditionnel, mais les changements
concertation et la démocratie et plus seulement par pédagogiques n’ont pas vraiment eu lieu. En effet,
des professionnels. L’accent est mis sur une politique les initiatives ont été investies par les méthodes
qui allie prévention et répression. et institutions traditionnelles, et non par les nou-
veaux acteurs. La capacité de mobilisation des
Les Conseils existent à trois échelons : jeunes reste donc en esquisse ;
celui national, qui fixe les lignes stratégiques, la politique de « coup », conjointement à la décen-
mène une campagne nationale de prévention et tralisation, a permis de mobiliser les ressources
aide à la structuration des autres échelons ; existantes pour répondre aux problèmes plutôt
ceux départemental et communal, qui élaborent que de créer des équipements supplémentaires.
et mettent en place la politique de prévention en Le principal bénéficiaire de ce travail est l’éche-
donnant le pouvoir aux maires. lon politique local, ce qui est perçu comme une
Suite au succès des opérations « anti-été chaud », menace par les travailleurs sociaux dans leur
les élus locaux ont réalisé la nécessité de construire légitimité ;
une vraie politique de prévention et de sortir des
réseaux professionnels. Ils prennent en main des ces initiatives n’ont pas permis d’endiguer la montée
institutions traditionnelles, comme les travailleurs du sentiment d’insécurité, voire de xénophobie.
sociaux, et politisent les problèmes en renforçant
le pouvoir municipal sur les administrations et les
associations.
9Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Banlieues en difficultés : la relégation
Rapport au ministre d’État, Jean-Marie Delarue,
Paris, éd. Syros, 1991
En 1990, les émeutes de Vaulx-en-Velin rappellent donner les moyens de se prendre en charge. Pour ce
aux Français la situation d’isolement géographique, faire, il faudrait affecter les ressources budgétaires
de fragilité économique et de difficile d’insertion des nécessaires à une vie démocratique locale et aux
jeunes des quartiers. Le président de la République, associations, créer des mairies de quartier avec des
François Mitterrand, crée alors le ministère de la élus de quartier aux vraies prérogatives.
Ville, qui s’accompagne d’un plan de rénovation sur
cinq ans et d’un effort de solidarité entre communes Quant à l’action, les principales orientations straté-
riches et communes pauvres. 400 quartiers sont giques proposées sont les suivantes :
alors concernés par la politique de développement limiter le nombre de quartiers à 150 et non 400,
social urbain, et le nouveau ministre de la Ville com- car une plus grande souplesse et la concen-
mande, en 1991, un rapport à Jean-Marie Delarue. tration des ressources permettront de meilleurs
résultats ;
Huit ans après le rapport Dubedout, le rapport Dela- se reposer sur des contrats de ville ou d’agglo-
rue dresse un portrait de l’exclusion des banlieues. Il mération ;
fait le bilan de dix ans d’action gouvernementale et faire une politique globale alliant urbain, social
cherche à renouveler les méthodes et les champs et économique, qui permette d’améliorer la situa-
du développement social urbain, en s’appuyant de tion des quartiers et d’en transformer l’image
nouveau sur ceux qui travaillent au service de la tant pour les résidents que pour le reste de la
population dans les quartiers défavorisés. population.
Les politiques mises en place depuis le début des Concernant l’urbain, la principale différence avec le
années 1980 ont eu un rôle préventif important – rapport Dubedout relève de l’abandon des objec-
mais difficile à quantifier – et de prise de conscience tifs de diversification pour favoriser un retour à la
par l’État et les autres acteurs de l’ampleur du pro- mobilité, c’est-à-dire de pouvoir sortir du quartier
blème. Cependant, le double enchevêtrement de comme on y entre, si possible dans des logements
compétences, entre État et communes ainsi qu’entre équivalents ou meilleurs. L’auteur préconise, par
les différentes administrations de l’État, a rendu l’ap- ailleurs, d’arrêter la vente des logements locatifs,
plication de la politique de développement social de réhabiliter plutôt que de démolir et de densifier
urbain complexe et, en partie, inefficace, d’autant le tissu urbain des quartiers. Pour le volet social, il
qu’elle manque d’objectifs clairement définis et donc faudrait réunir travailleurs sociaux et professionnels
évaluables. Avec la décentralisation, l’État a déserté du développement afin de bénéficier de la complé-
tant l’animation que les finalités d’une politique de mentarité des expertises et d’assurer une continuité
développement social des quartiers. de l’action dans la durée pour traiter des questions
de l’adolescence, de la petite enfance, de la santé
Pour l’auteur du rapport, la politique de la ville doit et des loyers impayés. L’auteur envisage même de
avoir deux missions principales : d’une part, la paix regrouper les conseils de prévention et les missions
sociale ; d’autre part, la transformation des quartiers locales. Enfin pour l’aspect économique, l’action
déshérités en quartiers d’habitat populaire pleine- passe d’abord par une meilleure connaissance sta-
ment considérés. La fin de relégation passe par la tistique du terrain et de son économie souterraine.
possibilité pour les habitants de ces quartiers de Il faudrait y développer les entreprises d’insertion
choisir le lieu de résidence et la transformation des et les régies de quartier, et renforcer le lien entre
cités. Il faut aussi faire des quartiers des laboratoires actions d’insertion et emploi.
d’innovation urbaine, dont les solutions seront aussi Cette politique doit aussi associer transports,
applicables à leurs centres-villes. école et culture pour rapprocher les quartiers des
Le préalable indispensable à l’action est la citoyen- centres-villes. Pour les transports, les infrastructures
neté (plutôt que la participation), où habitants et ne doivent plus isoler le quartier : on peut enterrer
associations ont des lieux et des moyens pour s’ex- les grandes voies de transport ou construire plus
primer et agir, afin de sortir de l’assistance et de leur d’ouvrages de franchissement pour la circulation
10Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
locale et obliger la maîtrise d’ouvrage à assurer la moyen de désenclaver le quartier et de lui donner son
continuité urbaine entre ville et quartier. Il faudrait identité propre, par la valorisation de l’expression de
aussi améliorer les transports collectifs, en ce qui la vie des quartiers et de projets à long terme.
concerne les dessertes, les installations de voya- En dernier lieu, le rapport s’attache aux modalités
geurs et la sécurité. législatives et administratives des propositions pré-
Quant à l’école, les politiques de développement cédentes. Le rapport préconise l’adoption d’une
social de quartier (DSQ) doivent être là où il y a des loi d’application générale pour définir le cadre des
Zones d’éducation prioritaires. L’école doit pouvoir conventions, leurs conditions de mise en œuvre et la
s’ouvrir sur les quartiers – par exemple en se ren- portée de la décision de classement, alors prononcé
dant chez les parents d’élèves ou en ouvrant après par décret par le Conseil d’État. Une autre préconi-
les heures de classes – et compter sur des appuis sation est de créer un organisme de gestion de la
extérieurs en matière culturelle et sociale. Il faudrait convention commun aux collectivités participantes,
aussi lui laisser plus d’autonomie dans sa gestion des qui signerait ainsi le retour des techniciens de l’État
horaires et des contenus. Enfin, la culture doit être le dans la politique de la ville.
11Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Violences urbaines. Ascension et chute
des classes moyennes à travers cinquante
ans de politique de la ville,
Christian Bachmann et Nicole Leguennec,
Paris, éd. Albin Michel, 1995
Violences urbaines retrace cinquante années de bile en son centre. Avec la Ve République et Pierre
la politique de la ville en entrelaçant mouvements Sudreau, les grands ensembles sont intégrés à la
sociaux, actions de l’État et des acteurs privés et vie planification locale, qui isole et spécialise les aires
résidentielle. urbaines. Les Zones à urbaniser en priorité (Zup) sont
L’ouvrage retrace tout d’abord la lutte contre la bâties entre 1959 et 1969 pour offrir près de deux
pénurie et la vétusté des logements au sortir de la millions de logements aux mal-logés. À cette époque
Seconde Guerre mondiale, portée entre autres par émerge un nouvel acteur privé : le promoteur. Paral-
certains mouvements chrétiens qui n’hésitent alors lèlement, l’État crée la Datar pour mener à bien une
pas à pratiquer le squat (MPF) ou l’autoconstruc- politique d’aménagement du territoire, et les ingé-
tion solidaire et communautaire (Castors). Jusqu’au nieurs des Ponts deviennent les nouveaux patrons de
début des années 1950, l’État n’intervient pas dans la l’urbain. Les infrastructures et les équipements sont
question du logement, bien qu’il soit le seul à avoir minimalistes et standardisés.
la capacité de la maîtrise d’ouvrage. Le problème L’État, les communes et les associations régulent les
urbain est considéré comme un problème social, grands ensembles et cherchent à mettre en place
donc subalterne, relevant du domaine privé. Tant une société contractualisée, stratifiée et pacifiée,
les ministres communistes que socialistes sont en logée dans un habitat normalisé et encadré par des
retrait sur la question. Raoul Dautry, premier des associations relais et des professionnels médiateurs.
ministres de la Reconstruction, met en place un Si les grands ensembles logent les ouvriers sans
système décisionnaire avec, en son cœur, un projet logis et les employés mal logés, les exclus sont, eux,
national et social de promotion d’une communauté logés dans des cités de transit pour pauvres avec
forte cadrant l’individu, mené par une planification une action socio-éducative spécifique. La culture
centrale autoritaire, pilotée par une petite élite de ouvrière évolue avec le passage de l’habitat indivi-
techniciens-gestionnaires. L’arrivée de Claudius-Pe- duel aux grands ensembles collectifs : les relations
tit en 1948 pose les jalons nécessaires (loi de finan- sociales s’espacent, et de nouvelles contraintes
cement, loi d’expropriation, nouveaux standards de économiques surgissent ; la vie se resserre autour
conforts et de ressources pour les anciens HBM du logement. Les classes populaires perdent alors
devenus HLM) pour que l’État s’empare de la ques- un espace de protection et un système informel
tion du logement. Son successeur, Courant, lance d’entraide.
un plan de construction avec un objectif de 240
000 logements par an à partir de 1953. La ren- La troisième partie part du « Mai 1968 urbain » qui
contre de l’hiver exceptionnellement rigoureux de place les habitants au cœur du projet urbain. Une
1954, mortel pour les sans-logis, et la dramatisation préoccupation grandissante des conditions de vie
sociale orchestrée par l’appel de l’abbé Pierre sus- des migrants dans les bidonvilles, la révolte des usa-
citent dans l’imaginaire public un bouleversement gers contre les appareils de normalisation que sont
symbolique et mettent la question des sans-logis au les équipements, la préoccupation environnemen-
cœur des débats et des mesures politiques. tale et les protestations contre des opérations de
rénovation qui « déportent » les résidents marquent
La deuxième partie se penche sur la construction un tournant. Certains professionnels de la ville et
des grands ensembles, non désirés par la popula- des élus locaux, Hubert Dubedout et les GAM auto-
tion qu’ils doivent loger. La charte d’Athènes et Le gestionnaires en tête, tentent alors de mettre en
Corbusier – alliés à des arguments gestionnaires œuvre la participation des habitants à leur cadre
d’industrialisation de la construction – vont servir de vie. Le nouveau ministre de l’Équipement, Albin
d’alibis pour convaincre de la nécessité des grands Chalandon, consomme la rupture avec les ministres
ensembles, synonymes de « progrès », qui cou- reconstructeurs ; il se méfie des grands ensembles
ronnent un urbanisme de circulation, avec l’automo- aux ambitions sociales et leur préfère une architec-
12Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
ture originale et variée à petite échelle, « à l’hori- de la délinquance, Banlieues 89 : tous se révèlent
zontale ». insuffisants pour les transformations économiques
La quatrième partie s’attache à retracer les premiers et sociales encore non diagnostiquées.
craquements des banlieues. Dans un contexte de La dernière partie revient sur le contexte de la fin des
triomphe du marché sur l’État en matière de loge- années 1980 et le début des années 1990 expliquant
ments, de dégradation des HLM où se concentrent la crise sociale et urbaine : montée du FN et de l’an-
les populations les plus fragiles et de stigmatisation tiracisme, casse-tête partenarial de la décentralisa-
croissante des immigrés y résidant qui ont remplacé tion, difficultés des maires des communes pauvres à
les petites classes moyennes ayant accédé à la pro- appliquer la politique de la ville. La décentralisation
priété, la fin des années 1970 présente des signaux n’a pas favorisé la démocratie locale, les classes
avant-coureurs de la montée des violences urbaines. moyennes continuent de s’effriter. Ressurgissent
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, suivie alors mal-logés, sans-abris et squatters que l’on pen-
par les rodéos des Minguettes, de nombreux dispo- sait disparus. Ce ne sont pas pour autant des exclus,
sitifs sont mis en place suite à plusieurs rapports : mais des acteurs comme en témoigne leur capacité
missions locales pour l’emploi des jeunes, Zep, opé- à se mobiliser dans des mouvements sociaux qui
rations DSQ, conseils communaux de prévention peuvent devenir les moteurs de l’action publique.
13Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
Une Saison en banlieue : courants et
prospectives dans les quartiers populaires,
Adil Jazouli, Paris, éd. Plon, 1995
Une Saison en banlieue est le fruit des quatre pre- parole. Les pouvoirs publics ouvrent alors le dia-
mières années de travail de Banlieuescopies, un logue avec eux et les poussent à se constituer
observatoire indépendant d’évaluation des politiques en association, ce qui discrédite les médiations
publiques dans les banlieues, fondé et dirigé par l’au- classiques et crée une concurrence avec les
teur de 1990 à 1995. Grâce à l’étude d’initiatives éma- professionnels. L’autre facteur de création, plus
nant des quartiers et des entretiens menés avec des classique, est le manque d’animation sociale et
adolescents et ceux qui travaillent avec eux, il dresse éducative dans le quartier. Dans les deux cas,
un portrait des quartiers. Un manifeste qui dégage travailler dans le quartier permet d’allier utilité
les fractures et points d’appui au sein des familles, sociale et collective et insertion professionnelle
entre les jeunes et les institutions, autour des actions individuelle ;
collectives des habitants des cités et à propos du politiques. Pour certaines de ces initiatives,
service public en banlieue, conclut l’ouvrage. l’étape suivante est le passage au politique, afin
de peser plus en mettant à profit le capital social
La première partie est consacrée à 17 ethnographies, accumulé et espérer moderniser par le bas le
situées pour moitié en banlieue parisienne, ainsi que système politique.
dans les banlieues de Lille, Lyon, Marseille et Nîmes.
Les cas choisis sont des exemples d’initiatives, princi- La deuxième partie est consacrée aux entretiens
palement émanant des associations, créées par des réalisés avec des jeunes de 10 à 16 ans à propos de
habitants de chaque quartier étudié. Elles partent leurs représentations de l’avenir, de la famille ou de
des problèmes du quotidien plutôt que d’un militan- l’école. Leur conscience précoce de leur environ-
tisme idéologique et couvrent différents domaines : nement (chômage, drogue, etc.) leur fait porter un
ces initiatives peuvent être strictement culturelles jugement sévère sur le monde des adultes et les
ou économiques, à caractère social ou tout à la fois. règles de la société qui leur paraissent arbitraires
Les actions collectives des habitants se doivent de et inégalitaires. Leur conscience d’être mis à l’écart
répondre aux attentes des quartiers, notamment en produit une sorte de légitimation des comporte-
termes de dégradation urbaine et sociale, et aux ments déviants par rapport à une norme sociale
logiques propres aux financements publics, ce qui perçue comme non légitime. Ils ont globalement
est source de conflits et de ruptures et entraîne une une vision pessimiste, voire cynique, de leur avenir
double dépendance des associations. et développent ressentiment et colère. Le mensonge
devient une attitude et un mode de gestion aux
On peut distinguer trois types d’actions : autres, notamment avec leurs parents, pour préser-
initiatives portées par des parents, pour contrer ver leur indépendance et pouvoir vivre leur vie dans
le thème récurrent de leur démission comme le quartier. Il devient l’espace de l’autonomie adoles-
cause de la délinquance. Les actions se font en cente par rapport au monde des adultes
dehors des grandes associations institutionnali- Le système éducatif est surinvesti : lieu d’intégration
sées. Les logiques locales et autonomes sont à sociale et culturelle, l’école est leur meilleure chance
l’origine des actions, qui témoignent d’un effort pour accéder à un autre avenir. Rater sa scolarité,
de traitement social, là où les acteurs classiques c’est rater son entrée dans la vie ; ils en veulent à
sont inopérants voire absents. Elles permettent l’école quand ils sont mis dans des voies de garage.
ainsi de créer un lieu de débat et de citoyen- L’école cristallise l’espoir déçu d’une réussite et la
neté, de socialiser les revendications. Les actions cause de l’échec. Elle provoque chez de nombreux
témoignent, par ailleurs, de la volonté des parents préadolescents, pourtant respectueux de leur envi-
de nouer des relations égalitaires avec les institu- ronnement, un manque de respect pour leurs ensei-
tions, que ce soit l’école, la police, etc. ; gnants, qu’ils peuvent insulter voire agresser. Néan-
initiatives du fait de jeunes qui constituent un moins, ils attendent d’eux écoute, patience, respect
pôle d’action sociale, culturelle et éducative. Le et une certaine autorité. Injustices et discriminations
schéma est, en général, le suivant : suite à un peuvent aussi être le fait des enseignants. Dans ce
événement grave, de jeunes leaders prennent la contexte, la famille reste un élément important et
14Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
l’un des rares repères stables, malgré de nombreux à la place une logique de débrouille individuelle, par
conflits sur la façon dont les interdits sont fixés par le travail au noir ou la délinquance, les liens entre
les parents et rarement expliqués. jeunes et institutions peuvent se renouer quand les
professionnels répondent aux attentes des premiers
Quant aux adultes, chaque corporation professionnelle en les écoutant et en adaptant les règles.
rejette son impuissance sur l’incompétence des autres.
Un fort sentiment d’abandon et d’isolement se mani- 3. Quant aux services publics, la logique de repli
feste. Ils manquent d’une image claire de cette tranche sur soi comme protection des agents et la multi-
d’âge et oscillent entre une vision où les préadoles- plication des acteurs professionnels ont créé une
cents n’ont pas de problèmes, sauf pour un noyau dur, certaine distance et cacophonie pour les usagers.
et l’incompréhension d’une violence apparemment Cependant, les fortes convictions de certains pro-
sans objet. Ils éprouvent une certaine difficulté à définir fessionnels et le développement d’un réel partena-
les règles et les normes à partir desquelles négocier riat d’action entre les différents secteurs de l’action
avec les jeunes, en attente d’une certaine autorité. publique viennent renverser cette tendance.
L’ouvrage se clôt sur un manifeste qui met en avant Enfin, l’auteur distingue trois moments de l’action
les éléments suivants. collective. Tout d’abord, les associations d’adultes
créées dans les années 1970 et 1980 autour des pro-
1. Malgré les déchirures personnelles et collectives blèmes de logement, des relations interethniques
des parents et des enfants et l’instauration de rap- et intergénérationnelles, du sport, de la culture, etc.
ports toujours plus instrumentaux, dépendants et Elles en sont perte de vitesse au début des années
agressifs avec les institutions publiques et leurs 1990, car elles manquent de moyens et de renou-
agents sur le terrain, la famille reste un lien essentiel. vellement et sont en rupture avec les jeunes. On
Les exemples montrent des parents s’impliquant de trouve ensuite les associations de jeunes créées
plus en plus dans la vie de la cité, via des actions pendant les années 1980 à la suite de mobilisations
récréatives ou éducatives, souvent portées par les collectives et qui ont investi les champs de l’action
femmes et les grandes sœurs, ainsi que la renais- sociale et de l’animation. La logique d’autonomie a
sance de mouvements de solidarité interethnique et cédé le pas à l’intégration à l’action publique pour les
intergénérationnelle. associations qui ont survécu. Enfin, les années 1990
marquent l’émergence d’associations culturelles ou
2. S’il y a un rapport conflictuel, voire d’évitement communautaires imprégnées d’idéologie religieuse,
et de mépris, des jeunes en situation de précarité qui deviennent le lieu d’une reconstruction de l’es-
envers les structures d’insertion et s’ils développent time de soi par le don de soi des bénévoles.
15Politique de la ville
et quartiers populaires
Bibliographie analytique
et sélective
En marge de la ville, au cœur de la société.
Ces quartiers dont on parle,
Collectif*, éd. de l’Aube, 1997
Initiative conjointe du PIR-Villes, du CNRS, de la Délé- discriminations à l’embauche – a un effet social. Leur
gation interministérielle à la Ville, de la Caisse nationale réponse est que l’origine ethnique des habitants, com-
d’allocations familiales, du Plan urbain au ministère de binée au niveau de diplôme ou au taux de chômage de
l’Équipement et de l’Insee, l’ouvrage s’offre de procé- la zone habitée, prévaut sur l’effet adresse. Ce n’est pas
der à un diagnostic sur la situation et les besoins des tant le cadre de vie en soi qui pose problème, mais le
quartiers ; il s’attarde notamment sur la question d’un fait que les individus soient confrontés à la crise éco-
éventuel « effet de quartier ». Les données du recen- nomique et dépendent des dispositifs de la protection
sement de l’Insee et de l’enquête Insee de 1994 sur sociale pour obtenir des ressources. Ils ressentent alors
les conditions de vie des ménages ont servi de point un sentiment de chute, de dégradation sociale. L’envi-
de départ. Elles ont été complétées par le travail de ronnement collectif trop semblable du quartier, ainsi
sociologues, politologues et d’anthropologues sur les que son image négative, sa « mauvaise réputation »
sept quartiers sur lesquels se penche plus particuliè- véhiculée par les non- résidents et les médias viennent
rement l’ouvrage. renforcer ce sentiment. La délinquance, la violence, la
drogue ou la dégradation du cadre bâti surdéterminent
L’ouvrage se centre sur sept études de cas de sites en les représentations du quartier. On renvoie alors le stig-
dispositif Développement social des quartiers (DSQ). mate sur son voisin, dont on cherche à se démarquer.
Deux sont situés en région parisienne : la cité des
4 000 à La Courneuve et le Val-d’Argent à Argenteuil ; Les habitants aspirent, avant tout, à la « normalité ».
les autres se trouvent dans différentes métropoles : les Les modes de socialisation changent et de nouveaux
Hauts-de-Garonne à Bordeaux, le Mirail à Toulouse, les processus identitaires apparaissent, qui font des pro-
quartiers Nord de Marseille et Lille-Sud et Lens-Liévin. blèmes du quotidien une responsabilité individuelle et
Chaque quartier est décrit dans ces caractéristiques personnelle. Ce ne sont ni l’anomie ni l’enclavement qui
sociodémographiques, socioprofessionnelles, ses caractérisent ces quartiers, mais la capacité de leurs
formes d’habitat et sa configuration géographique. résidents, en mobilisant des ressources matérielles
diverses, de résister aux conditions qui leur sont faites.
Les quartiers en DSQ présentent certaines caractéris- Les recherches contredisent, en partie, l’idée de relé-
tiques sociodémographiques communes. On y trouve gation et donnent des exemples de trajectoires ascen-
une surreprésentation des familles nombreuses, des dantes, qu’elles soient entrepreneuriales – comme on
familles monoparentales, des populations immigrées, en trouve chez les populations d’origine immigrée qui
des jeunes, des ouvriers et des chômeurs. Ceci ne doit ont maintenus des liens avec le pays ou la famille élar-
pas cacher la grande hétérogénéité entre les quar- gie – ou plus liés aux emplois récemment créés par les
tiers et au sein même des quartiers, qu’elle concerne dispositifs de la politique de la ville.
la pluralité des formes d’habitat (habitat social, quar-
tiers centraux d’habitat ancien, quartiers pavillonnaires, Chaque quartier est analysé et permet de mettre en
anciennes cités ouvrières), des structures démogra- lumière différents processus sociologiques.
phiques et familiales ou encore de leur composition
socioprofessionnelle (ouvriers et employés du secteur Les Hauts-de-Garonne, à Bordeaux, illustreraient le
public, ouvriers non qualifiés, indépendants, cols bancs passage d’une partie de sa population des classes
d’entreprise, etc.). Les quartiers en DSQ sont affectés populaires aux « classes moyennes paupérisées ».
différemment pas des formes multiples de pauvreté : Celles-ci adhèrent aux modèles culturels des classes
conditions du logement, précarité et condition de tra- moyennes ; elles ont un degré d’intégration et de
vail, absence de relations de sociabilité, état de santé, stabilité qui justifie leur appartenance aux classes
faible insertion culturelle, etc. moyennes, mais souffrent d’un sentiment de chute, de
pauvreté relative et de la mauvaise réputation de la
Les chercheurs s’interrogent sur un éventuel « effet cité où elles habitent. Elles sont prolétarisées, n’ont plus
de quartier », c’est-à-dire qu’ils cherchent à savoir si l’impression de pouvoir progresser socialement et, face
la ségrégation spatiale – du fait d’un mauvais accès à à leur dépendance à l’aide sociale, elles cherchent à
l’emploi, à la présence d’une culture particulière ou de construire leur autonomie et à préserver l’espace privé,
16Vous pouvez aussi lire