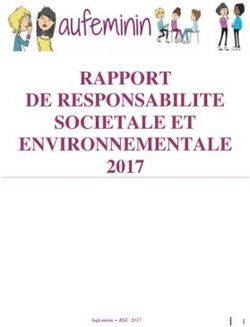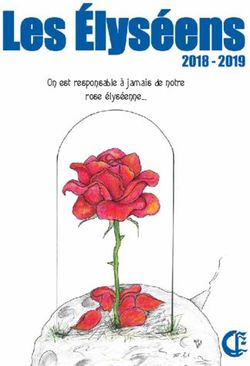Réflexion sur l'implication de la population face à un accident nucléaire majeur en France - Directeur de recherche : Professeur Patrick ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Réflexion sur l’implication de la population face à un
accident nucléaire majeur en France
Directeur de recherche : Professeur Patrick LACLEMENCE
Mémoire de recherche présenté par Jean-Pierre LAMADE
Janvier 2018
1Sommaire
Résumé…………………………………………………………………….page 3
Abstract…………………………………………………………………….page 3
Remerciements………………………………………………………...page 4
Répertoire des figures……………………………………………….page 5
Liste des abréviations………………..…………………………..….page 6
Table des matières……………………..…………………………..…page 7
Bibliographie……………………………………………………………..page 97
Sommaire des annexes……………………………………………..page 99
2Résumé
A ce jour, 58 réacteurs électronucléaires sont en exploitation sur le territoire français. Le 11 mars
2011, la catastrophe de Fukushima Daiichi au Japon a une nouvelle fois bouleversé l’approche de la
sureté nucléaire dans notre pays. Une des conséquences directes a été à l’échelle gouvernementale,
la réalisation d’un plan national interministériel de réponse à un accident nucléaire ou radiologique
majeur (SGDN-2014). Ce plan préconise entre autre l’augmentation des rayons de dangers autour
des centrales nucléaires et ainsi élargir ceux-ci de 10 à 20 km. A ce jour, selon une étude de l’ASN,
seulement 50 % de la population a fait l’effort de se procurer des comprimés d’Iode stable mis à
disposition par les exploitants.
La population est-elle aujourd’hui sensibilisée et impliquée autour de la conduite à tenir face à un
accident nucléaire majeur sur notre territoire ?
Sommes-nous bien préparés à subir une telle situation et surtout la population est-elle prête ?
Pour répondre à ces questions, ce mémoire traite dans une première partie du comportement de la
population face aux situations de crise. Une seconde partie est ensuite consacrée à la compréhension
du manque d’implication de la population et de son ressenti sur la question du risque nucléaire qui
divise les français. Cette étude s’attache également à trouver des pistes et des axes de recherche afin
de mieux préparer la population en l’impliquant pleinement dans le dispositif d’information et de
préparation afin de faire face à un accident nucléaire majeur sur notre territoire.
Mots clés : risque nucléaire, implication de la population, information du public.
Abstract
To date, 58 nuclear power reactors are in operation in France. On March 11, 2011, the Fukushima
Daiichi disaster in Japan once again upset the approach to nuclear safety in our country. One of the
direct consequences has been, at the government level, the completion of a national
interdepartmental response plan for a major nuclear or radiological accident (NWMO-2014). This
plan advocates, among other things, the increase of danger radii around nuclear power plants and
thus widen them from 10 to 20 km. To date, according to an ASN study, only 50% of the population
made the effort to obtain stable iodine tablets made available by the operators.
Is the population made sensitive and involved in a major nuclear accident on our territory today ?
Are we prepared to undergo such a situation and especially to a population she is ready ?
To answer these questions, this report deals with a first part of the behavior of the population in
front of crisis situations. A second part is then dedicated to the understanding of the lack of
involvement of the population and the sound of the issue of the nuclear risk which divides French.
This study also seeks to find avenues and research axes in order to better prepare the population by
fully involving them in the information and preparation system in order to deal with a major nuclear
accident on our territory.
Key words : nuclear risk, involvement of the population, public information.
3Remerciements
Je tiens ici à remercier :
Le Colonel Hors Classe Olivier BOLZINGER, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours de la Drôme jusqu’en juin 2017, et Benoit GABRIEL, chef de la mission sureté du CNPE de
Tricastin pour m’avoir autorisé à suivre cette formation,
Monsieur Philippe KESSLER, expert incendie au sein de l’UNIE-GPSN du groupe EDF, pour son aide
précieuse à la réalisation de mon projet de Master,
Le Professeur Patrick LACLEMENCE, responsable de la spécialité Ingénierie te Management en
Sécurité Globale Appliquée de l’Université Technologique de Troyes, directeur de mémoire, le
Docteur Guillaume DELATOUR et au Doctorant Paul Henri RICHARD pour leurs conseils précieux et le
suivi de ce travail,
Au Lieutenant-Colonel Mohamed KARHAZE, responsable des formations sur la gestion de crise et la
formation des élus à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers et au
Commandant Eric DUFES pour leur aide précieuse,
Au Colonel Bertrand DOMINEGHETTI de la Mission d’Appui aux Risques Nucléaire au sein de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, pour son aide,
A Madame Marie-Hélène EL-JAMMAL, responsable du « Baromètre IRSN » au sein de l’IRSN, pour ses
conseils avisés, sa disponibilité et son aide,
A Madame Céline FABRE, chargé de mission au Conseil Départementale auprès des CLI du
Département de la Drôme, pour ses conseils et son aide,
A Monsieur David ANTOINE, chef du SIDPC du Département de la Drôme pour son aide,
A Madame Véronique FERDINAND, responsable du service communication du CNPE de Tricastin,
pour son aide,
A Madame Aurélie GAMON, auditrice au sein de la mission sureté du groupe EDF, pour son aide
précieuse, ses conseils avisés, sa disponibilité et son soutien sans faille,
A Laurence, pour sa patience…
Que toutes ces personnes trouvent ici, toute ma reconnaissance.
4Répertoire des figures
Figure 1 : Cartographie des centrales nucléaires en France à ce jour……………………..…..page 14
Figure 2 : Plan d’ensemble de l’entrepôt « Loiret et Haentjens »………………………………..page 21
Figure 3 : Photo de l’incendie du 29 octobre 1987 à Nantes…………………………………..…..page 23
Figure 4 : Cartographie du sinistre de Nantes et de ses communes avoisinantes………..page 24
Figure 5 : Le cycle de vie d’une crise selon E. Dufes et C. Ratinaud – 2016……………….…page 33
Figure 6 : Le modèle 3D d’E. Dufes et de C. Ratinaud – 2013………………………………………page 35
Figure 7 : Typologie des comportements humains observées au sein des zones
d’impact et de destruction selon la temporalité de la catastrophe – Dubos,
Paillaud, Provitalo – 2012………………………………………………………………….……………………….page 37
Figure 8 : Dynamique posturale des individus face à une situation de crise
E. Dufes – 2016………………………………………………………………………………….………………………page 39
Figure 9 : L’échelle INES : principaux incidents et accidents enregistrés – IRSN…………..page 43
Figure 10 : Diagramme crédibilité/compétence du Baromètre IRSN en 2016…………..…page 55
Figure 11 : Tableau des cooccurrents de communication selon Valérie Delavigne
1995…………………………………………………………………………………………………………..……………….page 58
Figure 12 : Schémas et photos de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986……..…page 63
Figure 13 : Perception des risques – Schéma constructiviste – Pages et al. 1988………..page 72
Figure 14 : Exemple d’information donnée au public lors des campagnes
d’information de la Préfecture de l’Isère et du CNPE de St Alban – 2016…………………...page 76
Figure 15 : Diagramme d’un programme évolutif d’exercices
Ministère de l’Intérieur – 2008…………………………………………………………….…………………….page 92
5Liste des abréviations
AFP : Agence France Presse
AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique
ANCCLI : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Informations
ASN : Autorité de Sureté Nucléaire
CLI : Commission Local d’Information
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
CRIIRAD : Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radioactivité
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DGSCGC : Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
INES (échelle) : Echelle internationale de classement des évènements nucléaires
(Intenational Nuclear Event Scale)
IPSN : Institut de Protection et de Sureté Nucléaire
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
MARN : Mission d’Appui à la gestion du Risque Nucléaire
OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PUI : Plan d’Urgence Interne
REP : Réacteur à Eau Pressurisée
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
UNGG : Uranium Naturel Graphite Gaz
6Table des matières
Préambule…………………………………………………………………………………………………………………………page 11
La société moderne et ses contraintes de sécurité…………………………………………………….…………..page 11
Quelle est la place du nucléaire dans la sécurité globale ?.........................................................page 13
Introduction……………………………………………………………………………………………………………………..page 15
Le nucléaire français, ou en est-on aujourd’hui ?.......................................................................page 15
A quoi peut-on s’attendre en terme d’impact sur la population et sur l’environnement
en cas d’accident nucléaire majeur sur un CNPE ?....................................................................page 15
Les acteurs, vecteurs d’information et de désinformation…………………………………….……………….page 18
1ère partie :
Le comportement de la population face aux situations de crise………………..page 20
1. Une étude de cas : l’incendie du dépôt d’engrais de Nantes le 29 octobre 1987
Une première en France dans l’évacuation massive des populations…………………………page 20
1.1 Le contexte général du site et de son environnement………………………………….………page 20
1.1.1 Etat des lieux du stockage de l’entreprise le 29 octobre 1987…………….…page 21
1.1.2 Le contexte réglementaire de l’entreprise en 1987………………………….……page 22
1.2 Une situation accidentelle qui évolue vite en situation de crise……………………..…….page 22
1.2.1 Les premières actions……………………………………………………..…………………….page 22
1.2.2 Constitution d’une cellule de crise…………………………………………………………page 23
1.3 La gestion de l’évènement par les autorités…………………………………..…………………….page 25
1.3.1 L’organisation des secours en 1987………………………………………….…………..page 25
1.3.2 La gestion proprement dite………………………………………………..…………………page 26
1.4 Pourquoi un déclenchement du Plan ORSEC ?.........................................................page 28
1.4.1 Les raisons historiques………………………………………………………….………………page 28
1.4.2 Les informations en possession des autorités………………………………..……..page 29
1.5 Que pouvons-nous en retenir ?................................................................................page 30
1.5.1 La remontée d’information et la perception des enjeux……………………....page 30
1.5.2 La problématique d’information de la population………………………………...page 30
2. Le comportement de la population, aide ou gène dans la gestion de crise ?.................page 31
2.1 Faire face à une situation de crise…………………………………………………………………………page 31
72.1.1 Qu’est-ce qu’une crise ?.............................................................................page 32
2.1.2 Le cycle de vie d’une crise…………………………………………………..………………….page 32
2.2 Le management des situations de crise…………………………………………………………………page 34
2.2.1 Les premières modélisations………………………………………………………..………..page 34
2.2.2 Le modèle 3D……………………………………………………….………………………………..page 34
2.3 La place de l’humain dans la gestion de crise………………………………………………………..page 36
2.3.1 L’acronyme « HOME »………………………………….…………………………….………….page 36
2.3.2 Le volet humain……………………………………………………………………………..………page 36
2.4 Le comportement des populations en situation de crise…………………………….…………page 37
2.4.1 Typologie des comportements humains……………………………….……………….page 37
2.4.2 Les différentes postures des individus…………………………………………………..page 39
2.5 L’auto-organisation de la population en situation de crise…………………………….………page 40
2.5.1 Des difficultés d’approche……………………………………………………………………..page 41
2.5.2 Une phase indispensable, la rupture d’équilibre…………………………………….page 41
3. Peut-on appliquer ces phénomènes à un accident nucléaire majeur sur le territoire
français ?..........................................................................................................................page 42
3.1 L’absence de retour d’expérience sur le territoire français………………………….…………page 42
3.1.1 La caractérisation des évènements, l’échelle INES……………………………….…page 42
3.1.2 L’accident de St Laurent des Eaux en 1980……………………………………………..page 43
3.2 La préparation de la crise nucléaire vu par les pouvoirs publics et les exploitants….page 44
3.2.1 Plus de 30 années de sûreté nucléaire………………………………………..………….page 44
3.2.2 Des avancées notables depuis les années 2000………………………………………page 45
3.3 La prévention et le contrôle des installations…………………………………………..…………….page 46
3.3.1 L’autorité de Sureté Nucléaire………………………………………………………………..page 46
3.3.2 L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire………………………………page 47
3.4 Les outils de planification actuelle pour gérer une situation d’exception de nature
radiologique………………………………………………………………………..………………………………………page 47
3.4.1 Les outils prévisionnels…………………………………………………………..………………page 47
3.4.2 Les outils opérationnels………………………………………………..………………………..page 48
3.5 La communication française face aux accidents nucléaires internationaux :
l’évolution des discours……………………………………………………………………………………………….page 55
3.5.1 La crédibilité et les compétences……………………………………………………………page 55
3.5.2 Le rôle des mouvements antinucléaire…………………………………..………………page 57
3.5.3 Le discours des exploitants…………………………………………………………..………..page 58
82ème partie :
La perception du nucléaire influence-t-elle les individus ?...............................page 62
1. Tchernobyl : perte de la confiance de la population envers les décideurs ?...................page 62
1.1 L’impensable devient soudain réalité……………………………………………………………………page 62
1.1.1 L’installation nucléaire « Lénine »………………………………………………….……….page 62
1.1.2 L’engrenage tragique………………………………………………………………………………page 62
1.2 La communication autour de l’accident…………………………………………………..…………….page 64
1.2.1 Le panache radioactif au-dessus de la France…………………………..…………….page 65
1.2.2 Une communication désastreuse………………………………………..………………….page 65
1.2.3 Les controverses et les polémiques autour du panache radioactif……….…page 66
1.3 Quelles conséquences sanitaires sur le territoire français ?......................................page 68
1.3.1 Augmentation du nombre de cancers de la Tyroïde ?...............................page 68
1.3.2 Des estimations imprécises…………………………………………………………………….page 69
1.4 La position des autorités, controverse et perte de confiance…………………………………page 70
1.4.1 Le temps des mises en examen……………………………………………….……………..page 70
1.4.2 Le débat reste d’actualité…………………………………………………………..…………..page 71
2. La perception du risque nucléaire en France aujourd’hui………………………….………………..page 71
2.1 Le nucléaire et les français…………………………………………………………………………………….page 71
2.1.1 Les facteurs propre à l’individu…………………………………………….…………………page 71
2.1.2 Le « Baromètre IRSN »…………………………………………………………………..……….page 73
2.2 Les efforts de communication, d’information et de concertation de la population..page 75
2.2.1 L’information par les exploitants……………………………………………….……………page 75
2.2.2 L’information par les autorités……………………………………………….………………page 76
2.2.3 L’information par les autorités de contrôle et les experts (ASN et IRSN)…page 77
2.2.4 L’information par les Commissions Locales d’Informations (CLI)…………....page 78
2.3 Pourquoi ce défaut d’implication de la population sur le risque nucléaire ?............page 79
2.3.1 L’irrationalité du risque………………………………………….………………………………page 79
2.3.2 La perte de confiance des autorités et des exploitants…………………………..page 80
2.3.3 Les aspects secrets et cachés de l’industrie nucléaire…………………..………..page 81
2.3.4 Le fatalisme autour du risque nucléaire………………………………………………….page 81
3. Des pistes de travail…………………………………………………………………………..………………………..page 82
3.1 L’information du public en amont…………………………………………………………………………page 82
3.1.1 L’aspect réglementaire et les obligations……………………………..………………..page 82
3.1.2 Une information transversale…………………………………………………………………page 83
93.2 Quel message délivrer ?.............................................................................................page 83
3.2.1 Une sensibilisation indispensable…………………………………………………………..page 83
3.2.2 Sur quels aspects doit porter la sensibilisation ?........................................page 83
3.2.3 Qui doit informer ?.....................................................................................page 85
3.2.4 Comment informer efficacement ?........................................................page 86
3.3 Gagner la confiance de la population……………………………………………………………..……..page 86
3.3.1 La transparence avec la Loi 2006-686 du 13 juin 2006, dite Loi « TSN »….page 86
3.3.2 L’implication de la population par le biais des CLI…………………..………………page 87
3.3.3 L’expertise indépendante………………………………………………..……………………..page 88
3.4 Mieux préparer la population à un accident nucléaire majeur……………………………….page 88
3.4.1 La communication…………………………………………………………………..……………..page 88
3.4.2 La pérennisation des discours et de l’information de la population………..page 90
3.4.3 S’entrainer avec des exercices appropriés…………………………………..………….page 91
Conclusion…………………………………………………………………………………………………………………………..page 93
Le nucléaire « made in France »……………………………………………………………………………..………………..page 93
Des axes de progrès à développer……………………………………………………………………………………………page 95
Les limites de l’étude et de nouvelles perspectives………………………………………………………………….page 96
10Préambule
La société moderne et ses contraintes de sécurité :
La société actuelle, complexe, pluridisciplinaire, multiculturelle en pleine évolution et changements,
se transforme. Une des principales inquiétudes des citoyens composants les sociétés modernes
occidentales fortement industrialisées est la question de la place de sa sécurité au quotidien.
De tous temps, l’homme a cherché à assurer sa propre sécurité. Mais que cache le véritable sens du
mot « sécurité » ? Qu’entend-on par ce terme faisant partie du langage courant ? Le sentiment de
sécurité chez les individus correspond, selon sa définition littéraire, à « une situation dans laquelle
quelqu’un ou quelque chose n’est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d’agressions
physique, d’accidents, de vol ou de détérioration ». En d’autres mots, le sentiment de sécurité chez
les individus correspond à une situation, un sentiment, où l’être se sent à l’abri d’un danger, où il se
sent rassuré.
Depuis la nuit des temps, le sentiment de sécurité fait partie intégrante de la survie des individus.
Durant la Préhistoire, le besoin de sécurité de l’homme résidait principalement dans l’interaction
qu’il pouvait développer avec son environnement. Sa propre sécurité était assurée par la présence de
nourriture de façon suffisante, par la mise à l’abri et la protection de son foyer des intempéries et
des agressions extérieures, qu’elles soient de d’origines naturelles, animales ou humaines.
Dans l’antiquité, le mot sécuritas en latin issu du mot securus, « libre de soins et de soucis » signifiait
« absence de souci, la tranquillité, la sureté » (Née, 2009).
La perception des dangers et des menaces chez l’homme et le sentiment d’insécurité, évolue très
vite au cours des siècles. De la préhistoire jusqu’à la fin du XVIIème siècle, les fléaux et catastrophes
étaient considérés comme une punition divine. Les hommes acceptaient ces calamitées, comme une
fatalité, sans pour autant agir pour les éviter, puisque ces évènements étaient une punition de la
main du ou des Dieux. La croyance en Dieu, la bonne conduite et les prières pouvaient uniquement
conduire à une protection salvatrice afin de se sentir en sécurité.
A partir du siècle des Lumières, au début du XVIIIème siècle, le courant de pensée littéraire et culturel
en vogue à cette époque, chez les intellectuels et les philosophes, était d’encourager les sciences et
les échanges de pensées s’opposant ainsi à la superstition, à l’intolérance et aux abus de l’Eglise. Les
origines mystiques des calamités, famines, intempéries, séismes, déluges, maladies et guerres
commencent à disparaitre dans les esprits de chacun. Nous pouvons de ce fait devenir acteur pour
éviter ces phénomènes catastrophiques qui ne sont plus, dans la pensée collective, une fatalité
punitive. La perception de la sécurité va elle aussi évoluer en associant l’idée de prévention des
risques, c’est-à-dire d’instaurer une volonté de mieux les comprendre, avec les avancées de la
science, pour mieux les appréhender et ainsi mieux s’en protéger.
D’une manière générale, le sentiment de sécurité des individus est un sentiment indispensable à la
vie et au maintien psychologique apaisé de l’état mental. Il participe grandement au bien-être de
l’homme dans sa globalité.
11En 1970, le psychologue Abraham Maslow1 a d’ailleurs hiérarchisé le sentiment de sécurité et de
protection de l’espèce humaine en seconde position de sa pyramide des besoins fondamentaux,
juste après les besoins physiologiques et biologiques vitaux. Le besoin de sécurité et de protection,
de sécurité physique et psychologique implique un environnement social, familial et professionnel
stable et prévisible, sans anxiété ni crise, sans agressions extérieures.
Par conséquent, assurer la sécurité revient en réalité à tenter de répondre, à une somme de
sentiments individuels.
Qu’en est-il aujourd’hui de la sécurité dans notre société moderne ?
Définissons tout d’abord ce qu’est une société moderne.
Une société moderne est un terme des sciences sociales défini par le sociologue Émile Durkheim2
décrivant un type de société particulière par opposition à la société traditionnelle. La société
moderne, orientée vers le changement et le progrès, se caractérise par trois grandes idées qui sont
l’unité, la liberté et enfin l’efficacité de l’activité humaine.
L’unité : les hommes sont « désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux,
techniques, culturels ».
C’est ce que nous appelons la « mondialisation » ou la « globalisation » : les évolutions techniques
paraissent conduire inéluctablement à une interdépendance entre les hommes jamais connue ni
même imaginée jusque-là.
La liberté : au XXème siècle, surtout au sortir des deux guerres mondiales, elle est devenue la grande
revendication des hommes, de tous les hommes dans tous les peuples et dans tous les domaines de
leur existence : liberté morale, liberté économique, liberté sociale et politique.
Les hommes ne veulent plus être conduits comme des enfants mineurs, en aucun domaine.
À la source de ces deux caractéristiques de notre société moderne, un fait décisif : l’incroyable
efficacité de l’activité humaine.
L’homme moderne ne se contente plus de supporter son sort en tâchant de l’améliorer comme il
peut, parfois, souvent, au détriment des autres.
Cette société moderne dans laquelle nous vivons, est en adéquation avec le monde actuel, global,
complexe et interdépendant.
Nous allons donc parler de sécurité globale, qui se veut comme le monde actuel, complexe et
interdépendant.
La sécurité globale se déploie sur l’ensemble des activités qui fondent les bases de notre société. Elle
comprend la sécurité sanitaire, la sécurité civile, la sécurité sociale, la sécurité publique, la sécurité
environnemental, la sécurité nationale, la sécurité politique, la sécurité humaine, ou bien encore la
sécurité économique.
1
Abraham MASLOW (1908-1970) psychologue américain considéré comme le père de l’approche humaniste.
2
Emile DURKHEIM (1858-1917) sociologue français considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie moderne
12Selon le Professeur LACLEMENCE3 (2005) l’approche globale de la sécurité se caractérise par des
réponses qui s’inscrivent dans « une triptyque sécuritaire : l’urgence égalitaire, la proximité affective
et la sûreté permanente ». L’urgence égalitaire est de l’ordre institutionnelle, la proximité affective
de l’ordre social et territorial et enfin la sûreté permanente est du ressort de la science et des
avancées technologiques.
Le progrès et les avancées technologiques ont permis d’anéantir un certain nombre de risques. Nous
sommes de mieux en mieux armé pour faire face aux catastrophes naturelles, ou bien encore pour
faire face aux maladies qui ont pour certaines disparues de notre monde moderne. Pourtant, nous
n’avons jamais été aussi préoccupés par les risques qui subsistent. Le sentiment de vivre aujourd’hui
dans un monde plus dangereux qu’il n’était autrefois est relativement courant (Slovic, 1987, Beck
1999 et 2001). Nos sociétés modernes cherchent à atteindre le plus haut niveau de sécurité en
voulant à tout prix se rapprocher du risque « 0 » de manière très utopique. En contrepartie, le
développement économique et les avancées technologiques vont bien sûr aider à éliminer un certain
nombre de risques, mais vont aussi générer paradoxalement un accroissement de ceux-ci. Le
développement de nos systèmes d’information et de communication permet un partage des
connaissances mais va aussi générer la diffusion et l’amplification des peurs individuelles, face à ces
nouveaux risques et nouvelles menaces.
Retenons avec ces quelques définitions que dans le monde complexe dans lequel nous vivons, la
sécurité ne peut en aucun cas être unilatérale, elle doit s’inscrire dans une organisation complexe,
multi champs d’action, dépassant toutes les frontières et les organisations. La sécurité s’inscrit sous
toutes ces formes et sous tous les volets de la société, dans un monde où l’information est
universelle et extrêmement rapide, et de ce fait difficilement contrôlable.
Quelle est la place du nucléaire dans la Sécurité Globale ?
La France a lancé son programme nucléaire civil à partir de 1958. Cet ambitieux programme électro
nucléaire a débuté par la construction et l’exploitation de 1963 à 1971 de 6 réacteurs Uranium
Naturel Graphite Gaz (UNGG). Les conflits géopolitiques du monde arabe comme le conflit israélo-
palestinien, la guerre du Kippour en 1973 et le premier choc pétrolier d’octobre 1973 mettent
brutalement en évidence la dépendance énergétique des pays occidentaux et leurs fragilités à une
période où notre pays connaissait une formidable croissance économique. Les avancées de la
recherche sur le domaine de l’atome, ont vite conduit la France à vouloir disposer au plus vite de son
indépendance énergétique.
Les évènements importants se jouant sur l’échiquier international, ont conduit le pouvoir politique
français en place à accélérer encore le programme électronucléaire initié par le Général De Gaulle4.
La filière UNGG, vieillissante et dépassée a conduit le gouvernement en place à se tourner vers une
technologie américaine des Réacteurs à Eau Pressurisés (REP) sous brevet Westinghouse, qui sera
développé sur le territoire par la société Franco-américaine Framatome.
Ce ne sont pas moins de 55 réacteurs nucléaires de technologie REP construits dans la période 1972-
1980 pour atteindre un objectif de production de 55 000 MW. L’exploitation s’opérera par Electricité
de France (EDF) qui décida de créer un parc nucléaire basé sur des réacteurs de même conception.
3
Professeur Patrick LACLEMENCE enseignant, chercheur et Professeur à l’Université Technologique de Troyes
4
Général Charles De Gaulle (1890 – 1970) militaire, résistant, écrivain et homme d'État français.
13La technologie et les retours d’expérience aidant, la filière REP française n’a cessé d’évoluer et de
s’améliorer par différents paliers successifs des Contrats Programmes5, CP0, CPY, P4 et P4’, pour
obtenir une puissance de production de 900 MW, 1300 MW, puis 1450 MW par réacteur.
A ce jour, 58 réacteurs sont en service, répartis sur 19 sites sur le territoire métropolitain qui
représentaient en 2016, 77 % de la production nationale d’électricité soit une puissance de
production de 415 TWh/an.
Le dernier réacteur en construction à ce jour est un réacteur de 3ème génération de type EPR
(European Pressurized Reactor), construit sur le site de Flamanville situé dans le département de la
Manche. Il est une version européenne améliorée du REP de Westinghouse. Sa mise en service est
prévue courant 2018 et atteindra une puissance de production de 1600 MW.
Les réacteurs nucléaires constituent aujourd’hui la première source de production d’électricité en
France. Au nombre de 58, ces unités se situent à proximité des sources de refroidissement, en bord
de mer ou sur les rives des principaux fleuves français. Le parc actuel est composé de 34 réacteurs de
900 MW, 20 réacteurs de 1300 MW et 4 réacteurs de 1450 MW.
Carte des centrales nucléaires en France. - Wikimedia Commons
La France, outre les réacteurs de production d’électricité a également développé une industrie
nucléaire assez importante, notamment la filière d’enrichissement et de fabrication du combustible
et de retraitement des déchets. D’autres sites sont également présents sur le territoire français, les
réacteurs de recherche, les sites d’expérimentations, les anciens sites en déconstruction… Ces
industries possèdent leurs propres risques, souvent liés à de l’industrie chimique, comme c’est le cas
sur la filière d’enrichissement de l’Uranium sur les usines AREVA de Tricastin. Ces installations sont
bien définies comme des installations dites « à risques » au sens de leur classement réglementaire en
Installations Nucléaires de Base (INB) et soumises aux études de danger. Elles doivent disposer d’un
Plan Particulier d’Intervention (PPI). Les rayons de danger de ces sites, bien que conséquent, sont
bien inférieurs aux périmètres de danger des centrales nucléaires, qui sont à ce jour de 10 Km, et qui
vont selon les préconisations du Plan National Interministériel de réponse à un accident nucléaire ou
5
Contrat Programme : Il s’agit d’évolutions dans la conception même des réacteurs, prenant en compte le retour
d’expérience et les évolutions technologiques pour l’amélioration de la sureté.
14radiologique majeur (n°200/SGDN6/PSE/PSN-édition février 2014), prochainement être augmenté sur
un rayon de 20 Km.
Nous voyons bien ici par ce bref historique de la construction de l’industrialisation du nucléaire
français, la place de cette industrie dans notre société occidentale moderne qui, en pleine croissance
et expansion économique début des années 70, recherche à tout prix, au vu du contexte
géopolitique de cette période, son indépendance énergétique.
6
SGDN : Secrétariat Général de la Défense Nationale.
15Introduction
Le nucléaire français, ou en est-on aujourd’hui ?
Malgré la forte place du nucléaire français à l’échelle mondiale à la fin du XXème siècle, et des
retombées économiques florissantes pour notre pays, l’industrie du nucléaire français va petit à petit
perdre son blason doré. Sous la pression d’une partie de l’opinion public, des organisations anti-
nucléaires, et de l’actualité qui nous a montré que des accidents nucléaires majeurs étaient possibles
(Kychtym – URSS – 1957, Three Mile Island -EU- 1979, Tchernobyl – Ukraine - 1986, Fukushima
Daiichi – Japon – 2011), la France comme un bon nombre d’autres pays développés se pose la
question de l’avenir de la filière énergétique nucléaire et de son mode de remplacement progressif
par des énergies renouvelables, plus écologiques et surtout moins dangereuses.
Ainsi, la Loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
prévoit de diminuer de 75 à 50 % la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité
nationale. En admettant pour atteindre cet objectif un arrêt et démantèlement futur d’une partie du
parc de nos réacteurs à eau pressurisée (REP), ces installations en fin de vie représenterons même à
l’arrêt, des risques qu'il conviendra de maîtriser. Les matières radioactives doivent être évacuées,
l'installation déconstruite, puis décontaminée et les matériaux stockés en sites spécialisés.
Aujourd’hui, l’exploitation de l’énergie nucléaire divise les français, et selon les orientations
politiques des différents gouvernements, les perspectives de durée d’exploitation des sites restent
incertains. Nous pouvons être pour ou contre l’énergie nucléaire, mais peu importe notre opinion sur
la question, l’énergie nucléaire est bien présente sur notre territoire et il faut vivre avec elle.
A quoi peut-on s’attendre en terme d’impact sur la population et sur
l’environnement en cas d’accident nucléaire majeur sur un CNPE ?
Selon la Loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la Transparence et à la Sureté Nucléaire, dite Loi TSN,
la sureté repose sur quatre grands principes :
- La maîtrise de la réaction en chaine
- Le refroidissement du combustible
- Le confinement de la radioactivité
- La protection des populations
Les scenarii historiquement considérés comme les plus graves et les plus préoccupants sont sans nul
doute les accidents de fusion du cœur. Cette fusion peut intervenir après une élévation importante
de température des matériaux constituants le cœur. Elle est la conséquence d’une ou plusieurs
défaillances des systèmes de refroidissement par le fluide caloporteur. Ce type d’accident ne peut
intervenir qu’à la suite d’un grand nombre de dysfonctionnements, ce qui rend sa probabilité très
faible, de l’ordre de 1 pour 106 (objectif probabiliste global défini en 1977 et 1978 par le Service
Central de Sureté des Installations Nucléaires (SCSIN) pour la survenue de « conséquences
inacceptables »).
16Vous pouvez aussi lire