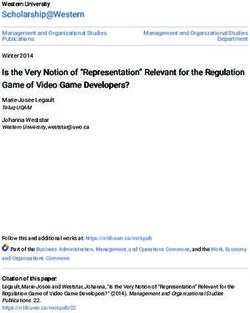Emplois précaires, emploi normal et syndicalisme
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Emplois précaires,
emploi normal et syndicalisme
Christian DUFOUR, Adelheid HEGE
P our nous intéresser aux relations
entre les formes d’emploi atypiques et les
té des pays et de leurs populations acti-
ves, pour qui la formalisation de l’activité
syndicalismes, nous retenons les situa- économique et l’amélioration des condi-
tions de neuf pays. Sept d’entre eux sont tions de travail les plus primaires sont en-
européens, mais tous comptent parmi le core des objectifs 1. La thématique de
petit nombre de pays à l’économie ancien- l’insécurisation ne se confond pas avec
nement développée. Le salariat s’y est pro- celle de l’acquisition de garanties mini-
gressivement imposé comme la forme do- mum des travailleurs(ses) engagé(e)s
minante d’intégration de la population dans l’acte productif, même si elles peu-
dans la vie économique et sociale. Dans vent se rejoindre ou se côtoyer.
chacun de ces pays, la présence syndicale La thématique de l’insécurisation des
est ancienne et les organisations de sala- statuts dans l’activité professionnelle se
riés s’y sont toutes attachées, au cours de pose si, préalablement, la sécurisation des
longues décennies, à développer des systè- parcours individuels et collectifs par son
mes de sécurisation de l’emploi. Ce sont intermédiaire a été construite comme une
ces systèmes qui sont aujourd’hui mis en norme sociale pratique pour un effectif si-
question. gnificatif de salariés et comme une norme
atteignable et désirable pour les autres.
La sécurisation Cela ne signifie pas que cette norme a été
de l’emploi en question acquise pour l’ensemble des salariés, ni
On s’intéresse ici à des pays où la for- même pour la grande majorité d’entre
malisation de l’activité économique est eux. Dans les neuf pays sous revue dans
très avancée, même si parfois des zones ce numéro spécial de la Chronique inter-
incertaines subsistent (travail au noir). La nationale, l’une des contributions essen-
formalisation des relations d’emploi via tielles des syndicats, au long d’un effort
un accès officialisé au salariat y constitue historique, a précisément consisté à impo-
une norme sanctionnée juridiquement et ser cette thématique, à en faire un élément
socialement. On ne se trouve pas dans la de structuration sociale, et à la faire re-
situation décrite par l’OIT pour la majori- connaître comme un bien collectif.
1. ILO (2005) « Global Employment Trends », February.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 5EMPLOIS PRECAIRES ...
Les normes d’emploi ainsi produites Garanties d’emploi et modèles
au long de plusieurs décennies d’âpres de relations professionnelles
conflits, et défendues par les syndicats re-
posent sur des arrangements profondé- Dans les pages qui suivent, on entre
ment différents les uns des autres. Les dans les débats nationaux en privilégiant
différences entre les pays portent sur trois l’implication des syndicats et les consé-
points principaux : quences pour eux des évolutions qu’ils
D’abord, les modes d’accès aux ga- connaissent ; on propose une typologie
ranties de sécurisation individuelle et col- des situations nationales à ce sujet. On
lective. Certains pays relèvent d’un mode tente ensuite de comprendre pourquoi la
« universaliste », avec une visée d’inté- question des garanties d’emploi, de leur
gration générale du salariat, jouant à la structuration et de leurs évolutions oc-
fois sur les statuts individuels (dans les cupe une place aussi décisive dans le de-
secteurs privé et public) et la protection venir syndical.
sociale généralisée. La deuxième diffé- La sécurisation des emplois est, dans
rence tient à l’extension de la sécurisation ces neuf pays, une priorité pour les syndi-
des emplois. Dans certains pays, elle est cats. Mais ils ne parviennent pas tous à
la règle et souffre des exceptions. Dans conserver, dans les évolutions en cours,
d’autres pays, elle est un avantage parti- les places qu’ils avaient acquises dans
culier de certaines situations d’emploi. La une phase antérieure de construction des
troisième différence se repère dans le rôle normes aujourd’hui mises en cause. Les
confrontations auxquelles ils sont soumis
des organisations syndicales en la ma-
sont inégales mais leurs résultats sont
tière. Il est toujours essentiel, mais il
partout significatifs de l’évolution des
passe par des interventions variées,
statuts des syndicalismes dans leurs pays
comme par exemple les niveaux de négo-
respectifs. Pour la clarté de l’exposé, on
ciation plus ou moins centralisés concer-
distingue ci-après respectivement les cas
nant ce thème, et il s’intègre dans des des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
configurations sociales variées, mettant puis des pays européens continentaux, et
directement en relation le syndicalisme et enfin du Japon.
le politique.
Les combinatoires entre ces trois li- Les systèmes étatsunien
gnes de partage donnent naissance à des et britannique inégalement affaiblis
objets nationaux originaux. Du coup, si le Dans ces deux pays, traditionnelle-
thème de la sécurisation (et donc de l’in- ment, les protections législatives et les ju-
sécurisation) du salariat est international, risprudences tissent un filet plus ou moins
les débats à son sujet s’ordonnent autour lâche de recours contre les renvois abu-
de formes et d’enjeux spécifiquement na- sifs mais sans proposer une sécurisation
tionaux. générale des emplois 1. Le niveau de sé-
1. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la question de l’insécurisation de l’emploi est surtout
abordée sous les vocables de bad jobs ou de job insecurity. Le terme de précarité commence à
s’y infiltrer : « Precarity is just another term for job insecurity or casual labour », trouve-t-on
synthétisé sur un forum militant consacré à ce thème. Http://en.internationalism.org/wr/
285_precarity.html
6 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
curité est alors directement corrélé à la sation. Et de fait, dans ces deux pays, la
présence syndicale sur les lieux de travail. déréglementation est passée par une con-
Les accords collectifs négociés se carac- frontation directe entre les partisans
térisent en particulier par la précision des d’une libéralisation du marché du travail
régimes de maintien en emploi des diffé- et les acteurs qui représentaient la perpé-
rentes catégories de salariés inclus dans tuation d’un modèle social partiel dans
l’accord. Le syndicat joue un rôle actif et son extension mais prégnant dans ses ef-
direct dans l’établissement et le contrôle fets sociétaux. Dans les années 1980, les
des règles de sécurisation des emplois. politiques des gouvernements Reagan et
Le principe du last in, first out vise à Thatcher – compris ici comme les met-
organiser les salariés lorsque des licencie- teurs en scène d’évolutions qui ne se limi-
ments interviennent, avec une hiérarchie t ent pas au s eul cadr e pol i t i que –
précise des départs et des rappels en em- connaissent des développements parallè-
ploi, liée généralement à l’ancienneté et à les dans leurs efforts de marginalisation
la qualification. La protection contre les des syndicats. Ces politiques sont aidées
renvois, les conditions d’introduction de (sinon incitées) par les restructurations
travailleurs à statuts spécifiques sur les si- économiques qui atteignent en priorité les
tes inclus dans l’accord constituent des industries anciennes de l’ère fordiste où
éléments clés de la négociation. Leurs les syndicalismes avaient installé leurs
spécifications, très variables, font la dif- bastions. Elles procèdent par des attaques
férence entre sites syndiqués et sites non directes contre des symboles des régimes
syndiqués, mais aussi entre les sites syn- syndicaux : les contrôleurs aériens aux
diqués eux-mêmes. La zone d’extension Etats-Unis (1981) trouvent leur pendant
de ces accords correspond à la taille de avec les mineurs en Grande-Bretagne
l’unité pour laquelle ils sont signés, mais (1984-1985) où sera adoptée une série de
ils peuvent en outre exercer un effet d’en- législations restrictives du droit syndical.
traînement implicite sur des pratiques pé- Il s’agit dans l’un et l’autre cas pour le
riphériques. Dans leurs phases les plus pouvoir politique de rompre avec la place
dynamiques, les syndicalismes étatsunien acquise par le syndicalisme, au-delà de
et britannique bâtissent leur statut sociétal ses implantations effectives.
sur cette capacité de normalisation indi- Vingt ans après le début de cette pé-
recte du marché du travail à partir de leurs riode, le syndicalisme étatsunien n’a pas
bastions. trouvé de réponse satisfaisante au défi qui
Dans ces deux pays, où il existe une lui a été posé. « Pénalisé par des mécanis-
corrélation immédiate entre présence mes de représentativité fondés sur un lieu
syndicale et garantie d’emploi construite, de travail fixe, une organisation indus-
les prescriptions réglementaires en ma- trielle … et des procédures de syndicali-
tière de protection du travail sont faibles. s at i on t r ès l our des auxquel l es l es
Il n’est donc pas nécessaire de s’en em pl oyeur s peuvent f aci l em ent
prendre aux textes pour modifier les s’opposer » 1, il souffre de graves dissen-
structures des marchés du travail. La dé- sions internes, d’un niveau d’adhésion
régulation va de pair avec la désyndicali- historiquement faible (Sauviat, 2005) et
1. Yannick Fondeur, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 7EMPLOIS PRECAIRES ...
ne semble pas en mesure de s’implanter dernière édition du Workplace Employ-
auprès des salariés à nouveaux statuts. ment Relations Survey (WERS) sur les
Les salariés des Etats-Unis doivent au- pratiques au sein des entreprises montre
jourd’hui compter sur un mince filet lé- que « la place grandissante de méthodes
gislatif de protection individuelle contre de communication directes entre mana-
les licenciements et sur le dynamisme du gers et salariés … répond au déclin des
marché du travail pour assurer leur par- formes de représentation collective » 2. Si
cours professionnel. « Outre-Atlantique, les salaires restent une prérogative (bien
un taux de chômage très bas est la condi- que contestée par un nombre croissant
tion sine qua non de l’acceptabilité so- d’employeurs) de la négociation collec-
ciale du système » 1. Le syndicalisme tive, il n’en va pas de même des garanties
étatsunien se trouve à une époque particu- d’emploi qui deviennent de plus en plus
lièrement difficile de son existence, l’apanage de la confrontation directe
même si certains pensent pouvoir lui pré- entre employeurs et salariés. De multiples
dire une convalescence proche (Turner, régimes d’emploi se côtoient sans s’inter-
2005). pénétrer.
Le syndicalisme britannique a connu Du coup, le syndicalisme doit tenter
lui aussi des coupes sombres dans ses de se développer dans une série de grou-
rangs, particulièrement au cours de la pé- pes spécifiques dont il devient de plus en
riode de gouvernement conservateur plus difficile de percevoir la cohésion.
(1979 à 1997) inauguré par Mrs. Thatcher « Ces derniers sont le plus souvent saisis,
(Edwards et alii, 1998). La succession du non pas dans leur identité corporative de
blairisme au thatchérisme a accordé un métier », celle qui fondait le syndicalisme
sursis au syndicalisme plus qu’un refuge. britannique historique, « mais dans leur
Le néo-travaillisme fait le pari d’une in- identité sociale ou catégorielle : les fem-
sertion de la Grande-Bretagne dans la mes, les migrants les jeunes … ou
concurrence internationale via un surcroît … dans leurs statuts d’emploi … ou en-
de compétitivité sur les marchés du tra- core dans leur condition sociale » 3. Si ce
vail, notamment face à l’Europe conti- grand écart est parvenu à freiner la perte
nentale. d’adhérents, il n’a pas encore montré
La dérégulation est donc une re-régu- qu’il était capable de redonner au syndi-
lation, opérée sur des bases qui ne s’en- calisme une place sociétale centrale. La
combrent pas de la représentation persistance du conflit entre le New La-
syndicale. Cette dernière parvient au- bour et le TUC symbolise cette confron-
jourd’hui à se maintenir aux alentours de tation dans laquelle le politique impose
27 % des salariés, essentiellement du fait au syndicalisme une régression de son es-
des implantations dans des services pu- pace de représentation sociale en lui dé-
blics en pleine phase de recrutement. La niant toute prétention à exprimer plus
1. Ibid.
2. IRS Employment Trends (2005), « Evolution, not revolution – the changing face of the
workplace », IRS Employment Review, 832, September, pp.8-15.
3. Florence Lefresne, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
8 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
qu’une série de groupes partiels, promis des premiers actes du gouvernement so-
pour certains d’entre eux au déclin démo- cialiste élu en avril 2004 en Espagne
graphique (Dufour, 2005). consiste à signer avec les organisations
syndicales une déclaration sur « la com-
Le cœur du modèle
pétitivité, l’emploi stable et la cohésion
social européen
sociale » (Vincent, 2005). Dix-huit mois
Les six pays d’Europe continentale plus tard, la difficile acceptation de réfor-
retenus pour la comparaison (Italie, mes gouvernementales concernant les
Espagne, Danemark, Suède, Hollande, systèmes de protection contre le chômage
Allemagne) ont pour caractéristique com- et les règles de licenciement connues
mune de disposer de règles d’emploi à comme « Agenda 2010 » conduisent à
prétention universaliste. Ils se distinguent une élection législative anticipée en Alle-
en cela des Etats-Unis, de la Grande-Bre- magne et à un changement de coalition
tagne et du Japon. Les règles s’appliquent
(Hege, 2005). Les débats menés dans le
à tous, par la loi et/ou la négociation col-
cadre politique et syndical européen (pac-
lective.
tes sociaux, stratégie de Lisbonne, etc.)
Dans ces pays, qui forment le cœur de
donnent un écho parfois confus aux dé-
ce que l’on a dénommé parfois le modèle
bats en cours sur les compromis natio-
social européen avant l’élargissement de
naux 1.
l’Union européenne, les dérégulations
Ces pays de l’Europe continentale ont
passent par les évolutions et la multiplica-
tion des formes d’emploi non standard en commun de disposer de systèmes com-
plus que par la remise en cause directe de plexes de protection du travail salarié.
la place des syndicalismes ou la contesta- Ces systèmes se construisent autour de
tion des normes de l’emploi stan- trois pôles : une protection sociale
dard (OCDE, 2004). Les traditions étendue 2, une législation sur le travail et
sociales- ou chrétiennes-démocrates héri- des principes de négociation collective
tées de l’après-guerre y jouent encore, qui relativement centralisés. Ils se différen-
se fondaient sur la double légitimité des cient les uns des autres par les ouvertures
représentations politiques et syndicales, qu’ils reconnaissent à chacun des angles
spécifiquement en matière de sécurisa- du triangle formé par ces trois pôles.
tion sociale. Aujourd’hui ces coalitions Soutenues par une imagination so-
souffrent toutes de ratés qui se transfor- ciale fertile, les transformations des régi-
ment dans certains cas en franches remi- mes d’emploi dans ces six pays au cours
ses en question. En tout état de cause, les des vingt dernières années sont d’une as-
régulations du travail y sont objets d’en- sez grande complexité technique. Là s’ar-
jeux électoraux portant explicitement sur rêtent les similitudes. Pour le reste, des
les caractéristiques nationales du modèle divergences substantielles se font jour,
de sécurisation de l’emploi. Ainsi, l’un tant en ce qui concerne la nature des
1. On pourrait sans doute ranger les référendums français et hollandais sur la constitution
européenne dans cette série d’avertissements électoraux.
2. Dans les pays nordiques, selon Hans Jensen et Jorn Neegaard Larsen, « the Welfare State is
characterised by its universalism ». Le premier auteur est président de LO et le second
directeur général de la confédération des employeurs. Cf. Jensen, Larsen (2005).
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 9EMPLOIS PRECAIRES ...
changements que la place réservée aux Dans cette configuration, les syndi-
organisations syndicales dans ces trans- cats se donnent comme les gagnants
formations. d’une opération au centre de laquelle ils
Trois cas de figure peuvent être rete- se trouvent. Confortés dans leur rôle so-
nus dans les évolutions récentes si l’on ciétal, ils établissent une étroite corréla-
s’intéresse spécifiquement au rôle syndi- tion entre la centralité de ce rôle et la
cal. possibilité pour le système de conserver
ses aspects dynamiques. Cela justifie
Des modèles syndicaux respectés leurs oppositions à des réglementations
sinon confortés :
de niveau européen sur ce sujet 2. Avec
Danemark, Suède, Pays-Bas
les employeurs, ils expriment des craintes
Le cas danois sert d’étalon à la géo- contre les risques d’exclusion de certai-
métrie sociale internationale en obtenant nes catégories. Ils s’inquiètent du devenir
le statut (temporaire ?) de triangle d’or. A des 900 000 personnes âgées de 15 à 65
la différence de ses homologues conti- ans qui perçoivent une allocation à un
nentaux, y compris la Suède, le Dane- titre ou un autre des autorités publiques.
mark s’est réorganisé à partir des années Ils n’imaginent cependant pas que cette
1980 sur la base d’une « flexibilité du population – 25 % de la population en âge
marché du travail qui se traduit par une de travailler – représente un élément de
grande facilité pour les entreprises de li- corruption du triangle d’or 3.
cencier » 1. Il compense cette ouverture En Suède, les organisations syndica-
par un système de protection sociale actif les « ont progressivement accepté la né-
qui vise à développer en permanence la cessité d’emplois dérogeant au principe
formation des salarié(e)s passant par le de la durée indéterminée ». Mais elles ne
chômage et par une intervention perma- font pas de l’emploi flexible et de sa ges-
nente de la négociation collective. Cet tion leur cheval de bataille. Elles surveil-
équilibre improbable repose tout entier lent particulièrement le développement
sur un « système conçu par les partenaires des emplois intérimaires, pour éviter
sociaux... dépendant d’un partage de qu’ils ne contribuent à « dégrader le ni-
compétences avec le système politique » veau de protection des emplois » 4. C’est
(Jensen, Larsen, 2005). Son efficacité est la raison qui a poussé à intégrer l’intérim
sensible au respect scrupuleux de ce par- dans le système de relations profession-
tage que le parti de droite reconduit ré- nelles au travers des procédures de négo-
cemment au pouvoir respecte. ciation. Cela ne semble pas poser de
1. Christèle Meilland, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
2. Cf. Danish Labour News, n°1, March 2005, p.3.
3. Jensen et Larsen (2005) affirment à ce sujet : « Beaucoup d’entre eux ne sont pas capables
d’exercer un emploi à plein temps pour des raisons de santé par exemple, mais une partie du
problème est aussi la mal-intégration de réfugiés et d’immigrants au Danemark. Immigrants et
réfugiés ont un taux de participation très bas (au marché du travail, N.d.T.), spécialement les
femmes ». Le Danemark compte 5,2 millions d’habitants dont 2 millions résident dans
l’agglomération de Copenhague, la capitale, qui se trouve au centre d’un marché du travail
encore plus large bien que géographiquement restreint.
4. Annie Jolivet, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
10 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
problèmes de fond à un syndicalisme qui les femmes étant spécialement affectées
reste fort à la fois de son taux d’implanta- par des maladies liées à l’usure au tra-
tion, proche de 80 %, avec une syndicali- vail 2.
sation des femmes légèrement supérieure Cette situation menace les statuts in-
à celles des hommes depuis les années dividuels et la protection collective. Si la
1990, et de ses relations avec le parti so- place des syndicats n’est pas ouvertement
cial-démocrate. contestée, LO se préoccupe d’une ten-
Le syndicalisme se veut à l’initiative dance des employeurs à utiliser les con-
sur le marché du travail. LO, le principal traintes internationales pour « jouer les
syndicat, centre sa politique sur l’accès et
salariés les uns contre les autres et affai-
sur le maintien en emploi, conscient qu’il
blir ainsi le syndicalisme ».
doit jouer sur le long terme, pour conser-
Les syndicats hollandais de leur côté
ver son statut de « folkrörelse », terme in-
ont tenté d’apprivoiser une flexi-sécurité
traduisible selon les Suédois et se
rapprochant de la notion de mouvement qu’ils ont négociée en période de hautes
populaire 1. Sa politique consiste moins à eaux de l’emploi. Les restrictions sur la
flexibiliser qu’à vérifier que les normes protection sociale survenues depuis lors,
d’emploi assurent des conditions de vie avec le retour du chômage, ont porté at-
globalement acceptables, au sein d’un teinte à l’image du miracle hollandais et
système socialement protégé où le syndi- des vertus de la négociation collective.
calisme joue un rôle déterminant. Il se fo- « Des personnes … antérieurement dis-
calise en particulier sur l’accès des pensées de chercher à s’insérer profes-
femmes à l’emploi et sur les conditions s i onnel l em ent » s ont auj our d’ hui
dans lesquelles le travail à temps partiel contraintes à se réinsérer sur le marché du
assure leur statut social. travail 3. Les faibles atouts dont elles dis-
D’après LO, une forte progression du posent les exposent à devenir des travail-
travail à temps partiel involontaire a été leurs pauvres. La menace qui pèse sur le
enregistrée au cours de la décennie 1990, système hollandais ressemble à celle qui
précisément celle où les femmes sont de-
est évoquée par les Danois : une perte de
venues plus nombreuses que les hommes
cohérence du système par un affaiblisse-
dans le syndicat. Depuis le milieu de cette
ment de la capacité de récupération dans
même décennie, ce type d’emploi a recu-
lé, mais les femmes sont toujours les pre- le filet de la protection généralisée. La dé-
mières concernées. De même, une forte gradation du système semble déjà à
préoccupation vient de l’effectif des se- l’œuvre. Si elle se poursuivait, les consé-
niors retirés du marché du travail plus tôt quences ne manqueraient pas de porter at-
qu’ils ne le devraient. Selon LO, ce se- teinte à la crédibilité du compromis social
raient 20 % des cols bleus âgés de 50 à 54 et de ses acteurs, surtout si cela devait se
ans et 50 % de ceux qui ont entre 60 et 64 traduire par une évolution du type de celle
ans qui seraient incapables de travailler, retenue dans l’Allemagne voisine.
1. Sven Nelander, « The Trade-Union as a People’s Movement », LO Sweden.
2. www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/291CF2DCAB5F4826C1256F6300507663
3. Marie Wierink, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 11EMPLOIS PRECAIRES ...
Espagne et Italie : ment, les organisations syndicales espa-
hésitations syndicales gnoles souffrent moins que certaines de
L’Espagne et l’Italie méritent une ob- leurs homologues dans (et de) leur parti-
servation parallèle parce qu’elles ont en cipation à la régulation des emplois pré-
commun, et de spécifique par rapport aux caires. Elles n’ont « en effet pas occupé la
autres, de se confronter à des marchés du place centrale d’autres syndicalismes
travail moins globalement formalisés que dans la construction au cours des années
ceux des autres pays pris en compte. Pour 1950-1960 d’un droit à la sécurité de
des raisons historiques différentes, le sala- l’emploi … Leur force ne provient pas de
riat n’y a pas agrégé sous ses auspices des la défense des titulaires de l’emploi stan-
fractions aussi importantes de travail- dard » 3. Reste à savoir si elles parvien-
leurs(ses). L’un et l’autre pays ont connu dr ont à concl ur e à l eur pr of i t des
dès les années 1980 l’organisation de déro- négociations actuellement entamées mais
gations multiples à un statut légal de l’em- inachevées sur la réforme du marché du
ploi salarié standard, sous la pression de travail. La question des nouvelles formes
niveaux de chômage et/ou de travail infor- de régulation de l’emploi apparaît donc
mel relativement hauts. A travers des pro- comme un élément complexe mais pas
cédures variées, les syndicalismes de ces spécialement déstructurant pour une vie
deux pays doivent tenir compte de cette for- syndicale qui se redéploie depuis la fin
malisation déficiente de l’activité écono- des années 1970, à la recherche d’équili-
mique. Elle les incite à accepter de légaliser bres avec les partis politiques.
des formes d’emploi éloignées des emplois En Italie, le syndicalisme hésite entre
de référence pour progresser dans la forma- une vision négative et une vision opti-
lisation de l’activité professionnelle. miste des nouvelles formes d’emploi,
En Espagne, les mesures de flexibili- imitant en cela les ministres promoteurs
sation (« insidieuse » 1) du marché du tra- des réformes du marché du travail qui, vi-
vail dans les années 1970 ont abouti à sant soit à « réguler et limiter les formes
situer durablement au-dessus de 30 % la de flexibilité existantes », soit à « multi-
part des emplois mal protégés. Ils cohabi- plier les formes de flexibilité » 4 poursui-
tent avec une forme majoritaire de con- vent néanm oi ns une pol i t i que de
trats de travail bien protégés. La réforme multiplication des formes de flexibilité.
consensuelle de 1997 n’a pas porté les Le syndicalisme débat et se divise sur ce
fruits attendus, mais les acteurs sociaux sujet, inégalement confiant dans les ver-
ne désespèrent pas de trouver un point tus de la négociation collective pour
d’équilibre entre le renforcement « des aboutir à un contrôle de la précarité des
emplois stables au détriment des précai- emplois nouveaux et de leurs effets sur
res ou (le rapprochement des) définitions l’édifice législatif antérieur. Il doit cons-
des contrats à durée indéterminée de cel- tater que « l’instabilité des emplois atypi-
les des temporaires » 2. Assez logique- ques , l eur hét ér ogénéi t é et l eur
1. Catherine Vincent, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Maria-Teresa Pignoni, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
12 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
fragmentation rendent encore plus diffi- encadrer les emplois flexibles … alter-
cile l’action syndicale à l’égard des tra- nant dé et re-régulation » 3. Ces mesures
vailleurs concernés » 1 . Leur réponse ont conduit à une augmentation substan-
consiste à tenter une intégration de ces sa- tielle du travail à temps partiel. Le travail
lariés dans des structures ad hoc et à trou- temporaire reste contenu mais fait l’objet
ver une nouvelle identité au travail pour de conventions collectives signées « par
les titulaires de ces emplois. une communauté tarifaire regroupant
Les syndicats ne semblent pas récom- l’ensemble des syndicats de branche du
pensés par des adhésions nombreuses à DGB… [et qui] contiennent des disposi-
leurs initiatives et restent partagés entre tions dérogatoires au principe du traite-
deux stratégies, celle cherchant à « porter m ent égal des s al ar i és f i xes et
des revendications spécifiques … pour temporaires, à la satisfaction des associa-
les précaires et celle qui vise leur régula- tions d’employeurs » 4. L’arrivée au pou-
risation dans le cadre de l’emploi salarié voir du SPD en 1998 semble pouvoir
“normal” » 2. Les effets du travail tempo- pallier les difficultés attribuées à une po-
raire sur l’encadrement juridique du tra- litique hostile. Mais les efforts menés à
vail informel rendent supportable une l’intérieur d’un projet de pacte social
flexibilisation qui agit plus sur la forme pour l’emploi échouent, marquant une
que sur le fond du marché du travail. Les étape dans la distanciation des relations
syndicats hésitent mais ne semblent pas historiques entre le SPD et le syndica-
déstabilisés par les conséquences de cette lisme. Redevenu de justesse majoritaire
flexibilisation, d’autant que les écarts de en 2002, le SPD s’engage avec l’Agenda
situation entre le Nord et le Sud de l’Italie 2010 dans une voie qui débouche en
permettent à peine de raisonner sur une 2003-2005 sur une série de réformes.
base nationale concernant les effets des Elles signalent « au fil des ans un glisse-
modifications des règles d’emploi sur les ment quasi-paradigmatique » qui fait pas-
syndicats. ser la responsabilité de la lutte contre le
chômage de l’Etat vers « les bénéficiaires
En Allemagne, changement d’aides » 5.
de paradigme Le syndicalisme allemand assiste
Comparativement, le syndicalisme al- avec une certaine impuissance à la mise
lemand paraît se sortir particulièrement en place d’un système étranger à celui sur
mal d’affaire. Il a dû se confiner dans une lequel il repose : il annonce la déqualifi-
attitude de spectateur plus ou moins cation des chômeurs et des risques de
consentant à des ouvertures dans l’édifice pauvreté accrus pour les salariés con-
législatif organisant l’emploi normal. traints de s’engager dans les emplois
« Depuis les années 1980, des mesures lé- flexibilisés. Il connaît en son sein des se-
gislatives cherchent à accompagner et à cousses qui aboutissent à une scission au
1. Ibid.
2. Ibid.
3. Adelheid Hege, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
4. Ibid.
5. Ibid.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 13EMPLOIS PRECAIRES ...
sein du SPD, à la veille d’élections légis- taille des entreprises, syndicalisation, etc.
latives anticipées en raison même des dif- Les systèmes de protection sociale sont
ficultés rencontrées par la majorité eux-mêmes spécifiques aux salariés « ré-
social-démocrate/écologistes à faire guliers » ou non réguliers.
avancer ses projets de réorganisation des Le syndicalisme s’est installé dans la
structures de régulation de l’emploi. partie la plus sécurisée du salariat, celle
« L’impossibilité (ou l’incapacité) des des grandes entreprises. Il fonctionne sur
syndicats à repenser le rapport salarial la base de « micro-corporatismes » 3 auto-
normal à la lumière des profondes muta- nomisés plus que sous le régime d’une
tions du marché du travail … n’est sans coordination verticale ou horizontale. La
doute pas restée sans incidences sur croissance et le plein emploi ont long-
l’évolution du rapport salarial normal temps permis de masquer cette dualité.
lui-même » 1. Ce qui laisse à entendre que Avec la crise, les emplois non réguliers se
les difficultés pour le syndicalisme ne sont développés en même temps que les
font que commencer s’il ne parvient pas à risques sur l’emploi régulier se sont fait
réintégrer la négociation collective, sur jour. Le chômage aidant, la dualisation se
laquelle il fonde sa légitimité, dans la dy- renforce, à la fois par l’augmentation des
namique des transformations en cours et effectifs de salarié(e)s concerné(e)s, par
donc s’il ne parvient pas à se renouveler l’augmentation de leur précarisation (via
par son implantation auprès des sala- le travail à temps partiel spécialement) et
rié(e)s directement concerné(e)s par ces la pression à la baisse sur leurs salaires
transformations. comparativement aux salariés réguliers.
Le syndicalisme se trouve ainsi de
Le Japon : les précarités plus en plus éloigné de cette fraction
hors du champ syndical croissante de la population alors même
Le Japon semble s’offrir comme un que ses bases traditionnelles perdent len-
contre-modèle aux situations européenne tement en importance. Certains syndicats
et anglo-saxonne où les syndicalismes af- ou des associations ad hoc ont commencé
fichent constamment un souci d’exten- à se préoccuper d’intégrer ou d’organiser
sion des normes les plus sécurisées de ces salarié(e)s de plus en plus nom-
l’emploi. Dans ce dernier pays, depuis les breux(ses). Leurs efforts aboutissent ac-
années 1920, « … l’existence même de tuellement surtout à assurer une défense
(la) sécurité de l’emploi pour les salariés individuelle. Une immixtion dans la né-
réguliers des grandes entreprises … a gociation collective, si elle devait se pro-
nourri l’existence d’un pan entier du mar- duire, ne pourrait que demander encore
ché du travail composé d’emplois essen- beaucoup de temps. « Il est aujourd’hui
tiellement précaires » 2. Les différentes difficile de dessiner des perspectives tant
strates de la hiérarchie salariale reposent soit peu crédibles quant à la chance que
ainsi sur des régimes sociaux que tout dis- les changements récents offrent ou non
tingue : salaires, conditions de travail, pour une représentation syndicale plus
1. Ibid.
2. Bernard Thomann, dans ce numéro de la Chronique internationale de l’IRES.
3. Ibid.
14 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
équitable » 1. Si le syndicalisme a joué un cette sécurisation de groupes plus ou
rôle d’organisateur de la dualisation, il moins larges, à transformer le travail sala-
risque aujourd’hui de souffrir du renfor- rié en statut social de référence. Ils créent
cement de cette dualisation s’il ne par- ainsi le salariat. Il n’est pas indifférent
vient pas à modifier radicalement les que cette sécurisation combine des procé-
bases de son implantation. dures de moyen et de plus long terme et
Mais n’est-ce pas précisément sous cet qu’elle concerne simultanément la vie au
angle des effets des changements des régi- travail (type de contrat, protections contre
mes d’emploi sur les syndicats et leur place les licenciements…) et la vie extra-pro-
dans leurs sociétés respectives que les dif- fessionnelle (santé, vieillesse, etc.). Il
férents pays deviennent comparables ? n’est pas indifférent non plus que certains
syndicalismes soient parvenus à rendre
Normes d’emploi universelles les protections ainsi obte-
et dynamiques syndicales nues, et que d’autres aient vu les résultats
Chacun des syndicalismes de ces neuf de leurs efforts cantonnés à certaines ca-
pays se trouve aujourd’hui confronté à tégories de salariés.
des processus de transformation des régi- Ces transformations sociales de très
mes d’emploi. Ces évolutions sont diffi- long terme produisent un double résultat :
ciles à quantifier comme à apprécier d’une part, elles installent le travail sala-
qualitativement. Elles sont aussi difficiles rié comme vecteur de sécurisation indivi-
à comparer parce que, se fondant sur des duelle et collective, ce qui n’était pas
principes variés, elles empruntent des inscrit dans ses gènes ; d’autre part elles
parcours inégaux pour se développer. Il manifestent les prétentions des syndica-
est frappant cependant de constater que, lismes à s’instituer en acteurs plus ou
même si dans la plupart de ces pays les moins centraux des développements so-
régimes d’emplois « normaux » ou « ré- ciaux. Au terme de cette histoire, avec
guliers » restent largement majoritaires, toutes les nuances que l’on peut leur trou-
les transformations sont perçues comme ver, des constructions très complexes se
potentiellement déstabilisantes pour l’en- transforment en évidences sociétales : ce
semble du salariat et pour les syndicats que l’on va nommer la « société sala-
eux-mêmes. Cela incite à s’intéresser à la riale » 2.
nature des relations des syndicalismes La durée des histoires établissant ces
avec cette question. compromis, comme l’intensité de l’enga-
gement des syndicalismes dans leur for-
Identification et distances mation permettent de comprendre
aux normes d’emploi standard l’identification de chacun des acteurs na-
Observés dans l’histoire longue, les tionaux avec son propre système. Le syn-
syndicats justifient largement leurs places dicalisme allemand s’identifie au modèle
dans leurs pays respectifs par leur capaci- du Alleinverdiener, le syndicalisme japo-
té à sécuriser les (des) salariés, et à travers nais à l’emploi à vie dans certaines entre-
1. Ibid.
2. Rappelons que l’abolition du salariat a été un temps un mot d’ordre syndical et politique à fort
contenu identitaire.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 15EMPLOIS PRECAIRES ...
prises, le syndicalisme français à la Les syndicalismes ne cherchent pas
défense du code du travail ou du statut de spontanément à se proposer comme des
la fonction publique, le syndicalisme agents de diffusion des « acquis » de leurs
nord-américain au seniority principle etc. propres membres. L’exemple japonais ne
Les tentatives de coopération internatio- doit pas être lu comme totalement exo-
nale montrent à quel point les syndicalis- tique. Les conditions restrictives d’accès
mes sont liés à leurs propres systèmes ; au syndicalisme qui ont longtemps préva-
les différences entre eux sont telles qu’el- lu dans nombre de pays illustrent le carac-
les rendent la compréhension réciproque tère toujours latent de cette option. Elle
incertaine et les coopérations difficiles, va cependant être partiellement aban-
quand elles ne conduisent pas à de francs donnée au cours de leur histoire par la
antagonismes. Comment assumer dans le majorité des syndicalismes nationaux que
syndicalisme européen le choix du syndi- nous analysons. Cet abandon conditionne
calisme danois de fonder son rôle de pro- souvent leur propre devenir social : pour
tecteur de l’emploi sur la flexibilité d’un se faire accepter y compris en tant que re-
marché du travail qui ne ressemble à au- présentants de groupes de salariés limités,
cun autre ? ils doivent faire reconnaître le caractère
Pourquoi les syndicalismes s’identi- potentiellement universel de la représen-
tation syndicale.
fient-ils particulièrement à leurs résultats
Le développement de leurs liens avec
en matière de sécurisation des salariés ?
des partis politiques se comprend dans cet
Pourquoi la mise en cause des résultats en
effort de reconnaissance officielle de la re-
la matière semble-t-elle aussi potentielle-
présentation syndicale. Les minima lé-
ment déstructurante pour eux ?
gaux, les systèmes « universels » se
Cette question revêt un intérêt d’au-
comprennent sur la base de ces différen-
tant plus grand qu’elle recouvre un pa- ciations. Cela ne signifie pas que les ac-
radoxe : pourquoi les synd i cat s quis des groupes centraux du syndicalisme
paraissent-ils menacés alors que leurs ont vocation à être étendus vers les grou-
membres restent parmi les mieux proté- pes périphériques, mais que ces derniers
gés et sont affectés de façon marginale peuvent bénéficier indirectement du dyna-
par des précarisations qui touchent juste- misme des premiers. Le rôle de référence
ment des salariés non syndiqués ? de l’emploi standard ne va de pair ni avec
sa généralisation, ni avec une uniformisa-
Des salariés au salariat
tion des bénéfices qui y sont attachés, ni
Ni la mise en évidence des modèles avec une égalité des conditions d’accès, de
nationaux et de leur diversité, ni la focali- maintien ou de promotion en son sein. Par-
sation sur les effets des dérégulations tout, se multiplient les subtilités explicites
vis-à-vis de l’emploi standard ne doivent ou implicites qui organisent une hiérarchie
faire oublier que chaque modèle se cons- salariale et provoquent simultanément in-
truit en prenant appui sur un salariat com- clusion et exclusion.
posite, sur des degrés inégaux d’insertion
des catégories sociales en son sein et sur La place des identités motrices
des rôles inégaux de sécurisation par le La reconnaissance du travail salarié
statut salarial pour les différents types de comme élément d’identité sociale se réa-
participants au salariat. lise par un passage en force, tributaire sur
16 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005… EMPLOI NORMAL ET SYNDICALISME
le très long terme des formes organisa- luxe de détails la longue histoire du salariat
tionnelles à travers lesquelles cette consé- anglais à ce sujet et les détours à travers les-
cration est obtenue. Ces formes sont quels le syndicalisme se met au jour,
elles-mêmes symptomatiques des com- Thompson illustre une réalité qui n’est ré-
promis instaurés entre des fractions iné- servée ni à ce pays ni à la seule époque fon-
galement puissantes de salariés. Les datrice du mouvement ouvrier (Thompson,
constructions historiques qui en résultent 1988) 1. Cela se joue, du fait même des be-
sont dépendantes de circonstances socia- soins d’adaptation aux changements écono-
les qui mêlent étroitement l’ensemble des miques et sociaux, à travers des débats
références statutaires autour desquelles récurrents, des conflits menés au sein
les groupes moteurs se sont donné une même des syndicalismes et étendus à l’en-
identité (Segrestin, 1980). La dynamique semble des organes de représentation poli-
de ces groupes moteurs, leur force d’at- tique et sociale du salariat. Ces conflits,
traction identitaire au sein du salariat jus- souvent fondateurs des identités et des rela-
tifient des effets de « vassalisation » tions syndicales avec le salariat dans ses di-
acceptés par des groupes et des identités versités, ne sont pas moins structurants
sociales moins puissants, qui concèdent pour lui que la confrontation directe avec
leur minoration au sein du modèle domi- les acteurs qui contestent ouvertement ses
nant en tribut à leur intégration : un jeune prétentions à intervenir comme une force
ouvrier ne vaut pas un ouvrier expérimen- socialement organisatrice (économique-
té, une femme ne vaut pas un homme, une ment et/ou politiquement).
salariée à temps partiel ne vaut pas un sa- Deux éléments clés doivent être pris
larié à plein temps, une appartenance eth- en compte pour comprendre les modifica-
nique ou religieuse n’en vaut pas une tions des liens entre les syndicalismes et
autre, tel métier n’en vaut pas tel autre, les relations d’emplois. D’une part, les
etc. différences de statuts au sein du salariat
Ces effets de vassalisation prennent ne sont étrangères ni à l’histoire ni aux
naissance d’abord dans l’acte de travail et principes de formation et de reproduction
ses divisions sociales (qualifications recon- tels qu’ils sont définis au sein des diffé-
nues, ancienneté, temps consacré au travail rents syndicalismes. Ces derniers se sont
salarié). Mais ils sont d’autant plus puis- construits sur leur capacité à prendre en
sants qu’ils débordent la sphère du travail, compte des inégalités de situation à
pour tenir compte de l’ensemble des carac- l’égard de l’emploi.
téristiques sociales constitutives du sala- D’autre part, les processus de sécuri-
riat : sexe, appartenance ethnique, âge, sation et d’insécurisation débordent lar-
statut familial, etc. En retraçant avec un gement la seule sphère du travail. Il faut
1. Le concept de classe joue bien sûr un rôle décisif dans la production de ces effets sociétaux, en
particulier parce qu’il permet simultanément une rupture avec des formes antérieures
d’organisation des travailleurs et avec les forces que Thompson décrit comme celles qui dès la
fin du dix-huitième siècle « cherchaient délibérément à fonder l’Etat sur les inégalités de la vie
et à accentuer et à perpétuer la position des travailleurs en tant que classe assujettie (p.176) ».
Thompson, comparatiste, décrit les effets sur la formation du salariat anglais de la Révolution
française, et en particulier de l’intervention de la notion de « citoyen », comme symbole de
statut social.
Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005 17EMPLOIS PRECAIRES ...
prendre en compte l’ensemble des rôles timent de rupture sociale et de menace à
sociaux des salarié(e)s au risque de ne long terme puisse devenir dominant. Le
renvoyer du salariat qu’une vision li- jeu de la distanciation et de la solidarité
mitée, l’amputant de son rôle d’organisa- au sein du salariat ne fonctionne plus et le
tion sociétale. Les syndicalismes sont rôle syndical est d’autant plus déstabilisé
aussi à l’origine de liens spécifiques entre que les catégories précarisées se tiennent
la sphère du travail et le hors-travail. éloignées de toute référence syndicale.
Il est intéressant de remarquer que, si D’autre part, dans cette dynamique,
les systèmes de sécurisation nationaux re- les syndicats risquent de voir leurs rôles
vêtent des formes institutionnelles très se restreindre à la sphère du travail. Pri-
variées, ils acceptent tous plus ou moins vés de leur fonction d’assimilation des
des systèmes de références identitaires différentes fractions du salariat, ils ris-
communs : l’ancienneté professionnelle, quent de ne plus pouvoir se réclamer
le travail à plein temps et la masculinité d’une fonction englobante de leurs inté-
servent de fils rouges à des compromis rêts et de leurs différents statuts sociaux.
nationaux qui font par ailleurs profession Les syndicats se trouvent alors lentement
de diversité. ramenés à des fonctions d’arbitrage au
sein de certains lieux de travail, fortement
Acquis sociétal typés, mais sans lien avec l’ensemble des
et dynamique sociale
lieux de travail et surtout sans relation
Par opposition, on voit se dessiner la avec l’ensemble des éléments de la condi-
double menace qui pèse sur les syndica- tion salariale hors travail.
lismes à travers le développement des di- Cette limitation du rôle syndical n’est
verses formes de précarisation. pas contradictoire avec le fait que, entre
D’une part, les salariés qui se situent temps, les éléments de statut salarial pour
au cœur de la construction syndicale, qui lesquels les syndicats sont intervenus au
sont aussi ceux qui bénéficient le plus long des décennies antérieures soient de-
pleinement des effets de la sécurisation venus des biens communs, naturalisés
de l’emploi et de ses avantages collaté- dans leurs pays de développement, identi-
raux, risquent de se retrouver isolés s’ils fiants des régimes sociaux et des équili-
ne peuvent plus arguer de leur rôle de bres politiques de ces derniers.
promoteurs de ces effets positifs vers une
part élargie du salariat. Privés de leur rôle L’éclatement du statut salarial,
moteur à l’égard des salariés plus ou enjeu politique ?
moins précarisés, ils vont au contraire se Mais les syndicats ont entre-temps
trouver décalés vers le rôle de détenteurs perdu la maîtrise d’œuvre sur ces ouvra-
de conditions d’emplois privilégiées. ges et ont été dépossédés des bénéfices de
Insensiblement, les syndicalismes ris- leur création. Comme on peut le constater
quent non seulement de perdre des adhé- dans un certain nombre de pays, les régi-
rents ou des zones d’influence, mais mes d’emploi et l’équilibre des systèmes
surtout de voir se transformer leur nature de sécurisation ne sont plus du ressort de
sociale. On comprend dans ces conditions la négociation « privée » entre les organi-
pourquoi il n’est pas nécessaire qu’un ef- sations syndicales et leurs homologues
fectif très important de salariés soit patronales. Longtemps, dans plusieurs
concerné par le précariat pour que le sen- des pays que nous étudions, tout en étant
18 Chronique internationale de l'IRES - n° 97 - novembre 2005Vous pouvez aussi lire