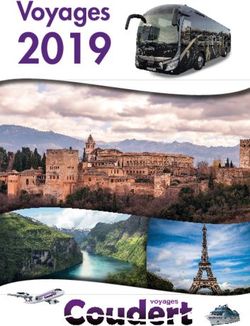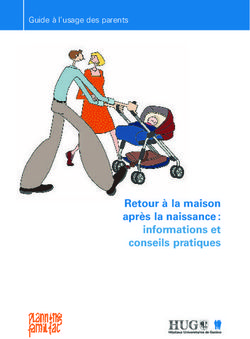GUIDE DE L'ACHAT PUBLIC DE JEUX ET DE JOUETS - GROUPE D'ÉTUDE DES MARCHÉS DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION GEM-EF (EX AB) JUILLET 2011
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
GUIDE DE L’ACHAT PUBLIC
DE JEUX ET DE JOUETS
GROUPE D’ÉTUDE DES MARCHÉS DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION
GEM-EF (EX AB)
JUILLET 2011LE PRESENT DOCUMENT, PROPOSE PAR LE GEM/ EF, A ETE ADOPTE PAR L’OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’ACHAT PUBLIC, LE 15 JUIN 2011
Sommaire
PRÉAMBULE : 3
CHAPITRE 1 : 5
LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR JEUX ET JOUETS 5
1.1 Données démographiques 5
1.2 Les principales données économiques en 2006 (source FJP) 5
1.2.1 La consommation 5
1.2.2 La distribution 5
1.2.3 Le commerce extérieur 5
1.2.4 La publicité (source TNS 2008) 6
CHAPITRE 2 : 8
LES PRINCIPALES STRUCTURES PUBLIQUES D'ACCUEIL 8
2.1. Structures d’accueil de la petite enfance 8
2.1.1. La crèche 8
2.1.2. Le multi-accueil 8
2.2. L’école primaire 9
2.3. Le collège et le lycée 10
2.4. La ludothèque 10
2.5. Les structures de soins 10
2.6. Autres structures publiques 11
2.6.1. Les accueils avec hébergement ; ils concernent l’accueil d’au moins 7 enfants et/ou
adolescents : 12
2.6.2. Les accueils sans hébergement pour plus de 7 mineurs 12
2.6.3. Les accueils de scoutisme 12
CHAPITRE 3 : 13
LA DEFINITION DU BESOIN EN JEUX ET EN JOUETS AU MOYEN DE L’ANALYSE
FONCTIONNELLE 14
3. 1. Les principes 14
3. 1. 1. Définir le besoin avec exactitude 14
3. 1. 2. Les principales étapes de la passation d’un marché de fourniture ou de prestation
de services 14
3. 2. Définition du besoin de l’acheteur public 14
3. 2. 1. Exigences de sécurité et de qualité en matière de produits 14
3. 2. 2. Utilisation de la certification dans les marchés publics 15
3. 3. Définir les documents justifiant le respect des exigences spécifiées 15
3.4. L’élaboration d’un cahier des charges 26
CHAPITRE 4 : 287
LA SECURITE DES JEUX ET JOUETS 28
ANNEXES 29
ANNEXE 1 : 30
PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’INDUSTRIE FRANCAISE DU JOUET 30
ANNEXE 2 : 31
DOCUMENTS TYPES ET SITES INTERNET D’INFORMATION SUR LES MARCHES
PUBLICS 31
1ANNEXE 3 : 32
LA SÉCURITE DES JOUETS – RÉCAPITULATIF DE LA REGLEMENTATION 32
1- Directives et décrets: 32
2-Normes applicables : 32
3- Autres documents normatifs : 34
4- Autres normes applicables : 34
5- Autres réglementations applicables : 34
6 - Marquages obligatoires : 35
7. Où se procurer les différents textes : 36
ANNEXE 4 : 37
LES JEUX VIDEO 37
ANNEXE 5 : 39
LES SERVICES DU JEU 39
ANNEXE 6 : 40
BIBLIOGRAPHIE 40
ANNEXE 7 : 43
LE GROUPE D'ÉTUDE DES MARCHÉS D'AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DES
BUREAUX ET ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT (GEM/AB) 43
2PRÉAMBULE :
JEUX ET JOUETS : Une approche particulière pour des fournitures courantes
L'acheteur public participe à la constitution du stock de jeux et jouets.
Cette responsabilité implique une connaissance approfondie du monde de l’enfant et du monde du
jouet.
C’est pourquoi ce guide, conçu par des spécialistes, apporte le maximum d’aide et de repères lors du
choix et de l’achat de ces jeux et jouets.
Les divers travaux contemporains (médecine, droit…) ont contribué à donner à l'enfant un véritable statut
de personne. Le jeu occupe une place déterminante dans son développement. L’enfant grandit, construit
sa personnalité et ses savoirs avec les outils - les jeux et les jouets - dont il dispose. Le droit au loisir et au
jeu a d'ailleurs été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 (article 31),
d'où la place particulière des jeux et des jouets dans le développement de l'enfant.
"FAIRE JOUER LES ENFANTS : ils ont besoin de jeux et de jouets"
Il est essentiel de regarder l'enfant jouer, de le laisser jouer et de jouer avec lui.
L'approche fonctionnelle permet à l'acheteur public de mieux définir son besoin en faisant prévaloir en
priorité l'intérêt de l'enfant.
Il existe une infinie variété de jeux et de jouets, tous fondés sur la notion de plaisir, car sans plaisir, il n’y
a pas de jeu. Ce plaisir s’accompagne d’un sentiment de liberté parce que, d’une part, l’acte de jouer est
naturel pour l’enfant et d’autre part, le parc de jeux et jouets est si vaste que l’expression privilégiée de
chacun peut s’y épanouir.
Au fil des jours, des mois, les jeux et les jouets de l’enfant se diversifient, s’enrichissent en étroite relation
avec ses capacités qui se développent. Ils s'étoffent, changent de thèmes et de sens au gré des besoins du
moment.
C’est ainsi que nous parlons des jeux d’éveil pour les tout-petits, d’imitation pour les 3-6 ans, des jeux à
règles à partir de 6 ans. Cependant, ces âges sont donnés à titre indicatif.
Les repères, acquis dès la naissance grâce aux jeux et jouets, sont bien connus et analysés par les
industriels du secteur du jouet qui ont fondé sur eux toute une production et y adaptent leur offre.
Les jeux et les jouets trouvent leur place dans des structures publiques qui en modulent l'achat selon leurs
besoins spécifiques.
3CHAPITRE 1 4
CHAPITRE 1 :
LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR JEUX ET JOUETS
La profession, outre le caractère saisonnier de la consommation de jeux et de jouets (58,1 % des
ventes sont réalisées d’octobre à décembre), est soumise à de multiples évolutions et mutations : la
mondialisation accrue des échanges, la concentration de la distribution et le comportement des
consommateurs à la recherche constante de nouveautés.
1.1 Données démographiques
En 2010, l’Union européenne comptait 75.9 millions d’enfants de 0 à 14 ans, soit 15,44% de la
population totale.
En France, les naissances ont été en augmentation de 2009 à 2010:
- 2009 : 824000 (France et Dom)
- 2010 : 828 000 (France et Dom)
Au sein de l’Union européenne, la France reste en pointe pour la fécondité.
Répartition de la population enfantine France métropolitaine (données INSEE provisoires) au 1er
Janvier 2011:
- Enfants de moins de 3 ans : 3 249 704
- Enfants de 3 à 5 ans : 2 384 014
1.2 Les principales données économiques en 2010 (source FJP)
1.2.1 La consommation
Pour l’année 2010, le marché du jouet a atteint 3.058 milliards d’euros, en croissance de +3%
(Panel Consommateurs NPD), ce qui classe la France au 2ème rang européen:
■Royaume uni: 23,7% ■France: 21,5% ■Allemagne : 17,6%
La répartition par catégorie de produits, par catégories d’acheteurs sont données en annexe 1.
1.2.2 La distribution
45,7 % des jeux et jouets sont vendus par des spécialistes en jouets et en modélisme et 39,9% sont
vendus en hypers et en supermarchés. La vente à distance avec Internet poursuit sa progression.
Voir part des circuits de distribution en annexe 1.
1.2.3 Le commerce extérieur
1.2.3.1 Les exportations
Les exportations françaises s’élèvent à 367,7 millions d’euros (hors jeux vidéo) dont 85,6 %
sont à destination de l’Union européenne.
51.2.3.2 Les importations
Les importations s’élèvent à 1539,3 millions d’euros (hors jeux vidéo). 61,1 % des importations
proviennent pour une grande part du sud-est asiatique.
Le second fournisseur est l’Union européenne avec 28,9 %.
La décomposition par catégorie de produits est donnée en annexe 1.
1.2.4 La publicité (source Revue du jouet février 2011)
L’investissement publicitaire jeux et jouets a atteint : 51 514 millions d’euros de janvier à septembre 2010
Répartition par catégories (en millions d’€)
- Jouets garçons 15.087 K€
- Autres jouets & Jeux 12.447 K€
- Jouets filles 10.034 K€
- Jouets 1er Age (0 à 30 mois): 3.634 K€
- Jeux de société: 10.311 K€
TOTAL 51.513 K€
Répartition par médias
Presse 3.119 K€
Radio 1.221K€
TV 45.887 K€
Internet 1.176 K€
Autres supports 6.613 K€
Total 58.016 K€
6CHAPITRE 2 7
CHAPITRE 2 :
LES PRINCIPALES STRUCTURES PUBLIQUES D'ACCUEIL
2.1. Structures d’accueil de la petite enfance
2.1.1. La crèche
Les parents et tous les professionnels qui gravitent autour du tout petit savent bien l'importance du jeu
dans son développement. C'est par le jeu que le bébé va se découvrir lui-même, explorer, comprendre ce
qui l'entoure.
Le bébé ne peut pas encore choisir et il est essentiel de proposer des jouets qui répondent à ses propres
stades de développement.
A titre indicatif, nous proposons ici quelques points de repères :
A sa naissance, le bébé voit les contrastes et les couleurs vives. Il apprécie les matériaux souples et doux.
Très vite, il suit un hochet des yeux ou les personnages de son mobile. La peluche est très douce et
s'imprègne d'une odeur rassurante.
Vers 3 mois, sur le dos, il tend la main vers les objets du portique. Sur son tapis de jeu, il tente d’attraper
les objets à sa portée. Il devient plus attentif aux formes, couleurs, mouvements, etc. Petit à petit, il
soulève la tête et observe les jouets éparpillés.
Vers 6 mois, il peut se tenir assis et attrape de mieux en mieux. Les miroirs captent son attention ; il
prend plaisir à écouter les bruits : tableau d'activité, pantin accroché, jouet suspendu, hochet miroir, boîte
à musique… répondent à son besoin. Sa capacité de préhension se développe. Il s’intéresse davantage à
son environnement sensoriel et peut fixer son attention plus longtemps.
Vers 8-9 mois, il se déplace, rampe et avance vers des formes rondes. Il commence à jeter. Il est sensible
aux notions dedans/dehors, hauteur et verticalité, d'où l'intérêt d'acheter des portiques et des jeux de bain.
A environ 12 mois, l'enfant se tient debout. Il élargit son territoire, il est maintenant capable d'empiler
des éléments, des cubes. Il commence à parler et est interpellé s'il entend sa voix enregistrée. L'aventure
de la marche et l'apprentissage de la parole sont facilités par tous les jouets qui constituent son
environnement.
Plus il grandit, plus il explore ses jouets.
2.1.2. Le multi-accueil
Structures d'accueil réunissant les anciennes structures : crèches et haltes –garderies.
Le multi accueil peut accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (jour anniversaire). L'accueil se
fait sans conditions d'activité professionnelle des parents. Les enfants reçoivent au multi accueil les soins
nécessaires à leur épanouissement physique et mental.
Le jeu étant un outil essentiel dans le développement de l'enfant, il est important de proposer de
nombreuses sources de stimulations sous forme d'activités.
L'enfant joue dès sa naissance ; c'est son principal moyen d'apprendre. Jeux de vocalise, jeux de main, de
regard, de jambes l'éveillent au monde, à son corps, aux formes, aux sons et aux couleurs. Viennent
ensuite tous les objets qu'il peut saisir, manipuler. Ses premiers jouets sont légers, ronds. Il les porte à sa
bouche.
8Les jeux moteurs d'éveil sensoriel sont à privilégier jusqu'à 6 mois. Le bébé jouera beaucoup avec ses
mains, son corps, saisira hochets, mobiles, les jeux avec sons et lumières sont des sources importantes de
plaisir.
Il est important d'avoir un stock de jeux relativement conséquent et en adéquation avec l'âge des enfants,
afin d'offrir un large choix d'expérimentation.
2.2. L’école primaire
Sans perdre de vue que jouer pour un enfant, c’est se divertir, avoir du plaisir et c’est aussi se construire.
L’enseignant utilise le jeu comme un outil pédagogique.
Dans le cadre de l’Ecole, le jeu a pour but de permettre aux élèves :
- d’utiliser des situations dans lesquelles s'établissent des démarches qui produisent des savoirs ;
- de développer des relations sociales ;
- d’amorcer et de renforcer des actions ;
- de soutenir une démarche à la fois :
. fonctionnelle,
. expérimentale,
. formative,
. rationnelle,
A travers le jeu, l’enseignant peut repérer chez les élèves des compétences, des stratégies et d’éventuelles
difficultés. Il peut contrôler des connaissances des élèves sur un sujet donné ainsi que leur progression
dans les apprentissages. Pour ces raisons, le jeu et le jouet sont essentiels à l’acquisition des compétences
et au développement intellectuel et affectif de l’enfant de l’école maternelle et élémentaire.
A l’école maternelle les enfants ont un profond besoin de jouer. L’enseignement leur propose des
activités de jeu, les unes libres, les autres encadrées. Tout enseignant sait qu'il est de son devoir de
constituer autour de l'enfant un "environnement riche et varié"1. C'est à travers le jeu, l'action, la
recherche autonome, l'expérience sensible que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y
construit des acquisitions fondamentales.
A l'école élémentaire, la tâche du pédagogue est de renouveler les partenaires et de complexifier le jeu
proposé aux élèves. Les caractéristiques du jeu sont à la fois implicites et explicites. Car jouer, à l’école
élémentaire, c'est entrer dans un monde avec ses limites et ses règles : limites spatiales, temporelles,
contraintes qui lui permettent de construire sa personnalité dans tous les processus de compétitions,
d'échanges et de convivialité.
Avec les jeux d’imitation, les enfants réinventent des situations qu’ils ont vécues. C’est une occasion
également d’améliorer leur langage, leur vocabulaire, leur syntaxe, voire leur relations avec les autres.
Grâce aux jeux de société dès l’école maternelle, les enfants développent leur socialisation en apprenant
à respecter des règles. Ils découvrent les joies et les désagréments de l’émulation et de la compétition. Ils
confortent, en outre, leurs apprentissages fondamentaux : compter, comparer, dénombrer, décrypter,
développer des stratégies, tenir compte de l’essentiel, penser...
Les jeux d’assemblage développent l’imagination, la créativité et l’innovation des enfants. Ils offrent
l’occasion d’échanges verbaux, d’activité motrice fine et stimulent le sens de l’observation et le goût de
l’expérimentation.
Les nouvelles technologies apportent à l’enseignant un outil supplémentaire qui peut lui permettre de
passer du concret à l'abstrait et de mieux conceptualiser.
De plus, le jeu ou le jouet offre à l’enfant des occasions de s’isoler, de se retrouver, de se ressourcer.
1
Programmes de l’Ecole primaire, BOEN du 19 juin 2008.
92.3. Le collège et le lycée
Le jeu a aussi sa place au collège et au lycée : il permet d'améliorer l'intégration et la socialisation des
jeunes.
Voici une pratique instituée dans un collège parisien : à l’heure de la demi-pension, un temps (environ
une heure) est consacré, pour les élèves, aux jeux de société. Le collège, après sondage auprès des jeunes,
a acheté les jeux souhaités : jeux d’échecs, de lettres, de connaissance, d’investigation, de mémoire, de
stratégie ; jeux de cartes, de petits chevaux, de l’oie, de dominos, de lotos. Deux salles de classe sont
ouvertes et les élèves, par groupes de quatre ou cinq, jouent en autodiscipline, les adultes étant à
proximité. Ces jeux intéressent beaucoup et en grand nombre les élèves de sixième et cinquième, un peu
moins ceux de troisième qui occupent leur temps sur ordinateur ou devant le téléviseur avec des casques à
infrarouges.
Tous les élèves prennent beaucoup de plaisir à cette expérience qui permet de canaliser des énergies dont
certaines manifestations pourraient se révéler fâcheuses. Elle développe chez eux l’autonomie et le sens
de la responsabilité, aide à leur socialisation tout en permettant d’utiliser ou d’acquérir des connaissances.
Elle satisfait les jeunes, leurs familles et le personnel de l’établissement.
2.4. La ludothèque
Une ludothèque est un espace organisé autour des jeux et des jouets où se pratiquent le prêt, le jeu sur
place et des animations. Elle favorise l’activité ludique sans la contraindre, dans un cadre de liberté et
d’autonomie. C’est un lieu ressource sur le jeu, un lieu de réflexion sur les pratiques ludiques, avec de la
documentation.
L’essentiel des activités de la ludothèque se déroulent dans ces locaux où sont accueillis des familles, des
enfants seuls mais aussi des groupes de collectivités (crèches, écoles, centres de loisirs…) ou
d’établissements spécialisés (centres d’handicapés, personnes âgées…). Les ludothécaires peuvent aussi
être amenés à intervenir en apportant du matériel ludique dans des collectivités (dans les classes par
exemple) ou auprès de publics spécifiques (maisons de retraite…).
La plupart des ludothèques participent à des animations importantes à l’échelle de la ville, parfois en
extérieur, avec des jeux surdimensionnés. (Fête du jeu en mai)
Grâce au système de prêt et de jeu sur place, la ludothèque paraît être un excellent endroit pour offrir aux
enfants et aux adultes qui aiment jouer, un parc de jouets dont la diversité et la modernité répondent à une
volonté d’éducation et de plaisir.
Elles doivent offrir un large choix de jeux afin de répondre au souhait des différents publics, de toucher,
de manipuler, d’expérimenter, de comparer.
Bon nombre de ludothèques utilisent la classification ESAR (voir chapitre 3, paragraphe 3.3.1.) et les
jeux proposés aux usagers doivent représenter un panel attractif des différentes catégories citées : jeux
d’exercice, jeux symboliques, jeux d’assemblage, jeux de règles, et ce quelque soit le support
(traditionnel ou virtuel).
Tous les documents techniques (catalogues des salons, revues et ouvrages spécialisés) et les catalogues
des fabricants sont une aide efficace pour constituer le parc de jouets.
2.5. Les structures de soins
10Sous ce titre il convient d’entendre tous les dispositifs de soins, qu'ils soient ambulatoires ou hospitaliers,
à temps partiel, de jour ou à temps plein. Cela concerne donc aussi bien un service de pédiatrie ou de
pédopsychiatrie en milieu hospitalier, qu'un hôpital de jour offrant des soins somatiques ou
psychiatriques, que des consultations ou que d’autres lieux de soins, intégrés dans des structures comme
une école, un centre pénitentiaire...
Il est aujourd'hui admis de façon partagée qu'un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, tirent
d'autant plus profit des soins qui leur sont prodigués que les conditions d'accueil et de vie qui leur sont
faites sont bonnes. C'est ainsi qu'il est désormais habituel d'équiper les structures de soins de matériels et
d'espaces permettant de jouer (qu'il s'agisse d'une salle de jeux équipée en service de pédiatrie ou de
l'usage de jeux de société en gériatrie, des jeux mis à disposition des enfants dans la salle d'attente d'une
consultation médico-psychologique ou pédiatrique...). A contrario, un enfant hospitalisé qui ne pourrait
pas disposer de jeux, dans des conditions adaptées à sa situation, serait plus en difficulté qu'un autre sur le
plan psychologique et affectif.
Il faut souligner que le patient ne se réduit pas à sa seule pathologie. Il est reconnu qu'il importe de
soutenir la « partie saine » du malade, tout autant que de soigner sa maladie. À ce titre, les propositions de
jeux sont très précieuses. C'est pourquoi il importe d'en faciliter l'accès dans tous les lieux de soins, sous
des formes adaptées aux pathologies accueillies et à la structure d'accueil.
Il est essentiel aussi que certains enfants, en particulier les plus jeunes, puissent disposer chacun de son
jouet favori afin de mieux supporter mieux la séparation d'avec son entourage et les soins qui lui sont
dispensés. Par ailleurs, la maladie peut atteindre l'activité psychique, la qualité des relations avec les
autres et l'humeur : les jeux partagés permettent une relance indispensable au mieux-être d'une dynamique
personnelle entravée.
Les structures qui bénéficient de jeux et d'espaces ludiques, de personnels dédiés à ces activités, facilitent
l'évolution des difficultés du patient. Elles contribuent à améliorer son état de santé, la qualité de ses
relations avec les autres, comme celles entre patients et soignants. Les échanges entre les patients et leurs
proches sont facilités par la médiation que le jeu représente. Le développement de l'enfant et de
l'adolescent bénéficie grandement des jeux, comme facilitateur des relations sociales, mode
d'apprentissage, source de plaisir partagé et comme moyen de traverser des situations difficiles.
Les adultes et les personnes âgées tirent aussi grand profit de telles dispositions.
Pour les malades, comme pour tous, il importe de considérer que le besoin de jouer est un droit à garantir.
Les structures de soins devraient toutes, à l'avenir, réserver une place conséquente à ces activités, y
compris celles recourant aux nouvelles technologies ou aux propositions d'expression artistique. Toute la
gamme des jeux et des jouets est bienvenue à condition de veiller au respect des conditions d'hygiène et
de sécurité établies par la structure : l’asepsie, l’adaptation du jouet à l’enfant.
Les progrès de l’accueil des enfants hospitalisés et de leurs parents ont permis de constater l’importance
du jeu et des jouets associés aux soins médicaux et chirurgicaux.
Les jeux et les jouets contribuent à réduire la ségrégation entre les enfants à l'hôpital. Le jouet a donc
pleinement sa place à l'hôpital au même titre que dans les autres structures d'accueil.
2.6. Autres structures publiques
Il existe d'autres structures publiques dans lesquelles l'achat de jouets peut se révéler nécessaire (salles
d'accueil pour enfants dans les maisons d'arrêt, PMI, salles d'attente d'administration…).
Les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, réglementés par l’Etat, avec ou sans
hébergement, sont destinés à accueillir pendant les vacances et le hors temps scolaire les enfants et les
jeunes âgés de moins de 18 ans pour leur permettre de pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de
détente.
Ils peuvent être organisés par des personnes morales, des groupements de fait ou par une personne
physique contre rétribution. Ils sont encadrés par des personnels qualifiés et sont structurés autour d’un
11projet éducatif propre à chaque institution organisatrice et d’un projet pédagogique propre à chaque
équipe d’encadrement.
Depuis le 1er septembre 2006, à la suite de l’aménagement de la réglementation, on distingue sept types
d’accueil répartis selon trois catégories :
2.6.1. Les accueils avec hébergement ; ils concernent l’accueil d’au moins 7 enfants et/ou
adolescents :
- le séjour de vacances (précédemment dénommé « centre de vacances » ou « colonie de vacances ») pour
une durée minimale de 4 nuits ;
-le séjour court pour une durée comprise entre 1 et 3 nuits ;
- le séjour spécifique qui ne peut être organisé que par des personnes morales dont l’objet est le
développement d’activités particulières définies réglementairement (séjours sportifs, séjours linguistiques,
séjours artistiques et culturels, rencontres européennes de jeunes et chantiers de jeunes).
Quant au séjour de vacances dans une famille (précédemment appelé placement de vacances), il
n’accueille que de 2 à 6 mineurs pour une durée minimale de 4 nuits.
2.6.2. Les accueils sans hébergement pour plus de 7 mineurs
L’accueil de loisirs (ex centre de loisirs ou centre aéré) est organisé pour 7 à 300 mineurs et fonctionne
pendant le temps extrascolaire ou périscolaire au minimum 14 jours par an, pour une durée minimale de
deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs
inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées.
L’accueil de jeunes est organisé pour 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans et fonctionne au minimum 14
jours par an. Il est destiné à répondre à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif.
2.6.3. Les accueils de scoutisme
Accueillant au minimum 7 mineurs, ils sont organisés par une association dont l’objet est la pratique du
scoutisme et bénéficiant d’un agrément national « jeunesse, éducation populaire » délivré par le ministre
en charge de la jeunesse.
12CHAPITRE 3 13
CHAPITRE 3 :
LA DEFINITION DU BESOIN EN JEUX ET EN JOUETS AU MOYEN DE L’ANALYSE
FONCTIONNELLE
3. 1. Les principes
3. 1. 1. Définir le besoin avec exactitude
Il est utile d’effectuer deux rappels préliminaires qui concernent la nécessité d’une exacte définition du
besoin préalable à la passation des marchés publics.
Premièrement, l’article 1er du code des marchés publics prévoit dans son 2ème alinéa un certain nombre de
principes (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des
procédures) auxquels sont soumis les marchés publics et accords-cadres et qui assurent ainsi l’efficacité
de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Par ailleurs, l’article 5 du code dispose dans son 1er alinéa que « la nature et l’étendue des besoins à
satisfaire sont déterminées avec précision » par la personne publique.
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à partir d’autres normes
applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 2009-
697 du 16 juin 2009, fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les
conditions prévues par ce décret.
Deuxièmement, il est utile de rappeler que les guides et recommandations des GEM n’ont pas de
valeur contraignante. Ils constituent simplement des instruments destinés à aider l’acheteur public dans
la rédaction des différentes pièces constitutives des marchés, et en particulier dans la conception des
cahiers des charges.
3. 1. 2. Les principales étapes de la passation d’un marché de fourniture ou de prestation de
services
On peut apprécier la régularité d’un marché à partir des éléments suivants :
Le premier élément concerne la définition précise et exhaustive du besoin. Cette phase préalable mérite
une réflexion attentive et approfondie. La juste définition du besoin doit permettre, notamment, aux
entreprises de bien comprendre la demande pour proposer des produits conformes. La rédaction du cahier
des charges doit aussi rester neutre afin de permettre à la concurrence de s’exercer pleinement en
n’orientant pas le choix de l’acheteur vers un produit particulier. En l’occurrence, la définition du besoin
ne doit pas être un cadre rigide au point de constituer un obstacle à l’innovation.
Enfin, il est indispensable de procéder à une double vérification de la conformité au besoin. Il s’agit
d’abord de vérifier que les moyens proposés par le candidat pourront permettre d'atteindre les résultats
souhaités. Ensuite, lors de la réception, l’acheteur public doit contrôler que les caractéristiques du ou des
produits lui confèrent l’aptitude à atteindre les résultats souhaités.
3. 2. Définition du besoin de l’acheteur public
3. 2. 1. Exigences de sécurité et de qualité en matière de produits
La démarche de l’acheteur public doit répondre à un impératif de cohérence.
Par ailleurs, il est important de savoir si l’acheteur a, pour le jouet qu’il souhaite acheter, des impératifs
nécessitant de fixer des exigences particulières venant s’ajouter aux exigences réglementaires.
14Les exigences réglementaires sont les exigences de sécurité imposées par la réglementation européenne :
directive relative à la sécurité des jouets du 3 mai 1988 transposée en droit français par le décret du 12
septembre 1989 et ses décrets modificatifs (cf. annexe 3). Ces exigences sont présumées être respectées
lorsque le jouet fini et neuf est conforme aux normes européennes harmonisées (liste donnée en annexe
3). Le fabricant peut alors apposer le marquage CE sur le jouet (ou son emballage). Toutefois, le fabricant
a le choix de faire tester ou non son jouet par un organisme extérieur avant la mise sur le marché, mais
dans les deux cas, il doit pouvoir prouver que son jouet est conforme à la réglementation : soit en cas de
contrôle, soit à la demande de l’acheteur public (déclaration de conformité, procès-verbal de conformité
d’un laboratoire).
Les exigences particulières imposées par l’acheteur. Il peut s’agir de caractéristiques techniques non
prévues par les normes, de modifications d’un produit existant ou de conception d’un produit nouveau en
vue d’un usage particulier…
Dans tous les cas, un cahier des charges fixant clairement les exigences demandées doit être établi par les
deux parties et son application au produit doit pouvoir être vérifiée.
La surveillance par l'acheteur est effectuée suivant les dispositions prévues dans les documents du
marché.
3. 2. 2. Utilisation de la certification dans les marchés publics
L’acheteur public peut mener une réflexion pour déterminer le niveau d’exigence concernant lea niveau
de qualité du processus de fabrication des produits.
Lors de la phase initiale de la procédure (examen des candidatures), l’acheteur public a la possibilité, soit
dans l’avis d’appel public à la concurrence, soit dans le règlement de la consultation, de demander que les
entreprises qui se portent candidates soient en mesure de justifier d’une organisation basée sur un système
qualité du type 9001 ou équivalent.
A partir de ce principe de base, lié à la justification des capacités techniques des candidats prévue à
l’article 52 du Code des marchés publics, ceux-ci ont deux moyens à leur disposition :
- proposer un certificat attribué par un organisme certificateur ;
- justifier de l’existence d’un document qualité et de procédures qui peuvent être éventuellement vérifiés
par l’acheteur ou son représentant.
Dans la phase d’examen des offres, l’analyse menée à partir de l’ensemble des critères cités dans le
règlement de la consultation permet, normalement, d’identifier objectivement l’une d’entre elles comme
étant la meilleure.
3. 3. Définir les documents justifiant le respect des exigences spécifiées
L’acheteur ne doit pas oublier de préciser dans l’appel d’offres la nature du document justifiant
l’adéquation des produits aux exigences spécifiées (certificat de conformité, procès-verbal du matériel).
Pour cela, il dispose de deux outils :
la classification ESAR établie à partir de travaux canadiens qui permet d’identifier les différents jeux et
jouets d’une part et, d’autre part l’approche fonctionnelle des besoins.
153. 3. 1 - La classification ESAR
TYPES DE JEUX PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT LUDIQUE
RÉPERTOIRE D'HABILETÉS MISES EN ACTION DANS TOUTE
ACTIVITÉ DE JEU
ENSEMBLE DES ACTIVITES DE DÉFINITIONS :
JEU PROPRES À CHAQUE ÉTAPE DU
DÉVELOPPEMENT
Habiletés cognitives : Habiletés motrices et psychomotrices :
Ensemble des habiletés cognitives Répertoire d'habiletés psychomotrices
permettant d'utiliser en cours d'action, nécessaires pour agir de manière
des processus mentaux à chaque étape efficace et fonctionnelle
du développement
Habiletés de relation : Habiletés langagières :
Répertoire d'habiletés ludiques Répertoire d'habiletés langagières
nécessaires pour jouer socialement de propres à chaque mode de
manière significative Communication
Conduites de maîtrise émotionnelle :
Répertoire de conduites affectives
décrivant différentes manifestations
émotionnelles à chaque étape du
développement
JEU D'EXERCICES
EXERCICE SENSORIEL ET MOTEUR Habiletés cognitives : Habiletés motrices et psychomotrices :
RÉPÉTÉ POUR LE PLAISIR DES EFFETS Elles sont également mobilisées dans les Répertoire d'habiletés fonctionnelles
PRODUITS ET DES RÉSULTATS conduites à dominante sensori-motrice. permettant de découvrir, d'expérimenter,
IMMÉDIATS La reconnaissance des informations notamment dans des activités
sensorielles et leur traitement se exploratoires, par essais et erreurs, par
Les premiers jeux pour les bébés (hochets, manifestent lors des activités motrices des manipulations, des déplacements
tableaux d’éveil, portique, boîtes à formes…) directes et immédiates, lors des dans tout l’espace environnant, proche et
Des jeux pour plus grands : cheval à bascule, répétitions par essais et erreurs. distant, et en utilisant :
porteur, cerceaux, échasses, tricycles, vélos, - des signaux auditifs ;
tunnels, balles… - des signaux visuels ;
- des signaux tactiles et proprioceptifs
- des signaux olfactifs
- des signaux gustatifs.
JEU SENSORIEL SONORE Habiletés de caractère social : Habiletés langagières :
JEU SENSORIEL VISUEL ACTIVITÉ INDIVIDUELLE LANGAGE RÉCEPTIF ORAL
JEU SENSORIEL TACT1LE Activité réalisée seul, avec ou sans Instrument de communication de la
JEU SENSORIEL OLFACTIF objets ou accessoires, sans lien direct pensée faisant appel à la capacité de
JEU SENSORIEL GUSTATIF avec les autres participants reconnaissance auditive permettant de
JEU MOTEUR Les types de jeu qui s’y prêtent sont : décoder et d'analyser un message verbal
JEU DE MANIPULATION Jeux individuels dans le but d'en comprendre le sens.
JEU D’ACTION-RÉACTION VIRTUEL Jeux « individuel et associatif » ; Il permet :
Jeu « individuel et compétitif » la discrimination verbale ;
Jeu « individuel et coopératif » le décodage du message verbal.
Conduites affectives :
RECHERCHE DE LA CONFIANCE :
Instauration d'une bonne et constante
relation entre l'enfant et l’adulte dans un
environnement familier et sûr.
16Permettre d’établir :
une différenciation moi / non moi ;
le sourire comme réponse sociale ;
l’attachement à un objet transitionnel ;
la réaction face à l'étranger.
RECHERCHE DE L’AUTONOMIE
Affirmation de soi se traduisant par la
capacité de l'enfant :
- à maîtriser et à contrôler son corps et ;
- à se reconnaître parmi les autres en
imitant ses propres gestes :
- maîtrise du corps ;
- reconnaissance de soi.
JEU SYMBOLIQUE
JEU PERMETTANT DE FAIRE SEMBLANT, Habiletés cognitives : Habiletés fonctionnelles :
D'IMITER LES OBJETS ET LES AUTRES, DE CONDUITE AXÉE SUR LA REPRÉSENTATION REPRODUCTION
JOUER DES RÔLES, CRÉER DES SCÉNARII Ensemble d'habiletés cognitives Répertoire d'habiletés fonctionnelles
ET REPRÉSENTER LA RÉALITÉ AU permettant de représenter la réalité à permettant de reproduire directement des
MOYEN D'IMAGES ET DE l'aide de mots de symboles et d'images éléments de la réalité.
SYMBOLES mentales. Reproduction de modèles ;
Pensée représentative de l’action. Reproduction de rôles ;
Reproduction d'événements
JEU DE ROLE Types d'activités sociales : Habiletés langagières :
Des jouets qui représentent des objets réels pour LANGAGE PRODUCTIF ORAL
jouer le rôle d’un papa, d’une maman, d’une ACTIVITÉ INDIVIDUELLE Instrument de communication faisant
princesse, d’un animal : poupées, déguisements, Activité réalisée seul, avec ou sans appel à la capacité d'attention phonatoire
dînette, accessoires de bricolage… objets ou accessoires, sans lien direct permettant de produire un message verbal
JEU DE MISE EN SCÈNE avec les autres participants pour exprimer sa pensée :
Des jouets miniatures ou des figurines comme Les types de jeu qui s’y prêtent sont : reproduction verbale de sons ;
les Playmobils, les poupées mannequins, les Jeux individuels expression verbale ;
petites voitures, les animaux de la ferme, les Jeux « individuel et associatif » ; mémoire phonétique ;
châteaux forts… Jeu « individuel et compétitif » mémoire sémantique ;
JEU DE PRODUCTION GRAPHIQUE Jeu « individuel et coopératif » mémoire lexicale ;
Ecrans magiques, personnages de feutrine, conscience du langage oral et réflexion
matériel de dessin, d’impression, tampons… ACTIVITÉ ASSOCIATIVE sur la langue orale.
JEU DE PRODUCTION À TROIS Activité réalisée en association avec les
DIMENSIONS autres, débouchant sur un but commun
Pâte à modeler, origami… précis et sur une véritable organisation :
JEU DE SIMULATION VIRTUEL Jeu associatif ;
Jeu associatif et compétitif ;
Jeu associatif et coopératif.
Conduites affectives :
INITIATIVE
Différenciation et identification des
nombreux attributs relatifs aux rôles
sexuels, aux rôles parentaux, aux rôles
sociaux, etc. :
identification sexuelle ;
identification parentale ;
Identification sociale.
17JEU D'ASSEMBLAGE
JEU QUI CONSISTE A REUNIR, À Habiletés cognitives : Habiletés fonctionnelles :
COMBINER, À CONSTRUIRE, CONDUITE INTUITIVE COMPETENCES PSYCHO-MOTRICES
À AGENCER ET À MONTER Ensemble d'habiletés cognitives Répertoire d'habiletés fonctionnelles
PLUSIEURS ÉLÉMENTS POUR permettant des raisonnements permettant d'effectuer des tâches avec
FORMER UN TOUT, EN VUE prélogiques limités par une perception aisance et d'agir avec un bon niveau
D'ATTEINDRE UN BUT PRÉCIS partielle de la réalité d'efficacité, en valorisant :
Triage Appariement - la discrimination auditive :
Différenciation de couleurs - la discrimination visuelle ;
Différenciation de dimensions - la discrimination tactile ;
Différenciation de formes - la discrimination olfactive ;
Différenciation de textures - la discrimination gustative.
Différenciation temporelle Sera également privilégiée l’activité de :
Différenciation spatiale Association la mémoire auditive ;
d'idées Raisonnement intuitif la mémoire visuelle ;
la mémoire tactile ;
la mémoire olfactive ;
CONDUITE OPÉRATOIRE CONCRETE la mémoire gustative ;
Ensemble d'habiletés cognitives la coordination œil-main, oeil-pied, la
permettant de trouver une solution aux latéralité ;
problèmes en s'appuyant sur les l’orientation par rapport au son.
opérations fondamentales de la pensée
logique comme classer, sérier,
dénombrer, additionner, soustraire,
égaliser, mettre en correspondance,
mesurer, etc. :
classification et sériation ;
relations de causalité ;
relations spatiales et temporelles
approche concrètes dans des opérations
numériques des notions de réversibilité,
de dénombrement, de conservations de
quantités.
JEU DE CONSTRUCTION Types d'activités sociales : Habiletés langagières :
JEU D'AGENCEMENT ACTIVITÉ INDIVIDUELLE (POUR LES LANGAGE RÉCEPTIF ÉCRIT
Encastrements, puzzles, mosaïques, enfilage ENFANTS SEULS) Instrument de communication de la
de perles… Activité réalisée seul, avec ou sans pensée faisant appel à la capacité
JEU DE MONTAGE MÉCANIQUE objets ou accessoires, sans lien direct d'attention visuelle et cognitive
JEU DE MONTAGE avec les autres participants permettant de décoder et d'analyser un
ÉLECTROMÉCANIQUE Les types de jeu qui s’y prêtent sont : message écrit dans le but d'en
JEU DE MONTAGE ÉLECTRONIQUE Jeux individuels comprendre le sens :
JEU DE MONTAGE SCIENTIFIQUE Jeux « individuel et associatif » ; discrimination de lettres et de syllabe ;
JEU DE MONTAGE ROBOTISÉ Jeu « individuel et compétitif » Correspondance lettres-sons ;
JEU DE MONTAGE VIRTUEL Jeu « individuel et coopératif » Décodage syllabique ;
Décodage de mots
ACTIVITÉ ASSOCIATIVE (POUR UN GROUPE Décodage de phrases et de messages.
D’ENFANTS)
Activité réalisée en association avec les
autres, débouchant sur un but commun
précis et sur une véritable organisation :
Jeu associatif ;
Jeu associatif et compétitif ;
Jeu associatif et coopératif.
Conduites affectives ;
INITIATIVE
18Différenciation et identification des
nombreux attributs relatifs aux rôles
sexuels, aux rôles parentaux, aux rôles
sociaux, etc. :
identification sexuelle ;
identification parentale ;
Identification sociale.
TRAVAIL PERSONNEL
Expérimentation de la réussite
personnelle et sociale se traduisant par
l'acquisition de connaissances dans tous
les domaines, par la recherche
d'approbation d'autrui à travers des
expériences dans des jeux de
performance conduisant à :
une connaissance personnelle ;
une reconnaissance sociale.
JEUX DE RÈGLES
JEU COMPORTANT UN CODE PRÉCIS À Habiletés cognitives : Habiletés fonctionnelles :
RESPECTER ET DES RÈGLES CONDUITE INTUITIVE COMPETENCES PSYCHO-MOTRICES
ACCEPTÉES PAR TOUS LES JOUEURS Ensemble d'habiletés cognitives
permettant des raisonnements Répertoire d'habiletés fonctionnelles
Jeux de société prélogiques limités par une perception permettant d'effectuer des tâches avec
partielle de la réalité aisance et d'agir avec un bon niveau
JEU D’ASSOCIATION Triage Appariement d'efficacité, en valorisant :
JEU DE SEQUENCE Différenciation de couleurs - la discrimination auditive :
JEU DE CIRCUIT Différenciation de dimensions - la discrimination visuelle ;
JEU D’ADRESSE Différenciation de formes - la discrimination tactile ;
JEU SPORTIF Différenciation de textures - la discrimination olfactive ;
JEU DE STRATEGIE Différenciation temporelle - la discrimination gustative.
JEU DE HASARD Différenciation spatiale Association Sera également privilégiée l’activité de :
JEU QUESTIONNAIRE d'idées Raisonnement intuitif la mémoire auditive ;
JEU MATHEMATIQUE la mémoire visuelle ;
JEU DE LANGUE la mémoire tactile ;
JEU D’ENIGME Habiletés cognitives : la mémoire olfactive ;
JEU DE REGLES VIRTUEL CONDUITE OPÉRATOIRE CONCRETE la mémoire gustative ;
Ensemble d'habiletés cognitives la coordination œil-main, œil-pied, la
permettant de trouver une solution aux latéralité ;
problèmes en s'appuyant sur les l’orientation par rapport au son.
opérations fondamentales de la pensée
logique comme classer, sérier, PERFORMANCE
dénombrer, additionner, soustraire, Répertoire d'habiletés fonctionnelles
égaliser, mettre en correspondance, permettant d'agir avec un très haut niveau
mesurer, etc. : d'efficacité :
classification et sériation ; acuités auditive et visuelle ;
relations de causalité ; dextérité et précision ;
relations spatiales et temporelles souplesse et agilité ;
approche concrètes dans des opérations force et endurance ;
numériques des notions de réversibilité, rapidité et précision ;
de dénombrement, de conservations de équilibre et inventivité.
quantités.
Habiletés cognitives :
CONDUITE OPÉRATOIRE FORMELLE
Ensemble d'habiletés cognitives
permettant de faire des hypothèses, de
les vérifier et de solutionner des
19problèmes théoriques à l'aide de
raisonnements abstraits, d'énoncés
verbaux, d'analyses déductives, etc., et
de considérer toutes les combinaisons
possibles :
- par raisonnement hypothético-
déductif ;
- par raisonnement inductif ;
- par analogie et par la combinatoire.
Il fait appel à un système de
représentations complexes.
Types d'activités sociales ; Habiletés langagières :
ACTIVITÉ DE NATURE COMPÉTITIVE LANGAGE RÉCEPTIF ÉCRIT
Activité réalisée seul ou en équipe, dans Instrument de communication de la
le respect de règles préalablement pensée faisant appel à la capacité
établies pour vaincre un ou plusieurs d'attention visuelle et cognitive
adversaires : permettant de décoder et d'analyser un
- jeu compétitif ; message écrit dans le but d'en
- Jeu compétitif et coopératif ; comprendre le sens :
- Jeu compétitif ou coopératif. - discrimination de lettres et de syllabe ;
- correspondance lettres-sons ;
ACTIVITÉ COOPÉRATIVE - décodage syllabique ;
Activité réalisée avec d'autres joueurs - décodage de mots
ayant des buts précis et des rôles Décodage de phrases et de messages
complémentaires dans l'intention de
réussir une tâche commune LANGAGE PRODUCTIF ÉCRIT
Jeu coopératif Instrument de communication de la
Jeu coopératif et compétitif pensée faisant appel à la capacité
Jeu coopératif ou compétitif d'attention visuelle et cognitive
permettant de d'exprimer sa pensée par
un message écrit faisant appel à :
la mémoire graphique ;
la mémoire grammaticale ;
la mémoire orthographique ;
la mémoire syntaxique,
au travers de l’expression écrite et de la
réflexion sur la langue écrite.
Conduites affectives :
TRAVAIL PERSONNEL
Expérimentation de la réussite
personnelle et sociale se traduisant par
l'acquisition de connaissances dans tous
les domaines, par la recherche
d'approbation d'autrui à travers des
expériences dans des jeux de
performance conduisant à :
une connaissance personnelle ;
une reconnaissance sociale.
IDENTITÉ
Réexamen et réintégration des différentes
identifications de l'enfant provoqués par
les nombreuses transformations
biologiques, psychologiques et sociales
Recherche de sa personnalité et
apprentissage de modes d'organisation
sociale.
203.3.2 L’analyse fonctionnelle des besoins
3.3.2.1 La définition de l’approche fonctionnelle
Cette démarche qui s’insère dans la démarche générale de l’analyse de la valeur, va conduire à
l’expression du besoin sous forme de cahier des charges fonctionnel (CdCF).
En effet, l’achat de jeux et de jouets par la personne publique n’est pas une démarche anodine ; l’achat
public vise à satisfaire le besoin de l’utilisateur exprimé sous forme de fonctions à satisfaire et précisé par
le responsable de l’entité utilisatrice : crèche, école, ludothèque, selon les publics accueillis.
L’analyse fonctionnelle consiste, dans une première phase, à exprimer, sous forme de fonctions, le besoin
que l’utilisateur réclame d’un produit dont on ne dispose pas encore ou qu’un produit existant peut
fournir. Les fonctions sont exprimées en termes de finalité, sans référence aux solutions techniques
susceptibles d’y répondre. Une telle formalisation préserve les possibilités d’émergence d’innovation au
moment de la conception du produit répondant au besoin exprimé. En seconde phase, elle permettra de
caractériser en énonçant des critères, en précisant les niveaux et les limites d’acceptation. Un critère
d’appréciation permet d’apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée.
Cela sous-entend que pour une même fonction, il ya souvent plusieurs critères d’appréciation de natures
différentes. Le niveau d’un critère d’appréciation s’apprécie dans une échelle adoptée par critère.
Le cahier des charges fonctionnel est un document par lequel le demandeur exprime son besoin, ses
besoins et ceux des utilisateurs qu’il représente tout en favorisant l’innovation ; il sert à favoriser le
dialogue entre les partenaires, il sert également à faciliter le dépouillement des propositions
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour procéder à l’analyse fonctionnelle du besoin. On peut
citer :
- l’analyse fonctionnelle d’un produit existant, inspirée de la méthode FAST ;
- la méthode intuitive ;
- la méthode d’inventaire systématique du milieu environnant (méthode APTE) ou dite des
interacteurs.
Lorsque l’on utilise cette dernière méthode, il est possible de mettre en relation le produit – le jouet, le
jeu- avec les différentes composantes de son environnement et ainsi d’identifier les fonctions à satisfaire.
Par exemple, en ce qui concerne le jeu et le jouet, une première approche des interacteurs peut se traduire
par cette représentation dite la « pieuvre » où chaque liaison entre le jeu ou le jouet et un élément de son
environnement représente une fonction…
sol
meuble
enfant
Fa 14
Fa 15
Fa 20
Fa 19
l'air
adulte
Fa 12 Fa 16
Les jeux et les jouets utilisés par les différents acteurs publics
Fa 11
unlaautre
chaleur
jouet
Fa 10 Fa 17
Fa 18
L'eau
l'intervenant
la chaleur
L’utilisation conjointe de la méthode des interacteurs et de la méthode intuitive, qui apparaît
généralement comme plus facile à mettre en œuvre, permet de cerner les fonctions essentielles qu’il
convient d’exprimer et de caractériser et qui seront à la base du cahier des charges de la commande
21Vous pouvez aussi lire