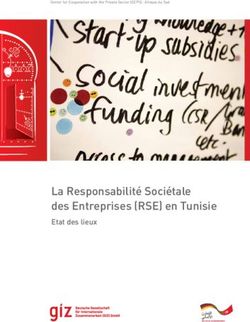La gouvernance des réseaux mondiaux de communication - Érudit
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Document généré le 21 fév. 2020 01:51
Politique et Sociétés
La gouvernance des réseaux mondiaux de communication
Thierry Vedel
Démocratie et réseaux de communication Résumé de l'article
Volume 18, numéro 2, 1999 Cet article s’interroge sur la façon dont on peut gouverner les réseaux de
communication internationaux qui semblent constituer un espace déterritorialisé
URI : https://id.erudit.org/iderudit/040171ar échappant au contrôle des États-nations. La gouvernance des réseaux de
DOI : https://doi.org/10.7202/040171ar communication pose la question du rôle des États dans leur développement. Depuis
la fin du 19e siècle, ceux-ci ont joué dans les pays industrialisés un rôle majeur dans la
mise en place des grandes infrastructures de communication. L’État, jadis
Aller au sommaire du numéro
planificateur et opérateur des réseaux, devient l’animateur d’un ensemble d’initiatives
privées.
La gouvernance des réseaux de communication soulève le problème de la régulation
Éditeur(s) des informations qu’ils permettent d’échanger. Comment concilier d’une part la
Société québécoise de science politique liberté d’expression, d’autre part, la protection des droits d’auteurs, de la vie privée ou
des cultures nationales? Pour faire face à ces enjeux, les modes traditionnels de
ISSN régulation — accords intergouvernementaux, organisations internationales — sont
aujourd’hui concurrencés par de nouvelles formes de gouvernance coopératives et
1203-9438 (imprimé) communautaires.
1703-8480 (numérique)
Découvrir la revue
Citer cet article
Vedel, T. (1999). La gouvernance des réseaux mondiaux de communication. Politique
et Sociétés, 18 (2), 9–36. https://doi.org/10.7202/040171ar
Tous droits réservés © Société québécoise de science politique, 1999 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services
d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous
pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour
mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/LA GOUVERNANCE DES RÉSEAUX MONDIAUX
DE COMMUNICATION
Thierry Vedel
Fondation nationale des sciences politiques - CNRS
INTRODUCTION
Le village planétaire, que prophétisait il y a plus de trente ans
McLuhan, semble devenir une réalité. Au cours des deux dernières
décennies sont apparus des réseaux de communication - systèmes
satellitaires, Internet - qui favorisent une circulation mondiale de
l'information. On entend souvent dire que ces réseaux conduisent à
un effacement des frontières nationales. Les individus, en pénétrant
dans l'espace mondial de l'information, perdraient leurs attaches
territoriales, les États ne seraient plus capables de contrôler les flux
d'informations, et les cadres réglementaires nationaux qui régulent la
production et l'usage de l'information deviendraient inopérants. À
l'espace politique des États-nations se substituerait un espace virtuel
et déterritorialisé, volontiers qualifié de cyberspace. Peut-on gouver-
ner - et comment - cet espace mondial de communication ?
Les réponses apportées à cette interrogation varient suivant les
pays : certains, par exemple le Canada, estiment qu'un réseau comme
Internet n'appelle pas de réglementation particulière tandis que
d'autres, tels la France ou l'Australie, considèrent qu'il nécessite de
nouveaux systèmes de régulation et adoptent des lois à cet effet1.
La gouvernance des réseaux de communication renvoie à un
vieux débat sur la nature de l'évolution technique. Les hommes
peuvent-ils orienter et maîtriser l'essor et la diffusion sociale des
1. Au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) a décidé de ne pas réglementer Internet en mai 1999 (voir:
www.crtc.gc.ca/FRN/NEWS/RELEASES/1999/R990517f.htm). En France, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) penche pour une réglementation spéci-
fique (« La régulation des services audiovisuels sur Internet: enjeux et probléma-
tique », La Lettre du CSA, n° 114, mars 1999, p. 2-10). En Australie, le Parlement
a amendé, le 30 juin 1999, le Broadcasting Services Act de 1992 afin de pouvoir
contrôler le contenu des sites internet.
Thierry Vedel, Centre d'étude de la vie politique française, Fondation nationale des
sciences politiques, 10, rue de la Chaise, 75007, Paris, France.
Courriel : vedel@msh-paris.fr
Politique et Sociétés, vol. 18, n° 2,199910 THIERRY VEDEL
technologies comme le pensent les socioconstructivistes ? Ou, au
contraire, les technologies sont-elles mues par une logique autonome
et imposent-elles des formes sociales inscrites dans leur modus
operandi?
La gouvernance des réseaux de communication doit d'autre part
être envisagée dans un double contexte : le contexte économique de la
mondialisation qui affecte la communication depuis deux siècles,
mais est aujourd'hui considérablement accéléré par l'évolution
technique ; le contexte politique du retrait des États. Ceux-ci ont joué
un rôle majeur dans la mise en place des grandes infrastructures de
communication, mais ils tendent désormais à abandonner leurs
fonctions d'opérateur pour devenir des États-animateurs.
La gouvernance des réseaux de communication soulève enfin, et
plus spécifiquement, le problème de la régulation des contenus de
l'information échangée par leur intermédiaire qui soulève de mul-
tiples interrogations. Notre arsenal juridique est-il suffisant pour enca-
drer l'essor des réseaux, ou faut-il inventer de nouvelles catégories de
droit? Comment concevoir un cadre réglementaire pour des réseaux
dont les usages sont encore très évolutifs ? Les modes traditionnels de
régulation - accords intergouvernementaux, organisations interna-
tionales - sont-ils à même de gérer les contacts entre les systèmes de
normes et de valeurs différents que provoquent les réseaux, ou bien
assistera-t-on à l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, par
exemple des formes associatives ?
L'ESSOR DES RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES MONDIAUX :
FORMES, CONTEXTE, ENJEUX
La mondialisation des communications
La mondialisation, ou globalisation, est a priori un phénomène
familier aux experts en communication, puisque c'est un spécialiste
des médias, Marshall McLuhan, qui, dans son livre La Galaxie
Gutenberg publié en 1962, a popularisé l'idée de village global2.
Reste à préciser ce que la globalisation, ou mondialisation3, des
communications recouvre exactement et comment on peut en prendre
la mesure. À cet effet, on peut retenir en première approche quatre
indicateurs.
2. Marshall McLuhan, The Gutemberg Galaxy, London, Routledge, 1962.
3. Pour l'anecdote, les dictionnaires anglais des années 1960 considéraient le terme
«global» comme un néologisme et recommandaient l'utilisation de «mondial».
Ce n'est qu'à la fin des années 1970, au moment où l'attention se porte sur le déve-
loppement d'entreprises industrielles internationales ou transnationales, que le
terme global est reconnu.La gouvernance des réseaux mondiaux de communication \\
Résumé. Cet article s'interroge sur la façon dont on peut gouverner les
réseaux de communication internationaux qui semblent constituer un espace
déterritorialisé échappant au contrôle des États-nations. La gouvernance des
réseaux de communication pose la question du rôle des États dans leur
développement. Depuis la fin du 19e siècle, ceux-ci ont joué dans les pays
industrialisés un rôle majeur dans la mise en place des grandes infrastruc-
tures de communication. L'État, jadis planificateur et opérateur des réseaux,
devient l'animateur d'un ensemble d'initiatives privées.
La gouvernance des réseaux de communication soulève le problème de
la régulation des informations qu'ils permettent d'échanger. Comment conci-
lier d'une part la liberté d'expression, d'autre part, la protection des droits
d'auteurs, de la vie privée ou des cultures nationales? Pour faire face à ces
enjeux, les modes de traditionnels de régulation - accords intergouvernemen-
taux, organisations internationales - sont aujourd'hui concurrencés par de
nouvelles formes de gouvernance coopératives et communautaires.
Abstract. This article examines ways in which networks of international
communication can be regulated, considering that they constitute a non-
territorial space that eludes the control of nation-states. The governance of
such networks calls into question the role of States in development. Since the
end of the 19th century, the State has played a major role in the establishment
of infrastructures of communication in the industrialized world. We are wit-
nessing today the crisis of this model. The State, formerly the planner and
operator of such networks, has come to be the organizer of an ensemble of
private initiatives.
The governance of networks of communication raises the problem of
regulation of information exchanges. How can freedom of expression, on one
side, and copyright restrictions, on the other, be reconciled? Moreover, there
is the question of private life versus the needs of national cultures. In order to
face such challenges, the traditional forms of regulation - inter-governmental
accords, international organizations - are today in competition with new
forms of cooperative and communal governance.
Quatre indicateurs de la mondialisation
On assiste en premier lieu à la mise en place de réseaux tech-
niques permettant matériellement une circulation mondiale de l'in-
formation sous ses formes les plus diverses. Par rapport aux réseaux
de communication internationaux qui existent depuis la seconde
moitié du XIXe siècle - télégraphe, puis téléphone - , les nouveaux
réseaux de communication possèdent des caractéristiques qui accrois-
sent dans des proportions considérables les possibilités d'échange
entre les habitants du monde :
- ce sont des réseaux polyvalents capables de transmettre l'infor-
mation sous toutes ses formes (voix, texte, image fixe ou animée)12 THIERRY VEDEL
et qui peuvent être utilisés aussi bien comme outils de diffusion
(de point à masse) que comme outils de communication (de
point à point) ;
- ce sont des réseaux extrêmement puissants ; Internet permet de
transmettre quasi instantanément des milliers de pages d'in-
formation à des dizaines de millions de personnes, tandis que
les satellites numériques peuvent diffuser sur plusieurs cen-
taines de chaînes de télévision ;
- ce sont des réseaux universels. Grâce à des systèmes satel-
litaires de plus en plus denses et sophistiqués, il devient
possible d'être connecté aux réseaux en tout point de la planète.
Le deuxième indicateur qu'on peut retenir pour mesurer la
mondialisation des communications est l'intensification des flux
d'informations (qu'il s'agisse d'images, de données ou de sons) entre
pays. Malheureusement, les études empiriques à ce sujet ne sont pas
très nombreuses. Dans le domaine audiovisuel, on dispose cependant
de l'enquête réalisée pour l'Unesco en 1985 par Tapio Varis, qu'on
peut mettre en regard des travaux plus récents de Preben Sepstrup4.
Cette comparaison nous montre qu'entre 1985 et 1992 les importa-
tions d'images de l'ensemble des pays européens se sont accrues sous
l'effet de deux facteurs : la libéralisation de l'audiovisuel et la créa-
tion de nouvelles chaînes. D'autre part, le recours à des images
étrangères est d'autant plus fort que le pays importateur est «petit»
(la demande de nouvelles chaînes y étant plus ou moins équivalente à
celle des «grands» pays, mais l'industrie audiovisuelle faible, voire
inexistante). Il n'est pas certain cependant qu'on puisse appliquer ce
dernier enseignement aux flux de données, et particulièrement aux
services internet : ceux-ci, contrairement aux programmes audio-
visuels, ne nécessitent pas de lourds appareils de production, ce qui
signifie que les pays aux économies les plus puissantes ne jouissent
pas d'avantages comparatifs. En d'autres termes, si Internet conduit à
une mondialisation accrue des flux d'informations, ce n'est pas tant à
cause de son économie qu'en raison des attentes et des demandes des
utilisateurs désireux de diversifier leurs sources d'information.
Le troisième indicateur est l'émergence d'acteurs économiques
définissant leurs stratégies à une échelle transnationale et concevant
leurs produits ou services pour un public mondial. Dans le domaine
4. Tapio Varis, « La circulation internationale des émissions de télévision », Études
et documents d'information, n° 100, Paris, Unesco, 1985; Preben Sepstrup, Trans-
nationalization of Television in Five European Countries, Paris, Unesco, 1992. On
trouvera aussi, pour les services d'information électronique, des éléments utiles
dans Manuel Castells, La société en réseaux. L'ère de l'information, Paris, Fayard,
1998.La gouvernance des réseaux mondiaux de communication 13
audiovisuel, l'archétype de ce type d'acteur est sans doute la News
Corporation de Rupert Murdoch, dont on peut suivre l'expansion
géographique au cours des vingt dernières années (naissance en
Australie, développement en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis,
conquête aujourd'hui de l'Asie du Sud-Est). Microsoft constitue un
autre exemple de firme à stratégie planétaire : après avoir mondialisé
ses systèmes d'exploitation DOS et Windows, elle s'attache désor-
mais à la production de produits électroniques universels tels que
l'encyclopédie En carta. A une échelle plus réduite - mais la logique
est similaire - on peut encore citer Canal + qui répète le même format
de chaîne payante dans différents pays : Espagne, Belgique, Pologne,
pays d'Afrique ou Italie. Enfin, dans le domaine des réseaux de télé-
communication, on assiste à la création de consortiums entre opéra-
teurs de télécommunication qui ont pour vocation de fournir à leurs
clients des services de communication leur permettant de joindre tout
point du globe.
Enfin, dans le domaine de la communication comme d'ailleurs
dans de nombreux autres secteurs, on observe depuis le début des
années 1980 une tendance croissante à l'internationalisation des
réglementations (notamment dans le domaine des droits d'auteur, de
la protection des données, du commerce électronique, de la radio-
télévision par satellite), dont l'un des exemples est la directive Télé-
vision sans frontières de l'Union européenne. Si les efforts en ce sens
n'aboutissent pas toujours, et ce, en raison de la persistance de
logiques étatiques, la nécessité d'une régulation transnationale des
communications et d'une coordination des politiques des gouverne-
ments est reconnue par les autorités gouvernementales de nombreux
pays. Le développement des autoroutes de l'information fait ainsi
l'objet d'une concertation régulière dans le cadre de groupes spécia-
lisés du G7. Les gouvernements «pensent de plus en plus global» et
les législations, tout en restant nationales, prennent en compte l'exis-
tence d'un environnement extérieur jouant sur la dynamique des
systèmes internes.
Un phénomène ancien, mais inachevé
Si la mondialisation des communications tend à s'intensifier, elle
constitue un phénomène qui n'est ni récent ni total5. Il n'est pas récent
parce que, depuis près d'un siècle et demi, il existe des réseaux interna-
tionaux relativement performants, par exemple le réseau télégraphique.
5. Pour une perspective historique, on pourra se reporter à Armand Mattelant, La
mondialisation de la communication, Paris, Presses Universitaires de France,
1996.14 THIERRY VEDEL
Il en découle d'ailleurs une tradition ancienne de régulation interna-
tionale dans les télécommunications. Dès la fin du XIXe siècle, les
opérateurs ont été confrontés à certains problèmes - tels que l'inter-
connexion des réseaux et la mise au point de normes techniques
communes ou encore le partage des recettes - qu'ils ont résolus par la
mise en place d'une institution intergouvernementale, l'Union inter-
nationale des télécommunications (UIT)6. La gestion de réseaux de
communication internationaux n'est donc pas une question entière-
ment inédite et il existe à cet égard un savoir-faire qu'il ne faut pas
négliger. De la même façon, la circulation mondiale des images est
devenue une réalité depuis les années 1930, époque à laquelle les
majors d'Hollywood ont organisé l'exportation de leurs films, d'une
part en concevant délibérément ceux-ci comme des produits cosmo-
polites (grâce notamment au concours de réalisateurs étrangers),
d'autre part en mettant en place des structures de distribution interna-
tionales. Et là aussi, des procédures de régulation ont été établies pour
gérer - souvent restrictivement - ces flux d'images7.
La mondialisation des communications n'est pas non plus totale,
elle affecte principalement les pays industrialisés. Une grande partie
du monde ne dispose tout simplement pas des infrastructures ou des
équipements qui leur permettraient de se joindre au village électro-
nique planétaire. Ainsi, en 1997, le nombre de lignes téléphoniques de
l'ensemble du continent africain (y compris l'Afrique du Sud) n'excé-
dait pas 15 millions, c'est-à-dire le nombre de lignes de la seule ville
de Tokyo. Même si on peut penser qu'à terme les nouvelles techno-
logies - particulièrement les télécommunications mobiles et les
satellites - permettront aux pays les moins développés de combler
leur retard (car elles exigent des investissements moins importants
que les réseaux filaires), il n'existe pour l'instant que deux médias à
peu près universels : la radio et l'audiocassette.
LE RETRAIT DE L'ÉTAT
L'essor des réseaux de communication mondiaux se poursuit
depuis le début des années 1980 dans un contexte politique nouveau,
marqué par un retrait de l'État qui tend à abandonner ses fonctions
d'opérateur et joue désormais un rôle d'animateur.
6. Voir à ce sujet : Susanne Schmidt et Raymund Werle, Coordinating Technology:
Studies in the International Standardization of Telecommunications, Cambridge,
MIT Press, 1998.
7. Pierre-Jean Benghozi et Christian Delage (dir.), Une histoire économique du
cinéma français (1895-1995). Regards croisés franco-américains, Paris,
L'Harmattan, 1997, p. 341-362.La gouvernance des réseaux mondiaux de communication 15
La crise du complexe postal-industriel
Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'au début des années 1980,
les États, dans les pays industrialisés, ont joué un rôle central dans la
mise en place des réseaux de communications. Durant cette période, a
prévalu une forme de gouvernance organisée autour de ce qu'Eli
Noam a appelé un complexe postal-industriel8, mais qu'en Europe on
désignerait plutôt comme le modèle PTT. Le complexe postal-indus-
triel se caractérise d'abord par deux principes politiques : l'accès de
tous les individus aux réseaux (principe auquel renvoie la notion con-
temporaine de service universel) et l'égalité de traitement de tous les
utilisateurs. Mais surtout, ce complexe met en œuvre, dans chaque
pays, un système de relations particulier entre les différents acteurs
qui le composent. Il repose en son centre sur un opérateur de télécom-
munications, fortement lié à la puissance publique ou sous contrôle de
la puissance publique, et en situation de monopole. Cet opérateur
entretient des liens privilégiés avec les fabricants d'équipements de
télécommunication indigènes et définit avec ceux-ci la répartition de
l'effort de recherche, l'allocation des parts de marché et le prix
d'achat ou de vente des équipements. L'ensemble est soutenu par une
constellation d'acteurs économiques, politiques ou sociaux (les minis-
tères des finances, les syndicats, les parlementaires) qui, les uns et les
autres, trouvent des avantages dans ce mode de fonctionnement
(recettes fiscales, avantages sociaux, accomplissement de missions de
service public favorables, par exemple, à l'aménagement du territoire
ou à la compétitivité d'autres secteurs économiques).
Ce modèle a pu connaître des variantes nationales9. L'opérateur
de télécommunication peut être une entité administrative (variante
européenne) ou une société privée soumise à une forte régulation
publique (variante américaine). Les liens entre l'opérateur et le
fabricant d'équipements peuvent être plus ou moins étroits, allant de
l'intégration totale à la simple coopération. Mais par delà ces va-
riantes, la logique du système est la même : une intégration forte aussi
bien sur le plan vertical qu'horizontal10 et un fonctionnement dans un
cadre purement national. À cela il faut ajouter l'existence d'une
culture commune (valorisant la performance technique et l'efficacité
du réseau et n'accordant qu'une importance secondaire aux para-
mètres financiers et à la satisfaction des utilisateurs) qui facilite les
8. Eli Noam, « The public telecommunications network : a concept in transition »,
Journal of Communication, vol. 37, 1987, p. 30-48.
9. Élie Cohen, Le colbertisme high tech. Économie des télécom et du grand projet,
Paris, Hachette, 1992.
10. Volker Schneider, « Telecommunications and the State. A Historical and Compa-
rative Perspective », Trends in Communication, 1997, n° 3, p. 7-33.16 THIERRY VEDEL
transactions aussi bien à l'intérieur de chaque système national
qu'entre les différents systèmes nationaux11. Cette structure de gou-
vernance était donc capable de gérer également l'internationalisation
des flux de communication.
Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une dissolution
progressive du complexe postal-industriel à la suite de sa contestation
par - en empruntant toujours la terminologie d'Eli Noam - une
seconde coalition électronique, constituée de firmes de l'informa-
tique, de grands utilisateurs et d'entreprises souhaitant accéder à un
marché des télécommunications très profitable, et soutenue par des
groupes politiques néolibéraux. Cette contestation aboutit, selon des
processus politiques aux formes et aux rythmes différents suivant les
pays, à une réorganisation profonde des systèmes de télécommunica-
tion, dont les grandes lignes sont identiques :
- séparation entre les États et les opérateurs de télécommunica-
tion par privatisation ;
- introduction de la concurrence dans tous les segments du
marché ;
- dissolution des relations privilégiées entre opérateurs et fabri-
cants d'équipements.
Les systèmes de télécommunication deviennent plus ouverts et en
quelque sorte plus fluides; ils se «dénationalisent» également en ce
sens qu'il n' y a plus de territoires réservés et que les acteurs du monde
des télécommunications tendent à internationaliser leurs activités.
De l'État opérateur à l'État animateur
La mise en place des autoroutes de l'information, qu'on appelle
aussi le réseau global de l'information {Global Information Infra-
structure), marque la fin du complexe postal-industriel et une redéfi-
nition du rôle des États12. Ceux-ci ont perdu leur fonction d'opérateur,
11. Du fait de cette communauté de valeurs et de culture, l'Union internationale des
télécommunications a pu pendant près d'un siècle, comme on Ta noté plus haut,
organiser sans difficulté (généralement par consensus) l'interconnexion des
réseaux nationaux et régler les problèmes que celle-ci soulevait (établissement de
normes communes, partage des recettes, allocation des fréquences, etc.).
12. Sur le cas français, voir Thierry Vedel, « Information Superhighway Policy in
France: the End of High Tech Colbertism?», in Brian Kahin et Ernest Wilson
(dir.), National Information Insfrastructure Iniatives. Vision and Policy Design,
Cambridge (Ma), The MIT Press, 1997, p. 307-348.La gouvernance des réseaux mondiaux de communication 17
cédée à des firmes privées qui doivent assurer le financement des
réseaux et qui deviennent en quelque sorte des États animateurs. Si
l'on étudie les documents gouvernementaux accompagnant les poli-
tiques nationales des autoroutes de l'information dans les pays indus-
trialisés, ou encore les principes d'action adoptés par les États du G 7
lors du sommet de Bruxelles en 1995, sommet consacré à la société
de l'information, on peut identifier quatre grandes fonctions assignées
aux États13 :
- une fonction d'impulsion et de mobilisation qui s'exerce par la
publication de rapports, des actions de sensibilisation, l'organi-
sation de débats, la création de structures spéciales ;
- une fonction de soutien financier à des activités de recherche,
des projets expérimentaux ou des applications pilotes ;
- une fonction d'entraînement qui s'effectue à la fois par l'équi-
pement des écoles en ordinateurs et leur connexion au réseau
Internet, et par la mise en ligne de services administratifs ou
publics. L'idée ici est de socialiser la population à la société de
l'information et de dynamiser le marché de l'information
électronique ;
- enfin, une fonction de réglementation et de régulation des
infrastructures et des services proposés sur celles-ci. C'est dans
ce domaine que l'activité gouvernementale est, pour l'instant,
la plus intense. La libéralisation du secteur des télécommuni-
cations exige en effet la mise au point d'un appareil de règles
très complexe compte tenu de l'augmentation du nombre
d'acteurs en présence, de la nécessité de codifier leur degré de
liberté et leurs modes de relation, de la technicité du domaine,
enfin de la difficulté à élaborer un cadre qui soit à la fois stable
et capable d'intégrer les évolutions techniques futures.
D'une certaine façon, cet État moderne, qu'on définit comme
devant être modeste et flexible14, n'est plus au dessus du jeu social,
mais à côté des autres acteurs sociaux en tant que partenaire ou associé.
On pourrait même dire que l'État est, parmi les autres acteurs sociaux,
un prestataire spécialisé dans la fourniture de certains services : la
13. Thierry Vedel, «Les politiques des autoroutes de l'information dans les pays
industrialisés: une analyse comparative», Réseaux, juillet-août 1996, n° 78,
p. 11-28.
14. Ainsi, lors du colloque «Les autoroutes et services de l'information », organisé à
Paris par le gouvernement le 7 décembre 1994, Didier Lombard, Directeur de la
stratégie industrielle au ministère de l'Industrie déclara : «Nous avons bridé notre
instinct colbertiste».18 THIERRY VEDEL
codification, la formation, la sécurité, voire la cohésion sociale. Cette
nouvelle conception de l'État apparaît particulièrement dans le
domaine réglementaire : la réglementation ne vise pas tant à exprimer
une volonté politique qu'à accompagner, en adaptant les règles du jeu
et en créant un environnement propice à l'innovation, les efforts des
entreprises privées. La réglementation n'a plus qu'une fonction ins-
trumentale, sauf lorsqu'elle a pour but de préserver certains principes
politiques tels que la diversité culturelle.
Des lois sans territoire, un territoire sans loi ?
Les problèmes de régulation que suscitent les réseaux de commu-
nication mondiaux peuvent être classés, suivant leur nature, en deux
catégories. La première est liée aux décalages qui peuvent exister
entre systèmes normatifs et soulève la difficulté de déterminer le
cadre réglementaire applicable aux services d'information. La seconde
renvoie aux spécificités techniques mêmes des réseaux, qui rendent
leur contrôle malaisé ou même impraticable.
La mise en contact de normes et de systèmes de valeurs et différents
La circulation des flux d'information met souvent en contact des
normes et des systèmes de valeurs différents. Ceci se produit lorsque
les lieux de production, de stockage et de consommation des services
d'information se situent sur des territoires distincts. Les réseaux de
communication ne sont ici qu'indirectement en cause, en tant
qu'instruments, et ce type de problèmes apparaît aussi bien à
l'occasion d'échanges internationaux non médiatisés par des réseaux.
Les réseaux électroniques introduisent toutefois deux faits nouveaux :
d'une part, ils simplifient et accroissent les possibilités de contact
entre systèmes normatifs distincts; d'autre part, ils tendent à
supprimer les intermédiaires de toutes sortes qui, dans les échanges
internationaux, remplissent une fonction d'ajustement, voire de
régulation.
Se range dans cette catégorie le problème des contenus indési-
rables. Des sites internet situés dans un pays A peuvent offrir des
services jugés indésirables dans un pays B, soit parce qu'ils sont en
contradiction explicite avec les lois nationales, soit parce que, sans
être illégaux, ils sont contraires aux valeurs sociales, politiques ou
culturelles dominantes dans ce pays. En France, une loi interdit les
textes néjationnistes, alors que ceux-ci peuvent être librement diffu-
sés aux Etats-Unis en vertu du Premier Amendement. Inversement,
les pays européens sont plus libéraux que les États-Unis quant à la
reproduction de la nudité. La régulation des transactions de toutesLa gouvernance des réseaux mondiaux de communication 19
sortes que permettent les réseaux de communication relève aussi de
cette catégorie. Quel droit de la consommation mettre en œuvre lors-
qu'un utilisateur d'Internet espagnol achète des marchandises aux
États-Unis ou au Japon? Quel est le régime des droits d'auteur qui
s'applique pour l'accès par Internet à des textes littéraires ou des
œuvres musicales ?
La nature technique des réseaux : un espace d'extraterritorialité ?
Le second type de problèmes tient aux caractéristiques spéci-
fiques des réseaux électroniques qui les font apparaître comme un
espace de communication échappant à toute possibilité de contrôle.
En premier lieu, la facilité d'accès à Internet accroît dans des propor-
tions gigantesques les possibilités de production des informations qui,
jusqu'à présent, étaient limitées par des obstacles techniques (rareté
des fréquences), économiques (coûts de production et de diffusion),
organisationnels (procédures de filtrage instituées par les médias
traditionnels ou les éditeurs). Il en résulte une inflation des sources
d'information qui, du fait de leur seul nombre, deviennent diffici-
lement contrôlables. L'origine des informations offertes sur Internet
est, ensuite, incertaine, soit parce qu'il est possible de recourir à
l'anonymat, soit parce qu'elle est reproduite, suivant le principe de la
boule de neige, par de multiples sites. Enfin, l'étendue et la rapidité
de diffusion d'un réseau comme Internet rend beaucoup plus malaisée
la maîtrise des effets des informations. Ceux-ci ne sont pas locali-
sables (comme ils peuvent relativement l'être avec les médias clas-
siques) et peuvent être beaucoup plus puissants : une information peut
ainsi toucher en très peu de temps plusieurs millions de personnes
dans des dizaines de pays.
Pour illustrer ce triple problème - entrée ouverte, origine incer-
taine et impact non localisable -, on peut prendre le cas d'une infor-
mation diffamatoire concernant une entreprise, diffusée dans un
groupe de discussion. Contrairement à ce qui se produit dans les
médias traditionnels, les filtrages préalables sont souvent très faibles ;
il est la plupart du temps difficile d'imputer cette information à une
source bien déterminée qu'il serait possible de poursuivre devant les
tribunaux ; cette information peut circuler dans des dizaines de pays
(sans qu'on sache exactement lesquels), ce qui rend illusoire toute
action de réparation et complique les stratégies de réplique (on n'est
pas sûr de toucher les mêmes récepteurs).
Au total, la loi régissant les services d'information dans un pays
peut s'avérer inopérante du fait de la déterritorialisation que les
réseaux électroniques permettent : la loi se retrouve en quelque sorte
privée de territoire. Les spécificités techniques de réseaux électro-
niques semblent d'autre part créer un espace de communication20 THIERRY VEDEL
incontrôlable et engendrer un territoire où il ne peut donc y avoir de
loi.
PENSER LA GOUVERNANCE DES RÉSEAUX
Systèmes techniques autonomes ou construits sociaux ?
La gouvernance des réseaux de communication renvoie d'abord à
un vieux débat sur la capacité des sociétés humaines à orienter et à
contrôler le développement des systèmes techniques qu'elles utilisent.
Ne peut-on pas penser, au contraire, que les systèmes techniques sont
mus par une logique autonome et imposent des formes sociales
inscrites dans leur modus operandi') Cette interrogation a fait l'objet
d'une abondante littérature, qui dépasse largement le cas des techno-
logies de communication, opposant d'un côté les tenants du détermi-
nisme technique à ceux qu'on appelle les socioconstructivistes15.
La thèse de l*autonomie des réseaux.
La thèse de l'autonomie de la technique recouvre deux processus
différents qu'on a souvent tendance à confondre dans le langage cou-
rant, voire dans le langage scientifique.
Elle renvoie d'abord au mode de gestation des techniques et
considère que les techniques naissent et se développent selon une
logique propre - celle des lois de la science - et échappent largement
à la volonté des hommes. Dans cette perspective, les ingénieurs ne
seraient que les serviteurs ou les accoucheurs, et non les producteurs,
d'un développement technique inévitable. Le rôle des gouvernements
se limiterait à accompagner l'évolution technique, par exemple pour
en accroître les retombées économiques ou en minimiser les coûts
sociaux. Les écrits de Jacques Ellul sont sans doute ceux qui portent à
l'extrême cette vision de la technique. À lire son maître ouvrage16, on
a presque l'impression que la technique a une vie propre, qu'elle est
douée d'une conscience et d'intentions (maléfiques dans l'esprit
d'Ellul, marqué par un fort pessimisme). Autre figure célèbre de ce
15. Pour une présentation plus détaillée de ces courants, voir : Patrice Flichy, L'inno-
vation technique. Récents développements en sciences sociales. Vers une nou-
velle théorie de Vinnovation, Paris, La Découverte, 1995. Thierry Vedel,
«Introduction à une socio-politique des usages», in André Vitalis (dir.), Médias
et nouvelles technologies de communication. Pour une socio-politique des
usages, Rennes, Éditions Apogée, 1994, p. 13-35.
16. Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990 (réédi-
tion de l'édition originale de 1954, remaniée en 1960 par l'auteur).La gouvernance des réseaux mondiaux de communication 21
courant, Robert Heilbroner, tout en ayant une vision moins animiste
de la technique qu'Ellul, soutient que l'évolution technique suit un
chemin nécessaire par lequel toutes les sociétés doivent passer. Ceci
est, selon lui, confirmé par trois éléments : la simultanéité des inven-
tions dans différents pays, qui montre que les processus de connais-
sance se font selon une frontière bien définie et non pas au hasard ;
l'absence de sauts technologiques et la progression incrémentale des
connaissances; enfin, le fait qu'on peut prédire le devenir de la
technologie qui atteste que celle-ci obéit à une logique interne17.
La thèse de l'autonomie de la technique est aussi une façon de
concevoir les effets de la technique : la technique porterait en elle un
modus operandi qui définit ses usages - donc ses conséquences
sociales. Cette vision déterministe de la technique est très répandue.
Elle imprègne les représentations des décideurs politiques et des
cadres économiques et surtout des ingénieurs, par exemple lorsqu'ils
décrivent les changements liés aux technologies de l'information.
Cette conception de la technique modelant la société semble naturelle
à beaucoup d'entre nous. Dans le domaine des sciences sociales, elle a
été illustrée par quelques figures célèbres : Harold Innis, Marshall
McLuhan, Lewis Munford. Ce dernier considérait que la technique
était capable de conditionner les rapports de pouvoir et estimait qu'on
pouvait distinguer des systèmes techniques autoritaires et des sys-
tèmes techniques démocratiques18. Cette thèse a été reprise récem-
ment, quoique de façon plus nuancée, par Langdon Winner19 qui
l'illustre par l'exemple des techniques de génération de l'énergie.
Selon L. Winner, l'énergie nucléaire appelle un système technique
autoritaire, car elle exige une structure de commandement centralisée
et hiérarchisée en raison de son coût de développement, des risques
pour l'environnement ou de la sécurité exigée pour empêcher les actes
terroristes. À l'inverse, l'énergie solaire favorise un système technique
démocratique qui peut se développer de manière décentralisée, sans
danger pour l'environnement ni mesures de sécurité renforcées.
Les réseaux comme cristallisation de rapports sociaux
À l'inverse des déterminismes techniques qui soulignent l'auto-
nomie de la technique, ceux qu'on appelle les socioconstructivistes
17. Robert L. Heilbroner, « Do Machines Make History?», Technology and Culture,
juillet 1967, n° 8, p. 335-345.
18. Lewis Mumford, « Authoritarian and Democratic Technics », Technology and
Culture, janvier 1964, n° 5, p. 1-8. Voir aussi : Lewis Mumford, The Myth of the
Machine. The Pentagon of Power, New York, Harcourt Brace, 1970.
19. Langdon Winner, Autonomous Technology. Technics-out-of-control as a Theme
in Political Thought. Cambridge, MIT Press, 1977.22 THIERRY VEDEL
appréhendent celle-ci comme un produit, une construction sociale
(d'où leur nom) 20 . Ce courant est plus récent dans les sciences
sociales, son émergence remontant à une trentaine d'années. Il est issu
de l'analyse historique des controverses scientifiques et d'études qui
se sont attachées à comprendre comment une théorie devient vraie
dans telle ou telle communauté scientifique.
Les socioconstructivistes constatent, par exemple, que si une
communauté scientifique reconnaît un théorème comme vrai, ce n'est
pas d'abord en raison de sa capacité à expliquer parfaitement le réel,
mais parce qu'un consensus politique a pu se faire autour de ce
théorème. En d'autres termes, la science et par extension les systèmes
techniques obéissent à la loi des hommes, à leur capacité ou incapa-
cité à se mettre d'accord avant de dépendre de lois naturelles. Ce rai-
sonnement a été ensuite transposé à l'étude des innovations tech-
niques et illustré par des dizaines d'études de cas. T. J. Pinch et W. E.
Bijker, deux figures de proue de ce courant, ont ainsi montré que le
choix de la forme des ailes d'avions dans l'armée américaine résultait
avant tout des coalitions d'intérêts (rassemblant des industriels, des
segments du ministère de la Défense et des parlementaires) qui
pouvaient se mettre en place pour soutenir telle ou telle option. Si
telle forme d'aile était adoptée, ce n'était pas parce qu'elle était plus
efficace ou parce que les lois physiques l'exigeaient, mais parce que
cette option était soutenue par une coalition plus puissante que la coa-
lition adverse. En d'autres termes, les choix techniques sont d'abord
des choix politiques en ce qu'il reflètent des rapports de force et des
configurations sociales particulières.
Internet, système technique autonome ou construit social ?
On retrouve aujourd'hui ces deux approches - déterministe et
socioconstructiviste - dans les manières de concevoir un réseau
comme Internet. D'un côté, il existe un courant qui, en filiation (plus
ou moins inconsciente) avec L. Munford, estime qu'Internet échappe,
par nature, en raison de sa configuration technique, à toute possibilité
de contrôle. Le fait qu'il repose sur un protocole de communication
par paquets (qui scinde les messages en sous-ensembles pour les
acheminer par des chemins différents et inconnus à l'avance) rend en
particulier difficile la censure des messages. De façon plus générale,
20. Pour une présentation très complète de cette approche, voir : Wiebe E. Bijker et
John Law (dir.), Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical
Change, Cambridge, Ma, MIT Press, 1992. Et aussi, l'article fondateur de Trevor
J. Pinch et Wiebe E. Bijker, « The Social Construction of Facts and Artefacts : Or
How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit
Each Other», Social Studies of Science, 1984, vol. 14, p. 399-441.La gouvernance des réseaux mondiaux de communication 23
certains pensent que l'évolution technique est si rapide dans le
domaine des technologies de communication qu'il est impossible de
mettre en place un cadre réglementaire efficace21. En outre, Internet
est fréquemment pensé comme un réseau naturellement - en raison de
sa structure décentralisée, ouverte à tous, sans risque pour l'environ-
nement - démocratique et libérateur, capable de renforcer le lien
social et de revitaliser la politique22.
Cette vision - qu'on peut qualifier de cyberlibertarienne - et qui
est spécialement vivace aux États-Unis, mère patrie du réseau Internet
- est portée par un courant hétéroclite regroupant aussi bien des
libéraux défenseurs du marché, de l'entreprise individuelle et du
primat de l'individu sur l'État, que des activistes radicaux qui ressus-
citent une conception jeffersonnienne de la citoyenneté et de la
politique. Elle se retrouve par exemple dans les écrits de George
Gilder, de Nicholas Negroponte, dans la revue phare des cybernautes
Wired, ou encore dans de nombreuses publications sur le web, telles
que le manifeste Cyberspace and The American Dream : A Magna
Carta for the Knowledge Age23.
À l'inverse, dans la double lignée du socioconstructivisme et de la
tradition critique de l'École de Francfort, un autre courant pense
Internet comme un espace de communication modelé par les rapports
sociaux et reflétant les structures de domination qui existent dans nos
sociétés. Le réseau mondial est alors vu comme le lieu où se redé-
ploient des stratégies de contrôle, économiques ou politiques, mises
en œuvre par de grandes firmes transnationales ou par les États. Les
unes et les autres mettent à profit les potentialités des nouvelles
technologies de l'information et de la communication pour régénérer
et reconfigurer leur pouvoir24 (un processus qui n'exclut pas de mul-
tiples conflits et contradictions, l'évolution technique faisant émerger
21. Ce point de vue est notamment défendu par Peter Huber, Law and Disorder in
Cyberspace, New-York, Oxford University Press, 1997. Huber pense en consé-
quence que le seul moyen d'aboutir à un ordre dans ce qu'il appelle le telecosmc
passe par le marché et l'arbitrage entre acteurs privés.
22. Pour une présentation - et une critique- de cette thèse, voir Doug Schuler,
«Global Communication and Community Networks. How Do We Institutiona-
lize Democracy in the Information Age?», Communications & Strategies, 1998,
n° 31, p. 79-91.
23. George F. Gilder, Microcosm. The Quantum Revolution in Economics and
Technology, New-York, Simon and Schuster, 1989. Nicholas Negroponte, Being
Digital, New-York, Alfred A. Knopf, 1995. Esther Dyson, et ai, Cyberspace and
the American Dream : A Magna Carta for the Knowledge Age, 1994. Consultable
à: http://www.townhall.com/pff/position.html.
24. Pour une mise en perspective historique de ce processus, voir : James Beniger,
The Control Revolution. Technological and Economic Origins of the Information
Society, Cambridge, Harvard University Press, 1986.24 THIERRY VEDEL
de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques qui s'opposent aux
acteurs dominants). Le réseau mondial n'est alors plus un outil de
libération capable de féconder une société plus harmonieuse - quoique
cette image continue à être diffusée par les États et les firmes
transnationales à des fins idéologiques comme mythe mobilisateur (et
mystificateur) pour légitimer l'avènement de la société de l'informa-
tion 25 . Internet - et plus généralement les réseaux électroniques
mondiaux - est avant tout un instrument de reproduction et d'adapta-
tion de la société capitaliste et de sa commercialisation rampante,
l'essor des transactions électroniques ou la stratégie monopoliste de
Microsoft peuvent l'indiquer; ou encore, un instrument de contrôle
social et de surveillance au service des administrations étatiques
(grâce aux capacités d'observation de la vie privée qu'il donne)26 et
de colonisation culturelle au service des États-Unis27.
De nouveaux cadres réglementaires sont-ils nécessaires ?
La gouvernance des réseaux de communication planétaires
soulève en second lieu la question de savoir, d'une part, si ces réseaux
créent des pratiques et des formes de communication inédites, pour
lesquelles nous ne possédons pas de répertoire d'action et que nous
devons donc conceptualiser, notamment sur le plan juridique, et
d'autre part, comment l'évolution technique peut être pratiquement
saisie par la réglementation28.
L'appréhension juridique des réseaux et de leurs usages
Il existe à ce sujet deux écoles. La première estime que nous
connaissons déjà la nature des problèmes liés à l'utilisation des
réseaux de communication mondiaux. Ce qui changerait seulement
c'est l'échelle territoriale et la vitesse de propagation de ces pro-
blèmes. Ainsi, selon cette approche, on peut soutenir que la divulga-
25. Voir: B. Woolley, Virtual Worlds, London, Blackwell, 1992, qui voit dans les
communautés virtuelles une version moderne de l'opium du peuple.
26. David Lyon, The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society, Cambridge,
Polity Press, 1994.
27. Herbert Schiller, «The Global Information Highway. Project for an Ungover-
nable World» dans J. Brook et I. Boal (dir.), Resisting the Virtual Life, San
Francisco, City Lights, 1995, p. 17-33.
28. Sur ces questions, on se reportera au remarquable et magistral ouvrage: Pierre
Trudel et al, Droit du cyberspace, Montréal, Éditions Thémis, 1997, dans lequel
on trouvera une bibliographie détaillée.Vous pouvez aussi lire