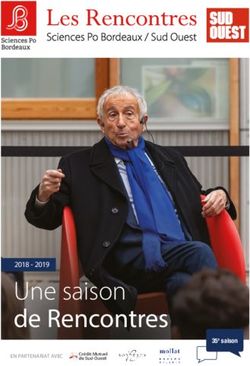JJoouurrnnaall ddee ll''AAPPFF - nn 7744 JJuuiilllleett 22001188 La Revue Semestrielle de l'Association Paléontologique Française - Association ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
JJoouurrnnaal ddee ll''A
APPF
F
nn°°7744 JJuuiilllleett 22001188
La Revue Semestrielle de
l’Association
Paléontologique Française
Numéro spécial :
les résumés du
Congrès 2018
de l'APF à Bruxelles.L'Association Paléontologique Française
Le bureau
Eric Buffetaut Nathalie Bardet Laurent Londeix
(CNRS) (CNRS) (Univ. Bordeaux)
Président Secrétaire Trésorier
Damien Germain Claude Monnet Thierry Tortosa
(MNHN) (Univ. Lille) (Conseil départemental
Conseiller Conseiller des Bouches du
Rhône)
Conseiller
Secrétariat : Cotisation :
1 an : 16 euros, 2 ans : 30 euros, 5 ans : 70 euros
Nathalie Bardet
Muséum National d'Histoire Naturelle Chèque au Nom de :
Département Histoire de la Terre Association Paléontologique Française
Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et A adresser à :
les Paléoenvironnements (CR2P)
UMR 7207 du CNRS Laurent Londeix
8, rue Buffon CP 38 UMR CNRS 5805 EPOC OASU
75005 Paris Université de Bordeaux, Site de Talence
Bâtiment B18
Tel. : (+33) 1 40 79 34 55 Allée Geoffroy SaintHilaire
FAX : (+33) 1 40 79 35 80 CS 50023, 33615 PESSAC CEDEX
email : bardet@mnhn.fr
Tel. : (+33) 5 40 00 88 66
FAX : (+33) 5 40 00 33 16
laurent.londeix@ubordeaux.fr
2Journal de l'APF n°74 SOMMAIRE
Editorial .......................................................................... 4
Compterendu du congrès
de l'Association Paléontologique Française 2018 ........ 5
Excursion post congrès .................................................. 7
Prix de l'APF 2018 .......................................................... 9
Résumés du congrès ....................................................... 11
Couverture : "Montage d'un premier iguanodon". tableau de Léon Becker (1884) exposé au
Museum d'Histoire Naturelle de Bruxelles.
3EDITORIAL
Chers membres de l'APF, La possibilité d'organiser la réunion
annuelle de l'APF dans le cadre très plaisant du
Ce numéro est consacré principalement au château du Fontenil, dans l'Orne, évoquée par
congrès 2018 de l'APF, qui, pour la deuxième fois Michel Laurin, a dû être écartée pour des raisons
après Bâle en 2015, s'est tenu hors de France, pratiques, le château ne pouvant accueillir le
cette fois dans le cadre prestigieux de l'Institut nombre de personnes qui participent
royal des Sciences naturelles de Belgique, où habituellement à notre congrès. Cependant, nous
Floréal Solé et Sébastien Olive ont très bien fait envisageons d'organiser au château une table
les choses pour assurer une réunion d'un haut ronde sur un thème qui est en cours de définition,
niveau scientifique dans une ambiance très avec un nombre limité de participants. Des
conviviale ! Outre le compterendu du congrès et précisions vous seront fournies dès que possible.
de l'excursion qui lui a fait suite, vous trouverez Bonne lecture !
aussi l'ensemble des résumés des communications
orales et posters qui y ont été présentés. Je Eric Buffetaut
rappelle d'ailleurs que le Journal de l'APF est une Président de l'APF
publication scientifique en bonne et due forme,
avec un numéro d'ISSN, et que les résumés qui y
sont publiés peuvent donc très bien être cités
comme tels, ils n'appartiennent pas aux limbes de
la « littérature grise ».
La question du lieu de notre prochaine
réunion annuelle a fait l'objet de discussions
animées. Il m'est désormais possible d'annoncer
que l'édition 2019 se tiendra à AixenProvence
du 16 au 19 avril, organisée par Yves Dutour et
Thierry Tortosa. La première circulaire donnera
tous les détails nécessaires. Je rappelle d'ailleurs
que toutes les suggestions sont bienvenues pour
les prix Cuvier (qui couronne une carrière de
paléontologue) et Saporta (qui récompense
l'activité d'un paléontologue nonprofessionnel,
ou d'une association). J'ajoute qu'une partie du
Conseil de l'APF doit être renouvelée, après appel
à candidatures, lors du congrès de 2019.
4Congrès de l'Association Paléontologique Française
Bruxelles, 4 6 avril 2018
Pour la deuxième fois de son histoire poursuivie par la visite libre du musée et une
récente, le congrès de l’Association visite guidée des collections par notre hôte
Paléontologue Française s’exporte chez nos Annelise Folie, conservatrice des collections de
voisins, et cette foisci en Belgique, au très paléontologie. Ce fut l’occasion d’admirer les
prestigieux Institut Royal des Sciences Naturelles fameux iguanodons de Bernissart dont de
de Belgique à Bruxelles. Situé à deux pas du nombreux squelettes sont exposés, mais
Parlement européen, l’Institut est une imposante également d’avoir un aperçu des très riches
bâtisse devant laquelle pose fièrement le fameux collections du Muséum. La journée s’est achevée
Iguanodontoboggan très prisé par la jeunesse par un cocktail de bienvenue avec, cela va sans
bruxelloise. C’est donc dans une salle située au dire, dégustation de bières belges, et pas qu’une
beau milieu du musée que se sont tenues les fois!
présentations. La deuxième journée de communications
dont une partie étaient présentées par les six
candidats au prix d’Orbigny nous a transportés
dans les mondes fossiles aquatiques du
Paléozoïque canadien aux environnements
terrestres du Crétacé de Sibérie en passant par le
Tertiaire d’Amérique du Sud. La mouture 2018 du
congrès de l’APF avait en effet pour thème la
paléontologie “out of Europe” qui a été plutôt
bien suivi. La journée s’est terminée par le
dîner de gala dans la brasserie belge “le Volle
Gas” au cachet traditionnel et décorations
Ils sont concentrés nos G. O.
Accueillis par nos zélés organisateurs
Floréal Solé et Sébastien Olive, la première
journée à débuté par les habituelles retrouvailles
autour d’un café suivies par les discours
d’ouverture de la directrive de l'Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique, Camille Pisani,
et du directeur de la direction opérationnelle Terre
et Histoire de la Vie du musée, Pascal Godefroit.
Les communications se sont ensuite enchaînées
avec des thématiques variées alternant entre
découvertes paléontologiques, avancées en
systématique, en évolution, avec notamment les
présentations de six candidats au prix Depéret,
mais également en histoire des sciences et histoire
des collections et de spécimens. Jérémy Anquetin
a profité de l’opportunité pour promouvoir une
plateforme de peerreview communautaire dédiée
à la paléontologie, gratuite et ouverte pour la Face aux portes des collections, on se sent...
petits!
paléontologie : PCI Palaeo. L’après midi s’est
5d’antan.
La troisième journée était dédiée à la
remise des différents prix de l’APF récompensant
une carrière de chercheur (prix Cuvier), le travail
d’un paléontologue “non académique” (prix
Saporta), la présentation d’une thèse récemment
défendue (prix D’Orbigny) et le prix de la
meilleur présentation d’étudiant (prix Depéret).
Cette année, le jury n’ayant pu se prononcer entre
deux candidats, le prix d’Orbigny a été partagé
(voir page 10). Les récipiendaires des prix Cuvier
et Saporta, cette année Alain Blieck et Marc Au dîner de gala, certains n'ont pas attendu
pour trinquer... A votre santé les jeunes !
Bosselaers, ont ensuite eu tout le loisir de nous
présenter leurs œuvres et leur passion de la l’assemblée générale a été l’occasion de faire le
recherche pendant le reste de la matinée. Les point des activités de l’association, de l’état du
communication scientifiques ont repris l’après site web et de la page Facebook, de confirmer le
midi, faisant la part belle aux dinosaures, lieu de la tenue du prochain congrès APF et de
ammonites, rongeurs, radiolaires, stromatopores, réfléchir à la création de journées “ateliers”
mais également à une tortue dont le nom scientifiques sous un format devant être discuté.
assurerait la victoire à un joueur de scrabble, si Les participants se sont enfin quittés en se
les noms latins étaient autorisés : donnant rendezvous en 2019 dans le sud, sauf
Nanhsiungchelys wuchingensis. La journée s’est pour ceux qui ont poursuivi l’expérience
poursuivie par l’événement qui ruine les jeunes paléontologique belge avec l’excursion dans la
papas et les dinosgeek, mais alimente les prix de contrée des iguanodons...
l’APF : la vente aux enchères des goodies et
ouvrages. Une fois encore les participants ont été
généreux, et le commissairepriseur joué par notre
président (Eric, pas Emmanuel…) était dans une
forme digne de celle des meilleurs représentants
d’antiquités “vraies” du souk d’Erfoud. Enfin,
6Excursion post congrès
7 avril 2018
C’est un large convoi de 43
paléontologues (environ 2/3 des participants au
congrès) qui s’est déplacé dans la région de Mons
pour l’excursion postcongrès.
Nous avons été reçus en matinée au musée de
l’iguanodon à Bernissart.
La localité d’âge crétacé de Bernissart est
célèbre pour les squelettes complets d’iguanodons
qu’elle a délivrés mais cette dernière a également
fourni de nombreux restes d’actinoptérygiens, de
crocodiles, quelques restes d’amphibiens, des
insectes, des coprolithes et une flore bien Bien reçus au musée de l’iguanodon à
Bernissart !
diversifiée. Tous ces restes ont été trouvés dans
une argile lacustre d’âge Barrémien/Aptien. Le Après un gourmand petitdéjeuner sur
musée de l’iguanodon retrace l’histoire des place et une visite du musée, une présentation du
fouilles à Bernissart et présente de nombreux projet ColdCase a été donnée par Koen Stein
fossiles collectés làbas. (VUB), JeanMarc Baele (UMons), Pascal
Godefroit, Cyrille Prestianni et Sébastien Olive
(IRSNB). Ce projet a pour but de comprendre ce
qui a mené à l’accumulation massive de tant de
squelettes d’iguanodons. S’en est suivi un pique
nique à la belge, dans le jardin du musée,
composé de fromages, charcuterie et bien sûr de
bières du pays.
Le musée recèle de trésors…
… en tout genre!
7Le premier arrêt de l’aprèsmidi s’est
déroulé, ou plutôt aurait dû se dérouler, à l’endroit Nous nous sommes alors rendus aux
où se situait l’entrée de la mine de Bernissart (le carrières souterraines de la Malogne, qui ont été
puit SainteBarbe). Malheureusement cette exploitées au début du 20ème siècle pour le
dernière se trouve désormais dans un jardin phosphate. D’âge Maastrichtien, ces carrières
privatif et notre commémoration n’a pas pu avoir exposent encore en place des fossiles de
lieu. mosasaures, tortues et bélemnites notamment.
Notre visite a été faite par Thierry Mortier de
l’ASBL Malogne (UMons) qui a su rendre le
voyage souterrain passionnant. Nous nous
sommes ensuite rendus à Binche (ville wallonne)
où le même Thierry Mortier nous a commenté
l’architecture de la ville et a fait avec brio le lien
entre paléontologie et architecture. Le retour à
Bruxelles a eu lieu en début de soirée et chacun a
pu retrouver son hôtel/train/avion respectif.
Des paléontologues au centre de la Terre
8Remise des prix de l'APF
Bruxelles, 6 avril 2018
Le Prix Cuvier 2018 a été remis à Alain Blieck,
Directeur de Recherche émérite au CNRS. Comme il
nous l'a rappelé dans une conférence aussi originale que
brillante, la carrière scientifique d'Alain est fortement liée
à la région lilloise, dont il est originaire, et où il a passé le
plus clair de sa vie professionnelle, à l'exception d'un
épisode parisien de quelques années, correspondant à la
préparation de ses thèses (de 3e cycle, sur les
hétérostracés du Dévonien inférieur du Spitsberg, et
d'état, une vaste synthèse sur les hétérostracés
ptéraspidiformes) au MNHN. Ses travaux sur les
vertébrés paléozoïques, dont il est un spécialiste
incontesté, l'ont donc mené à s'intéresser à des fossiles
provenant de contrées bien éloignées de sa Flandre natale,
de l'Arctique canadien à la Russie en passant par le
Svalbard. Outre ses nombreuses publications
scientifiques, l'implication d'Alain Blieck dans le milieu
associatif, entre autres à la Société géologique du Nord, Alain Blieck reçevant le prix Cuvier
qu'il a largement contribué à revivifier, mérite aussi d'être
signalée. Comme il l'a annoncé au cours du congrès, Alain est actuellement fort impliqué dans la rédaction
du "Handbook of Paleoichthyology" consacré aux agnathes. L'APF lui souhaite tous les succès dans cette
entreprise et dans ses autres projets de recherche.
Le Prix Saporta 2018 a été remis à Mark
Bosselaers qui, tout en menant une carrière dans
l'enseignement artistique, s'est passionné pour les
vertébrés fossiles du Néogène marin de la région
d'Anvers, tant en Belgique qu'aux PaysBas, où il a
collecté des spécimens aussi abondants que précieux –
comme il l'a raconté dans une conférence pleine
d'humour. Ses recherches l'ont conduit à collaborer avec
de nombreux chercheurs, notamment de l'Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique, sur des sujets
paléontologiques variés, avec une prédilection pour les
cétacés, mais aussi, entre autres, les tortues marines. De
ces travaux ont résulté de nombreuses publications
scientifiques, portant sur des sujets très variés et parfois
aussi inattendus que d'une grande ingéniosité
scientifique, tels qu'une étude sur les balanes fossiles
comme indicateurs de la diversité des cétacés
méditerranéens au Pléistocène. Mark Bosselaers n'est
pas un paléontologue « professionnel » au sens étroit du
terme, mais la qualité de ses travaux le place
Mark Bosselaers reçevant le prix Saporta
indéniablement parmi les spécialistes éminents de notre
discipline.
9Le prix d'Orbigny (prix de thèse) a été
partagé entre
Marion Chevrinais (Université de Nantes) pour sa
thèse, Perspectives phyloévodévo de la
diversification des vertébrés du Paléozoïque,
soutenue en 2016 à l'Université du Québec à
Rimouski,
et Jean Goedert (Université de Bordeaux) pour sa
thèse, Ecologie des premiers tétrapodes dévoilée
par la composition isotopique du soufre (34S/32S)
de leurs squelettes, soutenue en 2017 à
l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Marion Chevrinais et Jean Goedert reçevant le
Prix D'Orbigny
Le prix Depéret, décerné à l'auteur de la
meilleure présentation par un étudiant, a été
décerné à Kévin Le Verger (MNHN), pour sa
communication Anatomie crânienne de
Cynodictis (Mammalia, Carnivora), le plus
ancien Amphicyonidae d’Europe : implications
sur la radiation des Caniformia et la
paléoécologie au passage de la Grande
Coupure.
Kévin Le Verger reçevant le prix Depéret
10Résumés du Congrès
Communications orales
11La radiation initiale des ammonoïdes au Dévonien : richesse taxonomique et évolution
faunique
Ninon Allaire1, Claude Monnet1, Catherine Crônier1
1Univ. Lille, CNRS, UMR 8198 – EvoEcoPaleo, F59000 Lille, France (Ninon.Allaire@ed.univ
lille1.fr ; Claude.Monnet@univlille.fr ; Catherine.Cronier@univlille.fr)
Les ammonoïdes constituent un des groupes fossiles d’invertébrés marins les plus abondants et
prolifiques du Phanérozoïque. Ces céphalopodes à coquille externe sont apparus au Dévonien
inférieur et se sont diversifiés dans le contexte de la « Révolution dévonienne du Necton » avec
un développement de tendances morphologiques macroévolutives particulières. La fin du
Dévonien (crise Frasnien–Famennien) marque aussi le premier goulot d'étranglement majeur
de l'histoire évolutive des ammonoïdes. Afin de mieux comprendre l'établissement de cette
« Révolution dévonienne du Necton » et les événements d'extinction du Dévonien, le présent
travail concerne une analyse des fluctuations de la biodiversité caractérisant l'évolution des
ammonoïdes à travers le Dévonien. Dans ce contexte, nous concentrons nos investigations sur
la zone représentative des ammonoïdes du Maroc (Afrique du Nord), sur la composante
taxonomique de la biodiversité (richesse taxonomique, composition et similitudes), et sur deux
échelles temporelles (14 sousétages et 67 biozones à ammonoïdes). Ces analyses sont
effectuées sur une base de données construite à partir des informations issues des publications
les plus récentes (afin d’avoir une taxonomie et une biostratigraphie homogène et la plus
précise possible). Ce jeu de données contient 1810 occurrences d'ammonoïdes, réparties de
l'Emsien jusqu'au Famennien, et provenant de 64 localités différentes. Ces occurrences
comprennent 444 espèces (57 de l'Emsien, 71 de l'Eifélien, 129 du Givétien, 40 du Frasnien et
170 du Famennien), 146 genres, 45 familles et 19 superfamilles. Dans cette étude, la richesse
taxonomique et la composition des ammonoïdes du Dévonien marocain sont analysées au
niveau du genre et de l'espèce en utilisant des données d'incidence (présence) ; les données
d'abondance sont rarement disponibles et n'étaient présentes que dans quelques publications.
L’enregistrement fossile étant imparfait et biaisé, les fluctuations de richesse taxonomique ont
été analysées avec différents indices, et différentes méthodes classiques (indices de diversité
brute échantillonnée et de diversité normalisée ; taux de Foote ; polycohortes) et plus récentes
(indice de dédiscrétisation par rééchantillonnage), et de manière similaire pour l’évolution
comparée de la composition taxonomique (distinction taxonomique, faunes évolutives
factorielles), afin de corriger au mieux ces imperfections. Les résultats suggèrent d'importantes
variations de la richesse taxonomique, associées à des valeurs particulièrement élevées à
l'Eifélien supérieur, au Givétien moyen et au Famennien terminal (périodes de
biodiversification), et à des valeurs très faibles au début de l'Eifélien inférieur, au Frasnien
inférieur et supérieur, et au Famennien inférieur et moyen. Les analyses réalisées à l'échelle de
la biozone révèlent des variations de plus haute résolution, non observable en considérant les
variations au niveau de l'étage ou du sousétage. Des phases de diminution drastique de la
richesse taxonomique sont observées entre le Givétien et le Frasnien, et à la fin du Famennien.
Des phases de diminution importante sont également constatées au niveau des limites Emsien/
Eifélien et Eifélien/Givétien, et au cours du Famennien terminal. Certaines de ces fluctuations
peuvent être reliées à des évènements d'extinction connus au Dévonien, avec notamment une
forte influence des variations climatiques et des événements anoxiques.
12Climat et stratégies de reproduction aux hautes latitudes ; le cas des dinosaures du
Crétacé Supérieur de Sibérie orientale
Romain Amiot1, Lina B. Golovneva2, Pascal Godefroit3, Jean Goedert1, Géraldine Garcia4,
Christophe Lécuyer1
1CNRS UMR 5276 LGLTPE, Université Claude Bernard Lyon 1 and Ecole Normale Supérieure
de Lyon, 2, Rue Raphaël Dubois, 69622 Villeurbanne Cedex, France. Romain.amiot@univ
lyon1.fr; jean.goedert@enslyon.fr;christophe.lecuyer@univlyon1.fr
2V.L. Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia.
Lina_Golovneva@mail.ru
3Directorate ‘Earth and History of Life’, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, rue Vautier
29, B1000 Brussels, Belgium.Pascal.Godefroit@naturalsciences.be
4PALEVOPRIM, UMR CNRS 7262, Université de Poitiers, UFR SFA, Bat. B35, 6 rue M. Brunet,
TSA 51106, 86073 Poitiers cedex 9, France.geraldine.garcia@univpoitiers.fr
Les coquilles fossilisées d’œufs de deux oofamilles de dinosaures découvertes dans un
gisement Maastrichtien de Sibérie constituent la trace la plus septentrionale de reproduction de
ce groupe (Godefroit et al., 2009). La haute paléolatitude du gisement (environ 70 à 75°N)
associée à des conditions climatiques aux températures relativement basses estimées par les
données paléobotaniques (Golovneva, 2000) posent la question des stratégies de reproduction
adoptées par ces dinosaures afin d’incuber leurs oeufs et de prendre soin de leurs nouveaux
nés. Afin d’aborder cette question d’un point de vue climatique et saisonnier, nous avons
analysé les compositions isotopiques de l’oxygène (δ18Odent) et du carbone (δ13Cdent) de
l’apatite de dents de théropodes, d’hadrosaures et d’ankylosaures, d’écailles de lépisostéidés et
du carbonate de coquilles d’oeufs (δ18Ooeuf et δ13Coeuf) collectées dans le gisement
Maastrichtien de Kakanaut. A l’aide des équations de fractionnement isotopique établies entre
l’eau environnementale et le carbonate des coquilles d’oeufs (Lazzerini et al., 2016), ainsi
qu’avec le phosphate de l’apatite (Amiot et al., 2017), les compositions isotopiques de
l’oxygène des eaux ingérées par les dinosaures de Kakanaut ont été calculées et converties en
températures grâce à une relations existantes entre leδ18Oeau moyen des eaux météoriques et
la température moyenne de l’air (Lécuyer, 2014). La température calculée de 9±7°C correspond
à celle d’environ 10°C estimée à partir d’une analyse CLAMP (Golovneva, 2000), et correspond
aujourd’hui à la température moyenne observée aux moyennes latitudes soumises à des
climats tempérés frais. En considérant que la variabilité des valeurs de δ18Odent des dents de
dinosaures reflète au moins partiellement la variabilité annuelle du δ18Oeau des eaux de pluies
locales ingérées, alors les valeurs très basses de δ18Oeau des eaux calculées à partir du
δ18Ooeuf des coquilles d’œuf suggèrent que ces dinosaures ont pondu au début du printemps.
Comme pour de nombreuses espèces vivant aujourd’hui aux moyennes et hautes latitudes,
cette stratégie de ponte au printemps a permis aux dinosaures de Sibérie de profiter des
températures douces et de l’abondance croissante de nourriture pour élever leurs nouveaux
nés et les faire suffisamment grandir pour supporter l’hiver suivant.
Amiot, R. et al. 2017. Sci. Nat., 104, 47. DOI: 10.1007/s0011401714682
Godefroit, P. et al. 2009. Naturwissenschaften, 96, 495–501. DOI: 10.1007/s0011400804990
Golovneva, L.B., 2000. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ., 181, 43–54. DOI : 10.1144/GSL.SP.2000.181.01.05
Lazzerini, N. et al. 2016. Sci. Nat., 103, 81. DOI : 10.1007/s001140161404x
Lécuyer, C., 2014. WileyISTE, London 272pp.
13Peer Community in Paleontology (PCI Paleo) : une plateforme de peerreview
communautaire, gratuite et ouverte pour la paléontologie
Jérémy Anquetin1,2, Guillaume Billet3
1Jurassica
Museum, Porrentruy, Suisse (jeremy.anquetin@jurassica.ch)
2Départementdes Géosciences – Université de Fribourg, Suisse
3CR2P, UMR CNRS 7207 – MNHN, Sorbonne Université (guillaume.billet@mnhn.fr)
Le système de publication scientifique devient de plus en plus couteux pour les institutions, pour
les utilisateurs et au final pour le contribuable. De profonds changements sont en cours,
notamment une poussée en faveur du libre accès (Open Access). Cependant, la transition
progressive d’un modèle où le lecteur paie (journaux avec abonnement) à celui où les auteurs
paient (Gold Open Access ou Hybrid) ne réduira certainement pas de manière significative le
coût global de la publication scientifique. Par ailleurs, le système actuel manque
fondamentalement de transparence et reste relativement lent. Un système de publication plus
rapide, plus transparent, complètement ouvert et gratuit est désormais possible grâce aux
nouvelles technologies, et ce pour seulement une fraction du coût actuel. Il suffit simplement de
mettre en place ces outils pour les sciences biologiques. Les preprints (manuscrits publiés en
ligne avant relecture par les pairs) sont utilisés avec un certain succès depuis plus de 25 ans
par les physiciens, les mathématiciens, les astronomes et les informaticiens comme un moyen
de diffuser rapidement les résultats de recherche et de permettre une évaluation plus large et
immédiate. Les preprints sont apparus plus récemment dans le champ des sciences biologiques
et certains critiquent, probablement à juste titre, la diffusion de résultats nonvalidés par les
pairs. Par chance, la validation par les pairs (peerreview) est déjà un système autoorganisé
fourni par la communauté et peut très simplement être mise en place pour l’évaluation des
preprints. Le projet Peer Community In (PCI) appelle à la création de communautés de
chercheurs pour évaluer les articles disponibles sur les serveurs de preprints. PCI Evolutionary
Biology, la première de ces communautés, compte désormais plus de 350 scientifiques qui
évaluent des preprints dans leur discipline. Lancée début 2018, Peer Community in
Paleontology (PCI Paleo) est portée par un directoire international et par un nombre grandissant
de recommandeurs (= éditeurs). Il s’agit de la troisième communauté du projet PCI. Le
fonctionnement de PCI Paleo est très similaire à celui d’un journal conventionnel, sauf qu’il est
entièrement gratuit et transparent. Les manuscrits sont postés en ligne sous forme de preprints
et soumis à PCI Paleo pour peerreview. Ils sont ensuite évalués par au moins deux rapporteurs
extérieurs. Les versions révisées sont alors postées sur le serveur de preprints après chaque
série de peerreview. Si le papier est finalement accepté, une version finale est postée sur le
serveur et liée de manière permanente à un texte de recommandation (rédigé par l’éditeur) et
aux rapports d’évaluation publiés par PCI Paleo. Les articles recommandés par PCI Paleo sont
donc évalués (peerreviewed) de manière transparente, entièrement citables (DOI) et libres
d’accès, rendant ainsi caduque leur publication dans des journaux conventionnels (bien que
cela reste une
possibilité).
14Homologie sérielle, évolution corrélée et signal phylogénétique des molaires chez les
placentaires
Jérémie Bardin1, Guillaume Billet1
1Sorbonne Universités, CR2P, UMR 7207, CNRS, Université Paris 06, Museum national
d'Histoire naturelle, Paris, France.
Modéliser la complexité de l’évolution est crucial autant pour la reconstruction phylogénétique
que pour tester des scénarios évolutifs. Parmi les problèmes majeurs rencontrés se dresse le
cas de l’intégration morphologique et le problème de la prise en compte de la covariation entre
les caractères. Par exemple, l’intensité et les conséquences des corrélations entre les
structures sujettes à l’homologie sérielle comme les dents ont été largement discuté mais ont
rarement été investigué à une large échelle phylogénétique. Dans ce travail, nous avons
analysé les patrons de présence de cingulum sur les molaires (M1, M2, M3) de 274 espèces de
placentaires replacés dans leur contexte phylogénétique. Les analyses de codistributions
phylogénétiques tout comme des analyses de maximum de vraisemblance démontrent que
l’évolution de la présence de ces structures sur les trois molaires est fortement corrélée. Ces
caractères n’étant pas indépendants, ils ne doivent pas être codés séparément dans une
analyse phylogénétique. Les analyses de maximum de vraisemblance montrent que ces traits
morphologiques ont intérêts à être codé en un seul caractère composite avec des transitions
contraintes. Nos résultats sont, par ailleurs, en accord avec les connaissances actuelles sur les
mécanismes moléculaires et développementaux menant à la formation des cingulum. Cet
exemple démontre la nécessité de comprendre les patrons d’intégration entre les traits
morphologiques.
15Charophytes du Jurassique Supérieur Crétacé Inférieur du nord du bassin d’Aquitaine
(SO France)
RochAlexandre Benoit1,2, Didier Néraudeau1, Carles MartínClosas2
1Université Rennes 1, Géosciences, CNRS UMR 6118, campus de Beaulieu bât. 15, 263 avenue
du général Leclerc, 35042 Rennes cedex, France
2Departament de dinàmica de la Terra i l’Oceà, Facultat de Geologia, Universitat de Barcelona
UB, Marti i Franques s/n, 08028 Barcelona, Catalonia, Spain
Trois assemblages de Charophytes du Jurassique Supérieur Crétacé Inférieur de la partie
septentrionale du Bassin d’Aquitaine (SO France) ont été étudiés. Cela a permis de comprendre
les caractéristiques paléoécologiques, paléobiogéographiques et biostratigraphiques de cette
région au cours de cette période. En effet, le Crétacé Inférieur n’y est que très peu représenté,
en comparaison aux autres bassins européens. La présence de Latochara latitruncata (PECK,
1937) MÄDLER, 1955 au sein des dépôts de Chassiron représente l’occurrence la plus
méridionale de ce genre au cours du Jurassique Supérieur. La présence de Nodosoclavator
bradleyi (HARRIS, 1939) GRAMBAST, 1969 est notée pour la première fois dans l’assemblage
de Chassiron et a permis l’observation des caractéristiques de la couche structurée de l’utricule.
La présence de Porocharacées, en association avec des Clavatoracées et des Characées à
ChervesdeCognac et à AngeacCharente est en accord avec l’hypothèse d’environnements
saumâtres. L’association de Charophytes avec des spécimens abrasés de taxons marins (i.e.
Bryozoaires) dans les couches An2SA et An1SA à AngeacCharente est similaire à certains
faciès de deltas estuariens observés dans les bassins ibériques (Espagne). La présence de
Clavator grovesii var. grovesii (HARRIS, 1939) MARTÍNCLOSAS, 1996, associée à C. grovesii
var. discordis (SHAIKIN, 1976) MARTÍNCLOSAS, 1996, et des intermédiaires entre ces deux
variétés dans les populations de ChervesdeCognac et AngeacCharente représente un intérêt
stratigraphique important. En effet, ces deux variétés sont comprises dans les biozones (à
Charophytes) Maillardii, Incrassatus et Nurrensis, qui représentent l’ensemble du Berriasien.
Dans le cas d’AngeacCharente, ce résultat diffère de l’étude précédente qui lui attribuait un âge
hauterivienbarrémien, et considérant le matériel charophytique comme remanié. Ce résultat est
également pertinent pour l’étude de l’histoire sédimentaire de la partie septentrionale du bassin
d’Aquitaine puisque aucun dépôt compris entre le Berriasien Tardif et l’Albien Tardif ne semble
avoir été découvert dans la région jusqu’à présent.
Grambast, L. 1969. La symétrie de l’utricule chez les Clavatoracées et sa signification phylogénétique. Comptes
Rendus de l’Académie des Sciences [Paris], 269, 878–881.
Harris, T. M. 1939. British Purbeck Charophyta. Londres: British Museum (N. H.), 119p.
Mädler, K. 1955. Zur Taxonomie der tertiären Charophyten. Geologisches Jahrbuch, 70, 265–328.
MartínClosas, C. 1996. A phylogenetic system of Clavatoraceae (Charophyta). Review of Palaeobotany and
Palynology, 94, 259–293.
Peck, R. E. 1937. Morrison Charophyta from Wyoming. Journal of Paleontology, vol. 11, part. 2, 83–90.
Shaïkin, I. M. 1976. New data on the biostratigraphy of the Jurassic and Cretaceous of the ForeDobrogean Trough.
Geol. Zh., 36, T2, 77–86.
16La flore de Bernissart revisitée
Candela Blanco1, Lea de Brito2, Cyrille Prestianni2
1Departamento de Biología – Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid
(candela.blanco@uam.es).
2DO Terre et Histoire de la Vie – Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
(debrito.lea@gmail.com, cyrille.prestianni@naturalsciences.be).
Le nom de Bernissart est célèbre mondialement pour la découverte entre 1878 et 1881 de
nombreux squelettes d’Iguanodon quasiment complets. Dans la foulée, c’est tout un
environnement fossile qui a été mis au jour (crocodiles, amphibiens, poissons, plantes,…).
Jusqu’à présent ce sont les restes des vertébrés terrestres qui ont reçu la plus grande attention.
Poissons et plantes ont quant à eux été relativement peu étudiés. Effectivement, les plantes
n’ont fait l’objet que de deux publications. La première, dès 1878, consiste en une simple liste
sans illustration (Dupont, 1878). La seconde, plus détaillée, est abondamment illustrée et
correspond à un inventaire « exhaustif » de l’assemblage floristique (Seward, 1900). Ici, nous
vous présenterons une révision complète de la flore de Bernissart tant d’un point de vue
taxonomique que quantitatif. La flore de Bernissart a été récoltée dans les faciès Wealdien du
bassin de Mons au sein de la Formation de SainteBarbe. Ces niveaux argileux ont été datés
palynologiquement de la fin du Barrémien (Yans et al., 2009). Les restes végétaux sont très
fragmentaires et quasi systématiquement carbonisés. Weichselia reticulata représente
approximativement 90% de l’assemblage. Le reste se partage entre 9% de filicophytes et moins
de 1 % de plantes autres (gymnospermes, …). Ce sont donc les fougères qui dominent très
largement l’assemblage. Une approche quantitative nous a permis de définir plus finement les
relations existant entre ces plantes. L’assemblage révisé est comparé aux résultats obtenus
dans les localités voisines de Baudour et Hautrage. Ces dernières apportent des résultats
complémentaires permettant une reconstitution plus fine de l’environnement. Une comparaison
à plus grande échelle sera aussi proposée avec les localités anglaises, espagnoles (Las Hoyas)
et allemandes.
Dupont, E. 1878. Sur la découverte d'ossements d'Iguanodons, de poissons et de végétaux dans la fosse de
SainteBarbe du charbonage de Bernissart. Bulletin de l'Académie Royale des sciences de Belgique, XLVI, 387.
Seward, A.C. 1900. La flore wealdienne de Bernissart. Extraits des mémoires du Musée Royale d'Histoire Naturelle
de Belgique, T1, 1–37.
Yans, J., Dejax, J., Schnyder, J. 2012. On the age of the Bernissart Iguanodons. In Godefroit, P. (ed.), Bernissart
Dinosaurs and Early Cretaceous Terrestrial Ecosystems. Indiana University Press, Indiana, 79–82.
17Handbook of Paleoichthyology, vol. IA, « Agnatha » I: H.P. Schultze ed., Dr Friedrich Pfeil
publ., München (FRG) — Stateoftheart
Alain Blieck1, Philippe Janvier2, David K. Elliott3, Susan Turner4, Vadim Glinskiy5, Gai Zhikun6
1CNRS UMR 8198 EvoEcoPaléo, c/o ULille, Fac. des Sciences et technologies, F59655
Villeneuve d’Ascq cedex, France (alain.blieck@univlille1.fr)
2MNHN : Dépt. Histoire de la Terre, Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les
Paléoenvironnements (CR2P) : UMR 7207 du CNRS, CP 38, 8 rue Buffon, F75231 PARIS
cedex 05, France (janvier@mnhn.fr)
3Northern Arizona University, Geology Program, SESES, FLAGSTAFF, Arizona 860114099,
U.S.A (david.elliott@nau.edu)
4Geoscience Consultant, 69 Kilkivan Avenue, KENMORE Qld. 4069, Australia ;
paleodeadfish@yahoo.com
5Laboratory of Paleontology, Institute of Earth Sciences, St Petersburg University, 7/9
Universitetskaya nab., 199034 ST PETERSBURG, Rossiyskaya Federatsiya
(vadim.glinskiy@gmail.com)
6Academia Sinica: I.V.P.P., Xizhimenwai Dajie 142, P.O. Box 643, BEIJING 100044, People
Republic of China (gaizhikun@ivpp.ac.cn)
This project was initiated a very long time ago and mostly delayed because of the first author
here. Part Thelodonti (« Agnatha » II) was published on 2007 by three of our colleagues, viz.,
Tiiu Märss (Tallinn, Estonia), Susan Turner (Brisbane, Australia) and Valentina Karatajute
Talimaa (Vilnius, Lithuania). Here we present the stateofart of part « Agnatha » I. The following
contents were collectively decided :
INTRODUCTION « NODE XXX »
The ‘conovert’ theory Introduction
The calcichordate theory Anaspida : General Morphology, Histology, Habitat
CHORDATA and adaptations, Stratigraphic and geographic
General Morphology distributions, Biodiversity, Phylogeny/relationships,
Habitat and adaptations Systematics
Phylogeny/relationships Thelodonti > MÄRSS, TURNER & KARATAJUTE
Systematics: Tunicata (Urochordata), Cephalochordata, The TALIMAA 2007 : Handbook vol. 1B
case of Ainiktozoon, The anatolepid problem, Fossils falsely Pteraspidomorphi
attributed to chordates, Pikaianot a chordate. , Tullimonstrum, General morphology, Histology, Biomechanics ,
Etc. Habitat and adaptations, Stratigraphic and
Biodiversity geographic distributions, Biodiversity, Phylogeny,
CRANIATA / VERTEBRATA Systematics
Cyclostomata: General Morphology, Habitat and adaptations, Osteostraci
Stratigraphic and geographic distributions, Biodiversity, General morphology, Histology, Habitat and
Phylogeny/relationships adaptations, Stratigraphic and geographic
Systematics: Basal craniates / vertebrates, Basal hagfishes, distributions, Biodiversity, Phylogeny, Systematics
Myxinoidea , Basal lampreys, Petromyzontida, Fossils falsely Galeaspida
attributed to craniates /vertebrates Ibidem
« NODE X » Pituriaspida
Haikouichthys, Metaspriggina, Myllokunmingia Ibidem
EUVERTEBRATA PERSPECTIVES
Euphanerops, Jamoytius REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY
18Diversification initiale des Hystricognathes du Nouveau Monde (Caviomorpha, Rodentia)
Candidate au prix d’Orbigny
Myriam Boivin1
1UMR 5554 Laboratoire de Paléontologie, Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier –
Université de Montpellier, CNRS, IRD, EPHE (myriam.boivin@umontpellier.fr)
Les rongeurs caviomorphes constituent l’un des groupes de mammifères placentaires les plus
diversifiés d’Amérique du Sud. L’Amazonie, situées dans les basses latitudes des Néotropiques,
est l’une des zones géographiques qui de nos jours concentrent le maximum de la richesse
spécifique des caviomorphes. Malgré leur grande diversité actuelle et un riche registre néogène,
les premières phases de l’histoire évolutive du groupe n’étaient, il y a peu, documentées que
par quelques localités, majoritairement situées aux moyennes et hautes latitudes du continent
sudaméricain. Des recherches paléontologiques récentes menées en Amazonie péruvienne ont
permis la découverte de 18 localités éocènes et oligocènes, livrant de nombreux restes
dentaires de caviomorphes inédits. L’étude de ces fossiles a conduit à la description et à la
comparaison de 52 taxons distincts, dont 11 nouveaux genres et 17 nouvelles espèces. Une
riche diversité alphataxonomique des caviomorphes en Amazonie péruvienne a pu ainsi être
mise en évidence à la fin de l’Éocène moyen, mais surtout à l’Oligocène inférieur et à
l’Oligocène supérieur. Une analyse cladistique incluant un grand nombre de taxons (107), dont
plusieurs nouvelles espèces amazoniennes, a été réalisée. Pour la première fois, les quatre
superfamilles y ont été représentées avec toutes les familles actuelles, ellesmêmes
documentées par plusieurs représentants fossiles et/ou actuels. Une matrice de 513 caractères
morphologiques, essentiellement dentaires (432) mais aussi crâniens/mandibulaires (81), a été
assemblée. Les résultats révèlent l’existence de trois phases successives de diversifications
majeures au cours du Paléogène et du Miocène inférieur. La radiation initiale du groupe aurait
lieu à la fin de l’Éocène moyen, suivie à la transition Éocène–Oligocène par l’émergence des
quatre superfamilles actuelles.Enfin, ces superfamilles se diversifieraient principalement
autour de la limite Oligocène–Miocène. Ces phases semblent coïncider avec des évènements
climatiques globaux (optimum climatique de la fin de l’Éocène moyen ; refroidissement de la
transition Éocène–Oligocène ; refroidissement de la transition Oligocène–Miocène) et des
périodes intenses de surrection andine. Les régions de basses latitudes du continent sud
américain paraissent être le lieu de la première phase de diversification des caviomorphes.
L’origine géographique des superfamilles reste quelque peu ambiguë, excepté pour les
chinchilloïdes qui émergeraient dans les régions de basses latitudes.
19Deux nouvelles espèces de périssodactyles (Mammalia) de l’Eocène inférieur du
Quesnoy (Oise, France) et leurs relations phylogénétiques
Candidate au prix Depéret
Constance Bronnert1, Emmanuel Gheerbrant1, Marc Godinot2, Grégoire Métais1
1Sorbonne Université, CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7207 Centre de
Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P), 4 place Jussieu, Tour
56, 5ème étage, F75005, Paris, France, (constance.bronnert@mnhn.fr,
emmanuel.gheerbrant@mnhn.fr, gregoire.metais@mnhn.fr)
2Ecole Pratique des Hautes Etudes, PSL, UMR 7207 CR2P, Paris, France,
(marc.godinot@mnhn.fr)
Deux nouvelles espèces de périssodactyles ont été découvertes dans les Argiles à lignites du
Soissonnais, sur le site du Quesnoy (Oise, France). Les périssodactyles, qui incluent
aujourd’hui les chevaux, les rhinocéros et les tapirs, apparaissent lors de la transition
PaléocèneEocène, probablement en Asie, puis se dispersent rapidement dans tout
l’hémisphère Nord. La découverte au Quesnoy de deux nouvelles espèces nous renseigne sur
les chemins de dispersion de ce groupe. Le Quesnoy, qui se situe dans le niveau repère MP7,
le plus ancien de l’Eocène, est ainsi le plus ancien gisement européen à avoir livré autant de
fossiles bien préservés de périssodactyles. Le premier taxon, Pliolophus quesnoyensis, est un
hippomorphe connu par du matériel dentaire et postcrânien. Il est proche des espèces
anglaises de l’Eocène inférieur, et partage des caractéristiques avec les équidés nord
américains. Le second taxon, Chowliia sp. nov., connu par du matériel dentaire, est le plus
ancien tapiromorphe d’Europe. Il est apparenté à des espèces asiatiques et indique une
dispersion très tôt à l’Eocène des tapiromorphes de l’Asie vers l’Europe, et une disparition très
rapide des isectolophidés en Europe. Une analyse phylogénétique préliminaire basée sur des
caractères dentaires et un large panel de périssodactyles a été menée. Elle montre pour la
première fois la monophylie des Isectolophidae, dont on supposait une relation sur la base de
caractères anatomiques mais qui n’avait jamais été retrouvée dans les analyses
phylogénétiques.
20Perspectives phyloévodévo de la diversification des vertébrés du Paléozoïque : Cas
d’un acanthodien du Dévonien supérieur de Miguasha (Canada)
Candidate au prix d’Orbigny
Marion Chevrinais1,2
1Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, UMR 6112, Université de Nantes, France
(marion.chevrinais@univnantes.fr)
2Laboratoire de Paléontologie et Biologie Evolutive, Université du Québec à Rimouski, Canada
Une partie importante de l'histoire évolutive des vertébrés est inscrite dans le registre fossile. La
compréhension de cette histoire passe par l'étude de l'évolution des traits anatomiques et des
relations de parenté (i.e. phylogénie) entre les différents taxons de vertébrés. L'approche Evo
Dévo est utilisée afin de comprendre l'histoire évolutive des vertébrés et les interrelations au
sein des vertébrés chez un taxon du Paléozoïque (Lagerstätte du Dévonien supérieur de
Miguasha (Québec, Canada) (380 millions d'années): l'acanthodien Triazeugacanthus affinis. La
préservation exceptionnelle des fossiles du Lagerstätte de Miguasha en fait de bons candidats
pour améliorer la résolution de la phylogénie des vertébrés et comprendre les grandes
modifications évolutives ayant eues lieu à la période de transition entre les agnathes et les
gnathostomes. Des techniques d'histologie, de microscopie électronique, de spectrométrie à
rayons X ainsi que des dessins de précision et des analyses phylogénétiques sont utilisés afin
d'exploiter au maximum le potentiel de ces fossiles. La croissance de Triazeugacanthus, décrite
à partir d'une série de taille de 178 individus, est continue et composée de trois stades
ontogénétiques (larvaire, juvénile et adulte). Ces stades sont définis à partir 1) de l'étendue de
l'écaillure (i.e. les écailles sont absentes chez les larves, elles sont en formation chez les
juvéniles et l'écaillure est totale chez les adultes), et 2) de périodes de transitions déterminées
par les alternances de paliers et de seuils de la trajectoire développementale. La progression
de la minéralisation du squelette interne renseigne sur l'ossification d'éléments squelettiques
cartilagineux (neurocrâne et éléments vertébraux) au cours de la croissance. En plus de
l'ontogénie des spécimens complets, le développement d'éléments isolés a été étudié. Les taux
de croissance des épines des nageoires différent entre les larves, juvéniles et adultes, ce qui
indique que la croissance chez Triazeugacanthus est allométrique. La relation entre 1) la
croissance des écailles et le patron de développement de l'écaillure, et 2) la croissance des
spécimens complets indique que les écailles sont une bonne approximation de la croissance
des individus et de l'espèce. Ce résultat est primordial étant donné que les séries de croissance
sont rares dans le registre fossile (dû à la faible minéralisation du squelette des stades
précoces) alors que les écailles sont abondantes. En effet, l'ajout de caractères
développementaux aux caractères morphologiques déjà existants dans la littérature
(rassemblés à partir de spécimens adultes le plus souvent), représente une solution pour une
meilleure résolution de la phylogénie des vertébrés du
Paléozoïque.
21Vous pouvez aussi lire