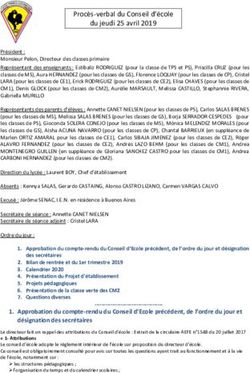RASSEGNA BIBLIOGRAFICA - Medioevo a cura di G. Matteo Roccati - EDITIONS SLATKINE
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
Medioevo
a cura di G. Matteo Roccati
Savoirs et fiction au Moyen Âge et à la Renaissance, chevalier, Joëlle Ducos parcourt de nombreux textes
sous la direction de Dominique Boutet et Joëlle littéraires et scientifiques afin de dévoiler les sens
Ducos, Paris, PUPS, 2015, 411 pp. concrets et symboliques de ces deux matériaux. Ambi-
gus tant par leurs usages que par leur sens (le second
Le but de ce recueil, dont nous rendons compte terme pouvant indiquer tant l’aimant que le diamant),
aussi dans la section «Quattrocento», est d’essayer de ils dévoilent indirectement, dans la citation du Lance-
répondre à la question, toujours d’actualité, du rapport lot mais non seulement, la compénétration du monde
entre littérature et promotion du savoir sur une longue de la fiction et de celui des savoirs (“Cuer de cire”, “cuer
durée, allant du Moyen Âge – qui voit la naissance tant d’aïmant”: la matière comme métaphore, pp. 201-219).
de la littérature que des «encyclopédies» en langue La contribution de Francine Mora (Femmes sa-
vernaculaire – au xvie siècle, où semble se situer une vantes et réflexion sur les savoirs au xiie siècle: la fiction
véritable rupture. romanesque au service de l’épistémologie, pp. 285-
De nombreuses contributions portent sur la pro- 297) s’attache à montrer comment le renouveau des
duction médiévale. sciences et de leur classement – notamment pour la
Jean-René Valette (Fiction arthurienne et ‘authen- médecine – qui se met en place au xiie siècle se reflète
ticité théologique’: la ‘Queste del Saint Graal’, pp. 123- aussi dans les romans: Médée chez Benoît de Sainte-
142) s’interroge sur le “savoir” impliqué dans la Queste Maure, Thessala dans Cligés et Mélior dans Partono-
(pour l’essentiel: patristique, liturgie, Bible), pour vé- peus, incarnent ce nouveau savoir et mettent en valeur
rifier ensuite le système qui s’y instaure par lequel le la médecine de leur temps.
Graal devient le signe romanesque de Dieu, et Galaad Sylvie Bazin-Tacchella (Malades et maladies dans
un alter Christus voire un miles Christi. La chevalerie les “Miracles de Notre Dame par personnages”, pp. 299-
s’affirme ainsi comme service rendu à Dieu. 320) étudie la représentation de la lèpre et du lépreux
Roman «historique», ou plutôt roman «géogra- dans quelques Miracles de Notre Dame (xive siècle). Les
phique», l’Alexandre de Thomas de Kent (vers 1170) occurrences des mots medicine / medicinable, garis /
fait une large part à l’encyclopédisme du xiie siècle, garison, malade (subst. et adj.) montrent que ce sont les
tout en marquant une étape importante dans la chris- manifestations les plus visibles de la maladie qui sont
tianisation de l’empereur des Macédoniens. Une pro- mises en scène, ainsi que les attitudes des proches et les
fonde connaissance des sources de Thomas permet à remèdes, essentiellement hors-norme et miraculeux.
Catherine Gaullier-Bougassas de reconnaître l’éten- Ce discours hérite évidemment en partie des sources
due de ses emprunts, mais aussi celle des fictions dues des Miracles, mais est aussi le reflet des représentations
à l’auteur médiéval (Savoir scientifique et «roman his- contemporaines de la lèpre, voire des traités médicaux
torique»: le “Roman d’Alexandre” de Thomas de Kent, les mieux connus – entre autres, celui de Guy de Chau-
pp. 143-159). liac.
Après avoir passé en revue la bibliographie critique, Associé souvent à la logorrhée et à l’incohérence, le
Didier Kahn nie la présence de l’alchimie dans la litté- discours de Nature, qui occupe quelque 2700 vers dans
rature médiévale, et en particulier dans les œuvres qui le Roman de la Rose, est analysé par Armand Strubel
lui ont été associées (le Conte du Graal de Chrétien, sa en relation avec le savoir de Jean de Meung, mais sur-
Seconde Continuation par Wauchier de Desnain, le Par- tout avec la fiction qui l’entoure et avec l’interpréta-
zival de Wolfram von Eschenbach, le Tristan de Gott- tion que donne Genius de cet enseignement cosmique
fried von Strasbourg; et, un peu plus tard Perceforest, hiérarchisé allant de Dieu à l’homme (Le discours de
le Cueur d’amour espris de René d’Anjou, le roman de Nature dans le “Roman de la Rose”: une mise en scène
Fauvel). Par ailleurs, D.K. souligne bien que des inter- des savoirs?, pp. 321-334).
prétations alchimiques d’une partie de cette littérature Seconde partie du Livres du roy Modus et de la royne
furent avancées dès le xvie siècle (Présence et absence Ratio, le Songe de Pestilence (1373-1377) est un ouvrage
de l’alchimie dans la littérature romanesque médiévale, allégorique qui se veut une condamnation des vices de
pp. 161-186, avec des extraits en annexe). son temps: s’avérant selon Jean-Patrice Boudet «à la
À partir d’une double métaphore qui, dans le Lance- pointe de la réflexion doctrinale et juridique» sur la
lot en prose, oppose cuer de cire et cuer dur d’aïmant du magie et la divination (p. 343), il fait notamment l’apo-102 Rassegna bibliografica
logie de l’astronomie-astrologie naturelle (Des savoirs Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601). Textes et
en question sous le règne de Charles V: sorcellerie et documents, sous la direction d’Alexis Charansonnet,
astrologie dans le “Songe de Pestilence”, pp. 335-346). Jean-Louis Gaulin, Pascale Mounier et Susanne Rau,
Jean-Marie Fritz recherche dans le corpus des «en- avec la collaboration de Frédéric Chartrain, Paris,
cyclopédies» du xiiie siècle – Image du monde de Gos- Classiques Garnier, 2015, «Bibliothèque d’histoire
suin de Metz, Trésor de Brunet Latin, Placides et Timéo médiévale» 14, 786 pp.
et Sidrac – le motif fictionnel de l’origine et de la trans-
mission du savoir: il peut ainsi montrer comment les Le volume rassemble quelque cent cinquante
«encyclopédistes» s’efforcent de dépasser les ruptures documents, textes et images, tirés de sources variées,
bibliques (péché originel, déluge, Babel) par l’idée connues ou inédites, présentés de manière accessible
d’une translatio continue et sans solution de continuité «à un public large, non exclusivement universitaire»
(Mise en fiction de la transmission du savoir dans les (p. 22). Répartis en six grandes sections, depuis la
encyclopédies françaises du xiiie siècle, pp. 347-361). partition de l’empire de Charlemagne jusqu’au règne
Laurent-Henri Vignaud (Un héritage bien encom- d’Henri IV, ils «proposent une relecture des étapes,
brant: la relecture des “Livres de merveilles” médiévaux des modalités et des conséquences du changement
par les savants de la Renaissance, pp. 73-95) suit la politique qui a fait de Lyon, dans les deux premières
réception du ‘merveilleux’ médiéval au xvie siècle, en décennies du xive siècle, une ville française certes,
rappelant les éditions de quelques œuvres représenta- mais pour longtemps encore – dans le langage des offi-
tives: le Livre des Merveilles, publié jusqu’en 1534, ou ciers du roi – “assize sur les extremitez et lisieres” du
les Etymologies d’Isidore, dont les éditions s’espacent Royaume» (p. 10).
au fil de ce siècle. En même temps, l’intérêt s’affirme Une introduction à chaque section situe les docu-
pour les merveilles locales, du Dauphiné en l’occur- ments au sein de l’évolution historique et dans la
rence, elles aussi d’origine médiévale (dérivées de Ger- perspective des rapports de la ville avec l’Empire et
vais de Tilbury), mais expurgées et revisitées. le Royaume. Traduits ou en langue modernisée, ils
sont précédés d’une présentation qui donne «les élé-
[maria colombo timelli] ments essentiels sur leur nature, leur producteur et le
contexte dans lequel ils ont vu le jour» (p. 20) et ils
sont suivis d’une bibliographie sommaire. Bibliogra-
Thierry Dutour, Sous l’empire du bien. «Bonnes phie générale pp. 643-681, index personarum pp. 683-
gens» et pacte social (xiiie-xve siècle), Paris, Classiques 733, et locorum pp. 735-63.
Garnier, 2015, «Bibliothèque d’histoire médiévale» 13, [g. matteo roccati]
698 pp.
L’expression «bonnes gens» n’est plus comprise au Chansons de geste et savoirs savants. Convergences et
e
xvii siècle, les dictionnaires l’attestent. Son emploi est interférences, sous la direction de Philippe Haugeard
e
«extrêmement courant depuis le début du xiii siècle et Bernard Ribémont, Paris, Classiques Garnier, 2015,
dans les textes à visée pratique rédigés en langue vul- «POLEN - Pouvoirs, lettres, normes» 2, 323 pp.
gaire. Ceux qui sont appelés “bonnes gens” sont les
membres actifs par excellence de la communauté Les contributions réunies dans ce volume, issu du
politique» (p. 23). À travers l’étude du discours «de congrès de la branche française de la Société Rences-
l’évidence ordinaire, de la banalité partagée, du lieu vals de 2013, sont organisées en trois volets qui se
commun» (p. 27), étudié dans «la pratique commune superposent nécessairement en partie: «empreintes sa-
du langage, saisie dans les occasions où se manifeste vantes», centré sur les références au savoir parsemées
l’utilité d’écrire» (p. 75), l’ambition de l’A. est de saisir dans les œuvres épiques, «figures de savants», clercs,
les conceptions courantes du monde social. lettrés et médecins, et un dernier qui, sous le titre
Par une démarche explicitée en faisant référence à «épopée et clergie» touche à des domaines spécifiques
l’approche phénoménologique de Husserl, soucieuse du savoir. L’intérêt de l’ensemble est de mettre l’accent
de rester au niveau du fait de langue sans vouloir at- sur des «convergences et interférences», selon les mots
teindre la subjectivité des personnes, l’ouvrage définit du sous-titre, qui n’ont pas souvent attiré l’attention
les traits caractéristiques des conceptions politiques à de la critique.
l’œuvre dans le discours ordinaire des actes de la pra- Un premier panoramique est dû à Nadine Henrard,
tique: une société fondée sur la confiance, confiance qui recherche Les mentions d’auteurs antiques dans les
justifiée par un comportement social digne d’estime, chansons de geste françaises (pp. 19-45). Cités expres-
garant de l’honorabilité, qui légitime et entraine sément, mais dans des proportions diverses, Aristote,
la participation à la vie publique et que confirment Caton, César, Homère, Ovide, Platon, se retrouvent
l’étude des discours alternatifs, mettant en avant la dans de nombreux poèmes; dans l’ensemble, ces évo-
condition sociale, et celle de la transgression des cations portent sur quelques éléments biographiques
normes. plus ou moins légendaires plutôt que sur leur produc-
Les sources de l’enquête sont «les écrits apparte- tion écrite; rattachés au monde de l’antiquité païenne,
nant à la fois au domaine de la pratique et à celui de leurs noms mettent aussi en relief la culture des auteurs
l’édiction proprement dite de la norme, ordonnances, médiévaux.
statuts, textes règlementaires, œuvres du droit cou- L’épopée franco-italienne se démarque en partie de
tumier» (p. 28), de la période 1200-1500, émanant de la production en langue d’oïl: c’est ce qui ressort de
l’ensemble de l’espace francophone de langue d’oïl – es- deux autres articles. Jean-Claude Vallecalle souligne
pace dont l’homogénéité est soulignée –, dans certains cette originalité, les poèmes franco-italiens s’inspi-
cas confrontés à des textes littéraires. Sources et biblio- rant de la matière venue de France, tout en la conci-
graphies pp. 575-680, Index des notions et des représen- liant avec la culture humaniste du Trecento de l’Italie
tations pp. 681-685, des auteurs pp. 687-688, des lieux, du Nord: la complexité du monde et sa diversité en
pays et régions pp. 689-692. viennent à remplacer l’univers bipartite et manichéen
[g. matteo roccati] des textes français, et parallèlement les héros subissentMedioevo 103
une métamorphose éthique où s’affirme un idéal diffé- modifier. Leur science s’associe cependant aussi à un
rent, humain et universel. savoir d’origine diabolique qui témoigne de la tension
La contribution de Chloé Lelong s’attache quant à entre nature humaine et forces surnaturelles (Science
elle à trois œuvres peu connues (l’Ystoire de la Passion, et merveille. La “nigromance” dans “Lion de Bourges”,
la Passion de Venise et la Passion de Nicolas de Vérone, pp. 183-196).
ces deux dernières en laisses monorimes): nettement Hubert Heckmann se propose de montrer les inter-
inspirées des évangiles, elles adoptent la forme épique férences entre épopée et hagiographie en étudiant la
et accentuent la dimension humaine des personnages. Vita Gerardi Comitis, qui transpose en latin non seu-
En analysant en particulier les figures de Judas et de lement la vie de Girart de Vienne, mais certains pro-
Pierre, elle en souligne certains aspects récurrents d’un cédés rhétoriques et stylistiques propres des jongleurs
texte à l’autre, à savoir la transformation du premier en (Quand le clerc dispute au jongleur le corps narratif du
personnage-type, incarnant le traître, alors que Pierre, héros épique. La chanson de geste détournée et réécrite
moins figé et dépendant plutôt de l’évangile dont elle par l’hagiographie latine, pp. 199-210).
est tirée, inspire des interprétations moins statiques et Les chansons de geste laissent aussi percevoir l’exis-
centrées sur l’homme plutôt que sur sa figure morale tence de règles patrimoniales concernant le mariage.
(Judas et Pierre dans les “Passions” franco-italiennes. Jerôme Devard présente les deux pratiques fondamen-
Personnages épiques ou figures morales?, pp. 61-82). tales dans ce domaine: la dos (donation ante nuptias par
Vaste compilation de la matière de France, les Cro- les parents de l’épouse) et le douaire (offert par le mari
niques et Conquestes de Charlemaine constituent, aux à la future épouse); et montre comment la littérature
yeux de Valérie Guyen-Croquez, un texte «savant» de fiction reflète en partie seulement des réalités juri-
dans la mesure où David Aubert attribue à son texte diques et historiques en partie toujours contradictoires
une fonction pédagogique, affichée dès le prologue, aux xiie et xiiie siècles (Douaires, dots, gains de survie.
cite ses sources et assume à leur égard une attitude cri- La condition patrimoniale de l’épouse épique au regard
tique (“Les Croniques et conquestes de Charlemaine” de d’un régime matrimonial embryonnaire, pp. 210-227).
David Aubert. Une épopée savante?, pp. 83-95). Court texte latin du xie siècle, la Conventio Hugo-
Peu nombreuses, les allusions aux héros épiques let- nis a été considérée tour à tour comme un document
trés ou quasi-lettrés existent néanmoins: Catherine M. historique ou comme un texte littéraire inspiré des
Jones examine les renvois, parfois purement ornemen- chansons de geste. Philippe Haugeard s’attache à
taux, parfois intégrés à un épisode précis (par exemple, montrer la proximité de la Conventio avec une partie
la lecture d’un message), dans un corpus de chansons de Garin le Loherenc, notamment pour ce qui concerne
de geste parmi lesquelles se signalent Aiol, Hervis de la question du fief, au cœur des relations féodo-vas-
Mes, Garin le Loherin (Le héros lettré dans les chansons saliques tant entre seigneur et vassal qu’entre vassaux
de geste, pp. 99-112). (La “Conventio Hugonis”, document historique et mo-
Ce sont les représentations du clerc dans les «chan- dèle épique. Retour sur la question à partir de “Garin le
sons d’aventures», composées entre la fin du xiiie et le Loherenc”, pp. 229-250).
e
xv siècle, qui retiennent l’attention de Claude Rous- L’article d’Éléonore Andrieu rapproche corpus
sel. En même temps auteur de certaines d’entre elles et épique et textes de la pratique (actes de notaires et de
cible d’une critique parfois acérée – le clerc est tour à grands ecclésiastiques) au regard de la représentation
tour lâche, cupide, lubrique –, il peut aussi être associé de l’espace: les (listes de) toponymes tendent dans les
à la figure de l’enchanteur, tel Maugis, destiné même à deux cas à dessiner l’espace de la chrétienté et du pou-
devenir pape dans la version rimée de Renaut de Mon- voir, laïc et religieux (Un savoir comptable dans la chan-
tauban (Le clerc obscur. Rôle et représentation du clerc son de geste au xiie siècle?, pp. 251-283).
dans les chansons de geste tardives, pp. 113-129). On signalera aussi la présence d’une riche Biblio-
Hélène Gallé consacre une analyse détaillée aux graphie finale, divisée en sources primaires et études
médecins, leur fonction, leurs gestes et attitudes à historiques (pp. 285-303), à laquelle s’ajoutent de
l’égard des malades et surtout des blessés. Un statut nombreux Index: des auteurs (anciens et modernes,
social ambigu, ainsi qu’un savoir proche de l’art ma- pp. 305-307), des œuvres (pp. 309-310), des person-
gique semblent caractériser des figures somme toute nages (pp. 311-312), des thèmes (pp. 313-314).
utilitaires et de second plan, à quelques exceptions
près: seul Fourré, dans Les Narbonnais, devient un per- [maria colombo timelli]
sonnage à part entière (Médecins épiques, pp. 131-162).
Devenue objet de débats scientifiques et théolo-
giques à partir de la fin du xiie siècle, la magie occupe La fascination pour Alexandre le Grand dans les
une place considérable dans les textes épiques. C’est littératures européennes (xe-xvie siècle). Réinventions
dans ce cadre que Blandine Longhi analyse l’évolution d’un mythe, sous la direction de Catherine Gaullier-
de Maugis de Renaut de Montauban à Maugis d’Aigre- Bougassas, Turnhout, Brepols, 2014, «Alexander redi-
mont: si sa magie est peu développée dans Renaut, elle vivus» 5, 4 voll., 2572 pp.
oscille dans Maugis entre christianisation et science,
dans un équilibre qui demeure pourtant extrêmement Quinta uscita della prolifica collezione Alexander re-
fragile (Maugis et les spéculations intellectuelles sur la divivus, i quattro volumi che compongono quest’opera
magie aux xiie et xiiie siècles, pp. 163-181). costituiscono un’analisi organica e ben documentata di
Tout en s’inscrivant dans une perspective purement come in tutta Europa la trasmissione e la rielaborazio-
terrestre, Lion de Bourges fait place au surnaturel: mi- ne dei testi antichi siano alla base di un florilegio di
racles, révélations, mais aussi personnages pratiquant opere letterarie che reinventano la figura di Alessandro
l’art magique. Martine Gallois analyse en particulier Magno.
le chrétien Basin et le païen Gombaut, pour lesquels Lo studio prende in considerazione opere apparte-
l’auteur s’est inspiré du type du “larron-enchanteur”; nenti alle letterature dell’Europa occidentale (medio-
chevaliers et guerriers, «de clergie lettréz», ils disposent latina, francese, italiana, iberica e aljamiada, ebraica,
de savoirs et de pouvoirs magiques qui leur permettent inglese, tedesca, olandese e scandinava) e dell’Europa
d’intervenir dans le déroulement de l’intrigue et de le orientale (ceca, serba, russa, bizantina e armena), com-104 Rassegna bibliografica
poste fra il x e la prima metà del xvi secolo. Questo di Amaia Arizaleta, Hugo Ó. Bizzarri e Fernanda
esteso corpus testuale comprende opere edite o anco- Nussbaum; L’image royale changeante d’Alexandre
ra inedite, note o inesplorate, sia dedicate esclusiva- dans le contexte du Saint Empire di Marie-Sophie
mente alla vita leggendaria del condottiero macedone Masse e Christophe Thierry).
o dei suoi antenati, sia testi che integrano episodi IV sezione (vol. 3, pp. 1269-1707): «Alexandre
della vita di Alessandro all’interno di una trattazione scientifique et aventurier. Un imaginaire de la con-
storica o didattica più ampia, sia opere che accordano naissance savante et des lointains exotiques». Dieci
una particolare attenzione ad alcuni degli episodi più studi che mettono in evidenza i diversi tentativi di
salienti della vita di Alessandro. proiettare sulla figura di Alessandro Magno il deside-
L’introduzione (vol. 1, pp. 7-23) precisa la struttu- rio di sapere, di sperimentazione scientifica, e l’aper-
ra generale dei quattro volumi e l’intento dell’opera, tura verso gli spazi esotici (in particolare: Alexandre
prefigurando un’impostazione diversa rispetto alla explorateur des merveilles de l’Orient dans l’“Historia
messe di opere precedentemente dedicate alla figura de preliis” di Alexandru Cizek; Rêves de connaissan-
di Alessandro, in particolare alle opere fondatrici di ce et d’exotisme: l’Alexandre aventurier en français
George Cary (The Medieval Alexander, Cambridge, di Catherine Gaullier-Bougassas e Hélène Bellon-
1956) e di David J.A. Ross (Alexander Historiatus, a Méguelle; Voyages de l’Alexandre grec: le goût des
Guide to Medieval Illustrated Alexander Literature, merveilles et sa mise en question di Corinne Jouanno).
London, 1963) che non abbracciano l’integralità del V sezione (vol. 3, pp. 1709-1813): «Alexandre et la
panorama letterario europeo né la sua evoluzione. È formation d’un espace littéraire européen». Quest’ul-
messa in risalto in particolare la volontà di affrontare tima sezione si focalizza sui ritmi rispettivi delle di-
lo studio della reinvenzione della figura di Alessandro verse letterature europee, sulla fortuna di ciascuna di
nelle diverse aree linguistiche e letterarie alla luce del- esse al di fuori del proprio ambito linguistico, sugli
la tradizione di studi sulla costituzione di uno spazio ambienti di produzione e di ricezione delle opere, sui
letterario comune europeo, inaugurata dalla opera rapporti tra eventi storici e finzione letteraria e infine
pionieristica di Ernst Robert Curtius (vol. 1, p. 10). sulle ragioni del successo della figura di Alessandro
Queste prime pagine sono l’occasione per ripercor- Magno nello spazio letterario europeo, con le sue
rere brevemente l’origine dei primi scritti storici su contraddizioni ed ambiguità.
Alessandro e del Roman d’Alexandre dello Pseudo- Una breve conclusione (vol. 3, pp. 1815-1823)
Callistene, fino al x sec., momento identificato come precede un’estesa bibliografia (vol. 3, pp. 1827-1978)
l’inizio della reinvenzione del mito di Alessandro nel- che contiene i riferimenti ai manoscritti, alle edizioni
le letterature europee. antiche e moderne ed agli studi critici utilizzati nel
Lo studio è articolato in cinque grandi sezioni ri- corso dell’analisi. Il terzo volume è infine completato
partite nei primi tre volumi, ognuna delle quali è pre- dall’indice delle opere e degli autori (pp. 1979-2020)
ceduta da una introduzione ed internamente suddivi- e dall’indice generale dei tre volumi (pp. 2021-2034).
sa secondo la lingua di composizione dei testi. Il volume 4 costituisce uno strumento di lavoro
I sezione (vol. 1, pp. 25-105): «Panorama des lit- a parte, contenente il repertorio dei principali testi
tératures européennes sur Alexandre (xe-xvie siècle)». del corpus europeo, ripartiti secondo la loro lingua
Breve rassegna che raccoglie le informazioni princi- di redazione. Le schede del corpus sono presentate
pali e le grandi tendenze dell’insieme dei testi che secondo lo schema: 1. edizione o manoscritto di ri-
trattano della figura di Alessandro Magno fra il x e ferimento; 2. autore; 3. data di redazione; 4. area di
il xvi secolo; le schede che la compongono introdu- redazione ed eventuale committente/dedicatario; 5.
cono le opere che saranno discusse in maniera più forma letteraria e lista degli episodi narrati; 6. fon-
approfondita nelle sezioni successive e in particolare ti; 7. elenco dei testimoni manoscritti o a stampa; 8.
nel volume 4. eventuali traduzioni, adattazioni o continuazioni; 9.
II sezione (vol. 1, pp. 107-678): «La traduction et bibliografia specifica.
l’adaptation aux sources de la création sur Alexan- Frutto della collaborazione interdisciplinare di
dre dans les littératures européennes». Un insieme diciassette ricercatori coordinati da Catherine Gaul-
di quindici studi che ripercorrono le modalità di lier-Bougassas, questi quattro volumi costituiscono
traduzione e adattamento dei testi antichi all’origine una summa preziosa ed aggiornata della fortuna della
del corpus europeo di Alessandro con un’attenzione figura di Alessandro Magno attraverso sei secoli di
prevalentemente stilistica e linguistica (in particolare: letterature europee.
L’“Alexandreis” de Gautier de Châtillon di Jean-Yves [graziella pastore]
Tilliette; L’Alexandre en français et ses univers lit-
téraires multiples di Catherine Gaullier-Bougassas,
Hélène Bellon-Méguelle et Janet Van der Meulen; Maud Pérez-Simon, Mise en roman et mise en image.
Lettres anglaises dans une culture plurilingue di Mar- Les manuscrits du “Roman d’Alexandre en prose”, Paris,
garet Bridges; Langues et genres littéraires de l’Ale- Champion, 2015, «Nouvelle bibliothèque du Moyen
xandre italien di Michele Campopiano; Aspects lin- Age» 108, 702 pp.
guistiques et littéraires de l’Alexandre russe di Elena
Koroleva). L’ouvrage, issu d’une thèse soutenue en 2008, est
III sezione (vol. 2, pp. 679-1268): «Le pouvoir organisé en trois parties. La première passe en revue
royal d’Alexandre: littérature et politique. Les au- les sources latines de la prose française et étudie at-
teurs, leurs mécènes et leurs publics». Dodici studi tentivement les prologues et les enluminures qui les
dedicati a mettere in luce l’assimilazione più o meno accompagnent. Dans la deuxième sont comparées «les
intensa di Alessandro ai valori politici, etici e religiosi stratégies de traduction avec les choix d’illustration»
nelle diverse letterature europee (in particolare: Les (p. 192), la troisième examine «les grandes théma-
exemplarités politiques de l’Alexandre français et leurs tiques que le traducteur a retravaillées dans le Roman
mises à l’épreuve di Catherine Gaullier-Bougassas d’Alexandre en prose: la modernisation du contexte,
e Hélène Bellon-Méguelle; Alexandre le Grand et l’intérêt porté aux scènes de bataille et la christianisa-
les idéaux politiques de la cour de Castille et Léon tion de l’ouvrage et du héros» (p. 362) afin de préciserMedioevo 105
de quelle manière les images suivent «les infléchisse- ni, tropi, versus) (2). I successivi quattro capitoli sono
ments que la traduction a fait subir au texte» (p. 489). dedicati a indagini su testi selezionati di quattro tro-
On trouvera dans plusieurs annexes (pp. 571-615) le vatori: Guglielmo IX d’Aquitania (3), Marcabru (4),
détail des illustrations et de leurs points d’insertion, Peire d’Alvernhe (5) e Gaucelm Faidit (6). I trovatori
ainsi que les notices des manuscrits. Bibliographie in questione vengono indagati per aspetti diversi che
pp. 617-685, Index des noms propres pp. 687-695, des emergono dai loro testi, come il culto dei santi del Poi-
manuscrits pp. 697-698. tou e del Limosino per Guglielmo IX, le citazioni dalla
[g. matteo roccati] Bibbia e da opere religiose contemporanee in Marca-
bru, le fonti effettivamente liturgiche di due canzoni
religiose di Peire d’Alvernhe, il diffuso atteggiamento
Lais, épîtres et épigraphes en vers dans le cycle de supplice dell’amante a partire da gestualità a un tem-
“Guiron le Courtois”, édition critique par Claudio po cristiane e feudali in particolare in Gaucelm Faidit.
Lagomarsini, Paris, Classiques Garnier, 2015, «Textes I capitoli settimo e ottavo riguardano la presenza dei
littéraires du Moyen Âge» 36, 214 pp. sacramenti, e specialmente della confessione, nei com-
ponimenti profani (7) e i rapporti fra la similitudine
Après une brève présentation de la problématique del fuoco amoroso presente in molte canzoni e la sim-
des insertions en vers à l’intérieur de la prose, l’intro- bologia dello Spirito Santo (8). Chiudono il volume un
duction (pp. 13-68) se concentre sur les textes versifiés (troppo) breve capitolo di conclusioni (9) e una ricca
dans le cycle de Guiron le Courtois, c’est-à-dire l’en- bibliografia (10).
semble des romans en prose appartenant à la matière [walter meliga]
guironienne, jusqu’au xve siècle. Font l’objet d’un
examen: la structure du cycle en prose et la distribu-
tion des insertions en vers, leur typologie (lais, épîtres, Herman Braet, Nouvelle bibliographie du “Roman
épigraphes), les références infratextuelles à la compo- de la Rose”, Leuven - Paris - Bristol, CT, Peeters, 2017,
sition des lais et la mise en texte des vers dans la prose. «Synthema» 11, 210 pp.
Des observations sur la versification viennent ensuite,
ainsi que la liste des manuscrits et leur classement, et Véritable best-seller du xiiie siècle, le Roman de la
des annotations linguistiques. Rose voit son succès se prolonger encore auprès de la
L’édition fournit également la transcription des critique moderne: cela justifie pleinement la parution
lignes en prose qui encadrent les vers; chaque texte est de cette nouvelle bibliographie, qui prend le relais de
précédé d’une notice qui indique les manuscrits, les celle établie en 1993 par Heather Arden (New York et
éditions, le schéma métrique, le contexte narratif, les Londres, Garland).
caractéristiques de la mise en page. L’apparat critique Une Introduction, aussi synthétique que claire, fait le
est distribué entre le bas de page et un appendice; point sur les domaines dans lesquels les recherches les
des notes critiques suivent (pp. 167-191). Le glossaire plus récentes se sont surtout développées, sans néan-
(pp. 193-199), la bibliographie (pp. 201-206), l’index moins négliger de mentionner les études fondatrices
des personnages et des lieux cités dans les textes en (pp. xi-xxiii). La présentation, raisonnée et chronolo-
vers (pp. 207-208), l’index des incipit des textes en gique, comprend quatre grandes sections, à l’intérieur
vers (p. 209) terminent le volume. desquelles les renvois de l’une à l’autre sont nombreux,
[g. matteo roccati] pour les travaux se situant à cheval sur les grands axes:
Histoire littéraire (éditions et traductions, manuscrits,
langue et style), Écriture (allégorie, composition et
Gianluca Valenti, La liturgia del «trobar». Assimi- exposition, intertextualité, élements intra-/extradiégé-
lazione e riuso di elementi del rito cristiano nelle can- tiques, images et motifs, lectures), Iconographie, Récep-
zoni occitane medievali, Berlin - Boston, De Gruyter, tion et fortune (Brunet Latin, Chaucer, Christine de Pi-
2014, «Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philo- zan et la Querelle, Eustache Deschamps, Dante et Du-
logie» 385, 295 pp. rante, Echecs d’Amours, Evrart de Conty, Gower, Gui
de Mori, Guillaume de Deguileville, Machaut, Marot,
Si tratta di uno studio interessante e documenta- Molinet, Ovide moralisé, Villon, Autres récepteurs).
to sui rapporti fra componenti e forme della liturgia Au total, plus de 1250 items – dont plus de 120 uni-
cristiana e la produzione poetica dei trovatori proven- quement pour la section Iconographie, ce qui prouve
zali, che si colloca nel filone di studi, da tempo per- la vitalité de ce secteur – numérotés et accompagnés,
seguito ma sempre ricco di suggestioni, dei rapporti ce qui est précieux, de quelques mots voire d’un bref
fra spiritualità religiosa e poesia profana in lingua vol- résumé du contenu; le cas échéant, les comptes ren-
gare. Si possono esprimere alcune riserve di metodo, dus sont aussi indiqués. Les travaux recensés ont paru
che avrebbe potuto essere più rigoroso: non sempre pour une écrasante majorité à partir des années 1990,
gli elementi raccolti possono essere rimandati preci- bien que certains titres plus anciens soient aussi signa-
samente a testi del rito e delle celebrazioni (ma sono lés pour remédier à un oubli dans la bibliographie de
invece la Bibbia e opere della letteratura teologica e H. Arden.
morale a essere chiamate in causa); inoltre, talora si Deux Index aideront des recherches croisées: le pre-
è di fronte a un accumulo non ben distinto di fonti e mier comprend les auteurs anciens et modernes ainsi
d’influenze (che si doveva cercare di distinguere mag- que les sujets (pp. 171-199); le second énumère les
giormente); in altri casi, infine, si ha l’impressione di manuscrits du Roman (pp. 201-207).
una certa sovrinterpretazione dei dati (mentre sareb- S’il est permis d’exprimer un regret, c’est que le titre
be stato auspicabile un atteggiamento di maggiore courant des pages impairs soit toujours le même (Nou-
prudenza). Ciononostante, il lavoro si rivela utile e di velle bibliographie du Roman de la Rose): la reprise du
proficua lettura. titre des différentes sections aurait en revanche permis
Il libro si articola in dieci capitoli, di cui i primi due au lecteur de se repérer plus aisément.
illustrano utilmente l’anno liturgico e i testi connessi
alla liturgia (1) e diversi tipi di testo poetico sacro (in- [maria colombo timelli]106 Rassegna bibliografica
«Reinardus» 28, 2016 Béatrice Delaurenti, La Contagion des émotions.
«Compassio», une énigme médiévale, Paris, Classiques
Nous rendons compte ici des articles concernant la Garnier, 2016, «Savoirs anciens et médiévaux» 4,
littérature française du Moyen Âge; les études consa- 338 pp.
crées au xve siècle sont signalées dans la section corres-
pondante de la Rassegna. Les Problemata physica, dont l’attribution à Aristote
Le livre IV de l’Ovide moralisé (vv. 2390-2785) n’est pas remise en cause au Moyen Age, traitent d’une
contient la mise en français et le commentaire moral série de questions liées à la physique. Dans la septième
de la fable des filles de Minée, métamorphosées en section sont évoqués des phénomènes où apparaissent
chauve-souris pour avoir refusé de participer à la fête des effets de contamination, corporelle ou psychique,
en l’honneur de Bacchus. Angela Calenda (La méta- dans les mouvements émotionnels et la maladie: le latin
morphose des Minéides en chauve-souris dans l’“Ovide utilise pour désigner cette réalité le terme, qui a plu-
Moralisé”, pp. 23-30) étudie la transposition française sieurs sens, de compassio.
des Métamorphoses pour «vérifier la stabilité de l’image L’ouvrage a comme objet «les discours médiévaux
de l’animal à travers les siècles» (p. 24) et elle parvient sur la compassion» (p. 15), les théories de la compas-
à mettre en évidence que la mise en français du récit sion étant saisies «comme le miroir des préoccupations
introduit quelques détails particulièrement significa- d’une société» (p. 13): à travers le terme de compassio
tifs pour la construction de la moralisation; en effet, se révèle «une conception du monde, une anthropo-
le clerc adapte le récit aux dogmes de la foi chrétienne logie à l’état naissant chez des auteurs qui tantôt l’ap-
et dans son commentaire tripartite, plusieurs artifices préhendent et l’utilisent, tantôt refusent de l’utiliser»
rhétoriques lui permettent de bâtir une interprétation (ibidem). La période 1260-1310 constitue un moment
complexe, à l’apparence antithétique, de l’animal sym- fondateur: l’expression dans son sens technique appa-
bolisant les trois sœurs. Celui-ci finit par acquérir une rait avec la traduction des Problemata par Barthélémy
dimension spirituelle hautement positive malgré les de Messine et le commentaire que Pietro d’Abano en
traits dépréciatifs normalement associés à son image. a donné, la notion est développée ensuite au xive siècle
Toujours dans l’Ovide Moralisé, le mythe d’Anti- par la tradition des commentaires aristotéliciens, mais
gone changée en cigogne (livre VI, vv. 616-634) est le terme n’est guère employé par les médecins et les
l’objet d’une transformation opposée, car l’oiseau est philosophes en dehors de celle-ci.
peint sous une lumière dévalorisante; Laura Endress L’étude est articulée en deux parties, la première,
(Antigone, «cigogne orde et vilz». L’histoire d’un por- après avoir défini la compassio et présenté les commen-
trait énigmatique, pp. 67-80) identifie les sources pos- tateurs des Problemata, passe en revue leurs explica-
sibles des qualifications que le commentateur a attri- tions à propos «des différentes espèces de compassion:
buées à cet animal, confondu souvent avec l’ibis: en la souffrance à distance, la contagion du bâillement
plus des Etymologiae d’Isidore de Séville, elle retrouve et de l’envie d’uriner, le frisson, la transmission des
des parallèles avec les bestiaires de Philippe de Thaon maladies» (p. 40). La deuxième porte sur les discours
et de Gervaise, la littérature encyclopédique, les gloses qui ont traité de la compassion n’appartenant pas à
aux textes bibliques et antiques, mais surtout avec les cette tradition, dans les autres sources: la théologie
commentaires sur les Métamorphoses rédigés entre (chez saint Augustin et saint Thomas) et la pastorale
le xiie et le xive siècle; l’A. prouve donc que dans la (dans les recueils de distinctions destinés aux prédica-
moralisation de l’histoire d’Antigone, l’Ovide moralisé teurs), la médecine salernitaine (seconde moitié du xiie
reflète l’imaginaire symbolique ambigu qui entoure la siècle), les sources médicales (Galien et Avicenne), la
cigogne au Moyen Âge. médecine scolastique (Gentile da Foligno, Tommaso
L’article de Margherita Lecco (Le miniature di “Re- del Garbo, Jacques de Forli, Ugo Benzi, Jérôme Tor-
nart le Contrefait” nel manoscritto Paris BnF fr. 1630, rella), la philosophie naturelle (Roger Bacon, Albert le
pp. 100-110) fournit une interprétation très convain- Grand, Nicole Oresme). Bibliographie et index (des
cante du cycle d’enluminures qui ornent le seul témoin noms de personnes, des œuvres anonymes, des auteurs
de la version A de Renart le Contrefait. En se fondant modernes et contemporains, des noms de lieux, des
sur une lecture en parallèle du texte et de l’image, l’A. manuscrits) aux pp. 299-322 et 323-333.
montre que le cycle iconographique est conçu en fonc-
tion d’une vision négative de l’histoire humaine teintée [g. matteo roccati]
de pessimisme, mais aussi de satire et de parodie. En
particulier, les deux dernières miniatures – dont l’une
consacrée à Renart prêchant devant les oiseaux – cor- Franck Collard, Les écrits sur les poisons,
roborent l’hypothèse que la critique de l’auteur se Turnhout, Brepols, 2016, «Typologie des sources du
focalise particulièrement sur la doctrine franciscaine. Moyen Âge occidental» 88, 196 pp.
Avec la dernière contribution consacrée au domaine
gallo-roman, on revient à l’image de la chauve-souris La parution d’un fascicule de la collection «Typolo-
(Jacqueline Leclercq-Marx, Un animal très ambigu: la gie des sources du Moyen Âge occidental» mérite assu-
chauve-souris dans la littérature savante et dans les menta- rément d’être signalée, dans la mesure où chacun de
lités médiévales, pp. 111-129); l’hybridité de cet animal ces volumes offre à la fois un panoramique bibliogra-
mi-oiseau, mi-mammifère est d’abord retracée dans ses phique et critique vaste sur un sujet donné en consti-
origines, puis explorée dans son acclimatation au sein tuant ainsi la base incontournable pour les recherches
de la culture médiévale, particulièrement dans les écrits ultérieures. Conformément aux règles de la série, le vo-
patristiques, la littérature didactique et les fables, ainsi lume de Franck Collard s’ouvre sur une Bibliographie
que dans les cycles iconographiques et les peintures. La raisonnée qui encadre le sujet, pour discuter ensuite les
diabolisation dont la chauve-souris est l’objet se fonde- questions rattachées au «genre» en question.
rait sur des caractéristiques physiques de l’animal et sur Un corpus de textes vénénologiques, assez dispa-
des comportements qui auraient profondément marqué rates quant à leur contenu, s’est constitué à partir des
l’imaginaire médiéval. années ’90 du xiiie siècle: entre cette date et 1500 – ter-
[paola cifarelli] minus ante quem de la «Typologie» – il compte uneMedioevo 107
trentaine d’œuvres à la fortune variée, produites sur- linguistiques et souvent l’histoire de la transmission
tout en Italie en milieu universitaire, toutes rédigées en des œuvres au sein des collections anciennes.
latin. L’inventaire donné en annexe énumère les titres Deuxième mérite, absolument novateur dans des
retenus; signalons que, face à de nombreuses traduc- recueils de ce genre: les vingt-sept contributions réunies
tions en italien et à de rares versions castillanes, on ne ici ont été soigneusement revues, non pas à l’intérieur
dénombre qu’une seule traduction en français: il s’agit du texte (cela aurait amené, sinon à les récrire partiel-
du Tractatus de venenis de Pietro d’Abano, composé lement, à compléter voire à refaire les notes), mais par
entre 1303 et 1316 (l’œuvre de loin la plus diffusée quelques lignes, ou quelques pages, de remarques qui
dans l’Europe entière, avec plus de 70 manuscrits, 35 constituent autant de post-scriptum critiques: c’est là que
éditions anciennes dont une vingtaine d’incunables), le lecteur trouvera des ajustements, des renvois biblio-
traduit par le carme Philippe Ogier pour le maréchal graphiques récents, parfois objets de discussion, ainsi
de Boucicaut en 1402 (Paris, BnF, fr. 14820), puis de que des remarques ponctuelles. Il est néanmoins remar-
nouveau par Lazare Boët et imprimé à Lyon en 1593. quable que la mise à jour de quelques points de détail
ne remet de toute façon jamais en cause la validité des
[maria colombo timelli] panoramiques proposés: preuve de la modernité et de
la valeur des articles (dont le plus ancien date de 1978,
le plus récent de 2007) et de la capacité de leur auteur
Matthieu Paris, Le Moine et le Hasard. Bodleian d’avoir une perception d’ensemble des phénomènes
Library, MS Ashmole 304. Texte présenté par Allegra appuyée sur des informations fondées et approfondies
Iafrate, Paris, Classiques Garnier, 2015, «Textes litté- que les progrès de la critique n’ont pas remise en cause.
raires du Moyen Âge» 39, «Divinatoria» 5, 277 pp. Le troisième mérite revient aux anciennes collègues,
amies et élèves de G. Hasenohr qui ont codirigé ce
Ce volume propose la reproduction en fac-similé recueil – Marie-Clotilde Hubert, Sylvie Lefèvre, An-
et en couleur du ms Oxford, Bod. Lib., Ashmole 304; ne-Françoise Leurquin, Christine Ruby, Marie-Laure
bien que les textes qu’il contient soient tous en latin, Savoye – en le complétant par une bibliographie ex-
l’importante introduction d’A.I. pourra intéresser haustive (pp. 17-24) et surtout par des Indices (auteurs
nos lecteurs, dans la mesure où elle fait utilement le et œuvres; personnes, lieux et milieux; manuscrits) qui
point sur la vie et l’œuvre de Matthieu Paris (ca 1200- révèlent certes des parcours, des sujets et des auteurs
1259), moine bénédictin dans l’abbaye Saint-Albans privilégiés, mais permettent surtout le repérage rapide
près de Londres, connu en tant que chroniqueur, des informations au lecteur intéressé à des recherches
diplomate, copiste et enlumineur, qui n’a pas négligé ponctuelles.
d’utiliser la langue vulgaire – l’anglo-normand en Soulignons enfin qu’un article apparaît ici en tra-
l’occurrence – pour ses œuvres hagiographiques. A.I. duction française (Les lectures religieuses des laïcs dans
présente d’abord l’ensemble de sa production (au la France du xve siècle: norme et pratique, lumières et
double sens du terme: composition de textes et fac- ombres, 1994, version originale en anglais) et surtout
ture des manuscrits, pp. 12-20), avant de se concentrer que la très précieuse contribution sur La littérature
longuement sur les textes divinatoires transmis par le religieuse à laquelle on a fait allusion (GRLMA VIII/1,
ms d’Oxford (pp. 20-88) et d’offrir une description 1988) est ici complétée par les «Fiches» qui auraient dû
codicologique détaillée (pp. 89-103). Bibliographie trouver place dans le volume VIII/2, jamais paru; ces
aux pp. 253-266. quelque 180 notices (pp. 79-143) ajoutent aux infor-
[maria colombo timelli] mations principales sur chaque œuvre, à la bibliogra-
phie de base et à la liste des manuscrits, le recensement
des éditions anciennes: bien que basé sur les catalogues
Geneviève Hasenohr, Textes de dévotion et lectures disponibles (Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Univer-
spirituelles en langue romane (France, xiie-xvie siècle), sal Short Title Catalogue, French Vernacular Books),
Turnhout, Brepols, 2015, «Codex & contexte» 21, 914 dont les données n’ont pas pu être toutes vérifiées,
pp. celui-ci représente une nouveauté par rapport aux cri-
tères du GRLMA et un véritable enrichissement, dans
Précieux recueil, quoique nécessairement partiel, la mesure où il intègre les perspectives les plus récentes
rendant compte de l’ensemble de la production d’une de la recherche, en dépassant les prétendues frontières
des plus grandes spécialistes de la littérature médié- entre Moyen Âge et Renaissance, transmission manus-
vale, ce gros volume a plusieurs mérites. crite et imprimée, pour essayer de mieux cerner la
Le premier est de réunir des contributions jusqu’ici réception même des textes.
relativement dispersées, souvent parues dans des vo- Ces compléments rendent ce volume bien plus riche
lumes difficilement accessibles en dehors des grandes qu’un simple recueil «d’auteur», et le transforment en
bibliothèques. Les intitulés des cinq parties donnent la une sorte de petite bibliothèque à laquelle beaucoup
mesure de la cohérence, de la continuité, mais aussi de de médiévistes, jeunes et moins jeunes, pourront puiser
la variété, du corpus: la célèbre synthèse sur La littéra- de précieuses ressources.
ture religieuse parue dans le Grundriss der romanischen [maria colombo timelli]
Literaturen des Mittelalters (1988) constitue à elle seule
la première section, les quatre autres portant sur les
lectures spirituelles (9 articles: la présence de la table Gabriele Giannini, Un guide français de Terre
des matières en-ligne sur le site de Brepols nous dis- sainte, entre Orient latin et Toscane occidentale, Paris,
pense d’en donner la liste), les traductions (4 articles), Classiques Garnier, 2016, «Recherches littéraires mé-
la prédication et la pastorale (6 articles), auxquelles diévales» 21, 352 pp.
s’ajoute une partie plus hétérogène centrée sur les
pratiques des copistes et sur le vocabulaire (8 articles). Le guide est assez court: il est transcrit dans les
Sans revenir ici sur le détail, on soulignera au moins ff. 173r-174r du ms. Ferrara, Biblioteca Comunale
l’approche globale de Geneviève Hasenohr, qui allie à Ariostea, II.280, manuscrit contenant aussi une copie
l’étude des textes celle de leur tradition, les questions du Tresor de Brunetto Latini. Ce volume relativement108 Rassegna bibliografica
épais donne l’édition du texte, surtout, il situe ce der- centre et Paris pour destination finale, terre d’élection
nier à l’intérieur d’un groupe de guides latins et verna- de la translatio imperii et studii (Géographies rêvées et
culaires apparentés. En plus de celui de Ferrare – qui vécues: les Europes de Philippe de Mézières, pp. 51-66).
appartient à «un vaste ensemble de manuscrits exécu- Kiril Petkov s’appuie sur trois catégories – temps,
tés entre Gênes et Pise à la fin du xiiie siècle» (p. 23) –, espace, appartenance – pour mieux comprendre et si-
les manuscrits examinés sont les suivants: Bruxelles, tuer la notion d’«Europe» telle que Philippe l’a conçue
Bibliothèque royale de Belgique, IV 1005; Città del Va- dans son projet de christianisation universelle (Past
ticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3136; Future? Identity, and the Project of Europe in Philippe
Paris, B.n.F., fr. 9082; Wien, Österreichische National- de Mézières, pp. 67-83).
bibliothek, Cod. 2590; Cambridge, University Library, Comme le souligne Christine Gadrat-Ouerfelli,
Gg.6.28 (pp. 11-159). Pour chacun sont détaillés l’his- voyageurs et explorateurs des xiiie et xive siècles ont
toire, la structure et le contenu, le contexte de produc- recours au procédé de la comparaison au moment de
tion, l’écriture et la décoration. Certains textes inédits décrire les distances, l’étendue des pays ou la popu-
ou significatifs, surtout au point de vue de la scripta, lation des villes d’Orient, mais aussi la richesse des
éventuellement ajoutés dans les feuillets inutilisés, sont souverains ou la diversité des langues. Ce relativisme,
édités et étudiés aussi. Quelques pages de synthèse et qui débouche souvent sur une vision pessimiste et sur
ensuite l’étude de la tradition (pp. 137-159) présentent le constat de l’exiguïté de l’Europe et de la chrétienté
ce groupe de guides qui dépendent de manière plus ou dans un monde autrement plus vaste, prépare l’appel à
moins lâche d’une source commune latine rédigée au la croisade qui sera aussi celui de Philippe de Mézières
Levant et traduite en français, datable entre 1219-1220 (‘Decima pars non sumus’. La place de l’Europe dans le
et 1260 environ (cf. p. 154). Est examinée ensuite la monde selon les ouvrages médiévaux, pp. 85-94).
scripta du Tresor et du Guide et le contexte socio-cultu- Un dernier article, de Benoît Grévin, pose d’abord
rel dans lequel le manuscrit de Ferrare a été produit la question des langues européennes au temps de Phi-
et utilisé (pp. 161-205). L’édition du Guide (pp. 209- lippe – à côté du latin, on reconnaît des continuums
212) est accompagnée de notes (pp. 213-249), ainsi entre les langues romanes, germaniques et slaves –,
que celle de trois autres guides français apparentés pour s’interroger ensuite sur le sentiment linguistique
(pp. 251-326). Bibliographie, glossaire et index des que Philippe a exprimé dans de rares passages de ses
noms propres aux pp. 327-337, 339-345 et 347-349. œuvres: on constate alors une fascination certaine pour
le latin, un latin non humaniste pourtant, qui n’exclut
[g. matteo roccati] pas, loin de là, un emploi privilégié malgré tout de la
langue vulgaire (L’Europe des langues au temps de Phi-
lippe de Mézières, pp. 95-112).
Philippe de Mézières et l’Europe. Nouvelle histoire, La deuxième partie, Aventures européennes?, porte
nouveaux espaces, nouveaux langages, Édité par Joël sur des personnages, des textes ou des évènements
Blanchard et Renate Blumenfeld-Kosinski, Genève, qui ne concernent pas tous directement Philippe de
Droz, 2017, «Cahiers d’Humanisme et Renaissance» Mézières: ils permettent cependant tous de mieux
140, 2017, 327 pp. encadrer sa production, dans un contexte historique
et culturel en perpétuel mouvement, voire en conflit.
Depuis quelques années, Philippe de Mézières fait Malgré des connaissances et des activités com-
l’objet d’une véritable (re)découverte: il suffira de rap- munes – diplomatie, voyages – Philippe de Mézières
peler le recueil Philippe de Mézières and His Age. Piety et l’empereur Charles IV ne se sont jamais rencontrés.
and Politics in the Fourteenth Century (Leiden / Bos- Pierre Monnet met alors l’accent sur les aspects qui les
ton, 2012), l’édition de l’Epistre lamentable sur le siege rapprochent: d’un côté, la conscience de certains pro-
de Nicopolis (par Ph. Contamine et J. Paviot, 2008: Stu- blèmes de leur temps (la papauté, la peste, la situation
di francesi 158, p. 371), ou celle du Songe du Viel Pele- politique de l’Europe), de l’autre la nécessité d’entre-
rin (par J. Blanchard, A. Calvet et D. Kah, 2015: Studi prendre des projets à l’échelle européenne, la croisade
francesi 178, pp. 100-101), précédée celle-ci d’une tra- notamment (L’Europe de Charles IV de Luxembourg:
duction en français moderne (de J. Blanchard, 2008). un espace, un système, une culture?, pp. 115-130).
Il n’est nullement exagéré de dire que l’Europe Présente dans plusieurs chapitres du Songe, l’Es-
n’existe pas au Moyen Âge, ce qui explique pourquoi pagne de Philippe de Mézières coïncide essentielle-
les titres des trois sections de ce volume prennent ment avec la Castille: si la reine Vérité traverse la pé-
la forme d’autant de questions. La première partie, ninsule ibérique, on peut s’interroger si son itinéraire
L’Europe, un concept multiforme?, s’ouvre par la est le reflet d’une expérience vécue par Philippe ou si
contribution de Klaus Oschema, De l’universalisme elle s’appuie sur des connaissances livresques. François
périmé au refuge de la chrétienté: l’«Europe» de Phi- Foronda souligne à ce propos l’importance de l’ami-
lippe de Mézières (pp. 27-50). Discret dans le Songe tié que lia l’auteur du Songe et Pedro López de Ayala
(1389: quatre seules occurrences), le nom «Europe» (L’Espagne dans le ‘Songe du vieil pelerin’: une expé-
n’y est pas spécialement mis en relief; une relation rience et une rencontre, pp. 131-148).
plus étroite entre «Europe» et christianisme s’établit Constatant les échos du Grand Schisme présentes
en revanche dans l’Epistre, adressée en 1397 à Phi- dans le Songe du vieil pelerin, Émilie Rosenblieh s’inter-
lippe le Hardi après la défaite de Nicopolis. En cela, roge sur le caractère «européen» des conciles réforma-
Philippe de Mézières devient en quelque sorte le pré- teurs de la première moitié du xve siècle: force lui est ce-
curseur du courant qui affirmera, après la chute de pendant de constater que ces assemblées s’organisaient
Constantinople en 1453, le rôle de l’Europe en tant plutôt en «nations», définies par l’origine géographique
que patrie de la chrétienté. et linguistique des participants; implicite, l’«européanité»
Anne-Hélène Miller souligne un autre aspect du en venait à coïncider avec l’universalisme chrétien ainsi
Songe: Philippe y exprime l’Europe en termes à la fois qu’avec les projets de croisade (Les conciles réformateurs
géographiques et spirituels; poète et voyageur, il mêle de la première moitié du xve siècle, pp. 173-189).
expériences vécues, cartes et mémoires de lectures, Catherine Gaullier-Bougassas étudie la transmis-
pour construire un itinéraire qui a Jérusalem pour sion d’une œuvre arabe, le Choix de maximes et ditsVous pouvez aussi lire