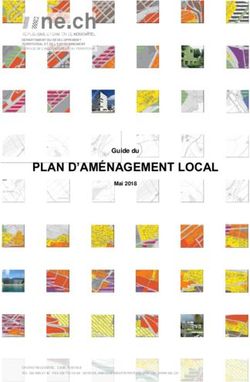Box office 2016 : Record battu pour les studios américains - Insight NPA
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Box office 2016 : Record battu pour les studios américains Rendus publics en marge du CES 2017, les données du Box-office 2016 confirment les bons résultats enregistrés par les salles en 2016 aux Etats-Unis et au Canada (et de même d’ailleurs qu’en France) : avec 11,37 Mds$ de recettes tirées des entrées, le cinéma nord- américain a battu en 2016 son record historique, en légère croissance (2,2%) par rapport à son niveau de 2015 et en progression plus marquée (9,8%) sur 2014. Avec 26,4% de part de marché pour l’ensemble de ses productions, Disney s’est montré l’an dernier particulièrement performant, laissant à plus de neuf points son second, Warner Bros (16,8%), et à plus de treize le troisième, la Fox (12,9%). Même domination dans le Top 10 des films ayant généré les plus grosses recettes : 6 sont signées Disney (Le Monde de Dory, Rogue One, Captain America : Civil War, Le Livre de la Jungle et Zootopia), contre deux à Warner (Batman v Superman : l’aube de la justice et Suicide Squad), un pour Universal (La Vie Secrète des Animaux), et un pour 21th Century Fox (Deadpool). Après l’annonce début décembre d’un output deal entre Universal et SFR, ce dernier succédant à Canal+ comme partenaire privilégié de la filiale du groupe NBC-U, ces résultats 2016 sont aussi l’occasion de dresser une photo du poids des studios liés aux éditeurs français de chaînes de cinéma premium : Canal+ (bénéficiant d’accords avec Disney, Warner Bros, 20th Century Fox et Paramount), OCS (Sony) et dès l’été prochain SFR. Sur la moyenne des 3 dernières années (2014/2016), afin de lisser les écarts liés aux calendriers de sortie des blockbusters, les 4 studios liés à Canal+ ont totalisé 56,7% des recettes du box-office américain, contre 9,3% pour Sony et 14,7% pour Universal. CES 2017 : l’Ultra HD Blu-Ray profite (encore ?) peu du boom de la 4K Près de 4 ans et demi après son lancement commercial, en octobre 2012, l’Ultra Haute Définition occupe une place croissante dans les gammes présentées au CES par les industriels de l’électronique grand public, comme dans les ventes enregistrées sur le
marché nord-américain : 6 millions de téléviseurs 4K écoulés en 2015, 10 millions en 2016, et 15 millions attendues pour 2017, selon les prévisions de la CTA (Consumer Technology Association), portant la base installée à 34 millions d’unités et la part des ventes à 40% (contre 27% l’an dernier). A ce stade, au moins, l’Ultra HD Blu-Ray ne profite guère de cette dynamique : après la finalisation du standard de disques 4K annoncée lors du CES 2016, Panasonic, Philips, Samsung et Microsoft (sur la Xbox One) ont démarré au printemps la commercialisation, à des prix oscillant entre $250 et $550. Prix des disques considéré par les consommateurs comme trop élevé ($25/30, contre $15/20 pour un Blu-Ray standard) ou catalogue jugé trop mince (110 titres à fin 2016, issus des productions Fox, Lionsgate, Paramount, Sony, Universal et Warner) ?, il ne s’était vendu que 80 000 lecteurs stand alone et 1 million de disques à fin novembre d’après le Blu-Ray Disc Association. L’élargissement de l’offre prévu en 2017 – 250 sorties attendues – permettra, pour partie de lever ces freins… et de vérifier si l’Ultra HD Blu-Ray ne souffre pas surtout de la concurrence des line-up de films et séries au format 4K / HDR proposés par les plateformes de SVoD Netflix, Amazon, Vudu ainsi que par Dish et DirecTV. Nouvel avatar de la lutte entre supports physique et mouvement de dématérialisation. Wearables, Réalité virtuelle, Smartcar, Intelligence Artificielle : les questions clé du CES 2017 A peine 96 heures à patienter et les médias, vœux et cotillons tout juste rangés, se mettront à l’heure du « plus grand salon mondial dédié à l’innovation » : le 4 janvier, le CES ouvrira à Las Vegas les portes de sa 50e édition. Son organisateur, le Consumer Technology Association célèbrera des chiffres de participation toujours plus impressionnants (3 870 exposants et 170 000 visiteurs venus de 150 pays en 2016) ; en France, les responsables de la French Tech ont d’ores et déjà annoncé que « la France y représentera la 3ème présence mondiale avec 275 entreprises et structures exposantes, après les Etats-Unis avec 1713 entreprises et la Chine 1307 entreprises (et qu’elle aura même) la deuxième délégation mondiale de l’Eureka Park », l’espace d’exposition plus particulièrement dévolu aux start- up. Tout n’est pourtant pas rose dans le ciel du monde numérique, et les nuages aperçus ces dernières semaines dans certains secteurs vedettes de ces dernières années, pousseront à
être particulièrement attentifs aux annonces des groupes présents à Las Vegas, et de leurs
dirigeants.
S’agissant des wearables, montres connectées surtout, 2016 s’est achevée en mode gris,
voire gris foncé : avec 2,7 millions d’unités écoulées seulement au niveau mondial, l’institut
e
IDC a fait état de ventes en chute de 51,6% au 3 trimestre 2016, par rapport à la même
période de 2015. Et la météo ne s’est pas améliorée en fin d’année, avec le jet de l’éponge
des numéros 4 et 5 mondiaux Motorola et Pebble. Le premier a indiqué avoir suspendu sine
die sa production et, plus brutal encore, le second qui avait fait figure de précurseur à la fin
de la précédente décennie, a annoncé la cessation totale de son activité et la reprise de ses
actifs par Fitbit. Dans de telles conditions, les performances de l’Apple Watch en fin
d’année seront observées avec une curiosité particulière : si elle a conservé son premier
rang mondial, cette dernière a vu ses ventes chuter de 3,9 à 1,1 millions d’unités, d’après
IDC, faisant par la même fondre sa part de marché de 30 points (de 70,2%à 41,3%). « Nos
données montrent que l’Apple Watch se porte bien et devrait être un des cadeaux les plus
populaires du moment, affirmait le 6 décembre le pdg d’Apple Tim Cook. Nous nous
dirigeons vers le meilleur trimestre jamais connu par l’Apple Watch » ; La prochaine
publication trimestrielle du groupe, le 24 janvier, permettra de trancher. Pas d’annonce à
attendre d’Apple, en revanche, au CES, puisque le groupe n’y participe pas. Google y sera
présent en revanche avec, peut-être, la possibilité d’y présenter les deux modèles de
montre connectée intégrant le nouvel OS Android Wear 2.0 annoncés pour 2017. La
communauté IoT cherchera à coup sûr à y débusquer les « killer app » qui pourraient y être
embarquées.
Même morosité autour de la réalité virtuelle, malgré la rafale de lancements de l’année
2016 (HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR, Google Daydream…). « Un premier Noël
incertain pour la réalité virtuelle », titrait le 8 décembre Le Figaro ; « Non, 2016 n’a pas
été l’année de la réalité virtuelle ! », renchérissait le site spécialisé Jeuxvideo.com.
Mauvaise compréhension des bénéfices utilisateurs, catalogue de jeux compatibles trop
limité, « effet mal de mer » lors d’une utilisation prolongée et surtout niveau des prix jugé
trop élevé (de 399 € pour Sony jusqu’à 950 € pour l’HTC Vive)… Autant d’arguments
avancés pour expliquer la révision drastique des prévisions de vente : de 2,6 millions à
750 000 en fin d’année pour la PlayStation VR, d’après l’institut Superdata et à peine un
million en cumulant HTC Vive, Oculus Rift et Google Daydream… Commercialisé à moins
de 100 €, le Samsung Gear VR semble le seul à avoir à peu près tiré son épingle du jeu avec
près de 2,5 millions de ventes prévues sur l’ensemble de l’année. L’intervention à Las
Vegas de son CEO of Consumer Business Group sera l’occasion pour Huawei d’en dire plus
sur l’avancée du casque Huawei VR, attendu depuis avril 2016. Les allées du CES
permettront aussi d’observer si certains acteurs ont trouvé les clés pour une exploitation
« industrielle » de la VR, au-delà du jeu vidéo ou des utilisations évènementielles (trailers
de nouveaux films ou séries, spots de publicité de marques de luxe…).
Etat des lieux plus balancé s’agissant de la voiture autonome, après l’interruption des tests
conduits par Uber en Californie. Après avoir perdu l’autorisation de faire circuler ses 16
prototypes dans les rues de San Francisco, le leader mondial des VTC a annoncé qu’il
poursuivrait son programme en Arizona, dont la réglementation est plus accommodante.
L’information intervient quelques mois après qu’un accident mortel est intervenu dansl’Ohio, impliquant une voiture Tesla circulant en mode Autopilot, et peu après l’annonce
d’un retard dans la livraison d’une version améliorée de ce dernier. A l’inverse, Volkswagen
devrait profiter du salon de l’automobile de Détroit pour présenter un modèle intégrant un
volant rétractable. En tout état de cause, le keynote speech que prononcera le jeudi 5
janvier Carlos Ghosn sera à suivre avec attention. En octobre dernier, il distinguait dans Le
Figaro « la voiture autonome de la voiture sans chauffeur. Concernant la première, vous
êtes à bord et vous décidez du moment où vous voulez conduire. (…) Ça, c’est pour 2020.
(…) Concernant la voiture sans chauffeur, elle n’arrivera probablement pas avant 2025 ».
Le patron de Renault et Nissan sera attendu sur la façon dont le secteur entend gérer les
challenges technologiques et réglementaires auxquels il est confronté pour tenir ce
calendrier.
A en croire l’institut IHS, le secteur de la smart home bénéficie d’un horizon sensiblement
plus dégagé : d’après ce dernier, le nombre des objets vendus a atteint 80 millions en 2016
au niveau mondial (+64%), et il devrait connaître un nouveau bond de 60% en 2017, à 130
millions… avec quand même quelques défis majeurs pour atteindre la pleine maturité : la
question des modèles économiques, notamment, de l’objet qu’on achète en paiement one
shot au service rendu quotidiennement, pour lequel la disponibilité du consommateurs à
être facturé reste à confirmer ; ou encore le sujet de l’interopérabilité entre les multiples
OS et standards qui coexistent sur le marché, et à la clé un double impact sur le coût de
production des objets et sur la simplicité à garantir au consommateur.
Les « contenus » s’annoncent plutôt en mineur, eux, pour ce CES 2017. Pas d’intervenant
venu de cette industrie dans la liste des keynote speakers, par exemple, alors que les
patrons de Netflix Reed Hastings et de NBC Universal Steven Burke, s’étaient succédé sur
scène en 2016. Il est vrai que la fin de l’année s’est plutôt jouée sur le terrain de
l’optimisation de la distribution (en France avec la restructuration des offres de Canal+ et
ses accords avec Free et Orange, par exemple ; à l’international avec le passage d’Amazon
Prime Video en division mondiale…), et sur la capacité, grâce à cette surface étendue, de
financer des programmes toujours plus ambitieux. Pas de rupture, donc, mais plutôt la
confirmation, qu’à la fin, content is king.
Au final, c’est autour d’un champ capable d’embrasser l’ensemble des dimensions
e
précédemment énoncées que pourrait se focaliser l’attention lors de cette 50 édition. Pas
forcément la plus spectaculaire, ni celle capable de fournir les meilleures images dans un
reportage de JT : d’IBM (Watson) à Amazon (Alexa) en passant par Microsoft (Cortana) ou
Google (Google Home), le CES sera l’occasion pour les géants mondiaux du numérique de
mettre en valeur leurs dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et de
reconnaissance vocale. Par les voies nouvelles d’accès aux services comme aux contenus,
ces dernières font le pari de mettre à la retraite les interfaces graphiques auxquelles nous
sommes habitués. Elles pourraient surtout dessiner de nouveaux écosystèmes et, partant,
s’affirmer comme de redoutables outils de suprématie dans l’univers numérique.
Cet enjeu dépasse de loin 2017.
D’ici là, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je serai au CES du 4 au 8 janvier,
et serai ravi, le cas échéant, d’y échanger conseils sur les stands à visiter ou ressenti plusglobal. Vous pouvez me contacter via Linkedin ou Twitter. C’est aussi sur ces comptes que je partagerai mes impressions de visite. USA : vers un raccourcissement du délai de sortie des films en VOD ? Certains des principaux studios hollywoodiens envisagent de rendre leurs œuvres disponibles en VOD deux semaines seulement après leur sortie en salles. Si l’idée n’est pas nouvelle outre-Atlantique, elle ne cesse de progresser en raison des mauvaises performances répétées des ventes de supports physiques et de positions plus souples chez les exploitants de salles. Chronologie des médias : multiplication des expérimentations L’essor de la vidéo en ligne, qu’elle soit gratuite ou payante, légale ou illégale, à l’acte ou par abonnement, bouleverse profondément la chronologie d’exploitation des œuvres cinématographiques. La tendance mondiale est au raccourcissement de la période d’exclusivité des différentes fenêtres et à l’expérimentation de nouvelles formules : inversion de l’ordre des fenêtres, simultanéité de diffusion (Day & Date), impasse sur la salle (e-Cinema)… Face aux reculs répétés des ventes de supports physiques (DVD et Blu- ray), l’année 2016 aura été marquée par un nombre croissant d’initiatives visant à faire bouger les lignes et à redynamiser un secteur du Home Entertainment (physique + dématérialisé) en stagnation. Face à la mutation du marché, l’industrie multiplie les expérimentations pour apporter au public de nouveaux moyens d’accès aux œuvres, en adéquation avec l’évolution de ses habitudes de consommation. La fenêtre spécifique réservée à l’achat dématérialisé (EST), ardemment soutenue par les studios américains, a ainsi connu un net raccourcissement en l’espace de quatre ans, passant de 3 mois et 28 jours après la salle début 2012 à 2 mois et 26 jours en moyenne fin 2016. D’autres initiatives, portant principalement sur une diffusion simultanée entre la salle et la vidéo à la demande, se sont quant à elles confrontées à la réticence des exploitants de cinémas. Le studio Paramount, qui avait fait le pari de raccourcir la période d’exclusivité de la salle à 17 jours[1] pour arriver plus rapidement sur les plates-formes légales de streaming vidéo en a ainsi fait les frais et s’est vu boycotté par les principaux réseaux du pays. Netflix, qui souhaitait diffuser ses productions « maison » en simultané sur grand écran et sur son service de streaming[2], a lui aussi essuyé le refus de l’écrasante majorité des salles américaines. Le service de SVOD a alors été contraint de se tourner vers des réseaux de moindre envergure, notamment Ipic, une chaîne de cinémas de luxe qui compte une quinzaine de salles outre-Atlantique. Quant au projet de VOD premium en Day & Date de Sean Parker, The Screening Room[3], dont la promesse est de
rendre accessible un film en VOD depuis son foyer le jour de sa sortie en salle, il semble s’enliser dans d’interminables négociations avec studios et exploitants salles malgré la mise en avant d’un système rémunérateur pour l’ensemble des parties. Surtout, au regard au potentiel économique du marché convoité, il semblerait que les majors hollywoodiennes ne soient pas décidées à partager le futur gâteau avec un tiers, qui souhaiterait disposer de droits exclusifs qui plus est. Une exigence particulièrement dure à satisfaire dans la mesure où les studios appartiennent le plus souvent à de grands groupes de médias qui détiennent leurs propres services de distribution de contenus (ex : Comcast, maison-mère des studios Universal, est également propriétaire de Fandango Now, anciennement M-GO et de Comcast Xfinity). Des studios se positionnent en faveur d’une fenêtre VOD deux semaines seulement après la sortie salles La possibilité de voir des films distribués en vidéo à la demande, tout en étant exploités sur grand écran, est revenue avec insistance dans l’actualité ces dernières semaines. Plusieurs studios hollywoodiens se sont en effet positionnés pour une diffusion en simultané sur les deux fenêtres. Warner Bros. et Universal Pictures auraient ainsi engagé des négociations avec les exploitants salles pour un raccourcissement de la période d’exclusivité sur grand écran. A la différence du projet de Sean Parker, il ne s’agirait pas de Day & Date mais d’une mise à disposition des œuvres en VOD deux semaines après leur sortie en salles. Une différence de taille, tout comme les conditions de « revenue share » entre studios et exploitants salles, plus à même de satisfaire les deux parties en supprimant l’intermédiaire que représenterait The Screening Room. Un partage plus favorable aux exploitants de nature à maintenir un climat de confiance avec ces derniers, dont le rôle demeure essentiel pour les studios, tant en termes de recettes que de valorisation des œuvres. Si peu d’informations ont fuité pour le moment, il est fait écho d’un tarif à la location oscillant entre 25 et 50 dollars par film. De nombreuses questions restent toutefois en suspens, tant sur le tarif définitif (seuil d’acceptabilité pour le client ? minimum requis pour rémunérer les exploitants et compenser l’éventuel report de fréquentation des salles vers la VOD ? prix plancher pour ne pas attirer une audience de masse et cannibaliser la salle ? …) que sur la méthodologie appliquée pour rémunérer les réseaux de cinémas (en fonction du nombre d’écrans ? du chiffre d’affaires ? de la fréquentation en salles sur les deux premières d’exploitation exclusive de l’œuvre ? sur la fréquentation enregistrée en simultané de l’exploitation en VOD ? …). Comme pour The Screening Room, le principal argument des studios réside dans la volonté d’élargir l’audience à un public qui ne fréquente pas ou plus les salles obscures : parents avec enfant(s) en bas âge, familles nombreuses découragées par le coût global de la sortie (entrée, parking, snack…), personnes âgées, zones rurales souffrant d’une quasi absence de salles, etc. Une cible qui n’a donc pas vocation à cannibaliser l’activité des exploitants de cinémas qui conserveraient leur cœur d’audience. Le projet est présenté en outre comme un rempart efficace contre le piratage qui, selon les studios, sévit quelques semaines après la sortie en salles des films. L’objectif est de limiter cette pratique en rendant les œuvres plus rapidement accessibles sur une plate-forme de streaming légale. Il n’en demeure pas moins difficile d’imaginer un système anti-piratage parfaitement sécurisé et infaillible sur la durée. La mise en ligne des œuvres deux semaines seulement après leur
sortie sur grand écran pourrait alors avoir l’effet inverse de celui escompté et favoriser la consommation illégale. Du côté des acteurs de l’industrie, trois majors ont d’ores et déjà pris position en faveur d’un avancement de la fenêtre VOD. Kevin Tsujihara, CEO de Time Warner, a confirmé que « Warner travaille de manière constructive avec les exploitants pour essayer de créer une nouvelle expérience VOD collée à la salle », ajoutant qu’il est devenu impératif de pouvoir « offrir aux consommateurs plus de choix plus tôt ». Universal Pictures a également reconnu l’existence de discussions avec les réseaux de salles pour une mise à disposition plus rapide des œuvres en VOD. James Murdoch, le patron de 21st Century Fox, s’est lui aussi prononcé en faveur d’une évolution du modèle actuel, insistant sur le fait que « les holdbacks imposés par les exploitants posaient problème pour une partie du public ». AMC, l’une des plus grandes chaînes du pays, a confié être entrée en négociations avec plusieurs studios au sujet de l’avancement de la fenêtre VOD. S’il sera difficile pour les majors hollywoodiennes de faire consensus auprès de l’ensemble des grands réseaux de cinémas américains, la création d’une fenêtre VOD premium devrait également questionner les exploitations situées en aval de la salle, que ce soit en termes de délai (glissement des fenêtres à prévoir ?) ou de valorisation. Le succès d’une œuvre au Box-Office définit en effet la valeur de ses droits d’exploitation pour les fenêtres successives (télévision payante, vidéo à la demande par abonnement, etc.). Toute action susceptible d’impacter la performance des films en salles pourrait alors avoir de lourdes conséquences pour l’ensemble de l’industrie. [1] Voir Flash #777 : « Paramount teste un nouveau modèle de distribution pour ses productions » [2] Voir Flash #811 : « Les films de Netflix sortiront également sur grand écran aux États- Unis » [3] Voir Flash #790 : « The Screening Room, un nouveau modèle de distribution qui divise Hollywood » Amazon Prime Vidéo : soft launch mondial ou excès de précipitation ? « We are excited to announce that starting today, fans around the world have access to Prime Video », said Tim Leslie, Vice President, International, Prime Video. Le communiqué diffusé ce mercredi 14 décembre par le site corporate d’Amazon s’inscrit dans la pure tradition de la communication « à l’américaine », avec son lot de superlatifs. Intervenant presqu’un an jour pour jour après l’annonce du passage à l’échelle mondiale de Netflx, lors
du CES 2016, il ne manque pas au-delà de pousser le bouchon encore un peu plus loin : quand Reed Hastings avait revendiqué une disponibilité dans 190 pays, le groupe dirigé par Jeff Bezos se targue d’être accessible dans « plus de 200 pays et territoires ». Ceci ne suffit pas à dissiper les interrogations sur ce mouvement. Dans sa manière et surtout dans son calendrier. Régulièrement évoqué depuis… 2012, le lancement d’Amazon Prime Video n’avait jamais été officiellement confirmé par le groupe. Pas même depuis l’été 2016 où la rumeur d’une arrivée coordonnée en France, en Espagne et en Italie s’était faite plus pressante. Et pas davantage, ces dernières semaines, quand les professionnels évoquaient un décalage au début 2017, le temps notamment pour Amazon, de franciser son interface et de procéder au doublage ou au sous-titrage, de son catalogue. A une stratégie d’expansion mesurée et soignée, le groupe a finalement préféré un mouvement massif et éclair, et renoncé pour ce faire à prendre en compte les spécificités nationales. A ce stade, au moins, l’ensemble de la navigation se fait donc en anglais. Et, comme le relevaient dès ce mercredi de nombreux observateurs, les séries ou films accessibles en Français (doublage et sous-titrage confondus) n’excèdent respectivement pas une vingtaine et un gros 150 avec même, parmi les curiosités pointées par le Huffington Post une section Bollywood exclusivement disponible en hindi. Du célèbre « think globally, act locally », Amazon semble avoir surtout retenu le premier terme, quitte à susciter des commentaires mitigés de la part de la presse, à réduire la capacité de son service à séduire le public mainstream, et à accroître les interrogations sur la date choisie : difficile, avec un lancement le 14 décembre, de tabler sur un afflux massif immédiat vers l’offre de SVoD et, partant, sur un levier significatif de cette dernière vers l’activité de e-commerce. Pas d’effet à attendre donc de Prime Vidéo, sur les ventes de Noël d’Amazon. Ce 14 décembre, le volume des recherches Google autour de la marque ne marquait d’ailleurs pas de progression par rapport au niveau des jours précédents. Les spéculations ne devraient donc pas manquer au cours des prochaines semaines autour du choix de Jeff Bezos. Reste au-delà une réalité tangible : en moins de douze mois, la SVoD aura vu se déployer ses deux premiers acteurs mondiaux. 2017 : l’année de tous les défis pour Snapchat L’entreprise continue de développer son réseau social à l’international et profite de l’accroissement de ses revenus publicitaires. Toutefois, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus accrue de la part de Facebook, mais aussi à la grogne des annonceurs. Focus sur les challenges qui attendent le groupe au cours de l’année qui vient,
à l’heure de sa prochaine introduction en bourse. Snapchat continue à innover Le réseau connaît ces dernières années une croissance rapide de son nombre d’utilisateurs au niveau mondial (23% des internautes, en hausse de 11 points en seulement deux ans) et de ses revenus publicitaires (ils s’élèveraient à près d’1 milliard de dollars en 2017, soit un bond de +155% par rapport aux 367 millions attendus en 2016). Il continue également à développer de nouvelles fonctionnalités à destination de ses utilisateurs. Au-delà des nouveaux Lenses, régulièrement proposés et très appréciés par les utilisateurs, le réseau a annoncé hier une nouvelle mise à jour offrant la possibilité de créer des conversations de groupe (jusqu’à 16 amis). Deux nouveaux outils font également leur apparition, le ciseau permettant de copier/coller une partie d’un snap, et l’intégration de Shazam permettant de retrouver le nom et l’auteur d’une chanson directement depuis l’application. Autre grand annonce faite par le réseau au cours du mois, le renforcement du partenariat noué avec le groupe audiovisuel Turner autour de la diffusion de contenus exclusifs sur le réseau. En effet la filiale du groupe Time Warner devrait faire profiter Snapchat de contenus issus de ses médias (TBS, CNN, Adult Swim entre autre) qui seront diffusés à la fois dans la rubrique Discover de l’application (Bleacher Report, site spécialisé sport devrait profiter de sa propre chaîne), mais aussi au travers de Live stories autour d’évènements spécifiques (rencontres sportives par exemple). Ce partenariat est le dernier exemple de la façon dont Snapchat veut devenir un support de référence pour les millennials. Turner déclarait pour l’occasion que son réseau et les contenus qu’il propose touchaient 75% des millennials américains chaque mois, le même public cible que Snapchat. Ce n’est pas la première fois que Snapchat noue ce type de partenariat puisqu’il annonçait en août dernier un partenariat similaire avec NBC autour d’émissions comme « The Voice », « Saturday Night Live » ou encore le « Tonight Show With Jimmy Fallon ». Ces partenariats devraient permettre à Snapchat de voir une hausse du temps passé sur l’application et ainsi mieux valoriser son audience auprès des annonceurs. Une concurrence de la part de Facebook de plus en plus féroce Cependant l’année 2016 aura été marquée par le développement par Facebook d’options similaires à celles que l’on retrouve sur Snapchat. On notera tout d’abord l’apparition en septembre 2016 des Instagram stories. Avec ces «Stories», Instagram propose à ses utilisateurs de publier des mini-séquences vidéos, qui, mises bout-à-bout, forment une «histoire» à partager avec ses amis, une des fonctionnalités qui a fait le succès de Snapchat auprès des Millennials. Des stories sont également en phase de test en Australie et en Pologne depuis quelques mois sur Facebook Messenger. De plus, Instagram a annoncé au mois de novembre dernier l’apparition d’une nouvelle fonctionnalité, directement inspirée de Snapchat : le partage de photos et vidéos éphémères en messages privés. Facebook a également annoncé le développement prochain de Facebook Collections, un clone de l’espace Discover. Le développement de ces nouvelles fonctionnalités ne fait que confirmer la volonté de Facebook de s’adapter à des usages qui font échos auprès d’une cible jeune. Avec des réseaux qui ne cessent de copier ce qui a fait son succès, pour mieux attirer et fidéliser les utilisateurs, l’application se retrouve confronter à un défi de taille. Surtout qu’elle pâtit encore de faiblesses, notamment dans les outils qu’elle met à disposition des
marques. L’absence d’analytics, principale faiblesse du réseau L’un des obstacles majeurs au développement du réseau, et de ses revenus publicitaires reste encore l’absence d’outils de mesure de la performance. A l’heure actuelle, une marque sur Snapchat ne dispose que de peu d’informations sur sa communauté (nombre d’abonnés) et sur la performance de ses contenus publiés (nombre de vues et nombre de screenshot). Un manque de données de performance qui se rajoute à des process de collecte d’informations manuels et fastidieux. Pour les marques qui achètent des espaces sur le réseau, l’application met à disposition plus d’informations telles que des données d’audience, des profils démographiques et le GRP, même si cela reste encore succincts : cela ne permet pas de savoir si un homme ou une femme a visionné la photo ou la vidéo, ni de connaître l’âge du public par exemple. Néanmoins l’application a noué des partenariats avec des acteurs tiers pour offrir plus d’outils de mesure de la performance aux marques. Ainsi Nielsen prend en charge, via son outil Ad Ratings, la mesure de la résonance et de la valorisation des marques mais aussi des publicités vidéo diffusées au sein de Discover, des stories et des Live Stories. Les médias présents sur le Discover disposent de plus d’informations, telles que le nombre de personnes ayant consulté leur page et le temps qu’ils ont passé dessus. (Cf. Performances des médias français sur Discover). Des annonceurs qui s’interrogent sur l’efficacité de certains formats proposés Avec une durée moyenne de consultation inférieure à 3 secondes, la question de l’efficacité des publicités vidéo sur le réseau se pose, surtout au regard des tarifs pratiqués par le réseau. Selon des témoignages anonymes d’annonceurs, relayé dans Adage, ils commencent à s’interroger sur la pertinence de communiquer sur le réseau. Car même si le réseau a baissé ses tarifs depuis janvier 2015, le coût d’une campagne reste élevé (il s’élève à 100k dollars, contre 750k début 2015, et le CPM dans Discover s’élève à 20$, au lieu de 100$). Le principal argument mis en avant par Snapchat pour contrer ce constat peu flatteur est que les deux tiers de ses publicités s’affichent avec le son actif, là où il est coupé chez ses principaux concurrents et que le contenu s’affiche sur tout l’écran mobile de l’utilisateur. De plus, viennent s’ajouter à ces chiffres des audiences qui stagnent sur les Live Stories, autre format présent sur l’application. En effet ce format serait de plus en plus boudé par les annonceurs. En juin 2015, l’un des dirigeants de Snapchat annonçait sur Recode que les Live Stories avaient en moyenne une audience de 20 millions de personnes sur des fenêtres de 24 heures. Un an après ces audiences ne seraient plus qu’en moyenne de 10 à 20 millions par jour. Une baisse qui s’expliquerait en partie par la nouvelle réorganisation des contenus sur l’application (Discover et Stories mieux valorisés par rapport aux Live).
L’échec de la diversification média de GoPro Véritables icônes de l’ère YouTube, les caméras GoPro ont permis à leur constructeur de se rêver en empire des médias alliant réseaux de chaînes digitales et production originale. Pourtant face à une concurrence accrue et l’échec de ses nouveaux modèle, l’aura de GoPro a décliné au point que le groupe vient d’annoncer sèchement la disparition de sa branche Entertainment et la fin de ses ambitions de diversification. GoPro, la fin d’une success story de l’ère YouTube Le groupe GoPro vient d’annoncer à la fois une importante réduction d’effectif et le départ de son PDG confirmant ainsi publiquement ses graves difficultés financières. GoPro va ainsi réduire ses effectifs de 15% (environ 200 personnes) et fermer deux de ses sites afin de renouer avec la rentabilité dans un contexte très défavorable à l’entreprise. Cette annonce a été accélérée par la dernière mésaventure du groupe qui a dû rappeler début novembre ses drones Karma, lancés depuis seulement quelques semaines. Ce rappel est particulièrement dommageable pour le groupe puisque le lancement du drone constituait le principal axe de diversification dans le domaine du matériel. Cet échec a fait plonger le titre de GoPro, confronté une nouvelle fois à sa principale faiblesse : une trop grande dépendance à son produit phare la fameuse caméra d’action GoPro Hero. Lancées en 2004, les caméras d’action GoPro Hero ont fait le succès de la marque en l’espace de quelques années seulement et sont devenues l’emblème d’une génération de créateurs de vidéo en ligne. En effet, si le succès auprès du grand public n’a pas été immédiat, les caméras GoPro, grâce à leur solidité, se sont par contre rapidement imposées sur le marché de niche des amateurs de sports extrême. Avec le développement des plates- formes de publication de vidéos en ligne, ces vidéastes amateurs ont trouvé un endroit pour partager leurs vidéos sportives et ainsi permis de donner la meilleure des vitrines aux caméras GoPro. La marque n’avait alors pas de concurrents majeurs et a pu positionner ses caméras très résistantes comme l’outil indispensable des vidéastes sportifs. Les ventes ont décollé au point que GoPro est devenu une des success-story de l’ère YouTube. En 2007 alors que les sports extrêmes rencontrent un engouement populaire sur Internet, GoPro quadruple son chiffre d’affaires et s’installe durablement dans le paysage audiovisuel avec son nouveau modèle la GoPro Digital Hero. La compagnie s’est ensuite employée à lancer un nouveau modèle chaque année en améliorant constamment leur résolution et leur capacité de stockage. A partir de 2010, la marque lance sa gamme de caméras haute définition nommée simplement GoPro HD. A partir de 2013, GoPro propose en outre des modèles haut de gamme 4K pour sa nouvelle GoPro HD 3. C’est l’apogée de la marque et les ventes doublent presque chaque année passant de 1,1 millions de caméras vendues en 2011, à 2,3 millions en 2012, 4 millions en 2013 et enfin 5,2 millions en 2014. Pourtant, à partir de 2015, la tendance s’inverse et les bénéfices s’effondrent. En effet, après des années de croissance à deux chiffres, les résultats de l’entreprise chutent lourdement au cours de l’année suite au lancement raté de la GoPro Hero 4. Au troisième trimestre le chiffre d’affaire baisse de 17% et au dernier trimestre le revenu des ventes
s’effondre même de 31% par rapport à 2014. En 6 mois, le cours de l’action de l’entreprise a chuté de plus de 80%. L’effondrement se poursuit en 2016 puisque le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de 49,5% au seul premier trimestre. Ces mauvais résultats s’expliquent par un lancement raté de son modèle Hero 4 mais également par une concurrence accrue sur un marché finalement assez réduit. En effet, la Hero 4 Session lancé à l’été 2015 à plus de 400$ n’a pas su trouver son public au point que le groupe a du baissé son prix de 50% 6 mois plus tard. Cet échec est du a un positionnement tarifaire trop haut de gamme d’autant plus problématique que les produits GoPro devaient alors faire face à une forte concurrence de la part de constructeurs comme Sony, LG, Xiaomi ou encore TomTom avec des tarifs plus abordables. En outre, la caméra d’action est également concurrencée par les smartphones désormais capables de filmer en HD et pour certains en 4K. Le marché de destination des GoPro étant de petite taille (10 à 15% de la population selon le groupe) cette concurrence est très problématique pour un groupe mono-produit. De ce fait, si le lancement de la GoPro 5 en octobre a permis au groupe de renouer un peu avec le succès, le report de son lancement sur le marché des drones et de diversification matérielle l’a mis dos au mur. La fin du rêve d’un empire médiatique GoPro Outre une réduction d’effectif, la chute des ventes a entraîné la fin de sa diversification dans les médias et le groupe a annoncé fin novembre la fermeture définitive de sa division Entertainment. La décision a été justifiée par le groupe par la nécessité de supprimer toutes les activités « hors du cœur de métier de l’entreprise et ne rapportant pas d’argent ». La disparition totale de la branche médias permet à GoPro de réduire drastiquement ces effectifs en épargnant relativement ses divisions historiques. Néanmoins, si cette fermeture semble logique, elle n’en reste pas moins surprenante puisque les médias étaient encore présentés jusqu’il y a quelques mois comme un relais de croissance prioritaire pour le groupe. La branche divertissement de GoPro a été lancée en 2014 alors que le groupe était au faîte de sa gloire. GoPro qui venait de lancer son modèle 4K semblait alors avoir atteint les limites des améliorations qu’il était possible d’ajouter à ses modèles de caméras. Le groupe cherchait donc de nouveaux relais de croissance au-delà du hardware et a jeté son dévolu sur une expansion dans le domaine des médias. Le choix était d’autant plus logique que le groupe avait une activité embryonnaire dans le secteur par ses liens avec certains vidéastes reconnus. En effet, dans le but de promouvoir ses produits, GoPro sponsorisait un grand nombre d’athlètes très présents sur les réseaux sociaux mais distribuait également ses produits à certains créateurs disposant de chaînes digitales populaires. La marque bénéficiait d’ailleurs d’une excellente exposition sur les réseaux sociaux vidéo et l’investissement dans les contenus est donc apparu comme une diversification naturelle. Afin d’accélérer, GoPro a débauché plusieurs dirigeants spécialistes du sport et de la création originale chez CBS, Hulu, HBO et MTV pour diriger sa branche Entertainment. Cette nouvelle division du groupe regroupait plus de 200 personnes avec l’objectif de redéfinir la façon dont GoPro créait des contenus afin d’en faire une activité lucrative.
Le premier axe de développement de la branche Entertainment de GoPro a été de constituer un réseau de talents pour la marque. Dès mai 2014, GoPro a réuni créateurs et sportifs (skaters, skydivers, surfers, BMX…) afin de les affilier au sein d’un réseau multichaînes spécialisé d’abord dans les sports de glisse et les sports extrêmes. Plutôt que d’investir directement et massivement dans la production originale, GoPro a donc fait le choix de se concentrer sur des contenus créés par les utilisateurs de ses produits. L’objectif était de systématiser la distribution de produits de la marque à des créateurs affiliés afin de favoriser la création de contenus GoPro. Les meilleures de ces contenus avaient vocation à être diffusés sur la chaîne centrale de la marque. D’abord lancée sur YouTube, la chaîne a été déclinée sur console dès l’été 2014 puis a bénéficié de son propre site. GoPro a également défini un autre axe prioritair e: l’amélioration de ses logiciels d’édition et de partage des contenus à destination des utilisateurs. Dans ce but, le réseau a multiplié les acquisitions de start-ups dont notamment Splice ou la française Replay. Ces applications présentaient l’avantage de simplifier la publication de contenus filmés avec une GoPro mais également de gérer les photos et vidéos prises avec un smartphones. En s’étendant aux terminaux mobiles, GoPro avait pour objectif de créer un écosystème plus vaste et ainsi développer son réseau de créateurs. Le dernier élément de ce projet devait être la mise à disposition de ces services dans le cloud avec potentiellement un système d’abonnement. Le service cloud devait permettre d’une part de redistribuer facilement les contenus vers ses différentes chaînes mais également de les monétiser plus efficacement auprès de tiers (annonceurs, agences de voyage, organisateurs d’évènements…). Justement, le dernier axe du projet initial de diversification visait à permettre la monétisation des contenus et talents auprès des marques. Le groupe s’est tourné dans un premier temps vers le brand-content en créant des contenus pour des partenaires comme Ford ou Wimbledon. Dans un deuxième temps, grâce à ses services dans le cloud, GoPro a créé un portail de vente directe de contenus à destination des marques. Enfin, à partir de 2016, l’objectif de l’unité Entertainment a évolué vers la production directe de contenus. Jusqu’à l’été 2016, GoPro prévoyait encore de lancer 32 créations originales pour la fin de l’année ou le début 2017. Parmi les contenus originaux prévus, GoPro avait annoncé une série sur le voyage, un format musical, une série documentaire
sur le Real Madrid et même des programmes familiaux. Les difficultés de l’entreprise ont donc mis un coup d’arrêt brutal à ce projet ambitieux. La baisse de profitabilité de l’entreprise lui a imposé de se recentrer sur son cœur de métier. Brian Mc Gee, directeur financier de GoPro, a récemment déclaré « qu’après une évaluation minutieuse le groupe est arrivé à la conclusion que la diversification dans les médias était une activité que GoPro ne pouvait pas finalement se permettre ». Le principal problème pour GoPro a été que le projet de diversification dans l’audiovisuel n’aurait dégagé des profits qu’à long-terme. Si des synergies semblaient possibles entre l’activité de constructeur de caméra et celle de créateurs de contenus, une diversification de cette ampleur nécessitait des investissements très lourds de la part d’un acteur spécialisé dans le hardware. Dans un contexte morose pour l’entreprise, GoPro n’a pas eu les moyens d’attendre que sa nouvelle activité dégage des profits. GoPro restera une entreprise de hardware et la majorité des projets de diversification médias sont arrêtés, y compris ceux qui concernaient le développement de logiciels d’édition vidéo puisque Splice pourtant racheté il y a moins d’un an a été fermée. GoPro devrait sans doute conserver seulement une poignée de chaînes YouTube au nom de sa marque pour promouvoir ses produits mais il est difficile de déterminer comment le groupe continuera de les alimenter en contenus. La FTC surveille la publicité clandestine sur Instagram Devant l’essor des opérations marketing faisant appel aux influenceurs sur Instagram, la Federal Trade Commission – organisme indépendant de protection des consommateurs aux Etats-Unis – tire la sonnette d’alarme. Car les accords d’endorsement [1] sont le plus souvent opaques, peuvent correspondre à de la publicité clandestine et tromper les utilisateurs. Mais le contrôle exercé par la FTC est loin d’être simple à mettre en place. Les « micro-influenceurs » posent problème à la FTC
Les problématiques de transparence des accords entre marques et influenceurs n’ont pas attendu l’explosion d’Instagram, ni celle des réseaux sociaux, pour émerger. Mais ce phénomène a pris une ampleur inégalée depuis leur apparition. S’ils ont pendant un temps échappé à la surveillance de la FTC, la Commission a toutefois pris soin de publier des guides d’information sur le sujet, et rappeler aux influenceurs les populaires l’impératif d’indiquer l’existence de partenariats commerciaux dans leur posts.C’est ainsi que Kylie Jenner, qui compte 81 millions d’abonnés sur Instagram, ajoute désormais systématiquement « #ad » dès qu’elle promeut une marque (cf. visuel ci-à côté). Mais la FTC est aujourd’hui saisie par des groupes de défense des consommateurs au sujet des « micro-influenceurs ». Ceux-ci ne sont pas millionnaires en audience mais sont affiliés à des agences spécialisés dans la mise en relation entre Instagramers et marques, tels BzzAgent, Influenster et PINCHme. Ces sociétés donnent aux utilisateurs de réseaux sociaux inscrits « la chance de tester de nouveaux produits et dire à tout le monde ce qu’ils en pensent, tout en étant rémunérés ». Or, c’est ce dernier point qui intéresse la Commission. Les 3 règles de transparence promues par la FTC La FTC conseille aux influenceurs de respecter 3 règles vis-à-vis de leurs audiences dès lors qu’ils participent à des campagnes d’endorsement, quel que soit le support et le format : Indiquer l’existence d’un partenariat C’est-à-dire informer la communauté d’un partenariat liant l’influenceur à une marque, qui peut orienter le commentaire ou la présentation de manière favorable à la marque ou au produit. Cette information prend place via l’utilisation de hashtags, tels que #ad ou #sponsored, qui permettent de faire apparaître facilement l’existence d’un lien commercial (compensation financière) motivant la publication d’un post. Rendre les informations claires et apparentes La Commission exige que l’insertion des informations, des hashtags indicatifs ne demandent pas à l’utilisateur de scroller. En cas de scroll inévitable, des indices visuels ou textuels doivent indiquer à l’utilisateur l’accès à la déclaration plus bas.
Les critères à respecter pour se conformer aux préconisations de la FTC : les indications doivent être proches du commentaire, dans une police lisible et dans une couleur qui ressort. Pour les publicités vidéo, elles doivent apparaître suffisamment longtemps pour être remarquées, lues et comprises. Pour les publicités audio, elles doivent être lues à une cadence facile à suivre pour les auditeurs et en utilisant des mots simples. Être honnête Les marques ont interdiction de faire de la publicité mensongère pour leurs produits sur n’importe quel support. Cette règle s’applique aux contenus postés par les influenceurs. Ces derniers n’ont pas le droit de parler d’un produit s’ils ne l’ont pas testé. Ils ne doivent pas mentir, s’ils n’ont pas apprécié le produit, ils ne peuvent pas en faire une critique positive. Enfin, les arguments utilisés par l’influenceur doivent être fournis par la marque : interdiction d’inventer des arguments. Si l’ensemble de ces règles garantissent une plus grande transparence et une meilleure information, il est nécessaire de les faire connaître à toutes personnes ayant un compte sur les réseaux sociaux et désirant monétiser leur audience. Il faut également contrôler leur application et sanctionner les contrevenants. L’existence de milliers, voire de millions, de micro-influenceurs rend ces tâches extrêmement complexes, si ce n’est impossibles, à mener. En France, la DGCCRF se penche sur le sujet de la publicité déguisée La Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes a lancé des enquêtes à partir de la fin 2015, pour vérifier si des célébrités du Web réalisaient des contenus (vidéos ou posts) promotionnels sans informer les internautes des rémunérations et du caractère publicitaire de leurs productions. L’objectif est de s’attaquer à des pratiques commerciales trompeuses (cf. l’article L. 121-1 du code de la consommation). Non seulement les influenceurs peuvent écoper d’amendes et de peines de prison, mais les intermédiaires, MCN ou agences de mise en relation, sont également dans le collimateur, surtout s’il est prouvé qu’ils ont encouragé ces pratiques opaques. Ce sont principalement des YouTubeurs qui ont été audités : une dizaine aurait touché entre 20K€ et 100k€ pour promouvoir un constructeur automobile, sans faire mention d’un contrat. Les transactions se passant généralement à l’amiable, les noms des personnes concernée n’ont pas été publiés. Sur Instagram, les pratiques sont loin de répondre aux objectifs de transparence et d’absence de publicité déguisée. Ainsi, le compte d’Anaïs Camizuli, participante de la 7ème saison de Secret Story (1,5M d’abonnés), est quasi-totalement dédié à la promotion de produits ou services, dont on se doute que certains ont rémunérés d’une manière ou d’une autre l’influenceuse. On note l’absence d’indication de partenariats. Autre exemple : alors que Kylie Jenner indique sur un post concernant un modèle de montre Daniel Wellington qu’il s’agit d’une publicité, la publication de Darko (participant à Secret Story 10, 164k abonnés) n’indique pas que ce post est sponsorisé, quand le contenu est clairement promotionnel.
Vous pouvez aussi lire