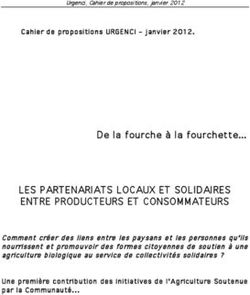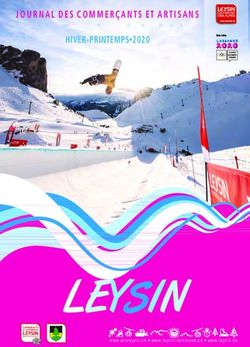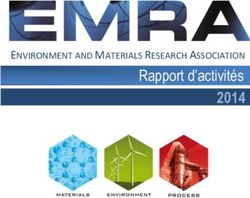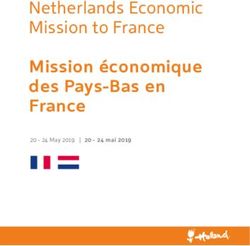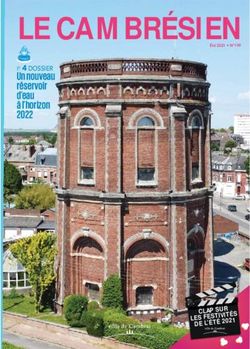Des application ciblées pour les bioplastiques - Serpbio
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
1 Des application ciblées pour les bioplastiques Jessica Huynh (Emballage Magazine 29/11/15) Alors qu'en France le marché des nouveaux plastiques fait du surplace, des initiatives viennent concurrencer les matériaux issus de la pétrochimie en visant la compétitivité hors prix. Les plastiques issus de ressources renouvelables sont-ils contraires à l’éthique? En ligne de mire, ceux produits à partir de produits alimentaires comme l’amidon de maïs ou de pomme de terre, employé dans la fabrication de l’acide polylactique (PLA), et la canne à sucre dont le brésilien Braskem se sert pour sa production de polyéthylène (PE) biosourcé. Les plastiques d’origine naturelle subissent ainsi de vives critiques depuis plusieurs années: comment justifier l’exploitation de ressources naturelles comestibles pour élaborer du plastique quand elles pourraient nourrir des populations entières? Pour les spécialistes, il faut replacer le problème à la bonne échelle. « Les bioplastiques ont fait l’objet de vifs débats il y a à peu près cinq ans. L’argument avancé était « l’utilisation, par l’industrie, de terres arables destinées à l’agriculture », explique Stéphane Bruzaud, enseignant- chercheur au laboratoire d’ingénierie et directeur du département sciences et techniques de l’université Bretagne Sud. Pourtant, selon les derniers chiffres de la Fédération européenne des bioplastiques, dans leur ensemble, les bioplastiques profiteraient de 0,01 % des terres arables et de 0,02 %, d’ici à cinq ans. « Un faux problème » donc, résume Luc Averous, professeur spécialisé dans les biomatériaux à l’université de Strasbourg. Pour s'affranchir de cette polémique, les industriels tendent à réorienter leurs recherches vers les ressources non comestibles, les résidus et les déchets. « Comme pour les carburants, il existe des PLA de première et seconde générations, qui ne sont plus produits à partir d'amidon par exemple. I1 n'y a quasiment plus de gros projet industriel basé sur l’utilisation de produits alimentaires à grande échelle. Les coproduits sont largement privilégiés », observe l’universitaire. Prix Bien plus concret qu’une simple idée reçue, le prix est le seul frein réel à l’essor des
2 nouveaux plastiques. Ce n’est pas nouveau mais hélas toujours d’actualité, près de quinze ans après l’émergence des plastiques d’origine non fossile: ils coûtent cher à produire. Si beaucoup espèrent une hausse du prix du pétrole, elle ne semble pas pour tout de suite. « Le tarif du baril de pétrole est historiquement bas, ce qui accentue encore plus la différence de prix entre le plastique d’origine fossile et celui d’origine renouvelable », constate Stéphane Bruzaud. Depuis le début de l'année, le cours du baril de Brent oscille entre 42 et 67 dollars (soit environ 37 et 59 euros). Sur la même période, le kilo de polypropylène (PP) se vendait entre 1,20 et 1,71 euro et celui du polyéthylène téréphtalate (PET), entre 1,02 et 1,36 euro. En comparaison, le PLA coûte au moins 2 euros le kilo et le polyhydroxyalcanoate (PHA), 7 voire 8 euros! S’il affiche un taux de croissance de 3,9 % entre 2012 et 2013, le marché des bioplastiques est embryonnaire et plus de 99 % des plastiques fabriqués sont encore d’origine pétrochimique. « Il faut dire que l’on part de rien, mais les capacités de production augmentent de manière exponentielle », souligne Stéphane Bruzaud. Même son de cloche chez Luc Averous: « Il convient de laisser le temps au développement industriel. On fait du polychlorure de vinyle (PVC) depuis 60 ans, les industriels ont donc eu le temps de faire des économies d’échelle et d'optimiser les procédés ». Pour l’instant, force est de constater que la filière des bioplastiques stagne. Hydrosoluble Comment surmonter l'obstacle du prix et espérer gagner quelques parts de marché? En comblant un vide sur l’actuel marché des emballages. C’est la stratégie adoptée par Lactips, une start-up créée en avril 2014. S’appuyant sur un brevet de l’université de Saint-Étienne, l’entreprise, installée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), transforme des protéines de lait en granulés de plastique. La principale application visée pour l’instant est l’emballage hydrosoluble des produits d’entretien ménager - notamment les capsules pour lave-vaisselle ou lave-linge- et phytosanitaires. Le but est d’offrir aux marques et aux consommateurs non pas un équivalent de la capsule aujourd’hui réalisée en alcool polyvinylique (PVOH) mais un produit encore plus performant, à l’impact environnemental réduit et doté d’un procédé de fabrication moins énergivore. Le tout est proposé à un prix similaire. « Les doses sur le marché sont non biodégradables et se dissolvent mal, ce qui risque de boucher les filtres, et des résidus de film mal solubilisé peuvent subsister sur les assiettes et les vêtements. Les capsules qui seront réalisées avec les granulés que nous produisons permettront au consommateur de laver à basse température s’il le souhaite, comme c’est souvent le cas en Asie. Proposer des films qui se dissolvent bien, quelle que soit la température de l’eau, permettrait ainsi aux marques de gagner des parts de marché à l’étranger», suggère Marie- Hélène Gramatikoff, fondatrice de Lactips. « Ce type de produit peut tout aussi bien intéresser des entreprises adeptes du tout bio qui souhaitent, par exemple, se lancer sur le marché du détergent liquide et qui ne l’ont pas encore fait car elles ne veulent pas utiliser de PVOH, qui n’est pas biodégradable, pour emballer leurs produits», poursuit-elle. Côté prix, si la chef d’entreprise préfère rester évasive sur le sujet, elle assure néanmoins que son produit est compétitif. « En France, le PVOH se vend actuellement entre 12 et 25 euros le kilo. Disons que nos granulés issus du lait se situent dans ces "eaux- là" même si nous sommes plutôt dans la fourchette haute », concède-t-elle. Pour le moment, la société, qui lève des fonds afin de finir le développement et installer des lignes de production, se concentre sur ses clients actuels pour la partie détergence. « Nous avons sept clients confirmés sur ce marché, que nous espérons fournir dès 2016, sans faire de prospective commerciale. Les marques sont venues nous voir en entendant parler du brevet. Il y a une pression du marché, cela montre bien qu’il y a un vide à combler », commente Marie-Hélène Gramatikoff. Dans un deuxième temps, elle prévoit de transformer des protéines de lait, comestibles cette fois-ci, pour
3 emballer des produits alimentaires comme le café et le riz. Pour la filière bioplastique, une autre piste consiste à viser des applications à forte valeur ajoutée, notamment l'impression 3D, l’électronique ou le biomédical. Depuis maintenant cinq ans, Stéphane Bruzaud, qui s’est spécialisé dans la chimie des polymères et des biopolymères, travaille sur la transformation de bactéries marines en PHA. Prélevées en mer puis congelées à - 80 °C, les bactéries sont ensuite placées dans un bioréacteur en présence de déchets végétaux issus de l’industrie agroalimentaire bretonne. Pendant la phase de fermentation, les bactéries, privées de nourriture, commencent à produire du PHA. « La matière obtenue se pose en concurrente du PP et du PET, dont les composants mécaniques sont assez proches. Esthétiquement, le rendu est semi-rigide », précise le chercheur. Il n'est cependant pas parfait en termes de transparence et présente, lui aussi, l’inconvénient d’un prix plus élevé. « Le produit n’est pas encore industrialisé, son prix est donc difficilement estimable mais le prix moyen du PHA tourne autour de 7 ou 8 euros, soit bien au-delà du plastique issu du pétrole, admet Stéphane Bruzaud. La demande n'est pas suffisante pour pouvoir baisser les prix, c'est un peu le serpent qui se mord la queue! Pour compenser le surcoût, puisque nous n’arrivons jamais au même prix que le PP, nous visons des applications plus spécifiques et pointues ». Financé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Adème), le projet 100 % breton BluEcoPHA, qui découle directement des précédents projets Biocomba et PHApack, fédère plusieurs entreprises de la région: Algosource, spécialiste des microalgues, le groupe agroalimentaire Sojasun, le fournisseur d’emballages Breizpack et Séché Environnement, qui valorise et traite les déchets ménagers et industriels. Actuellement au stade de la préindustrialisation, le dispositif mis au point est capable de produire dans des réacteurs de 50 litres. La prochaine étape sera de tester la faisabilité du procédé avec des réacteurs de 3000 litres, l’objectif final étant de développer une filière industrielle de fabrication d’emballages en PHA pour l'agroalimentaire, lorsque la filière des bioplastiques aura décollé. Si elle décolle un jour. BISPHENOL A : LE POINT DE L'INRS SUR L'EXPOSTION DES AGENTS DE CAISSE ANSES et C Philippe via ChemSud le 29/11/15 L’INRS (Institut National de Recherche Scientifique) vient de publier une étude sur l’exposition des agents de caisse au bisphénol A à travers les tickets de caisse. A ce jour, il n’existe que peu de données sur l’exposition par voie cutanée (et non pas alimentaire) et professionnelle. Selon des données de 2011, les personnels exposés seraient en France environ 186 000. Le bisphénol A, perturbateur endocrinien, est utilisé dans les papiers thermiques comme révélateur. Il y est présent sous forme libre, donc facilement transférable par la peau. En 2013, l’ANSES avait mis en garde dans un rapport sur l’exposition de femmes enceintes à des tickets de caisse contenant du bisphénol A, recommandant de réaliser des tests de dosage de BPA dans l’urine de ces populations sensibles exposées. Il est intéressant que l’INRS ait suivi ces recommandations, mais dommage qu’ils ne se soient pas focalisés sur les femmes enceintes. Si la substitution du BPA (remplacé par du bisphénol S ou autre chose) a commencé dans les 10 entreprises des secteurs visés restauration, grande distribution et commerce par l’enquête de l’INRS, les données confirment que les taux de BPA présents dans les échantillons urinaires des 90 professionnels exposés sont plus élevés que ceux des professionnels "témoins" (au nombre de 44). L’INRS note que 76% de ces professionnels sont des femmes. L’institut ne peut
4 conclure à l’effet sur la santé du BPA présent dans les tickets de caisse, mais recommande de prendre en compte ces données dans les évaluations des risques à venir. Suite aux recommandations de l’ANSES, la France a déposé une demande de restriction du bisphénol A dans les tickets de caisse en Europe, dans le cadre du règlement REACH. Après la proposition française, plusieurs comités et instances de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doivent se prononcer, avant que la Commission européenne n’adopte ou non cette restriction. Une décision devrait avoir lieu d’ici la fin 2015 (ou début 2016). La France a entretemps entrepris une démarche de labellisation des tickets de caisse "sans BPA" et "sans phénols" DES FIBRES TEXTILES A BASE DE LAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION BE via ChemSud le 29/11/15 L’entreprise allemande QMilk de Hanovre (Basse-Saxe) développe depuis 2011 de nouvelles fibres pour l’industrie textile, en utilisant les protéines contenues dans le lait impropre à la consommation (les caséines). Le procédé consiste à extraire la caséine du lait pour en faire une pate semihydratée. Cette dernière est ensuite introduite dans un pressoir d’où ressortent de longs fils fins comme de la soie d’araignée. Une fois ceux-ci séchés, ils peuvent être utilisés par l’industrie textile. Le procédé n’utilise que très peu d’eau (contrairement à la culture du coton) et les fibres ont l’avantage d’être biodégradables et compostables en fin de vie. Chaque année environ 2 millions de tonnes de lait impropre à la consommation sont jetés en Allemagne. La valorisation de ce gisement pourrait permettre de produire jusqu’à 240 millions de t-shirt. L’objectif de QMilk à court terme est de parvenir à bâtir un réseau logistique pour récupérer 6% de ces rebuts d’ici 2017 et les acheminer à Hanovre où l’entreprise dispose d’une capacité de production de 2 000 tonnes de fibres par an. Par ailleurs, la valorisation d’autres éléments contenus dans le lait, comme les graisses, est actuellement à l’étude. Avec ces dernières, QMilk compte développer des cosmétiques et des biopolymères. Les fibres à base de lait restent plus chères que les fibres de coton (25€/kg contre 3€/kg), cependant ses caractéristiques sont davantage comparables à celle de la soie avec laquelle l’écart de prix est plus faible, voire à l’avantage des fibres à base de lait. De nombreuses entreprises du secteur textile se sont déjà montrées intéressées et les premiers produits devraient arriver sur le marché allemand en 2016. QMilk a reçu en 2015 le prix allemand "GreenTec Award" de l’innovation verte de l’année dans la catégorie "production". NOUVEAU CENTRE DE CULTURE DE MICROALGUES POUR LE BIOKEROSENE BE via ChemSud le 29/11/15 L’université technique de Munich (TUM, Bavière) a inauguré en partenariat avec le groupe Airbus une nouvelle installation pour la culture des microalgues sur le campus Ludwig Bolkow à Ottobrunn (Bavière). Ce centre de 1 500 m2 a pour objectif de développer de nouvelles espèces pour la production de biokérosène. L’installation est à même de couvrir l’intégralité de la chaine de valeur du biokérosène : de la croissance des algues à la synthèse du carburant. Des bacs d’eau salée pour la culture des algues sont disposés dans trois verrières équipées de glace laissant passer les rayonnements ultraviolets du soleil. Par ailleurs, ces verrières disposent aussi de LEDs modulables dans des longueurs d’onde allant
5 de 300 à 800 nm afin de pouvoir simuler au mieux tout type de conditions climatiques. Enfin, des laboratoires et des bureaux adjacents permettent aux scientifiques de travailler sur place à la synthèse de biocarburant. L’objectif du centre est d’étudier de nouveau types d’algues dans des conditions différentes. En effet, les scientifiques estiment qu’il existe environ 150 000 types d’algues mais que seule 5 000 d’entre elles ont été étudiées. Par ailleurs, la plupart des espèces peuvent croître différemment selon les conditions climatiques. Les chercheurs veulent ainsi déterminer si des espèces subtropicales prometteuses pourraient être acclimatées en Allemagne, que ce soit au sein de systèmes fermés (photobioréacteurs) ou ouverts (halles de culture). Le centre a été développé dans le cadre du projet "AlgenFlugKraft" et a couté 10 millions d’euros. Le groupe Airbus et le ministère de l’Economie bavarois ont chacun apporté la moitié de cette somme. Les entreprises Clariant et Conys GmbH sont aussi partenaires du projet. Bio Base NWE leverages €71million of investments and the creation of 320 jobs in the Northwest European biobased economy. 01/12/15 Press release - 1 December 2015. Bio Base NWE, a three-year project co-financed by the INTERREG IVB programme of the European Union, has come to an end and proudly presents its results. This network of biobased economy experts advised over 500 small and medium enterprises (SME’s) to facilitate innovation and business development in biobased technologies and to stimulate the growth of the biobased economy in Northwest Europe (NWE). 27 SMEs received financial support through the project to conduct feasibility studies and scale-up trials at the Bio Base Europe Pilot Plant (Ghent, Belgium). Almost all of them declared these trials speeded up the commercialisation of their innovation. The work done within the innovation coupons scheme created a substantial leverage effect: up to €71million of investments and the creation of 320 new jobs in the biobased economy in the coming years. Furthermore the project partners discussed policy recommendations with their local and EU policy makers aimed at removing the hurdles SME’s encounter during their journey to bring lab scale innovations to the market. In the biobased economy lays a big opportunity for Europe. Locally produced biobased feedstocks rather than imported fossil resources are used to produce materials, chemicals, energy… creating a new knowledge and technology intensive economy with high employment potential and with reduced environmental impact. However, to achieve this transition, Europe needs to turn more of its biobased research into commercial innovation. Companies need to be able to scale-up their innovations from lab scale to an industrially viable process; this often is a challenge because of the cost, capital equipment and expertise required. Furthermore they need to find partners, users and investors, assess their feedstock security, get legal support... to successfully bring their product to the market.
6 In 2013, the European Commission launched Bio Base NWE, a three-year and €6,2 million project to support the development of the biobased economy in North West Europe (NWE). The Bio Base NWE consortium brought together biobased economy experts from eight organisations in five different countries. They provided networking opportunities and technological solutions to more than 500 SMEs, identified hurdles SME encounter during their innovation track and translated these into policy recommendations which were discussed with regional, as well as European policy makers. Furthermore web-based training tools (process simulation and e-learnings) were developed to help tackle the shortage of skilled professionals in North West Europe’s biobased industries. Innovation Coupon Scheme Bio Base NWE successfully implemented an Innovation Coupon Scheme. A coupon represented a value of maximum €30.000 for feasibility studies and scale-up work undertaken at the Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP), an independent, flexible, state-of–the-art demonstration facility in Ghent, Belgium, to validate innovative biobased technologies and scale them up to an industrial level. Early collaboration with experienced personnel in a flexible facility with a wide range of pilot equipment can substantially reduce costs, risks and development time and reinforces the chance to successful market entry. This scheme became a very attractive support mechanism for many SMEs. Eventually, 27 SMEs working on sound and ambitious biobased innovations were selected across the NWE region. Evaluation of the progress these SMEs made after the trials show a huge leverage effect. Seventeen SMEs either signed contracts with investors or are negotiating, five signed contracts with customers and four biobased products were already commercialised before the end of the project. Sixteen SMEs reported to have concrete plans to build a dedicated pilot line for further development or a new production line for a total investment of over €71million. Forty-three new jobs were created; an estimated 275 new jobs will be created in the coming years. TeeGene Biotech Ltd. (UK), a Teesside University spin-out venture, received a coupon and comments: “It is an immense help for start-up companies like ours to conduct feasibility studies to prove our technology platform. Experts at Bio Base Europe Pilot Plant brought new insight into our business prospective and uncovered many challenges we had been facing for two years in the process development”, says Dr Pattanathu Rahman, Founder of TeeGene Biotech Ltd, “The biosurfactant scale-up work was very successful, and made us confident that we can manufacture biosurfactants at an industrial level. We are now looking into the possibility to build our own pilot line.” More success stories can be found at: http://www.biobasenwe.org/en/skills-expertise/success-stories/. Whilst the project has completed its extensive work program, the network will continue to flourish and looks very much forward to further innovating with SMEs in the Northwest European region … and beyond. Contact For more information, comments or interview requests about Bio Base NWE, please contact: Mrs. Katrien Molders, Communication Manager, Tel: +32 (0)9 335 70 01, Mob: +32 (0) 486 951 109, E-mail: Katrien.molders@bbeu.org, www.BioBaseNWE.org. Or contact your local Bio-Innovation Agent: see http://www.biobasenwe.org/en/contact/. The Bio Base NWE partners are: Bio Base Europe international non-profit organisation (BE); Bio Base Europe Pilot Plant (BE); Ghent Bio-Economy Valley (BE); Bio Base Europe Training Center (NL); REWIN/Biobased Innovations (NL); Cluster Industrielle Biotechnologie 2021 (DE); National University of
7 Ireland, Galway, Competence Centre for Biorefining and Bioenergy (IRL); National Non-Food Crops Centre (UK) Dr Adrian Higson Lead Consultant - Biobased Products Tel:+44 (0)1904 435182 a.higson@nnfcc.co.uk Avec Végéplast, le maïs devient plastique Publié le 30/11/2015 Depêche du Midi VEGEPLAST transforme l'amidon et les fibres de céréales en matière plastique. Premier fabricant français de bioplastique, Vegeplast propose des produits entièrement d'origine végétale, 100% biodégradables. Des capsules de café aux filaments pour l'impression 3D, le plastique du futur se fait une place dans notre quotidien. Fabriquer du plastique en valorisant les ressources renouvelables, c'est aujourd'hui une solution d'avenir réaliste. Vegeplast, expert depuis plus de 15 ans dans la conception et la production de pièces et emballages 100 % biodégradables, le prouve. Cette entreprise de 40 personnes, installée à Bazet, près de Tarbes, maîtrise l'ensemble du processus, depuis la sélection des matières végétales (mais, blé…) jusqu'à la fabrication d'objets par injection thermoplastique. A partir de l'amidon, Vegeplast a d'abord produit des tees de golf, des attaches de vignes et des liens de parachutes. Le combat de la dosette Vegeplast s'est ensuite attaqué au marché porteur des dosettes biodégradables compatibles avec les machines Nespresso. Un véritable succès. En 2013, l'entreprise a investi dans une grosse unité de production pour sortir des capsules en grande quantité. Mais Nespresso a engagé une procédure et, même si Vegeplast et son partenaire, Ethical Coffee Compagny, ont gagné le procès, les dégâts étaient faits. «Nous avons souffert, explique le PDG de Vegeplast, le chiffre d'affaires est tombé de 5 millions d'euros à 3,5 millions. Mais nous avons rebondi en créant une éco-capsule innovante de 2ème génération à remplir, écologique et économique, qui permet de choisir son café. Et toujours compatible avec les machines Nespresso. D'autre part, nous allons lancer en fin d'année, une dosette en partenariat avec des torréfacteurs locaux qui font du très bon café.»
8 Recherche et diversification Au sein du bureau d'études, huit chercheurs inventent les bioplastiques du futur, plus performants, permettant de créer des produits novateurs d'ici 3 ou 4 ans. Mais la diversification est déjà en marche. «Jusqu'à présent, nous produisions la matière pour la transformer nous-mêmes, précise Vincent Pluquet. Nous proposons aujourd'hui, à la vente, des granulés permettant à des partenaires de fabriquer leurs objets. Ça commence avec la production de pots de fleurs.» L'entreprise se positionne sur d'autres marchés comme les emballages et sacs alimentaires ou les piluliers, générateurs de gros volumes, la vaisselle jetable, les produits de maraîchage et même les filaments pour impression 3D. Le volume d'activité a progressé et le chiffre d'affaires est de nouveau à la hausse, il pourrait atteindre 20 millions d'euros en 2020. Une récente levée de fonds de deux millions d'euros permet à cette entreprise unique de voir plus loin. Elle se tourne désormais vers l'international avec le lancement d'une cellule commerciale et marketing pour activer la prospection, notamment vers les Etats-Unis. ¦ Fabriquer du plastique en valorisant les ressources renouvelables, c'est aujourd'hui une solution d'avenir réaliste. Vegeplast, expert depuis plus de 15 ans dans la conception et la production de pièces et emballages 100 % biodégradables, le prouve. Cette entreprise de 40 personnes, installée à Bazet, près de Tarbes, maîtrise l'ensemble du processus, depuis la sélection des matières végétales (mais, blé…) jusqu'à la fabrication d'objets par injection thermoplastique. A partir de l'amidon, Vegeplast a d'abord produit des tees de golf, des attaches de vignes et des liens de parachutes. Le combat de la dosette Vegeplast s'est ensuite attaqué au marché porteur des dosettes biodégradables compatibles avec les machines Nespresso. Un véritable succès. En 2013, l'entreprise a investi dans une grosse unité de production pour sortir des capsules en grande quantité. Mais Nespresso a engagé une procédure et, même si Vegeplast et son partenaire, Ethical Coffee Compagny, ont gagné le procès, les dégâts étaient faits. «Nous avons souffert, explique le PDG de Vegeplast, le chiffre d'affaires est tombé de 5 millions d'euros à 3,5 millions. Mais nous avons rebondi en créant une éco-capsule innovante de 2ème génération à remplir, écologique et économique, qui permet de choisir son café. Et toujours compatible avec les machines Nespresso. D'autre part, nous allons lancer en fin d'année, une dosette en partenariat avec des torréfacteurs locaux qui font du très bon café.» Recherche et diversification Au sein du bureau d'études, huit chercheurs inventent les bioplastiques du futur, plus performants, permettant de créer des produits novateurs d'ici 3 ou 4 ans. Mais la diversification est déjà en marche. «Jusqu'à présent, nous produisions la matière pour la transformer nous-mêmes, précise Vincent Pluquet. Nous proposons aujourd'hui, à la vente, des granulés permettant à des partenaires de fabriquer leurs objets. Ça commence avec la production de pots de fleurs.»
9
L'entreprise se positionne sur d'autres marchés comme les emballages et sacs alimentaires ou
les piluliers, générateurs de gros volumes, la vaisselle jetable, les produits de maraîchage et
même les filaments pour impression 3D. Le volume d'activité a progressé et le chiffre
d'affaires est de nouveau à la hausse, il pourrait atteindre 20 millions d'euros en 2020.
Une récente levée de fonds de deux millions d'euros permet à cette entreprise unique de voir
plus loin. Elle se tourne désormais vers l'international avec le lancement d'une cellule
commerciale et marketing pour activer la prospection, notamment vers les Etats-Unis.
La bouteille biosourcée va-t-elle détrôner le PET ?
Par Baptiste Cessieux publié le 30/11/2015
L'immense majorité des bouteilles d'eau et de soda sont faites de polyéthylène téréphtalate.
Ce plastique est issu du raffinage du pétrole mais peut être en partie bio-sourcé.
Les géants de l’agroalimentaire courent tous après l’emballage miracle, la bouteille
biosourcée. Plusieurs matériaux se retrouvent sur la ligne de départ. Objectif : détrôner le roi
PET qui compose l’immense majorité des bouteilles plastiques.
Si vous jetez un œil sous n’importe quelle bouteille d’eau produite en France, vous avez 99 %
de chance de trouver le petit triangle du recyclage marqué d’un "1" en son centre. Ce sigle
signifie que la bouteille que vous tenez entre les mains est faite en polytéréphtalate d'éthylène
(PET), un plastique qui règne en maître sur la filière des boissons en bouteille… malgré de
nouveaux concurrents qui émergent en faisant valoir leurs arguments écologiques.
Le matériau historique cumule en effet les avantages : process de fabrication connus, tri aisé
et filière de recyclage désormais bien établie, ce plastique peut même être composé à un tiers
de produits biosourcés. Mais ce sont les deux tiers restants qui pourraient causer sa perte.
Le PET est un copolymère : un plastique formé de deux molécules A et B qui se répètent
inlassablement. Il est historiquement issu du pétrole mais l’un des deux composés (l’éthylène
glycol) peut être facilement obtenu à partir du sucre, donc de la biomasse. La deuxième
molécule (l’acide téréphtalique), peut également être produite à partir de la biomasse mais
uniquement au prix de nombreuses manipulations qui augmentent drastiquement le coût du
matériau.
« Economiquement c’est impossible, déclare formellement Franck Dumeignil, directeur
adjoint de l’Unité de catalyse et chimie du solide de l’Université Lille 1. L’acide recherché
contient un cycle aromatique. Cette particularité existe dans la biomasse mais uniquement
sous forme de longue chaîne hétérogène. Il faut alors briser cette chaîne maillon par maillon10 pour récupérer les molécules intéressantes. Les coûts de la séparation puis de la sélection sont bien trop importants pour concurrencer le pétrole qui contient la bonne molécule ». Le problème n’a pas empêché Coca-Cola et la jeune entreprise américaine Virent de présenter une bouteille 100 % biosourcée lors de l’Exposition universelle de Milan. Sans communiquer sur le coût de ce plastique. PLA, PEF, les concurrents sont dans les starting-blocks Le raisonnement qui vise à créer un PET biosourcé n’est pas le bon selon Franck Dumeignil. « On cherche à imiter les produits connus à partir d’une nouvelle source. L’idéal est plutôt de synthétiser de nouveaux polymères à partir des molécules offertes par la nature ». Et c’est ce que font le PEF et le PLA, les deux concurrents totalement biosourcés du PET. Le PEF (polyéthylène furanoate) est développé par Avantium, une entreprise néerlandaise, depuis une dizaine d’années. Ce polymère est obtenu à partir de sucre de betterave ou de canne et il possède des caractéristiques physiques égales ou supérieures au PET, notamment de meilleures propriétés barrières vis-à-vis de l’oxygène, du dioxyde de carbone et de l’eau. De quoi permettre de prolonger la durée de vie des produits contenus dans ces nouveaux emballages. Le PLA (acide polylactique) est également connu depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs largement utilisé pour l’impression 3D personnelle. Ce plastique est malgré tout inférieur au PET. « Il est plus poreux à l’oxygène, explique Thomas Lefevre, directeur de Nature Plast. Cela se traduit par une durée de vie plus courte (environ 1 an) et une évaporation du contenu. On ne pourrait pas l’utiliser avec des boissons gazéifiées par exemple ». Autre problème : une moins bonne résistance à température élevée. Les deux problèmes peuvent être résolus par l’ajout d’additif durant la fabrication comme cela se fait généralement dans l’industrie plastique. Mais de tels procédés doivent être étudiés et mis en œuvre de manières indépendantes pour chaque plastique. Le recyclage : principal ennemi des plastiques biosourcés PEF et PLA pourraient théoriquement rejoindre dès maintenant la fabrication de bouteille d’eau et de soda. Quelques exemples existent. Pourtant l’industrialisation à grande échelle se heurte à un problème structurel : la filière de recyclage. Aujourd’hui le circuit se contente de séparer les bouteilles transparentes des bouteilles colorées (qui contiennent des additifs différents). Au final 10 % de matière recyclée sont réincorporées dans les nouvelles bouteilles afin de ne pas en modifier les caractéristiques physiques. L’ajout d’un nouveau polymère, quel qui soit, dans cette chaîne de tri nécessiterait des modifications profondes. Les bouteilles devraient alors être sélectionnées en fonction de leurs compositions et envoyées vers des processus de recyclage différents. Un tel changement ne pourrait pas s’appuyer uniquement sur l’innovation. Pour changer la filière de recyclage, il faut aussi une décision politique. European Commission launches revised plans for Circular Economy December 3, 2015 By David Eldridge
11
The European Commission has released its new Circular Economy Package with lower
recycling targets than those contained in the original proposal announced in 2014, which was
later withdrawn.
In its statement today, the Commission said its new waste proposal includes: common EU
targets for recycling 65 percent of municipal waste and 75 percent of packaging waste by
2030; and a binding target to reduce landfill to a maximum of 10 percent of all waste by
2030. In the 2014 proposal, the targets were recycling 70 percent of municipal waste and 80
percent of packaging waste by 2030, and a total landfill ban from 2025.
Other key elements of the revised waste proposal include:
A ban on landfilling of separately collected waste.
Promotion of economic instruments to discourage landfilling.
Simplified and improved definitions and harmonized calculation methods for
recycling rates throughout the EU;
Concrete measures to promote re-use and stimulate industrial symbiosis – turning one
industry's by-product into another industry's raw material.
Economic incentives for producers to put greener products on the market and support
recovery and recycling schemes (for example, in packaging, batteries, electric and
electronic equipment, vehicles).
The proposal incorporates a strategy on plastics in the circular economy, which aims to
address issues of recyclability, biodegradability and the presence of hazardous substances in
plastics. The Commission said it will propose a more ambitious target for the recycling of
plastic packaging in the revised legislative proposal on waste.
The issue of marine litter is also tackled in the circular economy package, in part targeting
plastics litter. The Commission said the implementation of waste legislation will reduce
marine litter by at least 25 percent.
The concept of a circular economy involves the conversion of waste into new raw materials.
But there are barriers to greater take-up of secondary raw materials in the EU, notably
inconsistency in quality. Consequently, the Commission said it will start work to develop
quality standards for secondary raw materials, in particular for plastics.
Answering criticism about the withdrawal of the previous circular economy package in
December 2014, the Commission said it “committed at that time to use its new horizontal
working methods to present a new package by the end of 2015 which would cover the full
economic cycle, not just waste reduction targets, drawing on the expertise of all the
Commission's services. The comprehensive package adopted today represents a set of
tangible, broad and ambitious actions which will be presented during the Commission's term
of office.”
Frans Timmermans, first vice-president at the Commission, responsible for sustainable
development, said: "The circular economy is about reducing waste and protecting the12
environment, but it is also about a profound transformation of the way our entire economy
works. By rethinking the way we produce, work and buy we can generate new opportunities
and create new jobs.”
He continued: “This mix of smart regulation and incentives at EU level will help businesses
and consumers, as well as national and local authorities, to drive this transformation."
As well as its plastics strategy tackling the lagging recycling rate, the Commission said:
“Innovation in this sector is also an important aspect — it can contribute to the circular
economy by better preserving food, improving the recyclability of plastics or reducing weight
of materials used in vehicles.”
Bio-based resins get USDA certification
December 2, 2015 By Michael Lauzon
Laurel BioComposite LLC Laurel BioComposite's plant in Laurel, Neb.
Laurel BioComposite LLC reports it has earned the Certified Biobased Product Label from
the U.S. Food and Drug Administration for three polylactide-based polymers.
Laurel BioComposite said the certification applies to Bio-Res grades with 97 percent PLA
content, 62 percent PLA along with polyethylene, and a PLA powder. The USDA
BioPreferred program aims to boost usage of bio-based products under the Farm Security and
Rural Investment Act of 2002.
Bio-Res PLA products can be injection molded and extruded. They can be mixed with other
resins to make items used in agriculture and lawn and garden applications. Another potential
application is the use of Bio-Res powder to replace some calcium carbonate in sheet-molded
or bulk-molded thermoset composites where it can reduce part weight by 25 percent in
vehicle panel applications.
Laurel BioComposite recently expanded PLA production capacity and the laboratory at its
Laurel, Neb., headquarters plant.
Australian environmental groups push for bag bans
By Kate Tilley November 30, 2015 Updated 3 days ago
An alliance of 48 environmental groups has written to all environment ministers around
Australia asking them to ban plastic bags when they meet next month.
Federal environment minister Greg Hunt and his eight state and territory counterparts meet in
Melbourne on Dec. 15 to discuss a range of environmental issues, including research work
conducted by the office of Mark Speakman, environment minister for the state of New South
Wales (NSW), into initiatives to reduce the amount of plastic waste, including potential bans
on plastic shopping bags.13 Hunt’s spokesman said the environment ministers, at their last meeting in February, agreed to NSW investigating “practical solutions for the phase-down of lightweight plastic bags.” The Boomerang Alliance, led by Jeff Angel, director of the Sydney-based Total Environment Centre, has asked the ministers to ban all bags up to 70 microns and introduce policies aimed at maximum adoption of reusable bags for shopping. Angel estimates Australian plastic bag use will exceed 9 billion this year, including more than 4 billion single-use supermarket carry bags. Boomerang Alliance has asked the ministers to implement a range of actions, including banning single-use high density polyethylene carry bags and not automatically excluding low density PE carry bags from any ban. Angel said LDPE bags should be included in bans but case-by-case exemptions allowed if retailers can demonstrate effective management and/or minimal risk of the bags reaching the marine environment. The alliance is skeptical about oxo-biodegradable and bioplastic bags. The letter to ministers said: “While they offer some limited environmental resource benefit, using an oxo- degradable bag is as bad as a traditional HDPE bag in terms of litter and marine impacts. Until these options can provide proven benefit, they should be treated like any other plastic.” The alliance acknowledged banning single-use “non-carry” bags, for example, ice bags and sandwich, storage and freezer bags, is “more complex than eliminating plastic carry bags”, but its letter asks for “appropriate regulatory action.” The alliance also wants bags to be clear or dark colored only and unbranded. “Coloring plastic film integrates more toxic additives and makes the bags more likely to be ingested,” its letter said. It cited a 2014 study by the University of Tasmania of necropsies of 171 shearwater sea birds that found of 1,032 pieces of plastic in their gullets, just 0.87 percent was clear plastic, compared to 62 percent light-colored plastic, 22 percent medium colors and 14 percent dark colors. Angel said: “Plastic pollution is a major threat to wildlife. Globally it is estimated 1 million sea birds and [more than] 100,000 mammals die every year [from] plastic ingestion or entanglement. Of great concern are secondary microplastics derived from broken up bags and bottles.” Hunt’s spokesman would not elaborate on the agenda for the ministers’ meeting, but said: “Minister Hunt is supportive of the work being led by NSW and encourages businesses and members of the community to engage in any of the processes being run by NSW to ensure a suitable solution can be found for all parties. The states and territories have shown a willingness to work together to have approaches in place that are complementary.” Boomerang Alliance acknowledged that two states, South Australia and Tasmania, and two territories, the Northern Territory and the Australian Capital Territory, have taken some ban actions against plastic bags, but said voluntary programs are “incapable of resolving the issue and a levy is too complex and administratively inefficient.” Customized bacteria could be route to nylon precursor By Michael Lauzon December 2, 2015 Nylon 6/6 producer Invista and LanzaTech are developing bio-based routes to produce one of the raw materials for the engineering resin. Invista said the partners have developed a range of metabolic techniques to make butadiene, an intermediate chemical that Invista uses to make adiponitrile, a key precursor to nylon 6/6. The companies use detailed knowledge about a bacterium’s makeup to coax it to produce
14
butanediol in gas fermentation of waste products such as carbon dioxide and carbon
monoxide.
Invista and LanzaTech say they aim to commercialize the technology within several years.
The process using genetically tweaked bacteria could be an economic and sustainable source
of nylon precursors that doesn’t rely on petrochemicals made from oil and gas.
“By utilizing waste carbon resources, we are decoupling the production of butadiene from
today’s commodity feedstocks,” explains LanzaTech CEO Jennifer Holmgren.
LanzaTech was founded in New Zealand to displace fossil fuel resources with waste carbon
streams. Invista is headquartered in Wichita, Kan.
Et pourquoi pas des phéromones dans les pulvé?
Publié le 03/12/2015 par Séverine Favre
Alors que les préconisations et commandes de morte-saison se préparent, Pierre-Antoine
Lardier a répondu à nos questions. Il évoque les nouveautés de la firme BASF et la position
de l’entreprise sur les sujets qui ont marqué l’année 2015.
Il y a quelques années, vous parliez de commercialiser des diffuseurs de phéromones
Rak biodégradables. Où en est le projet?
"Nous continuons à travailler sur le contenant de nos diffuseurs. Désormais trois pistes
s’offrent à nous.
"Le diffuseur conçu à partir de plastique biodégradable en est une. En labo, nous sommes
capables d’isoler des plastiques résistants pendant la campagne de protection et
biodégradables ensuite par les bactéries du sol. Actuellement, plus de deux ans sont
nécessaires en conditions optimales. Mais sur le terrain, les caractéristiques pédologiques des
vignobles sont très hétérogènes. Nous devons encore travailler pour apporter une
biodégradabilité acceptable sur tous les terroirs.
"En parallèle, pourquoi ne pas imaginer de se passer de diffuseurs? En Italie, en arboriculture,
on voit apparaitre des «puffers». Il s’agit de genre de boîtes ressemblant à un nichoir et
contenant une bombe de phéromones activable à distance. Il faudrait entre 5 et 10 puffers par
hectare. Ce dispositif présente quelques limites: gestion des vents qui changent de direction
dans un contexte de vents dominants, prix de revient et gestion des «appareils»,
homologabilité de cette technologie alors que les phéromones ne sont pas libérées sous
forme gazeuse mais liquide. Il y a des risques de résidus sur les fruits aux alentours du puffer.
"La dernière piste est la pulvérisation de phéromones avec les pulvérisateurs présents sur
les exploitations."15
Comment BASF considère l’émergence des variétés résistantes aux maladies
cryptogamiques?
"Si elles s’imposent dans les cahiers des charges des indications géographiques cela va bien
entendu diminuer la taille du marché phyto mais pas le faire disparaître. Les variétés
résistantes sont sélectionnées pour résister au mildiou et à l’oïdium. Restent à maîtriser le
black-rot, la pourriture grise...
"BASF travaille donc déjà sur des programmes adaptés à ces variétés. Personnellement, je
crois au développement de variétés possédant des résistances polygéniques dans des
programmes allégés mais soutenus par des produits de protection des plantes."
BioBoard transforme le petit-lait en filon pour les
bioplastiques
Les échos (P.M.) 07/12/2015 via Pierre F. (merci Pierre)
Chaque année, l’Europe produit 50 millions de tonnes de petit- lait, qui contiennent 7 %
de matière sèche valorisables en tant que plastique vert.
Le consortium de recherche européen veut transformer le lactosérum en film plastique
alimentaire.
BioBoard entre dans sa phase finale de travaux.
Chaque armée, des millions de tonnes de sous-produits alimentaires finissent dans la poubelle
des industriels, faute de débouchés. Soutenu par un consortium d'universités, de collectivités
et de partenaires privés - au total 14 participants de dix pays -, le projet de recherche
européen BioBoard espère transformer ce gaspillage en nouveau filon pour produire des
revêtements de substitution biodégradables pour les conditionnements alimentaires.
Les papiers couchés, comme ceux qu’on trouve traditionnellement chez son traiteur,
intègrent en strate du polyéthylène représentant jusqu’à 20 % de la composition de
l’emballage. Cette résine thermoplastique inerte dotée d’une excellente résistance aux
agressions chimiques et au déchirement, complique terriblement le recyclage de près de 7
millions de tonnes par an d’emballage stratifié. D’où l’idée de créer une matière première
renouvelable dérivée des déchets alimentaires tels que le petit-lait issu de la fabrication de
fromage, le jus de pommes de terre résultant de la production d’amidon ou la pulpe solide
tirée de la fabrication de certains jus de fruits, produits en milliers, voire en millions de16
tonnes chaque année.
Les travaux démarrés au début de la décennie arrivent à leurs termes. A l’université de
Pise en Italie, la
chercheuse spécialisée dans les sciences des matériaux, Maria Béatrice Coltelli, a dosé
plusieurs mélanges de matériaux durables issus notamment de protéines de lactosérum, pour
concevoir des chaînes moléculaires semblables à celles des polymères. Du laboratoire, ses
granulés de bioplastiques gagnent l’industrie, où, selon Elodie Bugnicourt, coordinatrice du
projet BioBoard chez l’ingénieriste espagnol Iris, « ils répondent à la demande croissante des
producteurs d’emballages alimentaires », notamment en raison de la volatilité du prix des
combustibles fossiles :le marché de: bioplastiques se développe avec une croissance annuelle
de 20 à 30 %.
« Ajustements industriels »
Plusieurs démonstrations de faisabilité et de durabilité de films extru- dés ont déjà été faites.
Elles montrent un matériau robuste, imperméable à l’oxygène, facile à laminer et qui offre
aux matières auxquelles il est associé une capacité inédite de recyclage. « La protéine de
petit-lait peut être dissoute par des enzymes dans l’eau ce qui facilite considérablement le
réemploi des emballages qui en contiennent », détaille Iris. Son matériau nécessite « quelques
ajustements industriels » pour, notamment, en réduire l’épaisseur afin qu’il respecte les
normes d’emballage alimentaire, et le prix. Les ressources sont considérables : l’Europe
produit 50 millions de tonnes de petit-lait chaque année, qui contiennent 7 % de matière
sèche valorisables en tant que plastique vert.
La peinture biosourcée du français Algopaint respecte la
santé des travailleurs
07-12-2015 Eliane Kan (infos exoprotection)
Ce produit de décoration intérieur est réalisé à base d'algues. Il n'émet qu'un gramme de
Composants organiques volatiles (COV) par litre. Sans odeur, il limite les risques pour la
santé des peintres tout en améliorant la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments.
La peinture Algo est disponible en plusieurs tailles.© Algopaint
Les peintres en bâtiment sont exposés à de nombreuses maladies professionnelles. Outre les
Troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux postures de travail, ces professionnels
souffrent d'affections respiratoires comme l'asthme et la rhinite mais aussi de dermatoses
comme l'eczéma, selon le tableau dressé par le Carsat. En cause, la présence de solvants,
comme les Composés organiques volatiles (COV) et autres agents chimiques dérivés du
pétrole. Ces produits nocifs pour la santé des peintres mais aussi pour la qualité de l'airVous pouvez aussi lire